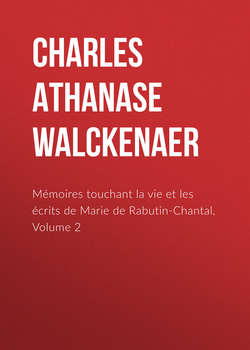Читать книгу Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 2 - Charles Walckenaer, Charles Athanase Walckenaer - Страница 1
CHAPITRE I.
1654-1655
ОглавлениеProjets de Mazarin.—Fausse position de Condé.—Il est le seul espoir des partis intérieurs qui s'opposent à Mazarin.—Dix mille Français ont suivi Condé.—L'absence des plus notables se fait remarquer au sacre du roi.—Nouvelle crise des affaires de France.—Siége d'Arras par Condé.—Projet d'Hocquincourt.—Menaces des parlements.—Turenne fait lever le siége d'Arras.—La duchesse de Châtillon est employée pour traiter avec d'Hocquincourt.—Le jeune roi intervient en personne pour imposer silence au parlement.—Différence qui existe entre la position du roi d'Angleterre et celle du roi de France.—Le parlement hasarde des remontrances.—Mazarin fait des coups d'autorité.—Il y joint la flatterie et la corruption.—Embarras que cause à Mazarin l'inimitié de Retz.—Fautes de celui-ci.—Il donne la démission de son archevêché.—Est transporté à Nantes.—S'en échappe.—Se fracasse l'épaule.—Est sur le point d'être pris.—Il traverse l'Espagne, et arrive à Rome assez à temps pour l'élection d'un nouveau pape.—Il intrigue contre Mazarin.—Lettre de Retz à Mme de Sévigné.—Différends entre Ménage et le cardinal de Retz.—Ménage brouillé aussi avec Bussy.—Lettre de madame de Sévigné à Ménage.—Elle y fait mention de Girault.—Détails sur Girault.
Nous avons laissé, dans la première partie de ces Mémoires, madame de Sévigné à sa terre des Rochers. Ses liaisons de parenté et d'amitié avec le cardinal de Retz l'enchaînaient aux événements politiques qui complétèrent le dénoûment de la Fronde; et comme ils devaient aussi l'occuper dans sa solitude, il est nécessaire de les faire connaître.
Au milieu de toutes les fêtes et de toutes les intrigues secrètes, tandis que Louis grandissait, et que des maîtres habiles, ou mieux encore les événements de chaque jour, achevaient son éducation d'homme et de roi, Mazarin poursuivait ses projets, Condé et les Espagnols les leurs. Mazarin fondait son ambition sur le rétablissement du pouvoir royal et sur la grandeur de la France; Condé, sa puissance sur le renversement du ministre et sur l'ascendant que lui promettait la victoire; mais il était obligé de se prémunir contre les faveurs qu'il savait lui ravir, pour qu'elles ne tournassent pas uniquement au profit des Espagnols. Ceux-ci, de leur côté, ne secondaient qu'avec défiance le génie de Condé, craignant toujours qu'au lieu d'être un instrument de leur puissance, il ne devînt un obstacle par les succès même obtenus avec leurs propres troupes.
Cette fausse position de Condé faisait la force de la France et la faiblesse de ses ennemis. Elle aurait fourni les moyens de terminer promptement la lutte, si cet état de choses n'avait pas été la suite et le résultat de divisions intestines. Les partis étaient comprimés, mais non anéantis; leurs débris s'étaient réunis. Les partisans des princes et ceux de Retz et des parlements, c'est-à-dire les princistes, les indépendants, les frondeurs, et même les royalistes mécontents, ne formaient plus qu'une seule phalange agissant contre Mazarin, leur ennemi commun. Ils entretenaient entre eux une correspondance active. Trop faibles pour renouveler leurs attaques à force ouverte, ils conspiraient dans l'ombre contre le gouvernement, et surtout contre la vie du premier ministre1. Toutes leurs espérances se rattachaient à Condé, qu'un arrêt du parlement avait reconnu criminel de lèse-majesté, et condamné à perdre ses biens, ses honneurs et sa vie, déclarant en même temps sa postérité déchue de tous ses droits à la couronne2. Dix mille Français qui avaient suivi Condé se trouvaient proscrits avec lui, et à leur tête on comptait des Montmorency, des Foix, des Duras, des La Trémouille, des Coligny. Le sacre du jeune roi, qui eut lieu à Reims le 7 juin3, montra, par l'absence de ceux auxquels des droits imprescriptibles assuraient une part dans cette auguste cérémonie, de quels puissants soutiens le trône se trouvait privé, combien était large et profonde la blessure que la révolte faisait à la monarchie.
L'occupation que le sacre donna au gouvernement français, la pénurie d'argent qu'éprouvaient les Espagnols, firent que le mois de juin arriva sans que dans le nord on fût entré en campagne. Mais depuis lors les opérations de la guerre, les négociations, et les intrigues, non moins efficaces, des ruelles furent poussées avec une prodigieuse activité, et mirent encore les affaires de la France dans une crise qui la plaçait sur le penchant de l'abîme. Arras était assiégé par Condé; des lignes formidables entouraient cette ville; sa prise paraissait certaine. Le duc de Lorraine, sacrifié par Fuensaldagne aux ressentiments et aux craintes qu'inspirait sa perfidie, avait été arrêté; toutes les forces d'une grande et guerrière province étaient tournées contre la France, et donnaient les moyens de pénétrer jusqu'à sa capitale4. Les séductions de la duchesse de Châtillon avaient arraché au maréchal d'Hocquincourt la promesse de livrer au prince de Condé Péronne et Ham, deux des principales clefs du royaume5. Les parlements essayaient de ressaisir le pouvoir qu'ils avaient perdu. Tous ces graves événements donnèrent à Mazarin et à Turenne des occasions de déployer l'activité de leur génie.
Le siége d'Arras fut levé par la hardiesse de Turenne, qui pénétra dans ces redoutables retranchements, réputés infranchissables. Condé prévint la destruction de l'armée espagnole par une savante retraite, et couvrit la Flandre, qui eût été aussitôt envahie par l'armée française après sa victoire. Quand tout paraissait perdu, il sauva tout6; et de son côté Turenne raffermit la fortune de la France au moment même où elle paraissait le plus ébranlée. La prise du Quesnoy et celle de Clermont en Argonne ne furent que les moindres conséquences de son succès. Les génies de ces deux grands capitaines parurent dans ces circonstances avoir changé de nature. Turenne déploya la brillante audace et l'irrésistible impétuosité de Condé, et Condé fit voir ce prudent courage, ces admirables prévoyances par où Turenne s'était rendu célèbre.
Hocquincourt commandait dans Péronne, et l'on savait que les Espagnols lui offraient pour leur remettre cette place un prix supérieur à celui que le gouvernement de France lui promettait pour rester fidèle. La trahison qu'il méditait fut empêchée par la duchesse de Châtillon, qu'il aimait. Mazarin la mit en chartre privée chez l'abbé Fouquet, qui la força d'écrire au maréchal d'Hocquincourt, afin de l'engager à procurer sa délivrance, en acceptant les propositions qui lui étaient faites par le premier ministre7. La maréchale d'Hocquincourt, adroite et spirituelle, fut aussi habilement employée par Mazarin en cette négociation. Elle détermina son mari à accepter les six cent mille livres qui lui étaient proposées, et obtint son consentement pour que Péronne fût livrée à leur fils aîné, qu'elle en fit nommer gouverneur. La duchesse de Châtillon fut, en vertu des mêmes stipulations, remise en liberté; mais le maréchal d'Hocquincourt acquit bientôt la preuve de ses nombreuses infidélités. Il s'était trop engagé, pour oser se replacer sans crainte sous la puissance du roi; il se jeta dans Hesdin, révolté, passa ensuite du côté des Espagnols, et fut tué en défendant Dunkerque8.
Le parlement, enhardi par les embarras du gouvernement et les progrès que faisait l'armée de Condé, voulut délibérer de nouveau sur les édits relatifs aux impôts vérifiés en lit de justice, sous prétexte qu'alors la présence du roi avait ôté la liberté des suffrages. Dans cette circonstance critique, Mazarin employa utilement l'intervention personnelle du jeune monarque, et jugea que s'il n'était pas encore assez mûr pour gouverner, il était d'âge à commencer à régner. Louis XIV partit donc un jour de Vincennes, et entra dans la salle du parlement assemblé, en justaucorps rouge, un fouet à la main, un chapeau gris sur la tête, et suivi de son cortége, comme lui vêtu en équipage de chasse. Il parla avec toute la hauteur du commandement, et déclara que sa volonté était que son parlement s'abstînt à l'avenir de toute délibération concernant l'administration de son royaume9. Mazarin avait compris que, dans une monarchie telle que la France, il ne suffisait pas au ministre d'exercer l'autorité au nom du roi, mais que pour s'assurer une obéissance prompte, facile, exempte de trouble et de résistance, il fallait encore qu'on fût bien convaincu que les ordres que ce ministre donnait étaient conformes à la volonté propre du monarque. Ceux qui de nos jours ont rêvé en France la possibilité d'un roi trônant sans gouverner, et qui, dans leur jargon, ont appelé monarchie constitutionnelle celle dont le chef n'aurait qu'un pouvoir de délégation; dont le rôle tout passif se réduirait à accepter pour ministres, et à reconnaître pour seuls maîtres de la direction des affaires, des hommes désignés par des assemblées n'ayant d'autre contrôle que leur volonté, d'autre impulsion que leurs passions; ceux-là n'ont connu ni le caractère national, ni la nature humaine, ni les vrais principes qui doivent régir une grande nation continentale, forcée de maintenir son indépendance au milieu d'autres nations également puissantes. Là le chef du pays est nécessairement le chef de l'armée, et le chef de l'armée doit aussi indispensablement être le chef du gouvernement, et de droit et de fait. Le roi et le royaume, le souverain et ses sujets, la couronne et le sol, sont inséparables. A ce pouvoir nécessaire il faut tracer des limites; contre cette puissance obligée, il faut établir des garanties; mais si vous les cherchez dans des institutions qui dénaturent son principe et arrêtent son action, vous affaiblissez l'État, vous le rendez incapable de soutenir la lutte incessante contre les forces extérieures qui tendent à l'anéantir, vous forgez pour lui le joug de l'étranger, vous préparez son asservissement et sa mort. Dans cette puissante machine qui opère tant de prodiges, si vous absorbez par une seule goutte d'eau froide le calorique qui donnait une si grande force d'expansion à la vapeur, le piston retombe: ainsi s'affaisse subitement tout gouvernement dont le principe est détruit.
Le parlement se tut devant le roi; mais cependant il ne lui obéit pas entièrement, et hasarda des remontrances. Mazarin alors se vit forcé de déployer, comme Richelieu, les rigueurs du pouvoir royal. Plusieurs conseillers furent exilés, d'autres furent mis à la Bastille10. A ces mesures l'habile ministre sut joindre la flatterie, la persuasion, et, au besoin, la corruption. Il parvint ainsi à obtenir, sans résistance et sans retard, la vérification et l'enregistrement des édits qui créaient de nouvelles taxes. Pour désigner les conseillers qu'il fallait écarter par l'exil ou la prison, il s'était servi de l'abbé Fouquet; pour connaître ceux qu'il pouvait gagner, il employa Gourville, auquel ses liaisons et ses intrigues avec les anciens frondeurs avaient donné une parfaite connaissance de ceux qui dans le parlement étaient les plus accessibles aux insinuations et aux propositions qu'il fut chargé de leur faire11.
Le cardinal de Retz était destiné à occasionner à Mazarin des embarras moins grands, mais plus prolongés, que ceux que lui avaient présentés les parlements. Après la mort de son oncle, Retz, quoique captif, se trouva, par sa seule déclaration et le secours de ses amis, canoniquement et légalement archevêque de Paris. C'est alors qu'il eût pu résister avec avantage à son puissant ennemi12. Il était soutenu par tous les curés de Paris, qui au nom de la religion demandaient au roi que le prélat fût rendu à son clergé et à son troupeau. Défendu avec chaleur par le pape, qui voyait avec indignation qu'on retînt en prison un prince de l'Église et qu'on violât des immunités ecclésiastiques, Retz eût obtenu promptement sa liberté, et eût pu présenter de grands obstacles à vaincre au ministre, qui voulait anéantir entièrement son influence: mais ces obstacles, Retz les fit de lui-même disparaître par ses imprudences, son défaut de jugement, de fermeté et de constance. Il montra pour sa propre cause moins d'habileté et d'intrépidité que Caumartin, Joly et d'Hacqueville, et déconcerta tous les efforts de leur dévouement pour le triomphe de ses intérêts. Il s'ennuya de sa prison, et ne put supporter les privations qu'elle lui imposait. Il craignit ou feignit de craindre que Mazarin ne le fît assassiner; et, contre l'avis de ses fidèles amis, il se dépouilla du seul bouclier qui lui restait, de la seule arme qu'il avait en main. Il remit au roi sa crosse pastorale; il se démit de son archevêché13. Par ce grand sacrifice, Retz n'obtint même pas la liberté après laquelle il soupirait; il échangea seulement son donjon contre une détention moins triste et moins dure, dans le château de Nantes, où le maréchal de La Meilleraye le fit garder avec autant de soin et de vigilance qu'il l'était précédemment14. La démission de Retz ne fut point acceptée par le pape, et Retz se proposa de la faire annuler, comme ayant été le résultat de la violence; mais la faiblesse qu'il avait eue de consentir à la donner découragea tous ses adhérents. On s'approche pour secourir l'homme que l'on voit lutter avec courage dans un combat inégal; on s'écarte de celui qui fuit, ou l'on reste en place pour le voir passer. Cette faute ne fut pas la seule que commit Retz. A Nantes il aurait pu, par sa conduite, trouver dans les fonctions de son ministère, dans l'étude et dans la retraite, des moyens certains d'intéresser à son sort et de changer sur son compte l'opinion, toujours indulgente envers le malheur, toujours sévère pour l'autorité, lorsqu'elle abuse ou même lorsqu'elle use de sa force. Il aurait ainsi réveillé le zèle de son clergé et de ses partisans, qui répugnaient à se détacher de lui. Au contraire, oubliant la gravité des circonstances, on le voit uniquement occupé à jouir des agréments de la société dont le maréchal de La Meilleraye eut soin de l'entourer15; et dans les adoucissements apportés à sa captivité, il ne voit d'autre avantage que celui de pouvoir se livrer à sa passion pour les femmes, à ses goûts pour le monde. C'est à cette époque qu'il essaya, mais en vain, de séduire mademoiselle de La Vergne, cette amie intime de madame de Sévigné. «Le maréchal de La Meilleraye, dit-il, ne pouvait rien ajouter à la civilité avec laquelle il me garda. Tout le monde me voyait; on me cherchait même tous les divertissements possibles; j'avais presque tous les soirs la comédie; toutes les dames s'y trouvaient, elles y soupaient souvent. Madame de La Vergne, qui avait épousé en secondes noces M. le chevalier de Sévigné, et qui demeurait en Anjou avec son mari, m'y vint voir, et amena mademoiselle sa fille, qui est présentement madame de La Fayette. Elle était fort jolie et fort aimable, et elle avait de plus beaucoup d'air de madame de Lesdiguières. Elle me plut beaucoup, et la vérité est que je ne lui plus guère, soit qu'elle n'eût pas d'inclination pour moi, soit que la défiance que sa mère et son beau-père lui avaient donnée dès Paris même, avec application, de mes inconstances et de mes différentes amours, la missent en garde contre moi. Je me consolai de sa cruauté avec la facilité qui m'était assez naturelle, et la liberté que le maréchal de La Meilleraye me laissait avec les dames de la ville, qui, étant à la vérité très-entière, m'était d'un fort grand soulagement16.» Quoique Retz eût donné sa parole de ne point chercher à s'échapper, le maréchal de La Meilleraye, qui ne s'y fiait pas, le faisait garder à vue. Cette gêne continuelle, la crainte de se voir confiné de nouveau dans une prison, ou transporté à Brest, lui firent prendre la résolution de recouvrer sa liberté. Aucun roman ne présente un intérêt égal à celui de sa fuite. Les moyens en furent concertés par Joly, le duc de Brissac et le chevalier de Sévigné. Il s'évada en plein jour, en présence même des surveillants et des sentinelles qui le gardaient17. Ils pouvaient l'arrêter dans sa course en faisant feu sur lui, mais ils ne pouvaient courir après lui et se saisir de sa personne avant d'avoir rompu la porte à jour par où il était sorti, et qu'il avait refermée sur eux. Cela lui donna le temps de descendre, et de remonter avec des cordes les murs d'un bastion de quarante pieds de haut, puis de s'enfuir à toute bride sur un cheval qu'on lui avait préparé18. A quelques lieues de Nantes, le cheval s'effraye, fait un écart: Retz tombe et se fracasse l'épaule; il se remet en selle, continue à courir, près de s'évanouir à chaque instant par la violence de la douleur. Ceux qui le poursuivent sont sur le point de l'atteindre; il se jette dans une meule de foin, et il y reste caché sept mortelles heures, entendant sans cesse marcher près de lui ceux qui le cherchaient; vingt fois au moment d'être découvert; étouffant les gémissements que les angoisses de sa blessure lui arrachaient. Enfin il arrive à Machecoul, dans le pays de Retz, chez son frère: il y séjourne peu de temps, et, avec son épaule mal remise et tourmenté par la fièvre, il passe dans une nacelle le petit bras de mer qui le sépare de Belle-Isle, s'embarque dans cette île19, aborde en Espagne, traverse ce royaume dans la litière que Philippe IV lui a envoyée, et refuse les présents de ce monarque, ennemi de la France et en guerre avec elle. En Aragon il n'est point atteint par la peste qui ravage cette province, et s'attendrit sur les malheurs qu'elle cause. A la vue des belles et fertiles campagnes de cet Éden enchanteur qu'on nomme le royaume de Valence, il ne peut contenir son ravissement. Plus délicieusement encore ses yeux sont réjouis par une nation de belles femmes dans l'île de Majorque. Là, des religieuses toutes jeunes, fraîches, et gracieuses sous le voile, se présentent à lui avec leur maintien doux et virginal, et lui donnent dans leur couvent d'harmonieux concerts; elles chantent, en baissant leurs longues paupières, des airs plus passionnés, dit-il, que ceux de Lambert20. A Minorque, il est frappé de la pittoresque magnificence de ces montagnes en amphithéâtre qui entourent le beau port de Mahon21. Par un naufrage il est forcé d'aborder en Corse. A peine rembarqué, poursuivi par une galère turque, sur le point d'être fait prisonnier, il éprouve des dangers plus terribles encore: une tempête furieuse l'assaille, et lui montre la mort sous mille formes. Pourtant il touche un instant à cette imprenable forteresse de Porto-Longone22, et trouve enfin terre et liberté à Piombino. Il termine sur la côte riante de la Toscane sa périlleuse navigation, et fait ensuite son entrée dans Rome23, où la mort d'Innocent X, son protecteur24, a lieu presque aussitôt son arrivée. Il se trouve en mesure pour assister au conclave qui va s'ouvrir.
Ainsi ce captif, ce banni, cet intrigant politique, ce tribun turbulent, cet échappé des ruelles, semble n'avoir été éprouvé par tant d'aventures, sauvé miraculeusement de tant de périls, que pour venir à temps, avec toute la pompe et la magnificence d'un prince de l'Église, siéger parmi les membres de ce sénat auguste, dont les libres suffrages doivent donner au monde entier un souverain pontife25.
A Rome comme à Paris, Retz devint l'âme de toutes les intrigues qui s'agitaient contre Mazarin. Il se montra même un ennemi plus redoutable dans le conclave qu'il ne l'avait été dans le parlement, puisqu'il réussit à faire nommer pape le cardinal Chigi, que Mazarin repoussait. En même temps l'intrépide Chassebras, un de ses vicaires, quoique banni par arrêt du parlement et obligé de se cacher, parvenait à déconcerter toutes les mesures de la police, et faisait afficher dans les carrefours et les rues de la capitale des exhortations, des ordres, des mandements propres à fomenter les passions religieuses parmi le peuple, à produire un schisme dans le diocèse. Chassebras en aurait mis toutes les églises en interdit, si son archevêque l'avait voulu26. Retz ne sut pas profiter de ce retour de la fortune. Plus habile à entraver qu'à diriger, comme dans tout le cours de sa vie politique, il voulait toujours marcher à un but mal défini, sans prendre conseil des événements. De ce qu'il avait contribué à la nomination de Chigi, il s'était persuadé que celui-ci se laisserait gouverner par ses conseils. Mais il s'était trompé sur son caractère. Alexandre VII, assis sur le trône pontifical, oublia bientôt les promesses et les engagements du cardinal Chigi; il se souvint seulement qu'il était pape et le père commun des fidèles. Il suivit dans sa politique un système tout contraire à celui qui eût été favorable à Retz, et dans lequel celui-ci aurait voulu l'engager. Au lieu de chercher à tout diviser, il s'efforça de tout concilier, et fit les plus grands efforts pour procurer entre la France et l'Espagne une paix stable. Il se trouva par là engagé à soutenir Mazarin, qui tendait au même but. Alors Retz s'aperçut, mais trop tard, qu'il avait eu encore cette fois tort de ne pas suivre les conseils de ses amis, qui l'engageaient à accepter l'appui que Lyonne, l'envoyé de Mazarin, lui avait offert. Il fut obligé de reconnaître qu'il s'était encore une fois perdu par son trop de confiance en lui-même; il vit que l'or qu'il avait prodigué, les dettes qu'il avait contractées, ses intrigues, si habiles et si multipliées, par lesquelles il était parvenu à surprendre les secrets et la correspondance de Lyonne, en favorisant les désordres de sa femme, et en fomentant la division parmi ses domestiques, n'avaient servi qu'à le conduire à des résultats contraires à ceux qu'il s'était proposé d'obtenir27.
Lors de sa fuite, durant le court séjour qu'il fit soit à Machecoul, soit à Belle-Isle28, il éprouva le besoin de se justifier auprès du maréchal de la Meilleraye, dont il n'avait eu qu'à se louer, et qu'il compromettait gravement en lui manquant de parole. Mais comme il ne pouvait communiquer avec lui sans le compromettre encore plus, il prit le parti d'écrire à la marquise de Sévigné, qu'il savait être en relation avec le maréchal. Il l'instruisit donc de son évasion, en expliqua les motifs, et colora son manque de foi le mieux qu'il put. Craignant que cette lettre ne fût interceptée, il l'envoya à Ménage pour qu'il la fît parvenir à madame de Sévigné, en lui indiquant en même temps l'usage qu'elle en devait faire. Ménage avait eu avec le cardinal de Retz quelques démêlés, dont la gazette de Loret avait retenti29; mais Ménage, après avoir occupé une place dans la maison du cardinal, était trop honnête homme pour ne pas oublier tous les sujets de plainte qu'il pouvait avoir eus contre lui, et pour ne pas lui rester fidèle dans le malheur: il paraît aussi que Ménage s'était brouillé, puis réconcilié, avec Bussy. On voit, d'après la réponse de madame de Sévigné à Ménage, que tout ce qui concernait son cousin Bussy l'intéressait vivement. Elle montre un grand empressement à connaître les motifs du raccommodement qui avait eu lieu entre lui et Ménage. Sa lettre est datée des Rochers, le 1er octobre 1654. Elle commence par rendre grâce à Ménage de la diligence qu'il a mise à lui faire parvenir la lettre du cardinal, qu'elle nomme toujours le coadjuteur, par habitude, quoiqu'à cette époque il ne portât plus ce titre. Elle ne doute pas que cette lettre, qu'elle a envoyée au maréchal, ne fasse impression sur lui; puis elle ajoute: «Mais voici qui est admirable, de vous voir si bien avec toute ma famille; il y a six mois que cela n'était pas du tout si bien. Je trouve que ces changements si prompts ressemblent fort à ceux de la cour. Je vous dirai pourtant qu'à mon avis cette bonne intelligence durera davantage; et pour moi, j'en ai une si grande joie que je ne puis vous la dire, au point qu'elle est. Mais, mon Dieu! où avez-vous été pêcher ce monsieur le grand prieur, que M. de Sévigné appelait toujours mon oncle le Pirate? Il s'était mis dans la tête que c'était sa bête de ressemblance, et je trouve qu'il avait raison. Dites-moi donc ce que vous pouvez avoir à faire ensemble, aussi bien qu'avec le comte de Bussy? J'ai une curiosité étrange que vous me contiez cette affaire, comme vous me l'avez promis30.»
Elle demande ensuite à Ménage d'accorder son amitié à l'abbé de Coulanges, qui se trouvait alors avec elle aux Rochers. «S'il est vrai, dit-elle, que vous aimiez ceux que j'aime, et à qui j'ai d'extrêmes obligations, je n'aurai pas beaucoup de peine à obtenir cette grâce de vous.»
Ménage, un jour, enchanté d'une lettre que lui avait écrite mademoiselle de Chantal lorsqu'elle était son écolière, dit qu'il ne la donnerait pas pour trente mille livres. Madame de Sévigné, plaisantant sur ce fait de sa jeunesse (jamais aucune femme n'oublie ce qui a été dit ou fait de satisfaisant pour son amour-propre), termine ainsi sa lettre: «Je vous assure que vous devez être aussi content de moi que le jour où je vous écrivis une lettre de dix mille écus.» Puis, par un trait de coquetterie aimable, elle signe Marie de Rabutin-Chantal, de même qu'était signée la lettre de dix mille écus.
Dans le post-scriptum de cette même lettre elle dit: «Un compliment à M. Girault; je n'ai point reçu son livre.» Ce livre était les Miscellanea, ou les Mélanges de Ménage, dont nous avons parlé; car dans la préface latine de ce recueil Ménage nous apprend que ce fut M. Girault qui prit soin de recueillir et de mettre en ordre les pièces qui s'y trouvent. Lorsque madame de Sévigné écrivait cette lettre, cet ouvrage venait de paraître; et comme elle y était louée, nul doute qu'elle n'en eût entretenu Ménage, si elle en avait eu connaissance. Girault était un ecclésiastique, bel homme et de bonne compagnie, qui fut le secrétaire de Ménage, et devint ensuite chanoine du Mans. Ce canonicat lui fut cédé par Scarron31. Girault était en correspondance avec plusieurs beaux esprits, et s'en faisait aimer par l'empressement qu'il mettait à les tenir au courant de toutes les nouveautés littéraires32. Son admiration pour Ménage lui fit donner une place dans les satires, les épigrammes et les diatribes que cet écrivain s'attira par sa plume caustique, guerroyante et pédantesque33.
1
MOTTEVILLE, Mém., t. XXXIX, p. 364, 365.
2
DESORMAUX, Histoire de Louis de Bourbon, prince de Condé, second du nom, 1779, in-12, t. IV, p. 14 et 15.—LORET, liv. V, p. 12, 24 janvier 1654, p. 37, 40.—MONGLAT, Mém., t. L, p. 430.
3
BRIENNE, Mém., t. XXXVI, p. 219.—MONGLAT, Mém., t. L, p. 534.—MONTPENSIER, Mém., t. XLI, p. 444.—LORET, lib. V, p. 72, 13 juin 1654.
4
DESORMEAUX, Hist. de Condé, t. IV, p. 18.—MONGLAT, Mém., t. L, p. 438.—MOTTEVILLE, t. XLI, p. 427.—LORET, liv. V, p. 30, 33, 82, 14 mars et 4 juillet 1654.
5
Mss. de l'hôtel de Condé cités par DESORMEAUX dans l'Hist. de Condé, t. IV, p. 45, 68.—NAVAILLES, Mém., 1701, in-12, p. 167.—BUSSY, Hist. am. des Gaules, t. I, p. 199, édit. 1754.—Ibid., Hist. am. de France, p. 216 et 239.—Ibid., Hist. am. de France, édit. de Liége, p. 160 à 189, édit. 1re; p. 130 et 154, édit. 2e.
6
DE RAMSAY, Hist. de Turenne, liv. IV, t. II, p. 18, édit. in-12, et la planche 6 de l'atlas.
7
DESORMEAUX, Hist. de Condé, t. IV, p. 49.—LORET, liv. V, p. 118, 12 septembre 1654.—RAGUENET, Hist. du vicomte de Turenne, p. 238 à 255.
8
MONGLAT, Mém., t. L, p. 469.—MOTTEVILLE, t. XXXIX, p. 426, 429.—DE RAMSAY, Hist. de Turenne, t. II, p. 47 et 87, édit. in-12.
9
MOTTEVILLE, t. XXXIX, p. 363.—MONGLAT, t. L, p. 458.
10
GOURVILLE, Mém., t. LII, p. 301.
11
GOURVILLE, Mém., t. LII, p. 397.
12
RETZ, Mém., t. XLVI, p. 243.—GUY-JOLY, t. XLVII, p. 262.
13
GUY-JOLY, Mém., t. XLVII, p. 292.
14
RETZ, Mém., t. XLVI, p. 253 et 254.
15
GUY-JOLY, Mém., t. XLVII, p. 294.—RETZ, Mém., t. XLVI, p. 253.
16
RETZ, Mém., t. XLVI, p. 253, ou p. 437 de l'édit. Champollion.
17
RETZ, t. XLVI, p. 258, 201 et 273.
18
Ibid., p. 271.—GUY-JOLY, Mém., t. XLVII, p. 312 à 317.
19
RETZ, Mém., t. XLVI, p. 281.
20
RETZ, Mém., t. LXVI, p. 285.—GUY-JOLY, t. XLVII, p. 238.
21
RETZ, Mém., t. XLVI, p. 287.
22
Ibid., p. 293.
23
GUY-JOLY, t. XLVII, p. 345 (le 28 novembre 1655).
24
RETZ, Mém., t. XLVI, p. 303.
25
RETZ, t. XLVI, p. 305, 348.—GUY-JOLY, Mém., t. XLVII, p. 372 et 374.—MONGLAT, t. L, p. 471.
26
GUY-JOLY, t. XLVII, p. 387 et 388.
27
RETZ, t. XLVI, p. 344.—JOLY, t. XLVII, p. 372-374.
28
GUY-JOLY, t. LXVII, p. 322, 323, 330.—SÉVIGNÉ, Lettres, 1820, in-8o, t. Ier, p. 28. Cette lettre de Retz ne fut point écrite d'Espagne.
29
LORET, Muse historique, liv. III, p. 140, 5 octobre 1652; Ménagiana, t. II, p. 5.
30
SÉVIGNÉ, Lettres, t. I, p. 1, 28 et 29 (1er octobre 1654), édit. 1820, et t. I, p. 34 et 37, édit. de G. de St.-G.
31
Ménagiana, t. II, p. 5; t. III, p. 192 et 193.—BRUZEN DE LA MARTINIÈRE, Hist. de M. Scarron, t. I, p. 58 des Œuvres, édit. 1737, in-18.—Voyez la première partie de ces Mémoires, p. 452.
32
TALLEMANT DES RÉAUX, t. V, p. 257, édit. in-8o; t. IX, p. 123, édit. in-12.
33
Jean BERNIER, Anti-Ménagiana, p. 43.—Gilles BOILEAU, Avis à M. Ménage sur son églogue intitulée Christine, dans le Recueil des pièces choisies de LA MONNOYE, 1714, t. I, p. 278, préface.