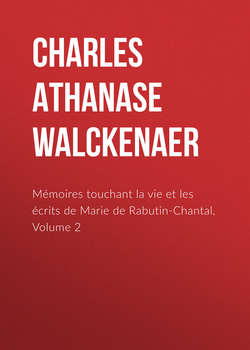Читать книгу Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 2 - Charles Walckenaer, Charles Athanase Walckenaer - Страница 7
CHAPITRE VII.
1656
ОглавлениеMadame de Sévigné passe toute cette année à Paris.—Elle assiste aux fêtes nombreuses qui s'y donnent.—Elle a des occasions de s'entretenir familièrement avec le jeune roi.—Les partis se rapprochent.—Gaston s'arrange avec la cour.—On n'était pas satisfait du gouvernement.—Mort du grand prieur Hugues de Rabutin.—Cette mort n'interrompt pas les plaisirs de madame de Sévigné.—Bussy écrit à sa cousine les événemens de la campagne.—Condé délivre Valenciennes.—Turenne prend la Capelle.—Départ du roi pour l'armée, le 17 mai.—Bussy va en Bourgogne, et revient passer l'hiver à Paris.—Les plaisirs n'avaient pas cessé pendant l'été.—Plusieurs occasions y donnèrent lieu.—Premier voyage de la reine Christine en France.—Admiration qu'elle excite.—Réflexion sur ceux qui se démettent du trône.—Christine est reçue en France avec de grands honneurs.—Madame de Sévigné est du nombre des femmes qu'elle goûte le plus.—C'est avec la France que Christine avait ses principales correspondances.—La France avait alors la supériorité en tout, et attirait l'attention de l'Europe entière.—Un mouvement nouveau s'y faisait remarquer dans les esprits.—Entretien à ce sujet, rapporté par Saint-Évremond.—Portrait que Saint-Évremond trace des précieuses de cette époque, bien avant Molière.—Discussions produites par les jansénistes.—Courte exposition de ces discussions.—Publications des Provinciales. Jugement sur cet ouvrage.—Effet qu'il produit.
Cette circonstance de l'arrivée du maréchal et de madame la maréchale de Schomberg et les lettres de Bussy démontrent que madame de Sévigné continua de résider à Paris pendant le cours de cette année 1656126. Elle fut donc témoin de toutes les fêles qui se donnèrent à la cour et chez les grands; et peut-être figura-t-elle dans les ballets et les mascarades, pour lesquels le jeune roi montrait de jour en jour plus d'inclination, et auxquels la reine et Mazarin se prêtaient. Le roi aimait aussi les courses de chevaux, les jeux de bagues, les carrousels, et il les renouvela cette année. Pendant le carrousel, il se plut à courir par la ville avec son frère sous divers déguisements, et à s'affranchir de toute étiquette127. Madame de Sévigné dut avoir plus d'une occasion de s'entretenir avec lui, non-seulement au milieu de ces grands divertissements, mais chez la princesse de Conti, chez la duchesse de Mercœur, et chez d'autres jeunes femmes d'un moindre rang, auxquelles elle se complaisait à faire des visites fréquentes et familières; et enfin chez le surintendant Fouquet, qui lui donnait, ainsi qu'au roi, à la reine et à toute la cour, de somptueux repas dans son château de Saint-Mandé128. Malgré tous ces moyens de dissipation, le théâtre et les concerts publics n'étaient pas moins fréquentés. La médiocre tragédie de Thomas Corneille (Timocrate) eut un succès qui rappela celui des chefs-d'œuvre de son frère, et les représentations en furent suivies tout l'hiver avec un empressement qui n'avait pas encore été égalé129. Le roi vint exprès au Théâtre du Marais, pour voir jouer cette pièce.
Les ressentiments que les divisions de partis avaient fait naître s'affaiblissaient et disparaissaient, par l'effet de ces fréquentes réunions, où l'on goûtait en commun les mêmes plaisirs. Les mariages, que des penchants mutuels ou des convenances de rang et de fortune faisaient contracter, formaient chaque jour des alliances étroites entre des familles que les haines politiques séparaient auparavant. Les exilés étaient presque tous rappelés, et le sort de ceux qui ne l'étaient pas était adouci130. On avait même permis à MADEMOISELLE de s'approcher de Paris, et elle avait profité de cette permission pour donner une fête superbe au roi et à la reine d'Angleterre, dans son château de Chilly. Gaston n'avait pas encore quitté Blois, mais il avait fait son arrangement avec la cour, et il devait bientôt y reparaître. Tous ces actes de clémence donnaient de la sécurité, et augmentaient l'allégresse générale. Elle se répandit dans les provinces, où l'on cherchait aussi à imiter la capitale, qui elle-même se modelait sur la cour.
Ce n'est pas qu'on fût complétement satisfait: les changements dans les monnaies occasionnèrent des murmures; on avait, sur de simples soupçons, renfermé plusieurs personnes à la Bastille: mais ces sujets de mécontentement ne pouvaient contre-balancer le bien-être que l'on éprouvait de se voir délivré des factions et des guerres civiles, par le rétablissement de l'autorité royale.
La mort de Hugues de Rabutin, grand prieur du Temple, qui eut lieu cette année, vers le commencement de juin, ne mit point obstacle aux plaisirs auxquels madame de Sévigné se livrait à cette brillante époque de son existence. Ce grand prieur avait les manières rudes et impolies d'un corsaire; il en avait aussi les mœurs dissolues: il rappelait à madame de Sévigné tous les défauts et les vices de son mari, sans aucune de ses qualités. Au grand contentement de notre jeune veuve, Hugues de Rabutin donna tout ce qu'il possédait à son neveu, le comte de Bussy.
Celui-ci, dans les lettres qu'il écrivait à sa cousine, lui rendait compte des événements de la campagne131; et par la part qu'il y eut, par le grade qu'il occupait dans l'armée, les détails auxquels il se livre sont précieux pour l'histoire, et plus certains que ceux des relations officielles; car la politique, l'intérêt du moment, tendent toujours dans ces sortes de relations à fausser la vérité. Nous apprenons encore par ces lettres de Bussy qu'il était en correspondance réglée avec Corbinelli, et que celui-ci communiquait exactement à madame de Sévigné toutes les nouvelles qu'il recevait par ce canal. Le marquis de la Trousse, cousin germain de madame de Sévigné, était dans l'armée; elle s'intéressait vivement à lui, et Bussy a grand soin de faire part à sa cousine de tout ce qui concerne ce jeune homme132.
Les événements qui font la matière des lettres de Bussy étaient d'une grande importance. Condé avait délivré Valenciennes avec autant de bonheur que Turenne avait fait pour Arras; et Turenne, de même que Condé, s'était illustré par une savante retraite, qui aux yeux des gens de guerre contribua plus à sa réputation qu'une victoire; ou plutôt cette défaite même, que l'obstination du maréchal de la Ferté avait causée, devint pour Turenne l'occasion d'un triomphe. Après une marche rapide et déguisée, il se présenta devant la Capelle, et prit cette place, avec tous les magasins que les ennemis y avaient déposés133.
Quoique le jeune roi allât chaque année rejoindre l'armée et emmenât avec lui une portion de sa cour, cependant la guerre n'interrompait point les plaisirs ni le mouvement ordinaire de la capitale. Les armées de part et d'autre étaient alors peu nombreuses; on ne s'était pas encore habitué, dans les calculs de l'ambition ou dans les combinaisons belliqueuses, à compter les hommes pour peu de chose, et l'on évitait d'ajouter aux effets destructeurs des combats ceux des rigueurs de l'hiver. D'un commun accord, on évitait de se mesurer avec ce terrible ennemi; on se cantonnait, et l'on restait en repos tout le temps que durait cet engourdissement de la nature; on entrait tard en campagne, et les officiers généraux ne se rendaient à l'armée que lorsque les opérations allaient commencer, c'est-à-dire en mai ou en juin; et ils revenaient souvent en ville en septembre et en octobre. Grâce au génie de Turenne, on redoutait peu les suites de la guerre. Avec lui toujours on espérait des succès; et lorsqu'il y avait des revers, on ne se laissait pas décourager, parce qu'on s'attendait à les voir presque aussitôt réparés. Ce grand capitaine prévoyait toutes les chances possibles de la fortune, et savait en effet la retenir avec fermeté au moment même où elle se disposait à lui échapper.
Ainsi cette année le roi ne partit que le 27 mai134, et il était de retour au 9 octobre135. Bussy ne quitta l'armée que le 2 novembre136, et se rendit en Bourgogne, où ses affaires l'appelaient; mais il passa par Paris, et revint y séjourner pendant l'hiver. Les plaisirs qu'on y goûtait n'avaient souffert aucune interruption; des occasions extraordinaires s'étaient présentées qui même leur avaient donné une nouvelle activité. Après le départ du duc de Modène, reçu avec une pompe et des honneurs qui excitèrent la jalousie et blessèrent l'orgueil du duc de Mantoue137, vint la visite de la princesse d'Orange à sa mère la reine d'Angleterre138, puis ensuite le premier voyage de la reine Christine en France. Le gouvernement du jeune monarque se surpassa en magnificence et en générosité hospitalière et chevaleresque, par la réception qui fut faite à cette reine virile. La curiosité qu'elle excita fut si vive et si générale, qu'elle fit quelque temps diversion à l'attention que l'on portait aux événements de la guerre, aux cercles des précieuses, et aux disputes religieuses, qui par la publication des premières Provinciales avaient acquis un nouveau degré de chaleur.
Cette fille du grand Gustave, qui parvint jeune à la couronne, s'était rendue célèbre par l'énergie de son caractère, son application aux affaires, ses liaisons et ses correspondances avec les savants et les hommes les plus éminents de son temps. Elle s'était faite leur disciple, et se montrait digne d'être leur émule; mais à vingt-huit ans elle résigna son sceptre, changea de religion, et se retira à Rome, pour se livrer sans distraction à ses penchants pour l'étude. Par cet acte extraordinaire elle s'attira des éloges universels, et fut l'objet de l'admiration générale; car c'est une opinion vulgaire et une erreur commune de penser qu'il n'y a rien de plus grand que le mépris des honneurs, des richesses, et de la puissance: le véritable héroïsme consiste à soutenir avec force le fardeau d'un rang éminent quand la destinée nous l'a imposé, et non pas à la répudier. Quiconque eut son berceau placé sur un trône ne doit quitter ce trône que pour un tombeau. En descendre, c'est se dégrader; se démettre de ses devoirs n'est pas s'en affranchir, mais les méconnaître. L'histoire nous démontre, par tous ceux qui ont donné de tels exemples au monde, que les souverains qui veulent entrer dans la vie privée ne trouvent ni en eux-mêmes ni dans les autres les moyens de s'y faire admettre, et qu'en cherchant à éviter les soucis des grandeurs, ils ne peuvent se procurer les avantages des humbles conditions. On sait ce qu'ils ne sont plus, on ignore ce qu'ils sont, et on ne sait pas bien ce qu'ils veulent être. Dépossédés des avantages de la puissance, ils ne peuvent acquérir les douceurs de la liberté; les soupçons ombrageux de la politique poursuivent également le monarque qui est descendu du trône de plein gré et celui qui en a été précipité malgré lui: car en tous deux résident des droits indélébiles, que la force ou la volonté n'ont pu anéantir, et que la force ou la volonté peuvent faire renaître; tous deux éprouvent la même contrainte dans leurs actions et dans leurs paroles; ils sont hors des lois communes, et sont mal protégés par elles. Aussi les actes pareils à ceux de la reine Christine ont-ils été toujours suivis d'un long repentir: elle-même, malgré sa philosophie, ne put échapper à l'ordinaire destinée de ceux qui ont cessé de porter la couronne139.
Les dames françaises dont Christine goûta le plus l'esprit et les manières furent Ninon140, les comtesses de Brégy et de la Suze141, et la marquise de Sévigné. Notre jeune veuve avait fait sur cette reine une impression dont elle garda le souvenir; car lorsqu'elle fut de retour à Rome, elle en fit l'éloge dans une lettre qu'elle écrivit à un de ses correspondants de France142.
C'est en effet avec la France que Christine entretenait la plus grande partie de ses relations littéraires143. Aucun autre pays n'offrait alors autant d'hommes remarquables et de génies supérieurs. Descartes et Corneille s'étaient, chacun dans leur genre, élevés à une hauteur à laquelle aucun de leurs contemporains en Europe ne pouvait prétendre. Les guerres qui avaient lieu n'étaient pas de celles où le sort des combats dépend uniquement de l'art de réunir à temps des masses énormes et nombreuses pour les précipiter les unes sur les autres, et où, après un immense carnage, celui qui pouvait faire donner la dernière réserve était certain de rester maître du champ de bataille. Les armées étaient peu nombreuses; elles pouvaient se mouvoir facilement: tout dépendait de l'habileté des chefs et de la valeur des troupes; et les nobles, qui s'y trouvaient en grand nombre et en formaient l'élite, leur donnaient l'exemple, et s'exposaient les premiers au péril. C'était pour la France un grand malheur, mais aussi un grand honneur, que les armées qui combattaient contre elle, comme celles qui combattaient pour elle, fussent commandées par des Français, et que ces Français eussent acquis la réputation d'être les plus grands capitaines de leur temps. L'Europe entière était attentive à cette lutte que la suite des événements avait établie entre Condé et Turenne, et où tous deux déployaient un génie qui accroissait encore leur grande renommée et excitait l'admiration des plus illustres guerriers.
Ce spectacle n'était pas le seul qui fût digne de fixer alors l'attention des étrangers sur la France; elle en offrait un autre, que Christine était bien capable d'apprécier. Un mouvement nouveau et extraordinaire se faisait remarquer dans les esprits. L'exemple donné par l'hôtel de Rambouillet fructifiait; l'instruction se répandait, et devenait en honneur parmi ces nobles qui faisaient autrefois gloire de leur ignorance. Le spirituel Saint-Évremond a raconté avec sa grâce accoutumée une conversation dont il fut témoin, qui peint à merveille l'état de la cour, et le contraste qu'offraient à cette époque les jeunes seigneurs à la mode, et ceux qui, plus âgés, étaient restés partisans des anciennes mœurs et des anciennes habitudes.
La présence de la reine Christine en France fut l'occasion de ce dialogue, dont les principaux interlocuteurs étaient Guillaume Bautru, comte de Serrant, connu par ses bons mots et son savoir, et d'autant plus grand partisan de la reine Christine qu'il en avait été fort goûté; le commandeur de Jars, de la maison de Rochechouart, bon guerrier, homme de grand sens, mais qui se vantait de ne rien devoir aux lettres ni aux sciences, et qui faisait gloire de mépriser ce qu'il appelait leur jargon144; de Lavardin, évêque du Mans, fort décrié par ses mœurs, recherché pour les délices de sa table, beau parleur, l'ornement des cercles des précieuses, qui admiraient son langage fleuri, correct, mais diffus145. D'Olonne et Saint-Évremond, tous deux présents, se contentèrent d'écouter, et ne prirent point de part à cet entretien. Mais comme avant qu'il ne fût terminé le comte d'Olonne quitta le salon, Saint-Évremond crut devoir lui envoyer dans une lettre le récit suivant, dont nous allons emprunter la substance.
Bautru entama un éloge pompeux de la reine Christine, qui, disait-il, parlait huit langues, et ne s'était montrée étrangère à aucun genre de connaissances. Tout à coup le commandeur de Jars se leva, et ôtant son chapeau d'un air tout particulier: «Messieurs, dit-il, si la reine de Suède n'avait su que les coutumes de son pays, elle y serait encore: pour avoir appris notre langue et nos manières, pour s'être mise en état de réussir huit jours en France, elle a perdu son royaume. Voilà ce qu'ont produit sa science et ses lumières, que vous nous vantez.» Alors Bautru de perdre patience, de s'étonner qu'on puisse être si ignorant; puis de citer Charles-Quint, Dioclétien, Sylla, et tous ceux qui se sont montrés admirables en se démettant du souverain pouvoir; puis enfin de mettre en avant Alexandre, César, M. le prince de Condé, M. de Turenne, et tous les grands capitaines qui ont estimé les lettres et les ont cultivées..... Bautru aurait continué longtemps, si le commandeur, impatienté, ne l'eût interrompu avec tant d'impétuosité, qu'il fut contraint de se taire. «Vous nous en contez bien, dit-il, avec votre César et votre Alexandre. Je ne sais s'ils étaient savants ou non savants: il ne m'importe guère; mais je sais que de mon temps on ne faisait étudier les gentils-hommes que pour être d'Église; encore se contentaient-ils le plus souvent du latin du bréviaire. Ceux que l'on destinait à la cour ou à l'armée allaient honnêtement à l'académie; ils apprenaient à monter à cheval, à danser, à faire des armes, à jouer du luth, à voltiger, un peu de mathématique, et c'était tout. Vous aviez en France mille beaux gens d'armes, galants hommes. C'est ainsi que se formaient les de Thermes146 et les Bellegarde147. Du latin! de mon temps du latin! un gentil-homme en eût été déshonoré. Je connais les grandes qualités de M. le Prince, et suis son serviteur; mais je vous dirai que le dernier connétable de Montmorency a su maintenir son crédit dans les provinces et sa considération à la cour sans savoir lire. Peu de latin, vous dis-je, et de bons Français!»
Bautru, retenu par la goutte sur son fauteuil, ne pouvait se contenir; il faisait des efforts pour se lever, et allait répliquer, quand le prélat, charmé de trouver une si belle occasion de faire briller son savoir et sa belle élocution, étendit les bras entre les deux interlocuteurs, trois fois toussa avec méthode, trois fois sourit agréablement à l'apologiste de l'ignorance; puis, lorsqu'il crut avoir suffisamment composé sa physionomie, il dit qu'il allait concilier les deux opinions; et il prononça un discours gonflé de fleurs de rhétorique, chamarré de comparaisons subtiles, embarrassé de distinctions frivoles, obscurci par d'inutiles définitions; ne cessant, pendant qu'il parlait, d'accompagner sa voix de gestes méthodiques, marquant du doigt indicateur le commencement, le milieu et la fin de chacune de ses longues périodes. Le commandeur ne put y tenir. «Il faut finir la conversation, reprit-il brusquement; j'aime encore mieux sa science et son latin que le grand discours que vous faites.» Bautru, de son côté, avoua qu'il préférait l'agréable ignorance du commandeur aux paroles magnifiques du prélat.
Ainsi finit cet entretien. L'évêque se retira en montrant une grande satisfaction de lui-même, et en paraissant avoir pitié de ces deux gentils-hommes, si peu en état d'apprécier la véritable éloquence et les savants artifices de l'argumentation, l'un parce qu'il n'avait aucune étude, l'autre à cause de la fausse direction des siennes148.
Le parti de ceux qui prônaient la doctrine du commandeur de Jars était partout le plus faible; le goût de l'instruction était général dans les hautes classes de la société; l'ascendant des femmes et leur influence sur le bon ton, le savoir-vivre et la politesse des manières, s'accroissaient encore par les inclinations naissantes du jeune monarque, par les ballets, les réunions, les divertissements, devenus de plus en plus fréquents. Plusieurs cercles s'étaient établis à l'imitation de celui de l'hôtel de Rambouillet; et quelques-uns offraient dans l'exagération de leur modèle des côtés ridicules, qui furent aussitôt saisis par les bons esprits, et que Saint-Évremond fit ressortir dans une satire intitulée le Cercle149. Cette pièce, faiblement versifiée, offre des tableaux moins comiques, mais peut-être plus exacts, que ceux de la comédie de Molière sur les précieuses, qui ne fut écrite que trois ans après.
Saint-Évremond, dans sa satire, nous présente d'abord le portrait d'un habitué
De certaine ruelle
Où la laide se rend aussi bien que la belle,
Où tout âge, où tout sexe, où la ville et la cour
Viennent prendre séance en l'école d'amour.
D'abord il peint la prude
qui partage son âme
Entre les feux humains et la divine flamme;
la coquette surannée, et la jeune coquette, qui n'a que la vanité en tête,
Contente de l'éclat que fait la renommée;
et la coquette solide, qui,
opposée à tous ces vains dehors,
Se veut instruire à fond des intérêts du corps.
Puis
L'intrigueuse vient là, par un esprit d'affaire;
Écoute avec dessein, propose avec mystère;
Et, tandis qu'on s'amuse à discourir d'amour,
Ramasse quelque chose à porter à la cour.
Mais le portrait de la vraie précieuse, de la précieuse sentimentale, platonique, de la précieuse subtile et doctrinaire, est celui qui est tracé avec le plus de bonheur et de vérité:
Dans un lieu plus secret, on tient la précieuse
Occupée aux leçons de morale amoureuse.
Là se font distinguer les fiertés des rigueurs,
Les dédains des mépris, les tourments des langueurs.
On y sait démêler la crainte et les alarmes;
Discerner les attraits, les appas, et les charmes:
On y parle du temps que forme le désir
(Mouvement incertain de peine et de plaisir).
Des premiers maux d'amour on connaît la naissance;
On a de leurs progrès une entière science;
Et toujours on ajuste à l'ordre des douleurs
Et le temps de la plainte et la saison des pleurs.
On sait que la reine Christine ayant demandé qu'on lui donnât une définition des précieuses, Ninon lui répondit que «c'étaient les jansénistes de l'amour».
Les jansénistes faisaient alors encore plus de bruit dans le monde que les précieuses; mais s'ils condamnaient les faiblesses en religion comme les précieuses en amour, ils ne réduisaient pas le culte au sentiment, ils mettaient en pratique ses préceptes. Le nombre des solitaires de Port-Royal s'était accru: cependant il n'allait pas au delà de vingt-sept; mais ces vingt-sept personnes, par leur conviction profonde, par leur zèle ardent, leurs vertus, leur abnégation pour le monde, leur savoir, leur indépendance, le génie supérieur de quelques-uns d'entre eux, leurs amis et leurs nombreux sectateurs, partout répandus, formaient une association qui luttait avec l'ordre puissant des jésuites, avec les abus de la cour de Rome, et la molle complaisance des ecclésiastiques envers les puissants.
La publication du livre d'Arnauld sur la fréquente communion avait réveillé la haine des jésuites contre la secte qui s'était attachée à l'Augustinus de Jansénius, contenant, selon eux, la véritable exposition de la foi catholique. A l'occasion de ce livre de Jansenius, on fit rédiger cinq propositions, qu'on prétendit être le résumé de sa doctrine, et on les déféra au pape, qui les condamna. Les jansénistes souscrivirent à cette condamnation des cinq propositions, mais ils soutinrent qu'elles n'étaient point dans Jansenius. Une assemblée d'évêques, suscitée par Mazarin et les jésuites, sur le rapport des commissaires qu'elle avait nommés, décida que les cinq propositions étaient dans Jansenius. Le livre d'Arnauld sur la fréquente communion fut en même temps déféré à la Sorbonne, où les docteurs se divisèrent. La dispute s'échauffa: soixante-dix docteurs furent expulsés. Le livre d'Arnauld fut censuré. Une nouvelle bulle du pape reconnut que les propositions étaient dans Jansenius: on rédigea un acte ou formulaire, que tous les prêtres, les religieux et les religieuses devaient souscrire, en signe de leur orthodoxie et de leur entière union avec le saint-siége. On avait à combattre une opinion évidemment contraire aux dogmes de l'Église comme à une saine philosophie; une opinion qui introduisait dans la religion la doctrine du fatalisme, et enlevait à l'homme son libre arbitre. Au lieu de recourir aux moyens de douceur et de persuasion, les seuls permis aux défenseurs de la foi, on employa la rigueur et la persécution; et en intéressant ainsi toutes les âmes généreuses au sort de ceux que l'erreur avait égarée, on fit son succès, on contribua à la propager.
Les jansénistes voulaient à la fois résister aux décisions du pape et se considérer comme des fidèles qui lui étaient soumis comme au chef de l'Église: c'est alors que, pour justifier leur résistance et tranquilliser leurs consciences, ils imaginèrent la subtile distinction du fait et du droit. Ils reconnaissaient que pour être sauvé on devait une soumission entière, une foi divine au pape et à l'Église, dans tout ce qui concernait le dogme, parce que le pape et l'Église avaient dans ces matières une autorité divine; mais que quand il s'agissait d'un fait, le pape et l'Église ne pouvaient réclamer des fidèles qu'une foi humaine, c'est-à-dire que chacun était libre de décider selon sa conscience. On devait donc condamner les cinq propositions, d'après la décision du pape; mais on n'était pas forcé de croire d'après la seule assertion du pape et des évêques, que ces cinq propositions fussent dans Jansenius.
Il y a trois principes de nos connaissances, de nos convictions: les sens, la raison, et la foi. Tout ce qui est surnaturel et touche à la révélation se juge par l'Écriture et les décisions de l'Église, et est du ressort de la foi; tout ce qui est naturel, et n'est pas relatif à la révélation, se décide par la raison naturelle. Quant aux faits, on n'est tenu qu'à en croire ses sens. Les propositions qui ne reposent que sur des faits, c'est aux sens seuls qu'il appartient d'en connaître. Dieu n'a pas voulu que jamais la foi pût anéantir la conviction qui résulte du témoignage des sens, ni que cette conviction pût être soumise en nous à aucune autorité; car c'eût été vouloir l'impossible, et anéantir notre propre nature. Les décisions du pape et de l'Église ne peuvent donc enchaîner la conscience en ce qui concerne les faits non révélés.
Ainsi raisonnaient les jansénistes; et comme ils soutenaient que les propositions condamnées n'étaient pas dans Jansenius, ils refusaient de se soumettre à la bulle du pape qui déclarait qu'elles y étaient; ils prétendaient que le pape avait été surpris et trompé. Toute cette contestation reposait sur une subtilité qui semble presque puérile. Il était bien constant qu'on ne pouvait trouver textuellement les cinq propositions dans le livre de l'évêque d'Ypres; mais, selon les juges les plus impartiaux sur ces matières, ces cinq propositions résultaient des doctrines exposées dans ce livre, et en étaient la substance. Il fallait bien cependant que les jansénistes ne pensassent point ainsi, puisqu'ils donnaient leur consentement à la bulle qui les condamnait.
Quoi qu'il en soit, le refus de reconnaître que ces cinq propositions fussent dans le livre de Jansenius devint le prétexte d'une persécution contre les vingt-sept solitaires de Port-Royal. On les expulsa de leur champêtre asile, et on les força de se disperser. Seulement Arnault d'Andilly, qui avait rendu de grands services à l'État dans les hauts emplois de la diplomatie, dont l'attachement au gouvernement était connu, qui inspirait la plus entière confiance à la reine et à Mazarin, et était aimé d'eux, obtint qu'aucune violence ne serait exercée contre les paisibles habitants de la vallée. On se contenta de leur intimer les ordres du roi; et la promesse qu'Arnauld avait faite en leur nom, qu'ils y obéiraient sur-le-champ, fut exécutée. «Je ne dirai point à votre éminence, écrivait Arnauld au cardinal, que j'obéirai; mais je lui dirai que j'ai commencé à obéir en quittant la sainte maison où Dieu, par sa miséricorde, m'a donné le dessein de finir mes jours; et je continuerai d'obéir en allant demain à Pomponne, que je ne regarde plus comme ma maison, quoique je l'aie fort aimée, mais comme le lieu de mon exil, et d'un exil si douloureux, que rien ne m'y peut faire vivre que ma confiance en la bonté dont la reine et votre éminence m'honorent. Ainsi mon prompt retour dans mon heureuse retraite n'étant pas une simple grâce que je demande à votre éminence, mais une grâce qui m'importe de tout, je la supplie de considérer les jours de mon bannissement comme elle ferait les années pour d'autres150.»
C'est dans ces circonstances, c'est lorsque la violation de tous les droits, des actes d'une tyrannie arbitraire, avaient rendu les jansénistes l'objet de l'intérêt général, que parurent les lettres intitulées les Provinciales151: la première est datée du 23 janvier 1656, et la dernière du 24 mars 1657.
Jamais pamphlets ne produisirent un effet plus puissant; jamais une cause ne fut défendue avec plus de talent; jamais une attaque ne fut dirigée avec une si terrible énergie, ni combinée et graduée avec un art plus subtil. Pour concevoir le succès que durent avoir ces écrits, qui paraissaient de mois en mois, il faut se rappeler ce que nous avons déjà dit, qu'à cette époque, où l'on remarquait tant d'ardeur pour le plaisir, tant d'intrigues immorales, tant d'aventures scandaleuses, le sentiment religieux était fortement empreint dans les esprits: ceux qui étaient le plus plongés dans les délices du monde les interrompaient souvent pour satisfaire ce besoin de l'âme; et même quelquefois ils les quittaient pour toujours, afin de s'occuper uniquement de Dieu et de leur salut. Leurs compagnons de plaisirs admiraient et enviaient leurs résolutions; et, dans le vide et l'ennui que laissent toujours après elles les passions satisfaites, ils regrettaient fréquemment de n'avoir pas le courage de les imiter.
Avec une telle disposition des esprits, comment pouvait-on ne pas être charmé d'un écrivain qui donnait aux raisonnements les mieux enchaînés, aux discussions les plus savantes, la forme d'un dialogue animé, la gaieté d'une scène comique, le sel mordant d'une satire enjouée, l'autorité d'une doctrine irréfragable, l'entraînement de la plus sublime éloquence? L'intérêt qu'inspiraient de tels écrits s'augmentait encore quand on savait qu'ils étaient composés pour venger des solitaires vertueux et inoffensifs, de saintes et faibles religieuses, des hommes admirés de l'Europe entière par le noble usage qu'ils faisaient de leur génie et de leurs loisirs, des femmes d'un mérite supérieur, gloire et modèle de leur sexe; quand on songeait qu'ils étaient opprimés au nom de la religion par un ministre qui, après avoir enlevé à tous la liberté politique avec une armée de soldats, voulait avec une armée de religieux ravir aussi à tous la liberté de conscience, et anéantir toute discussion sur les intérêts spirituels, comme il l'avait déjà fait sur les intérêts temporels.
Qu'on ne s'étonne pas qu'un livre composé pour une lutte qui n'existe plus, et pour un temps si différent du nôtre, ait survécu à l'époque qui le vit naître, aux motifs qui le firent écrire, et qu'il captive encore tellement notre attention, qu'on ne peut en quitter la lecture, lorsqu'une fois on l'a commencée. Ceux-là même qui l'ont le plus loué n'y ont vu qu'un livre de controverse religieuse, qu'un ouvrage de circonstance, et n'ont pas su apercevoir, sous la forme spéciale et théologique qui la déguise, toute la grandeur des questions qui y sont traitées. Les vérités qu'on y agite ne sont ni fugitives ni périssables; ce sont celles qui intéressent le plus l'homme sociable et l'homme religieux. Le système des opinions probables et de la direction d'intention, qu'est-ce autre chose que la vieille dispute des stoïciens et des sceptiques? Quel est celui qui ne fait pas un retour plein d'effroi sur lui-même, alors que l'auteur des Provinciales prouve, avec une évidence qui s'accroît à chaque page, que les principes de la morale ne peuvent se modifier ni se laisser fléchir; et que si par la faiblesse de notre nature on est amené à se permettre la moindre déviation, le premier pas nous conduit, par une route de plus en plus divergente, jusque dans l'abîme du crime et de la folie? Ne sentons-nous pas que nos passions, nos vices et notre égoïsme sont des casuistes toujours prêts à égarer notre conscience, et l'obligent à des capitulations qui tendent à altérer sa pureté, et même à la pervertir entièrement? Ces disputes, qui paraissent toutes théologiques, sur la grâce suffisante et insuffisante, diffèrent-elles en rien des doutes et des croyances sur l'absence ou l'existence de l'intervention céleste dans les choses terrestres, et sur la liberté de l'homme dans ses rapports avec Dieu? A quelle époque et chez quel peuple civilisé les philosophes ont-ils cessé de se partager sur ces questions, ou se sont-ils abstenus de les discuter? En est-il en effet de plus hautes? en est-il qui intéressent plus l'homme en général? En est-il qui embrassent d'une manière plus complète toute sa destinée dans sa vie présente et mortelle et dans son immortel avenir?
Le voile dont se couvrait l'auteur de ces lettres, et qui fut quelque temps avant de pouvoir être soulevé, contribua encore à leur réputation. Quand on sut quel était le nom célèbre que cachait le nom obscur de Montalte, et que Blaise Pascal, connu par ses sublimes découvertes en physique et en mathématiques, était celui que l'on cherchait, la surprise se mêla à l'admiration. Tout le monde voulut lire ces écrits théologiques du jeune et savant géomètre. Madame de Sévigné, qui avait parmi les solitaires de Port-Royal des amis dévoués, lut donc aussi les Petites Lettres (c'est ainsi qu'on les appelait alors); elle les lut avec l'intérêt puissant qu'excitaient en elle le sujet et les personnages; elle se pénétra des doctrines qu'elles contenaient. Nous nous en apercevons souvent en lisant ce qu'elle a écrit, et par cette raison nous avons dû signaler l'époque de leur apparition comme une circonstance essentielle dans sa vie.
L'effet des Provinciales ne se borna pas à exciter une stérile admiration. L'opinion publique fut tellement émue par elles, elles excitèrent une telle clameur, qu'elles forcèrent en quelque sorte l'autorité à permettre que les solitaires de Port-Royal reprissent possession de leur vallée chérie, et rouvrissent leur savante école: le gouvernement permit encore aux saintes vierges du couvent de les encourager par leurs prières, tandis qu'eux-mêmes les instruisaient par leurs discours et les édifiaient par leurs exemples152.
126
LORET, lettre du 22 avril 1656, liv. VII, p. 62.—BUSSY, dans Lettres de SÉVIGNÉ, t. I, p. 48 et 51, lettres du 2 et 9 juillet 1656, éd. M.
127
LORET, liv. VII, p. 1 et 2, lettre en date du 1er janvier 1656, p. 14, 15, 19, 29; lettres en date des 22 et 29 janvier, 19 février 1656.—MONGLAT, Mém., t. LI, p. 1 et 2.—BENSERADE, Œuvres, t. II, p. 142 à 172.—LORET, liv. VII, p. 23, 61, lettres en date des 2 février et 2 avril 1656.
128
LORET, t. VII, p. 35, lettre en date du 26 janvier 1656; lettres en date des 27 mai et 19 août 1656, p. 191; lettre en date du 2 décembre 1656, p. 50, 53, 54; lettres en date des 25 mars et 1er avril.—MOTTEVILLE, t. XXXIX, p. 371.
129
Frères PARFAICT, Hist. du Théâtre François, t. VII, p. 178 à 182.—LORET, liv. VII, p. 198, du 16 décembre 1656.—Ibid., p. 176, apostille de la lettre en date du 5 novembre 1656.
130
MONTPENSIER, Mém., t. XLII, p. 48, 51.—LORET, liv. VII, p. 3; lettre en date du 1er janvier 1656.—SÉVIGNÉ, lettre de madame de Coulanges du 24 juin. 1695.—LORET, liv. VII, p. 78, en date du 20 mars 1656, et p. 29, 30, 35, 36, 103; lettres en date des 19 février, 18 avril, 24 juin et 1er juillet 1656.—SÉVIGNÉ, lettre en date du 15 mai 1671, t. II, p. 72, édit. de G. de St.-G., et 2 novembre 1673, t. III, p. 203.—LORET, liv. VII, p. 104, lettre en date du 1er juillet 1656.
131
BUSSY, Mém., t. II, p. 65 et 72 de l'in-12.—Ibid., t. II, p. 78 et 87 de l'in-4o.—SÉVIGNÉ, Lettres, édit. Monm., t. I, p. 48 et 51; t. I, p. 59 et 82, édit. de G. de St.-G. (9 et 20 juillet 1656).
132
SÉVIGNÉ, Lettres, t. I, p. 50, note b, édit. M. (9 juillet 1656).
133
DESORMEAUX, Histoire du grand Condé, t. IV, p. 79, 86, 93.—MONGLAT, Mém., t. LI, p. 7.—GOURVILLE, Mém., t. LII, p. 303.—MOTTEVILLE, Mém., t. XXXIX, p. 392.—RAGUENET, Hist. de Turenne, édit. de 1769, p. 264.—BUSSY-RABUTIN, Mém., t. II, p. 72, 80, 82, édit. in-12; Discours de BUSSY à ses Enfants, p. 282, 302.
134
LORET, liv. VII, p. 84, lettre en date du 27 mai 1656.
135
MONGLAT, Mém., t. LI, p. 10.
136
BUSSY, Mém., t. II, p. 84 et 86.—LORET, liv. VII, p. 181, lettre en date du 18 novembre 1656.
137
MONGLAT, Mém., t. LI, p. 1.
138
LORET, liv. VII, p. 22, lettre en date du 5 février.
139
LORET, liv. VII, p. 41, 46, lettres en date des 18 mai et 9 septembre 1656; p. 50, 119, 126, lettre en date du 12 août, et p. 143, 144, 150, 155, 178; liv. VIII, p. 180, 181, 183, lettres en date des 17 et 24 novembre 1657; liv. IX, p. 34, 42, 43, des 2 et 16 mars 1658.—MONGLAT, t. LI, p. 12.—MOTTEVILLE, t. XXXIX, p. 376, 384, 390 et 392.—MONTPENSIER, Mém., t. XLII, p. 54, 55, 58, 73.—Ibid., t. XLII, p. 266 à 268.—BUSSY-RABUTIN, Hist. am. des Gaules, t. I, p. 180 à 190, édit. 1754.—CATTEAU-CATTEVILLE, Hist. de Christine, 1815, in-8o, t. II, p. 34, 37, 43, 48, 60, 61, 62.—Ibid., t. I, p. 29; Ménagiana, t. II, p. 257.
140
MOTTEVILLE, Mém., t. XXXIX, p. 392.
141
CATTEAU-CATTEVILLE, Hist. de Christine, t. II, p. 61.
142
Lettres de COSTAR, seconde partie, 1659, in-4o, lettre 199, p. 419.—MENAGII Poemata, 1656, in-8o, p. 76.—Lezione d'EGEDIO MENAGIO sopra in sonetto VII di messer Francesco Petrarca, p. 62, 68 et 74, dans Historia Mulierum Philosophorum; Lugduni, 1690, in-12.
143
Ménagiana, t. I, p. 220, t. IV, p. 24.
144
SAINT-ÉVREMOND, Œuvres, édit. 1753, t. II, p. 79 à 83.
145
DES MAIZEAUX, Vie de Saint-Évremond, dans les Œuvres, t. I, p. 78, 83.
146
Paul de la Barthe, maréchal de Thermes.
147
Le duc de Bellegarde, grand écuyer.
148
SAINT-ÉVREMOND, t. II, p. 83.
149
Ibid., p. 83, 85.
150
ARNAULD d'ANDILLY, Mémoires, t. XXXIV, p. 89, 94.
151
Les Provinciales, ou les Lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux RR. PP. jésuites, sur le sujet de la morale et de la politique des saints Pères; Cologne, 1657, in-18, Elzeviers, p. 1 et 369.
152
PETITOT, Notice sur Port-Royal, dans la Collection des Mémoires sur l'Hist. de France, t. XXXIII, p. 137.