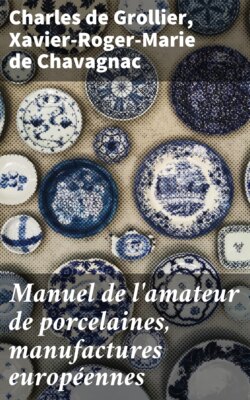Читать книгу Manuel de l'amateur de porcelaines, manufactures européennes - Charles de Grollier - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3° Définitions sommaires des termes cités dans l’ouvrage .
ОглавлениеTable des matières
Arcaniste. — Nom qu’on donne en Allemagne au chimiste qui fait les couleurs sur porcelaine.
Avers. — Côté de la médaille ou de la monnaie qu’on appelle aussi la tête, le droit ou la face.
Barbotine. — Pâte à porcelaine d’une liquéfaction visqueuse qui ressemble à de la boue et qu’on utilise par coulage dans les moules ou qu’on emploie pour faire des collages.
Basalte. — Voir noir égyptien.
Biscuit. — Pâte de porcelaine non émaillée qui après avoir reçu une cuisson est restée dans son blanc mat imitant le grain du marbre ou du plâtre.
Cadogan. — Théière de forme élevée et se remplissant par en dessous.
Gazette. — Enveloppe ou support en pâte argileuse très résistante qui dans le four a pour but de séparer les pièces les unes des autres ou de les supporter.
Coque d’œuf. — Trous ou boursouflures qui se forment dans la couverte pendant la cuisson par un défaut de feu ou parce que le vernis, trop dur, n’a pu être assez fondu.
Coulage. — Trois modes principaux pour façonner la porcelaine: le coulage, le moulage, le tournage. Le coulage, employé depuis un siècle environ, consiste à verser de la barbotine dans un moule. L’eau est absorbée par le plâtre; la pâte, raffermie, épouse les formes du moule, avec une épaisseur suffisante pour former un moulage.
Couleur. — A pour base un oxyde métallique qui se développe à la cuisson en adhérant à la porcelaine, excepté pour l’or, l’argent ou le platine.
Couverte. — Enduit vitrifiable à base de feldspath ou à base calcaire qui se fond à une température élevée et égale à celle de la pâte. On l’étend sur les porcelaines dures et sur quelques grès. La dilatation de la pâte et de la couverte doivent avoir un accord parfait . La couverte se fait en général par immersion, en Chine par insufflation.
Cuisson. — Elle peut se faire en une ou plusieurs fois suivant la pâte, le degré exigé par la couverte ou l’émail, ou les fours employés, qui sont d’une grande variété. Quand la pâte et l’enduit peuvent cuire à la même température, une seule cuisson suffit, surtout pour les poteries communes.
Dégourdi. — A pour but de faire passer la porcelaine à une température douce, environ 800°, afin de lui donner la consistance nécessaire pour recevoir la couverte par immersion sans se déformer ni se désagréger.
Ecran. — Médaillon encadré par le pied d’une porcelaine.
Email. — Enduit vitrifiable, opaque, ordinairement stannifère, qu’on met sur les porcelaines tendres et sur les faïences. Il consiste en une bouillie épaisse de vernis broyé et fondu qu’on étend par immersion ou au pinceau suivant les surfaces à couvrir.
Faïence fine. — Dite demi-porcelaine, terre de pipe ou cailloutage. Elle est en général opaque, ou par exception légèrement translucide; elle est revêtue d’un vernis plombifère.
Faïence ordinaire blanche. — Opaque, recouverte d’un vernis stannifère, ne va pas au feu.
Feldspath. — Roche d’une nature fusible qu’on broie en poudre impalpable et qui à une haute température donne la glaçure à la porcelaine.
Feu de moufle. — Se fait dans un four de moufle qui donne une température douce entre 800° et 1100°, — environ 950°, — mais suffisante pour faire adhérer et glacer les couleurs posées sur la couverte d’une porcelaine déjà cuite.
Fours. — Trop compliqués pour être décrits ici. Voir les ouvrages spéciaux.
Fritte. — Terre fine, lavée et mélangée à des matières vitrifiées. Après fusion, elle entre dans la composition de la porcelaine et lui donne la solidité sans nuire à la transparence. Le pé-tunzé ou caillou des Chinois est une fritte naturelle.
Garnisseur. — Préparateur des ornements qu’il applique sur les pièces au moyen de barbotine. Ces ornements sont ordinairement moulés ou quelquefois tirés comme les métaux.
Gerçures ou treissaillures. — Phénomène se produisant sur une pièce sortie du four avant la fin de la cuisson. La pâte et la couverte étant en désaccord, la seconde se rompt. Les Chinois en ont tiré parti dans leurs craquelés et dans leurs truités.
Glaçure. — Enduit vitrifiable qu’on applique sur les porcelaines pour leur donner leur éclat.
Grand feu. — Température nécessaire pour amener la fusion de la couverte, donner la translucidité et autres qualités caractéristiques de la porcelaine et fixer la décoration qui a été faite sur la pièce crue ou dégourdie. La palette est restreinte, beaucoup de matières colorantes ne résistant pas à cette température élevée.
Grès cérame. — Poterie à pâte dense, dure, sonore, opaque, glacée ou pas glacée, imperméable.
Hygiocérame. — Porcelaine dure de santé ou de pharmacie.
Imari. — Nom improprement donné au décor japonais ou coréen.
Impression. — Procédé pour transporter sur la porcelaine des épreuves tirées d’une planche gravée, en couleurs vitrifiables.
Jaspe. — Matière vitrifiée dont l’aspect jaspé lui a fait donner ce nom et qui permet de faire des camées en deux couleurs superposées.
Kaolin. — Argile pure, blanche, infusible, onctueuse, base de la composition de la porcelaine dure et qui donne à la pâte la plasticité nécessaire pour permettre le façonnage.
Lithophanie. — Procédé qui permet de simuler la transparence de la porcelaine à l’aide de plans différents dans l’épaisseur de la pâte.
Magnésite. — Silicate de magnésie, vulgairement écume de mer, employé surtout en Piémont et en Espagne dans la pâte céramique.
Manganèse — Le décor au manganèse est brun violacé.
Marli. — Bord d’une assiette ou d’un plat, qu’on écrit aussi Marly.
Moufle. — Boîte rectangulaire, légèrement voûtée et construite à l’intérieur du four pour faire cuire à basse température, environ de 800° à 1100°, les couleurs, les ors et la porcelaine tendre
Moulage. — Se fait à la main, à la balle, à la croûte, à la housse, à la presse. Voir les ouvrages spéciaux pour cette définition compliquée.
Noir égyptien. — Pâte sans kaolin, colorée en noir et qui entre dans la composition de certains grès cérames. On lui donne aussi le nom de basalte.
Parian. — Porcelaine imitant le marbre de Paros.
Pâte artificielle. — N’est autre que notre pâte tendre en opposition avec la pâte tendre anglaise, dite naturelle.
Pâte colorée. — Peut être obtenue en introduisant la couleur dans la pâte. Elle reste mate et n’est glacée que par la couverte, ce qui lui a fait donner le nom de décoration sous couverte.
Peigné. — Décor qui se trouve en général sur le bord du marli et dont les extrémités fines et détachées semblent avoir été faites par un peigne.
Pied. — Rebord sur lequel repose la pièce. Il est isolé dans le four au moyen de supports et de cazettes ou d’une couche d’alumine.
Pochoir. — Sorte de poncif encore plus ajouré.
Poncif. — Feuille ajourée représentant le dessin à reproduire et par les vides de laquelle on fixe sur la pièce les couleurs en poudre ou en liquide.
Porcelaine artificielle. — N’est autre que notre porcelaine tendre en opposition avec la porcelaine tendre anglaise dite naturelle.
Porcelaine dure. — Est caractérisée par une pâte dure, fine, translucide, par une glaçure résistante à l’acier, terreuse et appelée couverte. La porcelaine dure est composée de deux éléments principaux: le kaolin argileux, infusible, et le feldspath ou autres minéraux pierreux et fusibles. Elle reçoit une couverte de feldspath seul ou mélangé, toujours sans plomb ni étain. Sa cuisson pourrait être simple; car celle du dégourdi qui sert à l’immersion pourrait au besoin être supprimée.
Porcelaine hybride. — Sans caractères déterminés.
Porcelaine mixte. — Pâte dans laquelle il entre du kaolin et qui tient des deux compositions.
Porcelaine tendre. — Cette dénomination ne s’applique pas au peu de dureté de la pâte, mais à sa faible résistance à une haute température et à son émail au vernis stanifère, qui se raie facilement. Sa composition compliquée et sans kaolin naturel lui a fait donner le nom d’artificielle. Elle exige deux cuissons au moins.
Porcelaine tendre anglaise ou naturelle. — Porcelaine phosphatique, intermédiaire entre la porcelaine tendre artificielle et la faïence fine; plus fusible que la première, avec une glaçure plombifère un peu plus transparente que la seconde et ayant un vernis plus dur. Elle subit deux cuissons.
Putois. — Pinceau plus ou moins large, coupé en brosse à son extrémité, sert surtout à poser les fonds de couleur ou à égaliser les teintes larges ou dégradées.
Quartz. — Nom donné à plusieurs variétés de silice plus ou moins pures. Il entre dans certaines compositions de pâtes ou de couleurs.
Répareur. — Le réparage consiste à faire disparaître à la sortie du moule les imperfections, telles que trous, gerçures, traces de sutures, barbes des jours, etc.
Revers. — Côté de la médaille ou de la monnaie opposé à l’avers.
Smalto. — Sorte de verre opaque, souvent coloré en bleu, auquel on cherche à donner une apparence céramique.
Tireur. — Le tirage consiste à étirer une pâte très plastique et à façonner ainsi les pièces de garnissage d’un faible diamètre, toujours unies et qui ne sont pas moulées. Ce mode de fabrication est peu employé.
Tournage. — Ebauchage à la main sur le tour pour donner à la pâte molle une forme déterminée et la consistance nécessaire pour le tournassage qui donne le fini à la première opération.
Vissage. — Défaut qui consiste en des sillons partant de la base de la pièce, s’élevant en spirale et provenant de pressions inégales par la main de l’ouvrier dans le tournage.