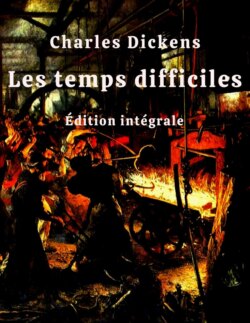Читать книгу Les temps difficiles (Édition intégrale) - Charles Dickens - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE VII.
Madame Sparsit.
ОглавлениеComme M. Bounderby était célibataire, une dame sur le retour présidait aux soins de son ménage, moyennant une certaine rétribution annuelle. Cette dame avait nom Mme Sparsit ; et je vous assure qu’elle occupait un rang fort distingué parmi la valetaille attelée au char de M. Bounderby, où se carrait d’un air triomphal ce fanfaron d’humilité.
Car non-seulement Mme Sparsit avait vu des jours meilleurs, mais elle était alliée à de grandes familles. Elle avait une grand’tante, encore vivante, nommée lady Scadgers. Défunt M. Sparsit, dont elle était la veuve, avait été, du côté de sa mère, ce que Mme Sparsit appelait « un Powler. » Il arrivait parfois à des étrangers sans instruction et d’une intelligence bornée d’ignorer ce que c’était qu’un Powler ; il y en avait même qui avaient l’air de se demander si ce mot désignait une profession, un parti politique ou une secte religieuse. Les esprits plus élevés, cependant, savaient très-bien que les Powlers étaient les représentants d’une antique lignée, qui allaient chercher leurs ancêtres trop loin pour ne pas se perdre quelquefois en route, ce qui leur était arrivé assez fréquemment, en effet, grâce au turf, à la roulette, aux prêteurs juifs et aux faillites.
Feu M. Sparsit, qui descendait des Powler par sa mère, avait donc épousé cette dame, qui descendait elle-même des Scadgers par son père. Lady Scadgers (vieille femme énormément grasse, ayant un appétit désordonné pour la viande de boucherie et une jambe mystérieuse qui, depuis quatorze ans, refusait de sortir du lit), avait arrangé ce mariage à une époque où ledit Sparsit venait d’atteindre sa majorité et se faisait principalement remarquer par un corps très-maigre, faiblement soutenu sur des jambes aussi longues que grêles et surmonté de si peu de tête que ce n’est pas la peine d’en parler. Il avait hérité de son oncle une fort jolie fortune qu’il avait engagée jusqu’au dernier sou avant de la toucher, et qu’il trouva moyen de dépenser encore deux fois de suite, immédiatement après. Aussi, lorsqu’il mourut à l’âge de vingt-quatre ans (la scène est à Calais : la maladie, l’eau-de-vie), il laissa sa veuve, dont il avait été séparé peu de temps après la lune de miel, dans une position de fortune assez précaire. La veuve inconsolable, plus âgée que lui de quinze ans, ne tarda pas à être à couteaux tirés avec lady Scadgers, la seule parente qui lui restât ; et elle consentit à entrer en condition moyennant salaire, un peu pour vexer milady, un peu pour se procurer des moyens d’existence. La voilà, dans ses vieux jours, malgré ce superbe nez à la Coriolan et ces épais sourcils noirs qui avaient fait la conquête de M. Sparsit, la voilà donc faisant en ce moment le thé de M. Bounderby, tandis que Monsieur s’assied pour déjeuner.
Bounderby eût été un conquérant et Mme Sparsit une princesse captive traînée à sa suite comme un des accessoires de son cortège triomphal, qu’il n’aurait pas pu faire, à propos d’elle, plus de bruit qu’il n’en faisait. Autant sa vanité le poussait à déprécier sa propre origine, autant cette même vanité lui faisait exalter celle de Mme Sparsit. De même qu’il ne voulait pas admettre que sa propre jeunesse eût été marquée par une seule circonstance heureuse ; de même il se plaisait à embellir la jeune existence de Mme Sparsit d’une auréole de bien-être, semant des charretées de roses sur le chemin qu’avait parcouru cette dame.
« Et pourtant, monsieur, avait-il coutume de dire toujours, par manière de conclusion, comment cela a-t-il fini, après tout ? La voilà qui, pour cent livres1 par an (je lui donne cent livres, ce qu’elle a la bonté de trouver généreux), tient la maison de Josué Bounderby de Cokeville ! »
Il fit même ressortir si souvent ce contraste vivant, que des tiers s’emparèrent de cette arme et parvinrent à la manier aussi avec beaucoup d’adresse, car c’était un des traits les plus désespérants du caractère de Bounderby, que non-seulement il embouchait sa propre trompette, mais qu’il encourageait les autres à lui en répéter les échos. On ne pouvait l’approcher sans gagner son mal de vantarderie contagieuse. Des étrangers, qui partout ailleurs se montraient assez modérés, se levaient tout à coup à la fin d’un banquet de Cokebourgeois, et portaient Bounderby aux nues dans des discours d’une éloquence rampante. Selon eux, Bounderby représentait à la fois les insignes de la royauté, le drapeau de l’Angleterre, la grande charte, John Bull, l’habeas corpus, les droits de l’homme. « La maison d’un Anglais est son château fort, » l’Église et l’État,… Dieu protège la reine : tout cela se résumait en Bounderby. Et quand un de ces orateurs citait dans sa péroraison (ce qui arrivait tous les jours) ce distique bien connu :
Les princes et les lords peuvent tomber par terre,
Le souffle qui les fit peut aussi les défaire,
les auditeurs demeuraient tous plus ou moins convaincus qu’il s’agissait de Mme Sparsit.
« Monsieur Bounderby, dit Mme Sparsit, vous êtes bien plus long à déjeuner qu’à l’ordinaire, ce matin ?
– Mais, madame, répondit-il, c’est que je songe à cette lubie de Tom Gradgrind (Tom Gradgrind, d’un ton plein de sans-gêne et d’indépendance, comme si quelqu’un eût constamment pris à tâche de lui offrir des sommes folles pour lui faire dire Thomas, mais sans y réussir), à cette lubie de Tom Gradgrind, qui s’est mis dans la tête d’élever la petite saltimbanque.
– Justement la petite, dit Mme Sparsit, attend qu’on lui dise si elle doit aller tout droit à l’école ou commencer par se rendre à Pierre-Loge.
– Il faut qu’elle attende, madame, répondit Bounderby, jusqu’à ce que je sache moi-même ce qu’elle doit faire. Nous ne tarderons pas à voir arriver Tom Gradgrind, je présume. S’il désire qu’elle reste encore un jour ou deux chez nous, elle pourra y rester, cela va sans dire, madame.
– Il va sans dire qu’elle pourra y rester, si vous le désirez, monsieur Bounderby.
– Hier soir, j’ai offert à Tom Gradgrind de faire dresser un lit quelque part pour la petite, afin qu’il eût une nuit à réfléchir avant de se décider à établir des relations entre Louise et la fille de signor Jupe.
– Vraiment, monsieur Bounderby ? C’est très-prudent de votre part ! »
Le nez coriolanesque de Mme Sparsit subit une légère dilatation des narines, et ses sourcils noirs se contractèrent, tandis qu’elle sirotait une gorgée de thé.
« Il me paraît assez clair à moi, dit Bounderby, que la petite chatte ne tirera aucun avantage d’une pareille société.
– Parlez-vous de la jeune Mlle Gradgrind, monsieur Bounderby ?
– Oui, madame, je parle de Louise.
– Comme vous parliez seulement d’une petite chatte, dit Mme Sparsit, et qu’il était question de deux petites filles, je ne saisissais pas bien laquelle des deux vous vouliez dire.
– Louise, répéta M. Bounderby, Louise, Louise.
– Vous êtes tout à fait un second père pour Louise, monsieur. » Mme Sparsit avala encore un peu de thé ; et, tandis qu’elle penchait de nouveau ses sourcils froncés au-dessus des vapeurs de sa tasse, son visage classique semblait occupé à une évocation des divinités infernales.
« Si vous aviez dit que je suis un second père pour Tom, je veux dire le jeune Tom, et non pas mon ami Tom Gradgrind, vous auriez été plus près de la vérité. Car je vais employer le jeune Tom dans mon bureau. Je vais le couver sous mon aile, madame.
– Vraiment ? N’est-il pas un peu jeune pour cela, monsieur ? »
Le « monsieur » de Mme Sparsit, adressé à M. Bounderby, était un terme de grande cérémonie, destiné plutôt dans sa pensée à se donner un air d’importance qu’à servir de titre honorifique à son bourgeois.
« Je ne vais pas le prendre tout de suite ; il faut d’abord qu’on ait fini de le bourrer de science, qu’il ait achevé son éducation, dit Bounderby. Par le lord Harry ! à tout compter, il en aura eu bien assez ! Comme il ouvrirait de grands yeux, ce garçon, s’il savait combien il entrait peu de connaissances dans ma tête à moi, lorsque j’avais son âge. (Le jeune Tom, par parenthèse, ne pouvait l’ignorer, on le lui avait répété assez souvent.) C’est extraordinaire combien j’ai de difficulté à parler d’une foule de choses avec le premier venu sur un pied d’égalité. Voilà, par exemple, que je perds ma matinée à vous parler de faiseurs de tours. Est-ce qu’une femme comme vous peut connaître ces gens-là ? À l’époque où la permission de faire des tours dans la boue eût été pour moi une bonne aubaine, le gros lot dans la loterie de la vie, vous étiez aux Italiens ; vous sortiez de l’Opéra, en robe de satin blanc et couverte de bijoux, éblouissante et radieuse, quand je n’avais pas seulement deux sous pour acheter la torche qui devait vous éclairer jusqu’à votre voiture.
– Il est certain, monsieur, répondit Mme Sparsit avec une dignité triste mais sereine, que j’ai été de fort bonne heure une des habituées de l’Opéra italien.
– Et ma foi, pour ce qui est de cela, j’ai moi-même été un habitué de l’Opéra, dit Bounderby ; seulement je restais du mauvais côté de la porte. Le pavé de ses arcades est un lit assez dur, je vous le garantis. Des gens comme vous, madame, accoutumés dès l’enfance à coucher sur de l’édredon, n’ont aucune idée de l’excessive dureté d’un lit de pavés. Il faut en avoir essayé. Non, non, ce n’est pas la peine de parler de faiseurs de tours à une dame de votre rang. Je devrais plutôt vous parler de danseurs étrangers, du quartier fashionable de Londres, de fêtes, de lords, de ladies et d’honorables.
– J’aime à croire, monsieur, répliqua Mme Sparsit avec une résignation décente, qu’il n’est pas nécessaire que vous m’entreteniez de pareilles choses. J’aime à croire que j’ai appris à me soumettre aux vicissitudes de la vie. J’aime mieux entendre le récit instructif de vos épreuves, que vous ne sauriez me redire assez souvent, et s’il m’inspire un vif intérêt, je n’ai pas en cela un grand mérite et je me garderai bien d’en tirer vanité ; car j’ai lieu de croire que tout le monde y prend le même plaisir.
– Il se peut, madame, dit son patron, qu’il existe des gens assez obligeants pour dire qu’ils aiment à écouter, malgré la grossière franchise de son langage, tout ce que Josué Bounderby de Cokeville a dû subir d’épreuves. Mais vous, madame, vous êtes bien forcée d’avouer que vous êtes née dans le sein de l’opulence. Voyons, vous savez que vous êtes née dans le sein de l’opulence ?
– Je ne saurais, répliqua Mme Sparsit secouant la tête, je ne saurais le nier, monsieur. »
M. Bounderby fut obligé de quitter la table, et de se poser devant le feu, afin de la mieux considérer, tant il était ravi du relief qu’elle lui donnait.
« Et vous fréquentiez la société la plus huppée ? Une société diantrement élevée, ajouta-t-il en se chauffant les mollets.
– C’est vrai, monsieur ! répliqua Mme Sparsit avec une affectation d’humilité exactement contraire à celle de M. Bounderby, ce qui écartait tout danger d’un conflit.
– Vous comptiez parmi les gens de la plus haute volée, et tout le reste, dit M. Bounderby.
– Oui, monsieur, répliqua Mme Sparsit avec un certain air de veuvage social. Cela est d’une vérité incontestable. »
M. Bounderby, ployant les genoux, embrassa littéralement ses propres jambes en signe de satisfaction et se mit à rire tout haut. Mais on annonça M. et Mlle Gradgrind : il reçut le premier avec une poignée de main et la seconde avec un baiser.
« Pourrait-on faire venir Jupe ici, Bounderby ? demanda M. Gradgrind.
– Certainement. »
Jupe arriva. En entrant, elle fit une révérence à M. Bounderby et à son ami Tom Gradgrind et à Louise également ; mais, dans son trouble, elle eut le malheur d’oublier Mme Sparsit. Le tempétueux Bounderby, ayant remarqué cette omission, jugea à propos de faire les observations suivantes :
« Ah çà, je vous dirai une chose, ma fille. Cette dame, que vous voyez près de la théière, se nomme Mme Sparsit. Cette dame occupe ici la place de maîtresse de maison. Conséquemment, s’il vous arrive encore une fois d’entrer dans une chambre quelconque de cette maison, vous n’y ferez qu’un séjour très-court, si vous ne vous conduisez pas envers madame avec tout le respect dont vous êtes susceptible. Vous saurez que je me moque comme de l’an quarante de la façon dont vous pouvez agir à mon égard ; car je n’ai pas la prétention d’être quelque chose. Loin d’avoir des parents haut placés, je n’ai pas de parents du tout, et je sors de l’écume de la société. Mais je tiens essentiellement à ce que vous agissiez comme il faut envers cette dame ; vous la traiterez avec déférence et respect, ou bien vous ne serez pas reçue chez moi.
– J’aime à croire, Bounderby, dit M. Gradgrind d’un ton conciliant, que Jupe n’est coupable que d’une simple inadvertance.
– Mon ami Tom Gradgrind croit être sûr, madame Sparsit, dit Bounderby, que cette petite n’est coupable que d’une simple inadvertance. Ça me paraît fort probable. Mais vous savez très-bien, madame, que je ne permets pas qu’on vous manque de respect, même par inadvertance.
– Vous êtes bien bon, monsieur, répliqua Mme Sparsit secouant sa tête avec sa pompeuse humilité. Ce n’est pas la peine d’en parler. »
Sissy, qui, pendant ce colloque, s’était faiblement excusée avec des yeux pleins de larmes, fut adjugée à M. Gradgrind par un geste du maître de la maison. Elle se tint immobile, le regard fixé sur son protecteur, et Louise, de son côté, demeura auprès de son père, l’air froid et les yeux baissés, tandis que celui-ci reprenait :
« Jupe, je me suis décidé à vous emmener chez moi et à vous employer, lorsque vous ne serez pas occupée à l’école, auprès de Mme Gradgrind, qui ne jouit pas d’une bonne santé. J’ai expliqué à Mlle Louise (voilà Mlle Louise) la terminaison malheureuse, mais naturelle, de votre récente carrière ; et il est expressément entendu que vous devez oublier tout votre passé et n’y plus faire aucune allusion. C’est à dater d’aujourd’hui seulement que commence votre histoire. Vous êtes restée ignorante, je le sais. »
– Oui, monsieur, très-ignorante, répondit-elle avec une révérence.
– J’aurai la satisfaction de vous faire donner une éducation positive ; et pour tous ceux avec qui le hasard vous mettra en rapport, vous serez une preuve vivante des avantages du système qui doit y présider. Vous allez être relevée et restaurée. Vous aviez coutume, sans doute, de faire la lecture à votre père et aux gens parmi lesquels je vous ai trouvée ? demanda M. Gradgrind, qui lui avait fait signe de se rapprocher et avait baissé la voix avant de formuler cette question.
– Je ne lisais que pour papa et pour Patte-alerte, monsieur. Pardon, je voulais dire pour papa, mais Patte-alerte était toujours là.
– Laissons là Patte-alerte, Jupe, dit M. Gradgrind dont les sourcils s’étaient déjà refrognés. Ce n’est pas la question. Vous aviez donc coutume de faire la lecture à votre père ?
– Oh ! oui, monsieur, mille et mille fois. C’étaient les plus heureux jours… oh ! monsieur, les plus heureux de tous les jours que nous avons passés ensemble ! »
Ce ne fut qu’en ce moment, lorsque sa douleur éclata, que Louise la regarda.
« Et quels ouvrages, demanda M. Gradgrind parlant encore plus bas, lisiez-vous à votre père, Jupe ?
– Des contes de fées, monsieur, et l’histoire du Nain, du Bossu et des Génies, sanglota-t-elle, et du…
– Chut ! dit M. Gradgrind, cela suffit. Ne soufflez plus mot de ces sottises dangereuses. Bounderby, voici un beau sujet pour une éducation réglée, et je suivrai l’opération avec le plus vif intérêt.
– Soit, répondit Bounderby, je vous ai déjà donné mon avis ; je n’aurais pas fait comme vous. Mais fort bien, fort bien. Puisque vous le voulez, très-bien ! »
Ce fut ainsi que M. Gradgrind et sa fille emmenèrent Cécile Jupe à Pierre-Loge, et tout le long de la route, Louise ne prononça pas une seule parole, ni bonne ni mauvaise. M. Bounderby, de son côté, s’en fut à ses occupations journalières. Quant à Mme Sparsit, elle se recueillit à l’ombre de ses formidables sourcils, et resta toute la nuit à méditer dans la profonde obscurité de cette retraite.
1 2500 francs.