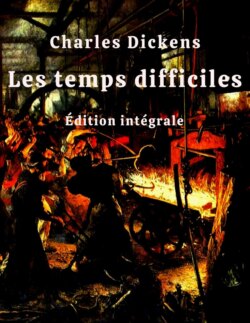Читать книгу Les temps difficiles (Édition intégrale) - Charles Dickens - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE IX.
Les progrès de Sissy.
ОглавлениеGrâce à M. Mac-Choakumchild et à Mme Gradgrind, Sissy Jupe passa d’assez vilains quarts d’heure, et durant les premiers mois de son épreuve elle ne fut pas sans ressentir de très-fortes envies de se sauver de la maison. Tout le long du jour, il lui tombait une telle grêle de faits et la vie en générale lui était présentée comme dans un cahier de corrigés si bien réglé, si fin et si serré, qu’elle se serait sauvée infailliblement sans une pensée unique qui la retint.
C’est triste à avouer ; mais ce frein moral qui la retint n’était le résultat d’aucune formule arithmétique ; bien au contraire, Sissy se l’imposait volontairement en dépit de tout calcul, bien qu’il fût en contradiction directe avec toute table de probabilités qu’eût pu dresser sur de telles données un teneur de livres expérimenté. La jeune fille croyait que son père ne l’avait pas abandonnée ; elle vivait dans l’espoir de le voir revenir, et dans la persuasion qu’il serait plus heureux de savoir qu’elle était restée chez M. Gradgrind.
La déplorable ignorance avec laquelle Jupe s’accrochait à cette pensée consolante, repoussant la certitude, bien autrement consolante et basée sur des chiffres solides, que son père était un vagabond sans cœur, soulevait chez M. Gradgrind une pitié mêlée de surprise. Qu’y faire, cependant ? Mac-Choakumchild déclarait qu’elle avait un crâne épais où il était difficile de faire entrer les chiffres ; que, dès qu’elle avait eu une notion générale de la conformation du globe, elle avait témoigné aussi peu d’intérêt que possible, lorsqu’il s’était agi d’en connaître les mesures exactes ; qu’elle acquérait les dates avec une lenteur déplorable, à moins que, par hasard, elles n’eussent trait à quelque misérable circonstance historique ; qu’elle fondait en larmes lorsqu’on lui demandait d’indiquer de suite (par le procédé mental) ce que coûteraient deux cent quarante-sept bonnets de mousseline, à un franc quarante-cinq centimes chaque ; qu’elle occupait dans l’école la dernière place qu’il était possible d’occuper ; qu’après avoir étudié pendant huit jours les éléments de l’économie politique, elle avait été reprise par une petite commère de trois pieds de haut pour avoir fait à la question : « Quel est le premier principe de cette science ? » l’absurde réponse : « Faire aux autres ce que je voudrais qu’on me fît. »
M. Gradgrind remarqua, en secouant la tête, que tout cela était bien triste ; que cela démontrait la nécessité de lui broyer sans désemparer l’intelligence dans le moulin de la science, en vertu des systèmes, annexes, rapports, procès-verbaux et tables explicatives depuis A jusqu’à Z ; et qu’il fallait que Jupe travaillât ferme. De façon que Jupe, à force de travailler ferme, en devint toute triste sans en devenir plus savante.
« Que je voudrais donc être à votre place, mademoiselle Louise ! dit-elle un soir que Louise avait essayé de lui rendre un peu plus intelligibles les faits qu’elle devait débrouiller pour le lendemain.
– Vraiment ?
– Oh ! je le voudrais de tout mon cœur, mademoiselle Louise. Je saurais tant de choses ! Tout ce qui maintenant me donne tant de peine, me paraîtrait si facile alors.
– Vous n’y gagneriez peut-être pas grand’chose. »
Sissy répondit humblement, après avoir un peu hésité :
« Je ne pourrais toujours pas y perdre. »
Mlle Louise répliqua qu’elle n’en répondrait pas.
Les rapports qui existaient entre les deux jeunes filles étaient si restreints (soit parce que l’existence des habitants de Pierre-Loge se déroulait avec une régularité mécanique trop monotone pour ne pas décourager toute intervention humaine, soit à cause de la clause qui défendait toute allusion à la carrière antérieure de Sissy), qu’elles se connaissaient à peine. Sissy, fixant sur le visage de Louise ses grands yeux noirs étonnés, resta indécise, ne sachant si elle devait en dire davantage ou garder le silence.
« Vous êtes plus utile à ma mère et de meilleure humeur que je ne saurais jamais l’être, reprit Louise. Vous êtes de meilleure humeur avec vous-même que je ne le suis avec moi.
– Mais, s’il vous plaît, mademoiselle Louise, plaida Sissy ; je suis… oh ! je suis bête ! »
Louise, avec un rire plus franc que d’habitude, lui dit qu’elle ne tarderait pas à devenir plus savante.
« Vous ne savez pas, dit Sissy en pleurant à moitié, comme je suis bête. Pendant tout le temps de la classe, je ne fais pas autre chose que des fautes. M. et Mme Mac-Choakumchild m’interrogent constamment, et toujours, toujours je me trompe. Je ne peux pas m’en empêcher. Il paraît que cela me vient tout naturellement.
– M. et Mme Mac-Choakumchild ne se trompent jamais, eux, je suppose, Sissy ?
– Oh ! non, répliqua-t-elle vivement. Ils savent tout.
– Racontez-moi donc quelques-unes de vos fautes.
– J’ose à peine, tant j’en suis honteuse, reprit Sissy avec répugnance. Aujourd’hui même, par exemple, M. Mac-Choa-kumchild nous donnait des explications sur la prospérité naturelle…
– Nationale ; je crois qu’il a dû dire nationale, reprit Louise.
– Oui, vous avez raison… Mais est-ce que ce n’est pas la même chose ? demanda-t-elle timidement.
– Puisqu’il a dit nationale, vous ferez aussi bien de dire comme lui, répliqua Louise avec sa sécheresse et sa réserve habituelles.
– Prospérité nationale. Par exemple, nous a-t-il dit, cette salle que vous voyez représente une nation. Et dans cette nation, il y a pour cinquante millions d’argent. Cette nation ne jouit-elle pas d’une grande prospérité ? Fille numéro vingt, n’est-ce pas là une nation prospère et ne devez-vous pas vous féliciter ?
– Et qu’avez-vous répondu ? demanda Louise.
– Mademoiselle Louise, j’ai répondu que je ne savais pas. J’ai cru que je ne pouvais pas savoir si la nation prospérait ou ne prospérait pas, ou si je devais ou non me féliciter, avant de savoir qui avait l’argent et s’il m’en revenait une part. Mais ça ne faisait rien à l’affaire. Ça n’était pas dans les chiffres, dit Sissy en s’essuyant les yeux.
– Vous avez commis là une grande erreur, remarqua Louise.
– Oui, mademoiselle Louise, je le sais maintenant. Alors M. Mao-Choakumchild a dit qu’il allait me donner encore un moyen de me rattraper. « Cette salle, a-t-il dit, représente une ville immense et renferme un million d’habitants, et parmi ces habitants il n’y en a que vingt-cinq qui meurent de faim dans les rues chaque année. Quelle remarque avez-vous à faire sur cette proportion ? » Ma remarque, je n’ai pas pu en trouver une meilleure, a été que je pensais que cela devait paraître tout aussi dur à ceux qui mouraient de faim, qu’il y eût un million d’habitants ou un million de millions. Et je me trompais encore.
– C’est évident.
– Alors M. Mac-Choakumchild a dit qu’il allait me donner encore une chance : voici la gymnastique… a-t-il dit.
– La statistique, dit Louise.
– Oui, mademoiselle Louise (ça me rappelle toujours la gymnastique, et c’est encore là une de mes erreurs) ; la statistique des accidents arrivés en mer. Et je trouve, dit M. Mac-Choakumchild, que, dans un temps donné, cent mille personnes se sont embarquées pour des voyages au long cours, et il n’y en a que cinq cents de noyées ou de brûlées. Combien cela fait-il pour cent ? Et j’ai répondu, mademoiselle, et Sissy se mit à sangloter pour de bon, comme pour témoigner l’extrême repentir que lui causait la plus grave de ses erreurs ; j’ai répondu que cela ne faisait rien…
– Rien, Sissy ?
– Oui, mademoiselle ; rien du tout aux parents et aux amis de ceux qui avaient été tués. Je n’apprendrai jamais, dit Sissy. Et ce qu’il y a de pis dans tout cela, c’est que, bien que mon pauvre père ait tant désiré de me faire apprendre quelque chose, et bien que j’aie grande envie d’apprendre parce qu’il le désirait, j’ai peur de ne pas aimer les leçons. »
Louise continua à regarder la jolie et modeste tête qui s’abaissait honteuse devant elle, jusqu’à ce que Sissy la releva pour interroger le visage de son interlocutrice. Alors celle-ci lui demanda :
« Votre père était donc bien savant lui-même, pour désirer de vous faire donner tant d’instruction ? »
Sissy hésita avant de répondre, et fit voir si clairement qu’elle sentait qu’on s’aventurait sur un terrain défendu, que Louise ajouta :
« Personne ne nous entend, et d’ailleurs, personne ne pourrait rien trouver à redire à une question si innocente.
– Non, mademoiselle, répondit Sissy après avoir reçu cet encouragement et en secouant la tête ; papa ne sait presque rien. C’est tout au plus s’il peut écrire, et c’est à peine si la plupart des gens peuvent lire son écriture, excepté moi, qui la lis couramment.
– Et votre mère ?
– Papa m’a dit qu’elle était très-savante. Elle est morte quand je suis née. C’était… Sissy parut un peu nerveuse en faisant cette terrible confidence, c’était une danseuse.
– Votre père l’aimait-il ? »
Louise faisait ces demandes avec cet intérêt vif, étourdi, désordonné, qui lui était propre ; intérêt qui, se sentant proscrit, s’égarait de droite et de gauche pour aller se cacher dans quelque asile solitaire.
« Oh ! oui, aussi tendrement qu’il m’aime. Père a commencé à m’aimer par amour pour elle. Il m’emportait partout avec lui, lorsque je pouvais à peine marcher. Depuis nous n’avions jamais été séparés.
– Et pourtant il t’abandonne maintenant, Sissy ?
– Uniquement pour mon bien. Personne ne comprend père, personne ne le connaît aussi bien que moi. Quand il m’a quittée pour mon bien (il ne m’aurait jamais quittée pour le sien), je suis sûre que c’est une épreuve qui lui a presque brisé le cœur. Il n’aura pas une seule minute de bonheur jusqu’à ce qu’il revienne.
– Dites-moi encore quelque chose de lui, dit Louise, je ne vous en parlerai plus. Où demeuriez-vous ?
– Nous voyagions par tout le pays, et n’avions pas de demeure fixe. Père est un clown. »
Sissy prononça à voix basse l’affreux monosyllabe.
– Pour faire rire le monde ? dit Louise avec un signe de tête pour indiquer qu’elle comprenait le mot.
– Oui. Mais quelquefois le monde ne voulait pas rire, et alors mon père se mettait à pleurer. Depuis quelque temps le monde ne riait presque plus, et père revenait tout désespéré. Père ne ressemble pas aux autres gens. Ceux qui ne le connaissaient pas aussi bien que moi et qui ne l’aimaient pas autant que moi, pouvaient croire que sa tête était un peu dérangée. Quelquefois on lui jouait des tours ; mais on ne savait pas le mal que ça lui faisait, et comme il se désespérait ensuite lorsqu’il restait seul avec moi !
– Et vous étiez sa consolation au milieu de tous ses ennuis ? »
Sissy répondit par un signe de tête affirmatif, tandis que des larmes inondaient son visage, puis elle ajouta :
« Je l’espère, car il me le répétait sans cesse. C’est parce qu’il était devenu si craintif et si tremblant, et parce qu’il savait qu’il n’était qu’un pauvre homme faible et ignorant (ce sont ses propres paroles), qu’il tenait à ce que j’apprisse beaucoup, afin de ne pas lui ressembler. Je lui faisais souvent la lecture pour lui redonner du courage, et il aimait beaucoup à m’écouter. C’étaient de mauvais livres, je ne dois jamais en parler ici, mais nous ne savions pas cela.
– Et il les aimait ? demanda Louise, dont l’œil scrutateur était resté fixé sur Sissy.
– Oh ! Beaucoup ! Bien des fois ils lui ont fait oublier ses peines. Et bien, bien souvent, le soir, il ne pensait plus à ses chagrins, et se demandait seulement si le sultan permettrait à la dame d’achever son histoire, ou s’il lui ferait couper la tête avant qu’elle l’eût achevée.
– Et votre père a toujours été bon pour vous, jusqu’à la fin ? demanda Louise, se mettant en contravention avec le grand principe, car elle s’étonnait de plus en plus.
– Toujours ! toujours ! répliqua Sissy joignant les mains. Meilleur, beaucoup meilleur que je ne pourrais le dire ! Il ne s’est fâché qu’un seul soir, et ce n’était pas contre moi, mais contre Patte-alerte. Patte-alerte (elle prononça à voix basse ce terrible fait) est son chien savant.
– Pourquoi s’est-il fâché contre le chien ? demanda Louise.
– Père, peu de temps après être revenu du cirque, avait dit à Patte-alerte de sauter sur le dos des deux chaises et de se tenir allongé, deux pieds sur l’une, deux pieds sur l’autre : c’est un de ses tours. Il regarda père et n’obéit pas sur-le-champ. Tout avait été de travers avec père ce jour-là, et il n’avait pas contenté le public. Il s’écria que le chien lui-même voyait qu’il se faisait vieux et n’avait pas pitié de lui. Alors il battit le chien et j’eus peur. Père, lui dis-je, je t’en prie, ne fais pas de mal à cette bête qui t’aime tant ! Oh ! père, arrête, et que le bon Dieu te pardonne ! Il s’arrêta, mais le chien était en sang et père s’assit sur le plancher avec le chien dans ses bras et se mit à pleurer pendant que le chien lui léchait le visage. »
Louise vit qu’elle sanglotait ; elle alla vers elle, l’embrassa, lui prit la main et s’assit auprès d’elle.
« Racontez-moi, pour finir, comment votre père vous a quittée, Sissy. Puisque je vous en ai tant demandé, je puis bien vous adresser cette dernière question. Tous les torts, s’il y en a, seront pour moi et non pour vous.
– Chère mademoiselle Louise, dit Sissy en se couvrant les yeux et toujours sanglotant ; je suis rentrée de l’école cette après-midi-là, et j’ai trouvé pauvre père qui venait aussi de rentrer du cirque. Il se balançait sur sa chaise devant le feu, comme s’il était souffrant. Et je lui demandai : « T’es-tu fait mal, père ? (ça lui arrivait quelquefois comme aux autres), et il répondit : « Un peu, chérie. » Et quand je vins à me pencher et à regarder son visage, je vis qu’il pleurait. Plus je lui parlais, plus il se cachait le visage ; et d’abord il trembla de tous ses membres et ne dit rien que : « Ma chérie ! et mon amour ! »
Au même instant, Tom arriva en flânant, et contempla les deux jeunes filles avec un sang-froid qui dénotait que sa propre personne avait seule le privilège de l’intéresser, et qu’il ne faisait pas grand abus de ce privilège pour le quart d’heure.
« Je suis en train d’adresser quelques questions à Sissy, Tom, dit sa sœur, tu n’as pas besoin de t’en aller ; seulement laisse-nous causer encore une minute ou deux, mon cher Tom.
– Oh ! très-bien ! répliqua Tom. Mais le vieux Bounderby est en bas ; et je voulais te demander de descendre au salon, parce que si tu descends, il y a vingt à parier que Bounderby m’invitera à dîner ; et si tu ne descends pas, il n’y a rien à parier du tout.
– Je descendrai dans un instant.
– Je vais t’attendre, dit Tom, pour être sûr que tu n’oublieras pas. »
Sissy reprit en baissant un peu la voix :
« Enfin, pauvre père me dit qu’on n’avait pas été content de lui ce jour-là, que maintenant on n’était plus jamais content de lui ; que c’était une honte et un déshonneur de lui appartenir, et que je me serais beaucoup mieux tirée d’affaire sans lui. Je lui dis toutes les choses affectueuses qui me vinrent au cœur, et petit à petit il se calma. Alors je m’assis à côté de lui et je lui racontai ce qui s’était passé à l’école, tout ce qu’on y avait dit, tout ce qu’on y avait fait. Quand je n’eus plus rien à raconter, il mit ses bras autour de mon cou et m’embrassa à plusieurs reprises. Puis, il me pria d’aller chercher un peu de cette drogue dont il se servait, pour frotter la petite meurtrissure qu’il s’était faite, et de la prendre au bon endroit, qui se trouve à l’autre bout de la ville ; enfin, après m’avoir embrassée encore une fois, il me laissa partir. Quand je fus au bas de l’escalier, je remontai afin de lui tenir compagnie un petit moment de plus, j’entrouvris la porte et je lui dis : « Cher père, faut-il emmener Patte-alerte ? » Père secoua la tête en me disant : « Non, Sissy, non ; ne prends rien avec toi de ce qu’on sait m’avoir appartenu, ma chérie ; » je le laissai assis au coin du feu. C’est bien sûr alors que la pensée lui sera venue, pauvre, pauvre père ! de s’en aller essayer de faire quelque chose pour mon bien ; car, lorsque je suis revenue, il était parti.
– Dis donc ! n’oublions pas le vieux Bounderby, Lou ! grommela Tom d’un ton de remontrance.
– Je n’ai plus rien à vous raconter, mademoiselle Louise, si ce n’est que je garde la bouteille pour lui et que je suis bien sûre qu’il reviendra. Chaque lettre que je vois dans les mains de M. Gradgrind me coupe la respiration et me donne des éblouissements, parce que je me figure toujours qu’elle vient de père, ou de M. Sleary qui donne de ses nouvelles. Car M. Sleary a promis d’écrire dès qu’il en aurait, et il n’y a pas de danger qu’il manque à sa promesse.
– Allons, Lou, n’oublions pas le vieux Bounderby ! dit Tom en sifflant avec impatience. Il sera parti, si tu ne fais pas, attention ! »
À dater de ce jour, chaque fois que Sissy faisait une révérence à M. Gradgrind en présence de ses enfants, et lui disait d’une voix un peu tremblante : « Je vous demande bien pardon, monsieur, de vous ennuyer comme je fais… mais… n’auriez-vous pas reçu quelque lettre qui m’intéresse ? » Louise interrompait le travail du moment, quel qu’il fut, et attendait la réponse avec tout autant d’anxiété que Sissy. Et lorsque M. Gradgrind répondait invariablement : « Non, Jupe, je n’ai reçu aucune lettre de ce genre, » le tremblement qui agitait les lèvres de Sissy se répétait sur les traits de Louise et son regard compatissant accompagnait Sissy jusqu’à la porte. M. Gradgrind profitait toujours de ces occasions pour faire la leçon en remarquant, dès que Jupe avait disparu, que, si elle avait été prise à temps et élevée d’une façon convenable, elle se serait démontré, d’après des principes irréfutables, la folle absurdité des espérances fantastiques qu’elle se plaisait à entretenir. Car il ne se doutait pas, le malheureux, qu’une espérance fantastique pût s’emparer de l’esprit avec autant de force et de ténacité qu’un fait réel.
Mais, s’il ne le savait pas, sa fille s’en était bien aperçue. Quant à Tom, il arrivait, comme bien d’autres étaient arrivés avant lui, à ce résultat triomphal du calcul qui consiste à ne s’occuper que du numéro un, c’est-à-dire de soi-même. Et pour Mme Gradgrind, si elle parlait jamais de cela, c’était pour dire, en se dégageant un peu de toutes les couvertures et les châles où elle était tapie comme une marmotte humaine :
« Bonté divine, comme ma pauvre tête est tracassée et tourmentée d’entendre cette fille Jupe demander avec tant d’insistance, coup sur coup, après ses ennuyeuses lettres ! Ma parole d’honneur, il paraît que je suis consacrée, destinée et condamnée à vivre au milieu de choses qui ne finissent jamais. C’est vraiment fort extraordinaire, mais il semble que je ne doive jamais voir la fin de quoi que ce soit. »
Vers cet endroit de son discours, elle sentait se fixer sur elle le regard de M. Gradgrind ; et sous l’influence de ce fait glacial, elle rentrait bien vite dans sa torpeur.