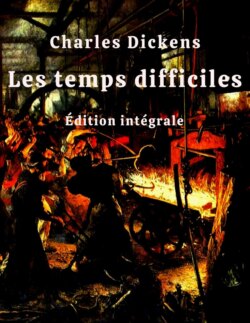Читать книгу Les temps difficiles (Édition intégrale) - Charles Dickens - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE VIII.
Il ne faut jamais s’étonner.
ОглавлениеDonnons de nouveau la tonique, avant de continuer notre air.
Lorsqu’elle avait une demi-douzaine d’années de moins, Louise avait été surprise commençant un jour une conversation avec son frère par ces mots : « Tom, je m’étonne que… » Et sur ce, M. Gradgrind, qui était la personne qui avait surpris ce début de conversation, s’était montré et avait dit : « Louise, il ne faut jamais s’étonner ! »
Cette phrase renfermait le ressort de l’art mécanique et mystérieux de cultiver la raison sans s’abaisser à prendre souci des sentiments ou des affections. Au moyen de l’addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division, arrangez tout d’une façon quelconque et ne vous étonnez jamais.
« Amenez-moi, dit Mac Choakumchild, cet enfant qui sait à peine marcher, et je vous garantis qu’il ne s’étonnera jamais. »
Or, outre un grand nombre d’enfants qui savaient à peine marcher, il se trouvait y avoir dans Cokeville toute une population d’enfants qui marchaient vers le monde infini depuis bien longtemps déjà, depuis vingt, trente, quarante, cinquante ans et plus. Ces enfants monstres étant des êtres qui ne pouvaient promener leurs grands corps au milieu d’aucune société humaine sans causer beaucoup d’alarme, les dix-huit sectes religieuses ne discontinuaient pas de s’égratigner réciproquement le visage et de s’arracher mutuellement les cheveux, sous prétexte de s’entendre sur la meilleure méthode à suivre pour arriver à les améliorer. Peine perdue ! N’est-ce pas une chose étonnante, lorsqu’on songe combien les moyens qu’on employait étaient heureusement adaptés au but que l’on se proposait ? Cependant, bien qu’ils différassent d’opinion sur tous les autres points concevables ou inconcevables (surtout sur les points inconcevables), elles se montraient à peu près d’accord pour défendre à ces malheureux enfants de jamais s’étonner. Secte numéro un leur disait qu’ils devaient tout croire sur parole. Secte numéro deux disait qu’ils devaient tout juger d’après les formules de l’économie politique. Secte numéro trois écrivait pour eux de petites brochures aussi lourdes que du plomb, démontrant comme quoi le grand enfant bien sage arrivait invariablement à la caisse d’épargne, tandis que le grand enfant qui se conduisait mal arrivait invariablement à la déportation. Secte numéro quatre, faisant de lugubres efforts pour être amusante (rien que d’en parler les larmes vous en viennent aux yeux), essayait de cacher sous une prose enjouée des trappes scientifiques où il était du devoir de ces grands enfants de se laisser choir. Mais, par exemple, il y avait une chose sur laquelle toutes les sectes étaient d’accord, c’est qu’il ne faut jamais s’étonner.
Cokeville possédait une bibliothèque dont l’accès était facile pour tous. M. Gradgrind se tourmentait beaucoup l’esprit de ce qui se lisait dans cette bibliothèque ; c’était même un sujet sur lequel des petites rivières de rapports avec tables à l’appui allaient, à époque fixe, se jeter dans cet orageux océan de rapports où personne n’a jamais pu plonger à une certaine profondeur sans en revenir fou. C’était un fait bien décourageant, un fait bien triste, les lecteurs de cette bibliothèque persistaient à s’étonner ! Ils s’étonnaient à propos de la nature humaine, à propos des passions humaines, des espérances humaines, des craintes, des luttes, des triomphes et des défaites, des soucis, des plaisirs, des peines de la vie et de la mort de certains hommes et de certaines femmes vulgaires ! Quelquefois, après quinze heures de travail, ils se mettaient à lire des récits fabuleux concernant des hommes et des femmes qui leur ressemblaient plus ou moins, et concernant des enfants qui ressemblaient plus ou moins aux leurs. Au lieu de demander Euclide, ils pressaient Daniel de Foë contre leur cœur, et ils avaient le mauvais goût de trouver Goldsmith plus amusant qu’un traité d’arithmétique. M. Gradgrind avait beau étudier constamment, soit par écrit soit autrement, ce problème excentrique, il ne pouvait réussir à s’expliquer comment on arrivait à ce résultat inconcevable.
« Je suis las de la vie que je mène, Lou. Je la déteste cordialement et je déteste tout le monde, excepté toi, dit ce dénaturé jeune Thomas Gradgrind dans la salle qui ressemblait à un salon de coiffure, vers l’heure du crépuscule.
– Tu ne détestes pas Sissy, Tom ?
– Je déteste d’être obligé de l’appeler Jupe. Et elle me déteste de son côté, dit Tom d’un ton maussade.
– Pas du tout, Tom, je t’assure.
– Ce n’est pas possible autrement, dit Tom. Il est clair qu’elle doit nous haïr et nous détester tous tant que nous sommes. Ils ne lui laisseront pas de repos qu’ils ne l’aient assommée, je crois. Elle est déjà devenue aussi pâle qu’une figure de cire et aussi ennuyée que moi. »
Ainsi s’exprimait le jeune Thomas, assis devant le feu à califourchon sur une chaise, les bras sur le dossier, et son visage grognon appuyé sur ses bras. La sœur était assise au coin le plus obscur de la cheminée, regardant tantôt son interlocuteur, tantôt les brillantes étincelles qui tombaient de la grille dans l’âtre.
« Quant à moi, dit Tom, ébouriffant ses cheveux dans tous les sens avec ses deux mains maussades, je suis un âne, voilà tout ce que je suis. Je suis aussi obstiné qu’un âne, je suis plus bête qu’un âne, je ne m’amuse pas davantage, je ne regrette qu’une chose, c’est de ne pas pouvoir lancer des ruades comme lui.
– Pas à mon adresse, n’est-ce pas, Tom ?
– Non Lou ; je ne voudrais pas te faire du mal, à toi. J’ai commencé par faire une exception en ta faveur. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi dans cette vieille geôle aussi gaie que… la peste. » Tom s’était arrêté un moment afin de chercher des mots suffisamment flatteurs et expressifs pour désigner le toit paternel, et l’heureuse comparaison qu’il venait de trouver parut apporter un léger soulagement à son esprit agacé.
« Vraiment, Tom ? Est-ce que tu penses réellement ce que tu dis là ?
– Oui, parbleu, je le pense. Mais à quoi bon parler de cela ! répondit Tom se frottant le visage avec la manche de son habit, comme pour mortifier sa chair et la mettre à l’unisson de son esprit.
– Je te demandais ça, Tom, dit sa sœur après avoir continué quelque temps à regarder les étincelles, parce qu’à mesure que j’avance en âge et que je grandis, je reste souvent assise ici devant le feu à m’étonner et à regretter de ne pouvoir réussir à te réconcilier avec notre genre de vie. Je n’ai pas appris ce qu’on apprend aux autres filles. Je ne puis pas te jouer un air ni te chanter une chanson. Je ne puis causer avec toi de façon à te désennuyer, car il ne m’arrive jamais de voir un spectacle amusant ni de lire un de ces livres amusants, dont ce serait un plaisir et un délassement de causer avec toi, lorsque tu es fatigué.
– Ma foi, ni moi non plus, je ne suis pas plus avancé que toi sous ce rapport ; et je suis une mule par-dessus le marché, ce que tu n’es pas. Comme père était décidé à faire de moi un freluquet ou une mule, et comme je ne suis pas un freluquet, il est clair que je dois être une mule… aussi ne suis-je pas autre chose, dit Tom d’un ton rageur.
– C’est bien dommage, dit après un nouveau silence et d’un air rêveur Louise, toujours cachée dans son coin obscur ; c’est grand dommage, Tom ; c’est très-malheureux pour toi et pour moi.
– Oh ! toi, dit Tom, tu es une fille, Lou, et une fille se tire toujours d’affaire mieux qu’un garçon. Je ne m’aperçois pas qu’il te manque rien. Tu es le seul plaisir que je connaisse. Tu égayes jusqu’à ce trou où nous sommes, et tu fais de moi tout ce que tu veux.
– Tu es un cher frère, Tom ; et tant que je croirai pouvoir te rendre la vie plus douce, je regretterai moins mon ignorance. Et pourtant, Tom, si on ne m’a pas appris à te désennuyer, on m’a enseigné une foule de choses que j’aimerais autant ne pas savoir. »
Elle se leva et l’embrassa, puis retourna à son coin.
« Je voudrais pouvoir rassembler tous les faits dont on nous parle tant, dit Tom montrant les dents d’un air plein de rancune, et tous les chiffres et tous les gens qui les ont inventés ; et je voudrais pouvoir placer dessous mille barils de poudre afin de les envoyer tous au diable du même coup ! C’est égal, quand j’irai demeurer chez le vieux Bounderby, je prendrai ma revanche !
– Ta revanche, Tom ?
– Je veux dire que je m’amuserai un peu à aller voir quelque chose et entendre quelque chose. Je me dédommagerai de la façon dont j’ai été élevé.
– Ne te fais pas illusion, Tom ; M. Bounderby a les mêmes idées que papa ; il est seulement beaucoup plus dur et loin d’être aussi bon.
– Oh ! s’écria Tom en riant, qu’est-ce que ça me fait ? Je trouverai bien moyen de mener et d’amadouer le vieux Bounderby ! »
Leurs ombres se dessinaient sur le mur ; mais celles des grandes armoires de la chambre se mêlaient ensemble sur le plafond, comme si le frère et la sœur eussent été abrités par une sombre caverne ; ou bien, une imagination fantastique (si pareille trahison eût pu pénétrer dans ce sanctuaire des faits) y aurait peut-être vu l’ombre de leur sujet de conversation et de l’avenir menaçant qu’il présageait.
« Quel est donc ton grand moyen pour amadouer et mener les gens, Tom ? Est-ce un secret ?
– Oh ! dit Tom, si c’est un secret, il n’est pas bien loin. C’est toi. Tu es l’enfant gâtée de Bounderby, sa favorite ; il ferait tout au monde pour toi. Quand il me dira de faire quelque chose qui ne me va pas, je lui répondrai : « Ma sœur Lou sera peinée et surprise, monsieur Bounderby. Elle me disait toujours que vous seriez plus indulgent que cela. » Si ce moyen-là ne suffit pas pour l’obliger à baisser pavillon, c’est que rien n’y peut réussir. »
Après avoir attendu quelque observation en réponse à ses paroles, Tom, voyant qu’il n’en recevait pas, tomba de tout le poids de son ennui dans le temps présent et se tortilla en bâillant, autour des barreaux de sa chaise, ébouriffant de plus en plus sa chevelure ; enfin, il leva la tête et demanda :
« Est-ce que tu dors, Lou ?
– Non, Tom ; je regarde le feu.
– Il paraît que tu y vois bien des choses que je n’y ai jamais vues, dit Tom. Encore un avantage que les filles ont sur nous, je suppose.
– Tom, demanda sa sœur d’une voix lente et d’un ton étrange, comme si elle eût cherché à lire dans le feu une question qui n’y était pas très-clairement écrite, l’idée de quitter la maison pour aller chez M. Bounderby te cause-t-elle une grande satisfaction ?
– En allant chez lui, répondit Tom se levant et poussant sa chaise de côté, je quitterai la maison, c’est déjà quelque chose.
– Entrer chez lui, répéta Louise du même ton, c’est quitter la maison ! Oui, c’est bien quelque chose.
– Ce n’est pas que je ne sois très-fâché, Lou, de te laisser, et de te laisser ici. Mais, tu sais, il faudra toujours que je m’en aille, bon gré mal gré, et autant vaut que j’aille où ton influence me sera utile, qu’ailleurs où j’en perdrais le bénéfice. Tu comprends ?
– Oui, Tom. »
La réponse s’était fait attendre si longtemps, quoiqu’elle n’annonçât aucune indécision, que Tom venait de s’approcher et de s’appuyer derrière la chaise de Louise, afin de contempler, du même point de vue, le feu qui absorbait la pensée de sa sœur, pour voir s’il n’y avait pas quelque chose à y voir qui expliquât la distraction de Louise.
« Ma foi, sauf que c’est du feu, dit Tom, il me paraît aussi stupide et aussi vide que tout ce qui nous entoure. Qu’est-ce que tu y vois donc ? Pas un cirque, hein ?
– Je n’y vois rien de bien particulier, Tom. Mais, depuis que je le regarde, je me demande avec étonnement ce que nous deviendrons, toi et moi, lorsque nous serons grands.
– Voilà que tu t’étonnes encore ! dit Tom.
– J’ai des pensées si rebelles, répliqua Louise, j’ai beau faire, elles sont toujours à s’étonner.
– Eh bien, je vous prie, Louise, dit Mme Gradgrind qui avait ouvert la porte sans qu’on l’eût entendue, de n’en rien faire. Au nom du ciel, fille inconsidérée, n’en faites rien, ou cela ne finira jamais avec votre père. Et vous aussi, Thomas, c’est vraiment honteux, lorsque ma pauvre tête ne me laisse pas un moment de repos, de voir un garçon élevé comme vous l’avez été et dont l’éducation a coûté tant d’argent, de voir un garçon comme vous encourageant sa sœur à s’étonner, lorsqu’il sait que son père a expressément défendu qu’elle se permît de s’étonner jamais. »
Louise nia que Tom eût participé en quoi que ce fût à ses torts ; mais sa mère l’interrompit par cette réplique concluante :
« Louise, comment pouvez-vous me dire cela dans l’état actuel de ma santé ! Car, à moins que vous n’y ayez été encouragée, il est moralement et physiquement impossible que vous vous soyez permis de le faire !
– Je n’y ai été encouragée par rien, mère, si ce n’est par le feu, par les étincelles rouges que je voyais tomber de la grille, blanchir et s’éteindre. Alors j’ai songé combien, après tout, ma vie serait courte et que je serai morte avant d’avoir fait grand’chose.
– Sornettes ! dit Mme Gradgrind devenant presque énergique. Sornettes ! Ne vous tenez pas là à me dire en face de pareilles sottises, Louise, quand vous savez très-bien que si cela arrivait aux oreilles de votre père, cela n’en finirait pas. Après toute la peine qu’on a prise avec vous ! Après tous les cours que vous avez suivis et les expériences que vous avez vues ! Après que je vous ai entendue moi-même, à l’époque où mon côté droit s’est tout à fait engourdi, débiter à votre maître une foule de choses sur la combustion et la calcination et la calorification, je dirai même sur toutes les espèces d’action capables de rendre folle une pauvre malade. Et après tout cela, vous venez me parler d’une façon si absurde à propos d’étincelles et de cendres. Je voudrais, pleurnicha Mme Gradgrind, prenant une chaise et lançant son argument le plus écrasant, avant de succomber sous ces ombres trompeuses de faits, oui, je voudrais vraiment ne jamais avoir eu d’enfants. Vous auriez vu, alors, si vous auriez pu vous passer de moi !