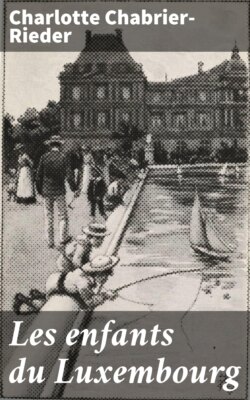Читать книгу Les enfants du Luxembourg - Charlotte Chabrier-Rieder - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES ENFANTS DU LUXEMBOURG.
ОглавлениеMme Fernel réunit la correspondance dans une large enveloppe, et après l’avoir cachetée et timbrée, elle dit à Rose et à Violette:
«Allez vous faire habiller par la bonne; moi je vais arranger votre petit frère. Nous allons sortir tous ensemble.
ROSE.
Où irons-nous, maman? jouer au Luxembourg, ou faire une promenade?»
Disons, pour les petits lecteurs qui ne connaissent pas Paris, que le Luxembourg est un vaste et splendide jardin public, avec des pelouses magnifiques, un gazon si bien entretenu qu’il semble un tapis de velours vert, des allées ombreuses, des parterres aux fleurs éclatantes, un grand bassin, où les enfants font naviguer toute une flottille de bateaux, des fontaines, des jets d’eau, des statues artistement placées parmi les bosquets, des arbres et des plantes de toute espèce, amenés à grands frais des cinq parties de l’univers: toutes ces merveilles réunies en font le plus bel endroit du monde. Les enfants privilégiés qui ont la bonne fortune d’habiter le quartier du Luxembourg se donnent rendez-vous dans ce jardin sans pareil, auquel nul autre, dans aucune capitale, ne saurait être comparé. Rose, Violette et Frédy y avaient vécu leur petite enfance, y arrivant le matin et, dans les jours d’été, ne rentrant que pour les repas. «Le Luxembourg, disaient-ils, était leur maison de campagne.» Et maintenant encore, en toute saison, par le froid et même par la neige, la maman ne manquait pas de les y conduire faire une promenade quotidienne.
La maman répondit à Rose:
«Vous viendrez d’abord mettre les lettres à la poste avec moi; puis je vous laisserai avec la bonne et vos petits amis au Luxembourg, et j’irai faire des courses indispensables.
ROSE, insistant curieusement.
Où donc, maman, ces courses indispensables?
LA MAMAN, souriant.
Rose, tu es une petite indiscrète. Les enfants ne doivent pas interroger leurs parents, je croyais te l’avoir dit. Pour cette fois, je veux bien consentir à te répondre, parce que je n’y vois pas d’inconvénient, mais ce sera la dernière. Je dois aller voir Henriette Walter au couvent, et m’entendre avec ces dames au sujet des vacances de Pâques, qu’elle passera chez moi, si sa conduite a été satisfaisante. Et maintenant, trève de questions, allez bien vite vous habiller.»
Les petites filles obéirent, Rosette, un peu penaude, contente tout de même d’avoir appris où allait sa maman. La curiosité n’était pas un des moindres défauts dont la maman prétendait la corriger avant le retour de son papa.
Peut-être, sans être aussi curieuse que Rose, voudra-t-on savoir qui était Henriette Walter. C’était une petite Anglaise avec qui Rose et Violette avaient fait connaissance, les vacances dernières, aux bains de mer. Jolie comme une poupée de cire et unique héritière d’un papa fabuleusement riche qui la gâtait sans mesure et avait toujours cédé à ses fantaisies les plus déraisonnables. Ainsi favorisée de la nature et de la fortune, Henriette Walter était pourtant fort à plaindre. Et vous serez de cet avis quand vous apprendrez que la pauvre enfant n’avait pas de maman; même elle était encore si petite quand elle l’avait perdue, qu’elle n’en pouvait conserver le souvenir. Son enfance s’était passée entre les mains de domestiques et de gouvernantes peu scrupuleuses qui, la voyant adulée par son papa, flattaient aussi tous ses caprices au lieu de reprendre et de corriger ses défauts, comme c’eût été leur devoir. Ainsi élevée, la pauvre Henriette, avec tous ses millions et sa beauté vraiment merveilleuse, devait inspirer plutôt la pitié que l’envie. Par bonheur, sa nature franche et loyale avait résisté aux basses flagorneries. Mais elle était devenue tyrannique, dédaigneuse, arrogante, et vraiment son orgueil démesuré avait quelque chose d’effrayant chez une créature aussi jeune.
Seule, Mme Fernel possédait quelque influence sur Henriette Walter. Au contact de Rose et de Violette, élevées simplement et sérieusement, la petite Anglaise avait beaucoup gagné. Tel fut le changement opéré en elle par les bons conseils et surtout le bon exemple, qu’à la fin des vacances, M. Walter ayant été appelé aux Indes par des affaires urgentes où toute sa fortune était engagée, elle consentit à rester en son absence pensionnaire dans un couvent de Paris, à condition que Mme Fernel, pour qui la fière petite créature s’était prisé d’une étrange affection, en dépit et peut-être à cause même des dures vérités que la maman de Rose et de Violette ne lui ménageait pas, viendrait la voir souvent et la ferait sortir aux jours de congé.
Au couvent, il y avait eu bien des hauts et des bas. Tantôt, au dire de la vieille Mère Assistante, «miss Henriette était un ange», et tantôt elle était «un démon». La vérité, c’est qu’elle n’était ni l’un ni l’autre, mais tout simplement une petite fille capricieuse et indomptée, à qui avaient manqué — hélas! ce que rien ne remplace — la tendresse et la direction d’une mère.
N’importe! avec tous ses défauts, il y avait beaucoup de bon chez Henriette; c’était une nature généreuse et droite, ayant le mensonge en horreur, incapable d’une action basse ou mesquine — et de ces natures-là, il ne faut jamais désespérer.
Henriette avait passé les congés de Noël chez Mme Fernel; elle devait y passer aussi les vacances de Pâques, à condition qu’elle l’eût mérité. Or, dans ces derniers temps, les notes de la petite fille devenaient de moins en moins satisfaisantes: zéro, à la «conduite», zéro, à la «politesse», et comme observation générale, «impertinence, révolte, mauvais exemple», tels étaient les fâcheux bulletins qui parvenaient chaque semaine à Mme Fernel. A vrai dire, pour le travail il n’y avait que des compliments à lui faire; bien qu’étrangère, Henriette tenait la tête de sa classe dans toutes les branches, grâce à sa vive intelligence bien plus qu’à son assiduité. Mais Mme Fernel faisait passer, et avec raison, la sagesse avant les succès scolaires, car si l’intelligence n’est pas donnée à tous les enfants, en revanche il ne tient qu’à eux de se montrer polis et dociles.
Mme Fernel n’avait nullement à redouter le contact d’Henriette Walter pour ses enfants. Rose et Violette, tout en aimant beaucoup la petite Anglaise, la trouvaient fort extraordinaire; ses caprices et ses grands airs leur causaient bien plus d’étonnement que d’admiration, et son exemple n’entamait point leur petit bon sens solide. Surtout elles n’avaient garde de l’envier: elle n’avait pas de maman! Quant à Frédy, il était encore trop enfant pour jouer et causer avec Henriette, et par conséquent pour se laisser influencer par elle. D’ailleurs ce jeune monsieur de cinq ans et demi nourrissait un mépris singulier à l’égard de la société des petites filles, et, comme il le disait lui-même: «MOI, je ne m’occupe pas des filles. Je suis un garçon, je ne m’occupe que des garçons.»
Arrivés au Luxembourg, Rose, Violette et Frédy s’empressèrent d’accourir à leur place favorite, celle où ils savaient retrouver leurs petits camarades. Ils s’écrièrent de loin: «Bonjour, Fernand; bonjour Roger, vous allez bien?» Puis avec une exclamation de joie: «Oh! bonjour, André ! tu es venu aujourd’hui, quel bonheur! ton rhume est guéri? Comment va ta bonne-maman?»
Roger et Fernand Provost étaient deux gros garçons ni trop bêtes ni trop intelligents, ni trop sages ni trop turbulents, rencontrés aux bains de mer comme Henriette Walter, et retrouvés au Luxembourg. André était également une connaissance de plage, — pauvre enfant infirme condamné à l’immobilité, toujours étendu sur le dos dans une petite voiture, sans même pouvoir s’asseoir ni se retourner. Ayant perdu son père et sa mère, il n’avait plus aucun parent, si ce n’est une bonne-maman, bien triste et qui se faisait vieille. Le petit André avait conquis l’affection de tous, l’admiration générale par sa douceur, sa résignation, sa bonne humeur inaltérable; jamais il ne se plaignait, jamais il ne faisait entendre une parole d’impatience ou d’envie. C’était encore lui qui avait le secret de calmer les disputes enfantines, et, du fond de sa pauvre couche d’infirme, d’où il ne bougeait jamais, il savait égayer et diriger les jeux de ses camarades bien portants. Tout le monde adorait André, et les petits oiseaux eux-mêmes, qui le connaissaient, voletaient autour de sa voiture dès qu’ils le voyaient arriver au Luxembourg, perchaient sur son épaule, et venaient becqueter les miettes de son goûter jusque dans sa main.
«Bonjour, Violette, bonjour, Rose, bonjour, Frédy, répondit André, avec un sourire de gaîté, si touchant sur ce petit visage pâli et émacié par la souffrance. Comment va votre maman? elle n’est pas venue avec vous?»
André aimait beaucoup ses trois petits amis, mais il aimait encore plus leur maman, pour laquelle il avait un véritable culte.
VIOLETTE.
«Elle nous a laissés au Luxembourg. Elle a été faire des courses et nous prendra en revenant.
ROSETTE, toujours pressée de bavarder.
Maman est allée au couvent des Oiseaux, voir si Henriette Walter a été assez sage pour sortir pendant les vacances de Pâques.
ROGER, faisant la grimace.
Alors elle passera les congés chez vous, cette princesse? elle viendra avec vous au Luxembourg? elle va gâter tous nos jeux et nous empêchera de nous amuser, avec ses grands airs.»
Roger et son frère Fernand n’aimaient pas Henriette Walter; ils l’accusaient d’être hautaine et prétentieuse, et de glacer les amusements par sa seule présence. Ce qui est vrai surtout, c’est qu’Henriette Walter leur en imposait singulièrement. Ils redoutaient ses dédains, son air de mépris, son silence glacial quand ils se permettaient quelque plaisanterie de mauvais goût, ou quand ils criaient et se bousculaient en jouant. Roger et Fernand étaient, nous l’avons dit, de braves petits garçons, mais d’intelligence et d’éducation peu affinées. Et la suprême distinction de la petite Anglaise, sa manière de prononcer: C’est «improper! » devant quelque chose qui la choquait, les mettait mal à l’aise et gênait leur exubérance de collégiens sans façon.
ANDRÉ, avec douceur.
«Mon cher Roger, tu as tort, je t’assure, de te figurer qu’Henriette Walter nous empêchera de nous amuser. Elle n’est pas du tout poseuse comme tu crois.
ROGER.
Ah ouiche! c’est une pimbêche. Elle regarde tout le monde du haut de sa grandeur, et à Cabourg, elle se moquait toujours de nous.
FERNAND, renchérissant.
Bien sûr! Ainsi quand je ne savais pas jouer de charades....
ROGER.
Et moi, quand je ne pouvais pas raconter d’anecdotes: «Roger, vous allez passer pour un imbécile!» et des manières, et des airs pincés! Tiens, tu auras beau dire, André, moi, je ne l’aime pas, cette «angliche spoken».
Roger et Fernand croyaient très spirituel d’appeler ainsi les Anglais — et ce n’était qu’absurde, puisque si «angliche spoken» (English spoken) eût pu signifier quelque chose, cela n’aurait voulu dire, en tous cas, que: «On parle anglais».
ANDRÉ, sérieusement.
«Mais moi je l’aime beaucoup, mes chers amis. Alors vous me faites de la peine en parlant d’elle de cette façon.»
La physionomie d’André était devenue toute triste. Roger et Fernand s’en aperçurent, et comme ils avaient bon cœur, ils cessèrent aussitôt leurs critiques. Personne n’eût voulu chagriner André, et ses petits camarades moins que qui que ce soit..
A ce moment, les enfants virent arriver une petite fille et deux petits garçons qui leur faisaient signe. Aussitôt ils s’élancèrent au-devant d’eux en s’écriant: «Stéphanie, Jules, Michel! pourquoi n’êtes-vous pas venus hier? Nous avions si peur de ne pas vous voir aujourd’hui!»
Stéphanie Kowalsky et ses frères Jules et Michel étaient de nouvelles connaissances qui n’avaient pas tardé à tenir une grande place parmi les amis de Violette et de Rose. Les engouements des enfants — comme ceux des grandes personnes — ne sont pas toujours justifiés; il leur arrive même de choisir assez mal leurs favoris, parmi ceux de leurs camarades qui leur donnent tout autre chose que le bon exemple. Mais ceux-ci — la fillette surtout — méritaient vraiment l’affection enthousiaste de leurs amis, et il n’y avait qu’à gagner en leur société. Au Luxembourg, Mme Fernel avait été frappée par la physionomie intelligente, l’air modeste et gracieux d’une petite fille qu’elle rencontrait aussi dans le quartier et à l’église avec trois petits garçons, frères ou cousins. Elle avait de jolis yeux bruns qui rient, un fin visage allongé, des joues un peu pâles, et des cheveux châtains en boucles courtes; tous ses mouvements étaient mesurés et harmonieux; elle ne courait jamais trop fort, elle ne parlait jamais trop haut; elle n’était jamais ni excitée ni «en dehors». Ce qui la caractérisait, c’était la réserve, la modération et la grâce. Elle surveillait les jeux des garçons qui l’accompagnaient, calmait leurs querelles, les faisait obéir d’un mot prononcé d’une voix douce, sans même élever le ton. Elle lisait ou cousait sagement, et quand, par hasard, elle causait avec des amies, c’était toujours d’un air paisible, avec des gestes sobres, bien éloignés de ces façons importantes, de ce ton de vulgaire commérage si déplaisants et si fréquents, hélas! chez les petites filles.
Mme Fernel était une observatrice des enfants; les aimant beaucoup, elle les avait beaucoup étudiés; peu de chose: une physionomie, une attitude, suffisaient pour lui dévoiler une nature, lui faire connaître un caractère. Il ne lui avait pas fallu longtemps pour se rendre compte, rien qu’à son extérieur, des aimables qualités de cette petite fille, et elle eut un grand plaisir à lui voir faire connaissance avec les siennes.
Un jour Violette, très étourdie, avait perdu son dé dans le sable. Elle en éprouva d’autant plus de chagrin que ce dé, en argent, avec ses initiales, était un des derniers cadeaux de son cher papa. Elle le cherchait en vain au pied des arbres, près du banc où elle s’était assise, quand la petite fille s’approcha gentiment et lui dit avec une gracieuse simplicité :
«Vous cherchez quelque chose, mademoiselle? Ne serait-ce pas ce dé que je viens de trouver?»
Violette, toute joyeuse, s’exclama:
«Oui, c’est mon dé. Oh! que je suis contente! Papa me l’avait donné pour ma fête. J’étais désolée de l’avoir perdu.»
Violette remercia avec effusion:
«Je m’appelle Violette Fernel. J’espère que vous voudrez bien jouer avec moi, et si j’en trouve l’occasion, je serai bien contente de vous faire plaisir à mon tour. Comment vous appelez-vous? Quel âge avez-vous?
LA PETITE FILLE.
Je m’appelle Stéphanie Kowalsky. Je suis Russe et j’ai treize ans.
VIOLETTE.
Comment, vous êtes étrangère? On ne le croirait jamais. Vous parlez le français comme une vraie Française, sans aucun accent.
STÉPHANIE.
Je parle aussi l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Nous avons beaucoup voyagé, de sorte que j’ai appris à parler la langue de chaque pays où nous avons séjourné.
VIOLETTE.
Mais c’est merveilleux! Et vous dites cela tout simplement, comme une chose naturelle! Moi qui ai tant de peine à me mettre à l’anglais et qui ne parviens pas à attraper les intonations!»
Stéphanie, avec une sincère modestie, bien éloignée de la fausse humilité de tant de petites prétentieuses:
«Oh! ce n’est pas merveilleux du tout, c’est bien plus facile d’apprendre une langue quand on a été dans le pays. Mes frères en parlent aussi plusieurs, et mieux que moi, je vous assure.»
Les frères de Stéphanie s’étaient approchés: la petite fille les présenta gracieusement. Michel et Jules étaient aussi d’aimables enfants; ils avaient les manières caressantes, le charme slave, qui est irrésistible. Pour souhaiter le bonjour, ils s’inclinaient profondément, vous prenaient la main, la portaient à leur front, selon la mode russe ou polonaise. Ceci plongea les fillettes dans l’admiration. Le troisième petit garçon qui accompagnait Stéphanie était resté à l’écart, d’un air renfrogné. Celui-ci n’était que le cousin des Kowalsky; il avait sept ans et s’appelait Auguste Boronine. Il était loin d’avoir l’extérieur agréable, les façons séduisantes de Michel et de Jules, et dans la suite, les enfants devaient s’apercevoir que les différences ne se bornaient pas à l’extérieur. Autant ses cousins étaient aimables, autant Auguste Boronine était insupportable. Élevé en dépit du bon sens, abandonné à lui-même par une mère indolente et frivole qui ne s’occupait pas de lui, n’allant pas au collège, dépourvu d’une occupation sérieuse et suivie, il traînait chez les uns et les autres, toujours maussade comme les enfants désœuvrés, et en quête de jeux destructifs. On ne le supportait qu’à cause de ses cousins, et en particulier de Stéphanie, à qui en retombait trop souvent la charge.
La connaissance ainsi faite, petits garçons et petites filles devinrent bien vite inséparables. On ne jurait que par Stéphanie: Stéphanie avait dit ceci, Stéphanie avait fait cela.... Stéphanie était un oracle. Sans bruit, comme elle accomplissait toutes choses, la petite fille s’était imposée à son jeune entourage. Mais comme elle possédait un tact parfait, une adresse naturelle qui ne nuisait en rien à sa droiture, elle avait su rester en bons termes avec tout le monde, et en particulier avec Henriette, à qui elle aurait pu porter ombrage. Bref, connaissez-vous des enfants parfaits? Rosette déclarait: «Stéphanie, c’est le plus-que-parfait!... » Sans doute Stéphanie n’était pas parfaite; elle n’échappait point à la loi commune, et, comme tout le monde, devait avoir ses défauts: mais ce qu’il faut dire, c’est que sa maman était la seule à les connaître.
Le petit cercle était au complet: Rose et Violette Fernel, Fernand et Roger Provost, André, Stéphanie, Michel et Jules Kowalsky, aussi, hélas! l’insupportable Auguste, toléré plutôt qu’admis. Les enfants s’engagèrent dans d’interminables conversations, se racontant mutuellement tout ce qu’ils avaient fait depuis qu’ils ne s’étaient vus. Une fois ensemble, ils ne connaissaient pas une minute d’ennui. Jamais les heures n’étaient assez longues pour tout ce qu’ils avaient à dire et à faire, mettant en commun jeux, travail, lectures. Parfois d’autres enfants venaient se joindre à eux. Mais ceux-ci formaient un petit cercle à part; on ne les voyait guère l’un sans l’autre; ils tenaient leurs assises dans les petits jardins, tranquilles et isolés, qui avoisinent l’avenue de l’Observatoire. C’était là qu’ils se retrouvaient dès que venait la belle saison, après la classe ou le cours, à tous leurs moments de loisir, et eux-mêmes s’étaient intitulés:
LES ENFANTS DU LUXEMBOURG.