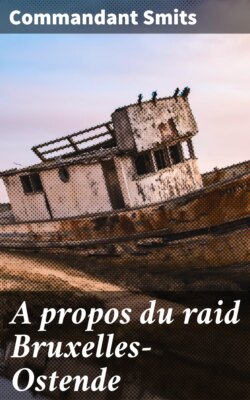Читать книгу A propos du raid Bruxelles-Ostende - Commandant Smits - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеTable des matières
Les marches de résistance en troupe.
Les courses sur routes et à travers pays peuvent se diviser en deux catégories bien distinctes: les marches de résistance en troupe, et les courses de cavaliers isolés. La marche en troupe exécutée par la cavalerie à grande distance et en l’air, a pour but un acte de violence et de surprise; la marche rapide d’un cavalier isolé ne vise généralement que la découverte des positions de l’ennemi, la recherche de renseignements précis, importants ou nécessaires à connaître.
Les peuples d’Asie furent les premiers à organiser la cavalerie sur des bases sérieuses et à entreprendre, avec des troupes de cette arme, les conquêtes que nous content les historiens anciens. Xénophon et Diodore, nous montrent les Perses et les Mèdes se portant vers l’Occident, leur exemple étant bientôt suivi par les Egyptiens; les récits de cette époque nous signalent souvent de tels exploits équestres, que l’on ne sait jusqu’à quel point on doit y ajouter foi.
Dans le Précis des guerres de Jules César, Napoléon Ier cite un fait qui constitue certainement le record de tous les raids de ce genre: «CÉSAR, dit-il, franchit, en moins de huit jours, la distance de Rome au Rhône, parcourant près de 150 kilomètres par jour; puis, lors de son expédition en Espagne, l’an 46 avant Jésus-Christ, il partit de Rome au commencement de décembre, par terre, traversa les Gaules, les Pyrénées et arriva le dix-septième jour à Sagunte, le vingt-troisième à la Sierra Morena et le vingt-septième à Obulco (aujourd’hui Portuna), ayant ainsi fait 87 kilomètres par jour pendant près d’un mois! et cela à la tête d’une armée!»
Au XIIe siècle, l’avant-garde de GENGIS-KHAN, le célèbre conquérant mongol, composée de dix mille cavaliers montés, et de trente mille chevaux, destinés soit à servir de remplacement, soit à être mangés en route, est allée, des bords de la mer Caspienne au Danube, en traversant le Caucase, l’Ukraine, la Pologne et en se rabattant au sud jusqu’à Vienne. En trois mois, elle avait parcouru plus de 6,000 kilomètres.
A l’époque de la chevalerie, l’emploi de chevaux aptes à porter des poids considérables, avait fait abandonner les allures rapides; ce n’est qu’après l’apparition de la poudre à canon que les cavaliers retrouvant des montures plus légères et plus vites, les entreprises hardies reprennent cours et ne font que progresser jusqu’à nos jours.
Parmi les opérations les plus audacieuses, il convient de citer une pointe remarquable poussée jusqu’aux portes de Versailles, en mars 1707, par quelques cavaliers de l’armée qui opérait en Flandre sous Malborough. Un partisan, nommé GROVESTEIN, ayant rang de colonel dans l’armée hollandaise, avait parié qu’il irait enlever, entre Paris et Versailles, quelque grand personnage de la cour de Louis XIV, et avait obtenu de ses chefs trente cavaliers choisis (seize officiers et quatorze dragons). La petite troupe parvient sans obstacles à Sèvres et là, croyant enlever le duc d’Orléans, s’empare de M. de Behringen, écuyer du roi, et le ramène prisonnier jusque dans les lignes ennemies.
En 1712, Louis XIV qui n’avait pas oublié l’audace de Grovestein, autorise JACOB PASTEUR à aller piller la ville de Thoolen, près de Berg-op-Zoom, et lui accorde pour accomplir ce coup de main le concours de cinq cents dragons. Le onzième jour de marche, le détachement arrive la nuit au bord de l’Escaut; six hommes traversent le fleuve à la nage, et s’emparent d’un bac dans lequel passe tout le détachement. La ville fut pillée et les dragons rentrèrent à Maubeuge en six jours, avec un nombreux butin et cent huit chevaux.
L’histoire des guerres de la Révolution et de l’Empire abonde en faits typiques: des cavaliers se lancent en masse, très loin en avant des armées, à travers une vaste étendue de pays ennemi, s’emparant de places fortes réputées imprenables; les noms de MURAT, LASALLE, KELLERMANN et de tant d’autres, en sont restés légendaires.
Passant sur beaucoup d’autres souvenirs intéressants, nous arrivons à la fameuse guerre de Sécession, de laquelle datent, selon beaucoup, la création et l’organisation des raids. L’on ne peut signaler les exploits de la cavalerie américaine, sans faire ressortir les conditions uniques où elle se trouvait et qui ne se rencontreront plus dans l’avenir.
La commission internationale sur la piste de l’hippodrome Wellington
Dans la marche d’un détachement de cavalerie, poussé au loin, ne garantissant pas sa ligne de retraite, et n’ayant plus à un moment donné de relations possibles avec les troupes en arrière, les cavaliers privés de leur monture, doivent être considérés comme irrémédiablement perdus; il convient donc avant tout de ne pas dépasser l’effort maximum que l’on peut demander aux chevaux. Pendant la guerre de Sécession, ce souci était nul; le pays traversé était précisément un centre d’élevage où les chevaux n’avaient guère de valeur et se rencontraient en nombre incalculable; les combattants employés dans ces missions hardies changeaient de monture jusque deux ou trois fois par jour; c’étaient des soldats d’occasion, habitués pour la plupart, dès leur enfance, au sport hippique, se servant avec habilité d’animaux qui auraient été considérés comme indomptables par les cavaliers d’une armée régulière.
Ce fut avec ces éléments que le général cessionniste VAN DORN et le chef des confédérés FORREST effectuèrent, en 1860, des raids fameux sur les derrières de l’armée du général Grant.
Grant, n’avançait qu’avec hésitation, appréhendant d’allonger de façon anormale sa ligne de communication vers la base de ravitaillement de ses troupes, et se préoccupait constamment de demeurer maître du Mississipi. Il était arrivé à 11 lieues environ au sud de Holly-Springs, lorsque la cavalerie du général Van Dorn fit irruption dans cette localité, enlevant la garnison et détruisant tous les approvisionnements de la place. Pendant ce temps, le général Forrest, plus au nord, parvenait à couper la ligne de chemin de fer en quantité d’endroits, sur une distance de 24 lieues; en quinze jours, la cavalerie livra trois combats sérieux et des escarmouches journalières, détruisit plus de cinquante ponts de chemin de fer, brûla vingt blockhaus, fit prisonniers ou mit hors de.combat deux mille cinq cents fédérés, s’empara de dix pièces d’artillerie, de dix mille fusils et d’un million de cartouches. Ce splendide résultat n’avait coûté que quatre cents combattants.
Le général MORGAN, dans le Kentucky et l’Ohio, parcourut 1,000 kilomètres en pays ennemi avec neuf cents cavaliers, s’empara de dix-sept villes, détruisit pour quarante millions de dollars de magasins et de matériel de chemin de fer, mais finit l’année suivante par être cerné et fait prisonnier par la cavalerie fédérale.
N’oublions pas le général SHÉRIDAN qui, dans cette même année de 1865, accomplit avec mille cavaliers une marche de 3,487 kilomètres en quarante jours.
En 1879, lors du soulèvement des Apaches, les généraux américains citent des performances absolument remarquables. Le colonel MAKENSIE, à la poursuite d’un parti Indien, fait avec un escadron, 260 kilom. en vingt-huit heures, à l’aller et au retour; pendant ce temps, il franchit la frontière mexicaine, et livra un combat sérieux, après lequel il dut se retirer sur le territoire des États-Unis. Le capitaine FECHTÉ, avec deux compagnies, faisait en même temps, dans le même but, une course d’égale étendue plus rapidement encore. Le colonel HENRI, avec quatre escadrons, parcourut 174 kilomètres en trente-trois heures, dont vingt-deux en selle, et ne laissant qu’un seul cheval en route. Le général MERRITT, avec quatre escadrons et un détachement d’infanterie, transporté sur des voitures, fit 274 kilomètres en soixante-six heures pour porter secours à la garnison d’un poste investi par les Indiens; aussitôt arrivé, il livra un combat très sérieux.
Pour terminer cette rapide revue des marches de fond exécutées par la cavalerie des armées, il ne reste qu’à citer le raid du général GOURKO pendant la campagne russo-turque et les déplacements d’une rapidité inconcevable, qui permirent aux combattants boers de lutter contre des forces dix fois supérieures, en arrivant toujours à se trouver en nombre pour supporter l’attaque, sur quelque point qu’elle se présentât.
Dans ces différentes marches, la distance parcourue journellement a, parfois, atteint presque 200 kilomètres, mais il est à remarquer que les vitesses moyennes (repos compris) ont toujours été relativement minimes et n’ont guère dépassé, pour les longues étapes devant se renouveler plusieurs jours de suite, 4 à 5 kilomètres à l’heure, ni plus de 10 kilomètres à l’heure pour les coups d’audace et de surprise, après lesquels les chevaux pouvaient prendre un long repos.
Les marches en troupe portent sur un nombre de points très considérables et qu’il importe de connaître parfaitement pour oser entreprendre une tentative de ce genre avec espoir de succès. L’alimentation des hommes et des chevaux, la répartition du paquetage, la ferrure, la réglementation des allures et les soins hygiéniques en cours de route sont autant de questions complexes, pour l’étude desquelles les cavaleries modernes ont fait des essais en temps de paix. Ces essais n’ont pas, selon nous, été pratiqués avec suffisamment de méthode ni de manière assez suivie, et nous estimons qu’il reste encore beaucoup d’éléments douteux, dont la connaissance augmenterait les chances de réussite. Voici quelques expériences tentées dans les différentes armées européennes en ces dernières années:
Le 25 août 1890, dans une manœuvre du 4e corps d’armée russe, dix-huit escadrons et quatre pièces d’artillerie exécutèrent une marche forcée de 115 kilomètres en vingt heures, dans le but supposé de détruire les gares du chemin de fer de Baranowitz. En défalquant les heures de repos et de manœuvre, la marche proprement dite avait pris onze heures et on n’avait eu à déplorer que deux accidents à la ferrure.
La même année, le 21e de cavalerie (régiment de chevau-légers de Padoue), qui tenait garnison à Palerme, fournit une reconnaissance de douze cavaliers sous le commandement d’un officier; elle parcourut 287 kilomètres en trois jours, à travers un pays de montagnes et de sentiers à peine praticables, où les cavaliers durent conduire leurs chevaux par la figure dans maints passages et sur d’assez longs parcours; tous sont rentrés dans les meilleures conditions de force et de santé.
Au mois de mars 1894 fut tentée, en Espagne, une intéressante épreuve de résistance. Le colonel commandant le régiment des chasseurs de Tétouan, en garnison à Reuss (Catalogne), obtint du général commandant le 4e corps, l’autorisation de se rendre en une étape à Barcelone, pour assister à une grande revue qui devait être passée à l’occasion de la fête du Roi. La quinzaine précédente fut consacrée à la préparation méthodique et progressive des hommes et des chevaux; l’équipement était celui de campagne, les chevaux portaient environ 100 kilogrammes. Le régiment effectua 106 kilomètres en quatorze heures dont trois de repos; le jour suivant, il assista à la parade et repartit le lendemain pour Reuss, en deux étapes. Quelques chevaux seulement montrèrent de l’inappétence à la suite de cette marche, mais sans qu’il en résultât de conséquences fâcheuses.
Le 29 juillet 1897, les officiers, les cadres et les éclaireurs du 5e cuirassiers, en garnison à Vouziers, parcoururent 125 kilomètres en vingt heures durant un service de cadres; tous les chevaux prirent part à la manœuvre le lendemain.
Un détachement du 4e spahis effectua, le 20 avril 1899, à titre d’expérience, une marche de 144 kilomètres en vingt-quatre heures, de Gabès à Grahilba; aucun cheval ne s’était ressenti de cette formidable étape.
Sans multiplier ces exemples, sans relater toutes les mesures qui ont été prises pour mener à bien ces tentatives, remarquons seulement, comme nous l’avons déjà dit, que les vitesses moyennes n’ont jamais dépassé 10 kilomètres à l’heure. On peut en conclure, dès à présent, qu’en marchant lentement, le degré de résistance des chevaux n’a pas de limites, et qu’une troupe bien entraînée, conduite par un chef compétent, composée de cavaliers choisis, peut arriver à parcourir, pendant un nombre de jours considérable, des étapes que l’on hésiterait à entreprendre accidentellement. De l’avis unanime, ce n’est pas la longueur de la route qui tue, mais la vitesse employée. L’étude de la vitesse maxima est donc la plus intéressante et la plus délicate, et c’est elle que nous allons entreprendre en nous occupant des cavaliers isolés.