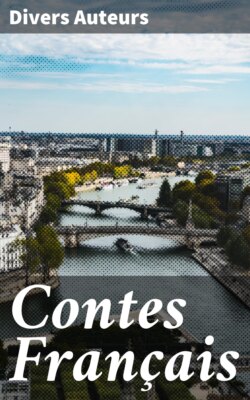Читать книгу Contes Français - Divers Auteurs - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавлениеsuppliant de l'aider, de la soutenir, de donner à son pauvre
corps usé la force qu'il lui fallait pour venger le fils.
Puis elle rentra. Elle avait dans sa cour un ancien
baril défoncé, qui recueillait l'eau des gouttières; elle le
[5] renversa, le vida, l'assujettit contre le sol avec des pieux
et des pierres; puis elle enchaîna Sémillante à cette niche,
et elle rentra.
Elle marchait maintenant, sans repos, dans sa chambre,
l'oeil fixé toujours sur la côte de Sardaigne. Il était
[10] là-bas, l'assassin.
La chienne, tout le jour et toute la nuit, hurla. La
vieille, au matin, lui porta de l'eau dans une jatte; mais
rien de plus: pas de soupe, pas de pain.
La journée encore s'écoula. Sémillante, exténuée, dormait.
[15] Le lendemain, elle avait les yeux luisants, le poil
hérissé, et elle tirait éperdument sur sa chaîne.
La vieille ne lui donna encore rien à manger. La bête,
devenue furieuse, aboyait d'une voix rauque. La nuit
encore se passa.
[20] Alors, au jour levé, la mère Saverini alla chez le voisin,
prier qu'on lui donnât deux bottes de paille. Elle prit de
vieilles hardes qu'avait portées autrefois son mari, et les
bourra de fourrage, pour simuler un corps humain.
Ayant piqué un bâton dans le sol, devant la niche de
[25] Sémillante, elle noua dessus ce mannequin, qui semblait
ainsi se tenir debout. Puis elle figura la tête au moyen
d'un paquet de vieux linge.
La chienne, surprise, regardait cet homme de paille, et
se taisait bien que dévorée de faim.
[30] Alors la vieille alla acheter chez le charcutier un long
morceau de boudin noir. Rentrée chez elle, elle alluma un
feu de bois dans sa cour, auprès de la niche, et fit griller
son boudin. Sémillante, affolée, bondissait, écumait, les
yeux fixés sur le gril, dont le fumet lui entrait au ventre.
Puis la mère fit de cette bouillie fumante une cravate
à l'homme de paille. Elle la lui ficela longtemps autour
[5] du cou, comme pour la lui entrer dedans. Quand ce fu
fini, elle déchaîna la chienne.
D'un saut formidable, la bête atteignit la gorge du mannequin,
et, les pattes sur les épaules, se mit à la déchirer.
Elle retombait, un morceau de sa proie à la gueule, puis
[10] s'élançait de nouveau, enfonçait ses crocs dans les cordes,
arrachait quelques parcelles de nourriture, retombait encore,
et rebondissait, acharnée. Elle enlevait le visage
par grands coups de dents, mettait en lambeaux le col
entier.
[15] La vieille, immobile et muette, regardait, l'oeil allumé.
Puis elle renchaîna sa bête, la fit encore jeûner deux jours,
et recommença cet étrange exercice.
Pendant trois mois, elle l'habitua à cette sorte de lutte,
à ce repas conquis à coups de crocs. Elle ne l'enchaînait
[20]plus maintenant, mais elle la lançait d'un geste sur le
mannequin.
Elle lui avait appris à le déchirer, à le dévorer, sans
même qu'aucune nourriture fût cachée en sa gorge. Elle
lui donnait ensuite, comme récompense, le boudin grillé
[25]pour elle.
Dès qu'elle apercevait l'homme, Sémillante frémissait,
puis tournait les yeux vers sa maîtresse, qui lui criait:
«Va!» d'une voix sifflante, en levant le doigt.
Quand elle jugea le temps venu, la mère Saverini alla
[30] se confesser et communia un dimanche matin, avec une
ferveur extatique, puis, ayant revêtu des habits de mâle,
semblable à un vieux pauvre déguenillé, elle fit marché
avec un pêcheur sarde, qui la conduisit, accompagnée de
sa chienne, de l'autre côté du détroit.
Elle avait, dans un sac de toile, un grand morceau de
[5] boudin. Sémillante jeûnait depuis deux jours. La vieille
femme, à tout moment, lui faisait sentir la nourriture
odorante, et l'excitait.
Elles entrèrent dans Longosardo. La Corse allait en
boitillant. Elle se présenta chez un boulanger et demanda
[10] la demeure de Nicolas Ravolati. Il avait repris son ancien
métier, celui de menuisier. Il travaillait seul au fond de
sa boutique.
La vieille poussa la porte et l'appela:
--Hé! Nicolas!
[15] Il se tourna; alors, lâchant sa chienne, elle cria:
--Va, va, dévore, dévore!
L'animal, affolé, s'élança, saisit la gorge. L'homme
étendit les bras, l'étreignit, roula par terre. Pendant
quelques secondes, il se tordit, battant le sol de ses pieds;
[10] puis il demeura immobile, pendant que Sémillante lui
fouillait le cou, qu'elle arrachait par lambeaux. Deux
voisins, assis sur leur porte, se rappelèrent parfaitement
avoir vu sortir un vieux pauvre avec un chien noir efflanqué
qui mangeait, tout en marchant, quelque chose de
[25] brun que lui donnait son maître.
La vieille, le soir, était rentrée chez elle. Elle dormit
bien, cette nuit-là.
L'AVENTURE DE WALTER SCHNAFFS
A Robert Pinchon Depuis son entrée en France avec l'armée d'invasion, Walter Schnaffs se jugeait le plus malheureux des hommes. Il était gros, marchait avec peine, soufflait beaucoup et souffrait affreusement des pieds qu'il avait fort plats et [5] fort gras. Il était en outre pacifique et bienveillant, nullement magnanime ou sanguinaire, père de quatre enfants qu'il adorait et marié avec une jeune femme blonde, dont il regrettait désespérément chaque soir les tendresses, les petits soins et les baisers. Il aimait se lever tard et se [10] coucher tôt, manger lentement de bonnes choses et boire de la bière dans les brasseries. Il songeait en outre que tout ce qui est doux dans l'existence disparaît avec la vie; et il gardait au coeur une haine épouvantable, instinctive et raisonnée en même temps, pour les canons, les fusils, les revolvers et les sabres, mais surtout pour les baïonnettes, [15] se sentant incapable de manoeuvrer assez vivement cette arme rapide pour défendre son gros ventre. Et, quand il se couchait sur la terre, la nuit venue, roulé dans son manteau à côté des camarades qui ronflaient, il [20] pensait longuement aux siens laissés là-bas et aux dangers semés sur sa route: S'il était tué, que deviendraient les petits? Qui donc les nourrirait et les élèverait? A l'heure même, ils n'étaient pas riches, malgré les dettes qu'il avait contractées en partant pour leur laisser quelque [25] argent. Et Walter Schnaffs pleurait quelquefois. Au commencement des batailles il se sentait dans les
jambes de telles faiblesses qu'il se serait laissé tomber, s'il
n'avait songé que toute l'armée lui passerait sur le corps.
Le sifflement des balles hérissait le poil sur sa peau.
Depuis des mois il vivait ainsi dans la terreur et dans
[5] l'angoisse.
Son corps d'armée s'avançait vers la Normandie, et
il fut un jour envoyé en reconnaissance avec un faible
détachement qui devait simplement explorer une partie du
pays et se replier ensuite. Tout semblait calme dans la
[10] campagne; rien n'indiquait une résistance préparée.
Or, les Prussiens descendaient avec tranquillité dans
une petite vallée que coupaient des ravins profonds,
quand une fusillade violente les arrêta net, jetant bas une
vingtaine des leurs; et une troupe de francs-tireurs,
[15] sortant brusquement d'un petit bois grand comme la main,
s'élança en avant, la baïonnette au fusil.
Walter Schnaffs demeura d'abord immobile, tellement
surpris et éperdu qu'il ne pensait même pas à fuir. Puis
un désir fou de détaler le saisit; mais il songea aussitôt
[20] qu'il courait comme une tortue en comparaison des maigres
Français qui arrivaient en bondissant comme un
troupeau de chèvres. Alors, apercevant à six pas devant
lui un large fossé plein de broussailles couvertes de feuilles
sèches, il y sauta à pieds joints, sans songer même à la
[25] profondeur, comme on saute d'un pont dans une rivière.
Il passa, à la façon d'une flèche, à travers une couche
épaisse de lianes et de ronces aiguës qui lui déchirèrent la
face et les mains, et il tomba lourdement assis sur un lit
de pierres.
[30] Levant aussitôt les yeux, il vit le ciel par le trou qu'il
avait fait. Ce trou révélateur le pouvait dénoncer, et il
se traîna avec précaution, à quatre pattes, au fond de
cette ornière, sous le toit de branchages enlacés, allant le
plus vite possible, en s'éloignant du lieu de combat.
Puis il s'arrêta et s'assit de nouveau, tapi comme un
lièvre au milieu des hautes herbes sèches.
Il entendit pendant quelque temps encore des détonations,
[5] des cris et des plaintes. Puis les clameurs de la
lutte s'affaiblirent, cessèrent. Tout redevint muet et
calme.
Soudain quelque chose remua: contre lui. Il eut un
[10] sursaut épouvantable. C'était un petit oiseau qui, s'étant
posé sur une branche, agitait des feuilles mortes. Pendant
près d'une heure, le coeur de Walter Schnaffs en battit à
grands coups pressés.
La nuit venait, emplissant d'ombre le ravin. Et le
[15] soldat se mit à songer. Qu'allait-il faire? Qu'allait-il
devenir? Rejoindre son armée?... Mais comment?
Mais par où? Et il lui faudrait recommencer l'horrible
vie d'angoisses, d'épouvantes, de fatigues et de souffrances
qu'il menait depuis le commencement de la guerre! Non!
[20] Il ne se sentait plus ce courage. Il n'aurait plus l'énergie
qu'il fallait pour supporter les marches et affronter les
dangers de toutes les minutes.
Mais que faire? Il ne pouvait rester dans ce ravin et
s'y cacher jusqu'à la fin des hostilités. Non, certes. S'il
[25] n'avait pas fallu manger, cette perspective ne l'aurait
pas trop atterré; mais il fallait manger, manger tous les
jours.
Et il se trouvait ainsi tout seul, en armes, en uniforme,
sur le territoire ennemi, loin de ceux qui le pouvaient
[30] défendre. Des frissons lui couraient sur la peau.
Soudain il pensa: «Si seulement j'étais prisonnier!» Et
son coeur frémit de désir, d'un désir violent, immodéré,
d'être prisonnier des Français. Prisonnier! Il serait
sauvé, nourri, logé, à l'abri des balles et des sabres, sans
appréhension possible, dans une bonne prison bien gardée.
Prisonnier! Quel rêve!
[5] Et sa résolution fut prise immédiatement:
--Je vais me constituer prisonnier.
Il se leva, résolu à exécuter ce projet sans tarder d'une
minute. Mais il demeura immobile, assailli soudain par
des réflexions fâcheuses et par des terreurs nouvelles.
[10] Où allait-il se constituer prisonnier? Comment? De
quel côté? Et des images affreuses, des images de mort,
se précipitèrent dans son âme.
Il allait courir des dangers terribles en s'aventurant
seul, avec son casque à pointe, par la campagne.
[15] S'il rencontrait des paysans? Ces paysans, voyant un
Prussien perdu, un Prussien sans défense, le tueraient
comme un chien errant! Ils le massacreraient avec leurs
fourches, leurs pioches, leurs faux, leurs pelles! Ils en
feraient une bouillie, une pâtée, avec l'acharnement des
[20] vaincus exaspérés.
S'il rencontrait des francs-tireurs? Ces francs-tireurs,
des enragés sans loi ni discipline, le fusilleraient pour
s'amuser, pour passer une heure, histoire de rire en voyant
sa tête. Et il se croyait déjà appuyé contre un mur en
[25] face de douze canons de fusils, dont les petits trous ronds
et noirs semblaient le regarder.
S'il rencontrait l'armée française elle-même? Les
hommes d'avant-garde le prendraient pour un éclaireur,
pour quelque hardi et malin troupier parti seul en reconnaissance,
[30] et ils lui tireraient dessus. Et il entendait déjà
les détonations irrégulières des soldats couchés dans les
broussailles, tandis que lui, debout au milieu d'un champ,
affaissait, troué comme une écumoire par les balles qu'il
sentait entrer dans sa chair.
Il se rassit, désespéré. Sa situation lui paraissait sans
issue.
[5] La nuit était tout à fait venue, la nuit muette et noire.
Il ne bougeait plus. Tressaillant à tous les bruits inconnus
et légers qui passent dans les ténèbres. Un lapin, tapant
du cul au bord d'un terrier, faillit faire s'enfuir Walter
Schnaffs. Les cris des chouettes lui déchiraient l'âme, le
[10] traversant de peurs soudaines, douloureuses comme des
blessures. Il écarquillait ses gros yeux pour tâcher de
voir dans l'ombre; et il s'imaginait à tout moment entendre
marcher près de lui.
Après d'interminables heures et des angoisses de damné,
[15] il aperçut, à travers son plafond de branchages, le ciel qui
devenait clair. Alors, un soulagement immense le pénétra;
ses membres se détendirent, reposés soudain; son coeur
s'apaisa; ses yeux se fermèrent. Il s'endormit.
Quand il se réveilla, le soleil lui parut arrivé à peu près
[20] au milieu du ciel; il devait être midi. Aucun bruit ne
troublait la paix morne des champs; et Walter Schnaffs
s'aperçut qu'il était atteint d'une faim aiguë.
Il bâillait, la bouche humide à la pensée du saucisson
des soldats; et son estomac lui faisait mal.
[25] Il se leva, fit quelques pas, sentit que ses jambes étaient
faibles, et se rassit pour réfléchir. Pendant deux ou trois
heures encore, il établit le pour et le contre, changeant
à tout moment de résolution, combattu, malheureux,
tiraillé par les raisons les plus contraires.
[30] Une idée lui parut enfin logique et pratique, c'était de
guetter le passage d'un villageois seul, sans armes, et sans
outils de travail dangereux, de courir au-devant de lui et
de se remettre en ses mains en lui faisant bien comprendre
qu'il se rendait.
Alors il ôta son casque, dont la pointe le pouvait trahir,
et il sortit sa tête au bord de son trou, avec des précautions
[5] infinies.
Aucun être isolé ne se montrait à l'horizon. Là-bas,
à droite, un petit village envoyait au ciel la fumée de
ses toits, la fumée de ses cuisines! Là-bas, à gauche; il
apercevait, au bout des arbres d'une avenue, un grand
[10] château flanqué de tourelles.
Il attendit jusqu'au soir, souffrant affreusement, ne
voyant rien que des vols de corbeaux, n'entendant rien
que les plaintes sourdes de ses entrailles.
Et la nuit encore tomba sur lui.
[15] Il s'allongea au fond de sa retraite et il s'endormit d'un
sommeil fiévreux, hanté de cauchemars, d'un sommeil
d'homme affamé.
L'aurore se leva de nouveau sur sa tête. Il se remit en
observation. Mais la campagne restait vide comme la
[20] veille; et une peur nouvelle entrait dans l'esprit de Walter
Schnaffs, la peur de mourir de faim! Il se voyait étendu
au fond de son trou, sur le dos, les deux yeux fermés. Puis
des bêtes, des petites bêtes de toute sorte s'approchaient
de son cadavre et se mettaient à le manger, l'attaquant
[25] partout à la fois, se glissant sous ses vêtements pour
mordre sa peau froide. Et un grand corbeau lui piquait
les yeux de son bec effilé.
Alors, il devint fou, s'imaginant qu'il allait s'évanouir
de faiblesse et ne plus pouvoir marcher. Et déjà, il
[30] s'apprêtait à s'élancer vers le village, résolu à tout oser, à
tout braver, quand il aperçut trois paysans qui s'en allaient
aux champs avec leurs fourches sur l'épaule, et il se replongea
dans sa cachette.
Mais, dès que le soir obscurcit la plaine, il sortit lentement
du fossé, et se mit en route, courbé, craintif, le coeur
battant, vers le château lointain, préférant entrer
là-dedans plutôt qu'au village qui lui semblait redoutable
[5] comme une tanière pleine de tigres.
Les fenêtres d'en bas brillaient. Une d'elles était même
ouverte; et une forte odeur de viande cuite s'en échappait,
une odeur qui pénétra brusquement dans le nez et jusqu'au
fond du ventre de Walter Schnaffs, qui le crispa, le fit
[10] haleter, l'attirant irrésistiblement, lui jetant au coeur une
audace désespérée.
Et brusquement, sans réfléchir, il apparut, casqué, dans
le cadre de la fenêtre.
Huit domestiques dînaient autour d'une grande table.
[15] Mais soudain une bonne demeura béante, laissant tomber
son verre, les yeux fixes. Tous les regards suivirent le sien!
On aperçut l'ennemi!
Seigneur! les Prussiens attaquaient le château! ...
Ce fut d'abord un cri, un seul cri, fait de huit cris poussés
[20] sur huit tons différents, un cri d'épouvante horrible, puis
une levée tumultueuse, une bousculade mêlée, une fuite
éperdue vers la porte du fond. Les chaises tombaient, les
hommes renversaient les femmes et passaient dessus. En
deux secondes, la pièce fut vide, abandonnée, avec la table
[25] couverte de mangeaille en face de Walter Schnaffs stupéfait,
toujours debout dans sa fenêtre.
Après quelques instants d'hésitation, il enjamba le mur
d'appui et s'avança vers les assiettes. Sa faim exaspérée
le faisait trembler comme un fiévreux: mais une terreur le
[30] retenait, le paralysait encore. Il écouta. Toute la maison
semblait frémir; des portes se fermaient, des pas rapides
couraient sur le plancher de dessus. Le Prussien inquiet
tendait l'oreille à ces confuses rumeurs; puis il entendit
des bruits sourds comme si des corps fussent tombés dans
la terre molle, au pied des murs, des corps humains sautant
du premier étage.
Puis tout mouvement, toute agitation cessèrent, et le
[5] grand château devint silencieux comme un tombeau.
Walter Schnaffs s'assit devant une assiette restée intacte,
et il se mit à manger. Il mangeait par grandes bouchées
comme s'il eût craint d'être interrompu trop tôt, de ne
pouvoir engloutir assez. Il jetait à deux mains les
[10] morceaux dans sa bouche ouverte comme une trappe; et des
paquets de nourriture lui descendaient coup sur coup dans
l'estomac, gonflant sa gorge en passant. Parfois, il
s'interrompait, prêt à crever à la façon d'un tuyau trop
plein. Il prenait à la cruche au cidre et se déblayait
[15] l'oesophage comme on lave un conduit bouché.
Il vida toutes les assiettes, tous les plats et toutes les
bouteilles; puis, saoul de liquide et de mangeaille, abruti,
rouge, secoué par des hoquets, l'esprit troublé et la bouche
grasse, il déboutonna son uniforme pour souffler, incapable
[20] d'ailleurs de faire un pas. Ses yeux se fermaient, ses
idées s'engourdissaient; il posa son front pesant dans ses
bras croisés sur la table, et il perdit doucement la notion
des choses et des faits.
Le dernier croissant éclairait vaguement l'horizon au-dessus
[25] des arbres du parc. C'était l'heure froide qui
précède le jour.
Des ombres glissaient dans les fourrés, nombreuses et
muettes; et parfois, un rayon de lune faisait reluire dans
l'ombre une pointe d'acier.
[30] Le château tranquille dressait sa grande silhouette noire.
Deux fenêtres seules brillaient encore au rez-de-chaussée.
Soudain, une voix tonnante hurla:
--En avant! nom d'un nom! à l'assaut! mes enfants!
Alors, en un instant, les portes, les contrevents et les
vitres s'enfoncèrent sous un flot d'hommes qui s'élança,
[5] brisa, creva tout, envahit la maison. En un instant cinquante
soldats armés jusqu'aux cheveux, bondirent dans
la cuisine où reposait pacifiquement Walter Schnaffs, et,
lui posant sur la poitrine cinquante fusils chargés, le culbutèrent,
le roulèrent, le saisirent, le lièrent des pieds à la
[10] tête.
Il haletait d'ahurissement, trop abruti pour comprendre,
battu, crossé et fou de peur.
Et tout d'un coup, un gros militaire chamarré d'or lui
planta son pied sur le ventre en vociférant:
[15]--Vous êtes mon prisonnier, rendez-vous!
Le Prussien n'entendit que ce seul mot «prisonnier,» et
il gémit: «ya, ya, ya.» Il fut relevé, ficelé sur une chaise, et examiné avec une vive curiosité par ses vainqueurs qui soufflaient comme des [20] baleines. Plusieurs s'assirent, n'en pouvant plus d'émotion et de fatigue. Il souriait, lui, il souriait maintenant, sûr d'être enfin prisonnier! Un autre officier entra et prononça: [25]--Mon colonel, les ennemis se sont enfuis; plusieurs semblent avoir été blessés. Nous restons maîtres de la place. Le gros militaire qui s'essuyait le front vociféra: «Victoire!» Et il écrivit sur un petit agenda de commerce tiré de sa [30] poche: «Après une lutte acharnée, les Prussiens ont dû battre
en retraite, emportant leurs morts et leurs blessés, qu'on
évalue à cinquante hommes hors»
Le jeune officier reprit:
[5]--Quelles dispositions dois-je prendre, mon colonel?
Le colonel répondit:
--Nous allons nous replier pour éviter un retour offensif
avec de l'artillerie et des forces supérieures.
Et il donna l'ordre de repartir.
[10] La colonne se reforma dans l'ombre, sous les murs du
château, et se mit en mouvement, enveloppant de partout
Walter Schnaffs garrotté, tenu par six guerriers le revolver
au poing.
Des reconnaissances furent envoyées pour éclairer la
[15] route. On avançait avec prudence, faisant halte de temps
en temps.
Au jour levant, on arrivait à la sous-préfecture de la
Roche-Oysel, dont la garde nationale avait accompli ce
fait d'armes.
[20] La population anxieuse et surexcitée attendait. Quand
on aperçut le casque du prisonnier, des clameurs formidables
éclatèrent. Les femmes levaient les bras; des vieilles
pleuraient; un aïeul lança sa béquille au Prussien et blessa
le nez d'un de ses gardiens.
[25] Le colonel hurlait.
--Veillez à la sûreté du captif.
On parvint enfin à la maison de ville. La prison fut
ouverte, et Walter Schnaffs jeté dedans, libre de liens.
Deux cents hommes en armes montèrent la garde autour
[30] du bâtiment.
Alors, malgré des symptômes d'indigestion qui le tourmentaient
depuis quelque temps, le Prussien, fou de joie,
se mit à danser, à danser éperdument, en levant les bras et
les jambes, à danser en poussant des cris frénétiques,
jusqu'au moment où il tomba, épuisé au pied d'un mur.
Il était prisonnier! Sauvé!
[5] C'est ainsi que le château de Champignet fut repris à
l'ennemi après six heures seulement d'occupation.
Le colonel Ratier, marchand de drap, qui enleva cette
affaire à la tête des gardes nationaux de la Roche-Oysel,
fut décoré.
TOMBOUCTOU
Le boulevard, ce fleuve de vie, grouillait dans la poudre
d'or du soleil couchant. Tout le ciel était rouge, aveuglant;
et, derrière la Madeleine, une immense nuée
flamboyante jetait dans toute la longue avenue une
[5] oblique averse de feu, vibrante comme une vapeur de
brasier.
La foule gaie, palpitante, allait sous cette brume enflammée
et semblait dans une apothéose. Les visages
étaient dorés; les chapeaux noirs et les habits avaient des
[10] reflets de pourpre; le vernis des chaussures jetait des
flammes sur l'asphalte des trottoirs.
Devant les cafés, un peuple d'hommes buvait les boissons
brillantes et colorées qu'on aurait prises pour des pierres
précieuses fondues dans le cristal.
[15] Au milieu des consommateurs aux légers vêtements plus
foncés, deux officiers en grande tenue faisaient baisser
tous les yeux par l'éblouissement de leurs dorures. Ils
causaient, joyeux sans motif, dans cette gloire de vie, dans
ce rayonnement radieux du soir; et ils regardaient la foule,
[20] les hommes lents et les femmes pressées qui laissaient
derrière elles une odeur savoureuse et troublante.
Tout à coup un nègre énorme, vêtu de noir, ventru,
chamarré de breloques sur un gilet de coutil, la face luisante
comme si elle eût été cirée, passa devant eux avec
[25] un air de triomphe. Il riait aux passants, il riait aux
vendeurs de journaux, il riait au ciel éclatant, il riait à Paris
entier. Il était si grand qu'il dépassait toutes les têtes;
et, derrière lui, tous les badauds se retournaient pour le
contempler de dos.
Mais soudain il aperçut les officiers, et, culbutant les
[5] buveurs, il s'élança. Dès qu'il fut devant leur table, il
planta sur eux ses yeux luisants et ravis, et les coins de sa
bouche lui montèrent jusqu'aux oreilles, découvrant ses
dents blanches, claires comme un croissant de lune dans
un ciel noir. Les deux hommes, stupéfaits, contemplaient
[10] ce géant d'ébène, sans rien comprendre à sa gaieté.
Et il s'écria, d'une voix qui fit rire toutes les tables:
--Bonjou, mon lieutenant.
Un des officiers était chef de bataillon, l'autre colonel.
Le premier dit:
[15]--Je ne vous connais pas, monsieur; j'ignore ce que
vous voulez.
Le nègre reprit:
--Moi aimé beaucoup toi, lieutenant Védié, siège Bézi,
beaucoup raisin, cherché moi.
[20] L'officier, tout à fait éperdu, regardait fixement l'homme,
cherchant au fond de ses souvenirs; mais brusquement il
s'écria:
--Tombouctou?
Le nègre, radieux, tapa sur sa cuisse en poussant un
[25] rire d'une invraisemblable violence et beuglant:
--Si, si, ya, mon lieutenant, reconné Tombouctou. ya,
bonjou.
Le commandant lui tendit la main en riant lui-même de
tout son coeur. Alors Tombouctou redevint grave. Il
[30] saisit la main de l'officier, et, si vite que l'autre ne put
l'empêcher, il la baisa, selon la coutume nègre et arabe.
Confus, le militaire lui dit d'une voix sévère:
--Allons, Tombouctou, nous ne sommes pas en Afrique.
Assieds-toi là et dis-moi comment je te trouve ici.
Tombouctou tendit son ventre, et, bredouillant, tant
il parlait vite:
[5]--Gagné beaucoup d'agent, beaucoup, grand'estaurant,
bon mangé, Prussiens, moi, beaucoup volé, beaucoup,
cuisine française, Tombouctou, cuisinié de l'Empéeu, deux
cent mille francs à moi. Ah! ah! ah! ah!
Et il riait, tordu, hurlant avec une folie de joie dans le
[10] regard.
Quand l'officier, qui comprenait son étrange langage,
l'eut interrogé quelque temps, il lui dit:
--Eh bien, au revoir, Tombouctou; à bientôt.
Le nègre aussitôt se leva, serra, cette fois, la main qu'on
[15] lui tendait, et riant toujours, cria:
--Bonjou, bonjou, mon lieutenant!
Il s'en alla, si content, qu'il gesticulait en marchant, et
qu'on le prenait pour un fou.
Le colonel demanda:
[20]--Qu'est-ce que cette brute?
--Un brave garçon et un brave soldat. Je vais vous
dire ce que je sais de lui; c'est assez drôle.
Vous savez qu'au commencement de la guerre de 1870
je fus enfermé dans Bézières, que ce nègre appelle Bézi.
[25] Nous n'étions point assiégés, mais bloqués. Les lignes
prussiennes nous entouraient de partout, hors de portée des
canons, ne tirant pas non plus sur nous, mais nous affamant
peu à peu.
J'étais alors lieutenant. Notre garnison se trouvait
composée de troupes de toute nature, débris de régiments
écharpés, fuyards, maraudeurs, séparés des corps d'armée.
Nous avions de tout enfin, même onze turcos arrivés un
soir on ne sait comment, on ne sait par où. Ils s'étaient
[5] présentés aux portes de la ville, harassés, déguenillés,
affamés et saouls. On me les donna.
Je reconnus bientôt qu'ils étaient rebelles à toute discipline,
toujours dehors et toujours gris. J'essayai de la
salle de police, même de la prison, rien n'y fit. Mes
[10] hommes disparaissaient des jours entiers, comme s'ils se
fussent enfoncés sous terre, puis reparaissaient ivres à
tomber. Ils n'avaient pas d'argent. Où buvaient-ils?
Et comment, et avec quoi?
Cela commençait à m'intriguer vivement, d'autant plus
[15] que ces sauvages m'intéressaient avec leur rire éternel et
leur caractère de grands enfants espiègles.
Je m'aperçus alors qu'ils obéissaient aveuglément au
plus grand d'eux tous, celui que vous venez de voir. Il
les gouvernait à son gré, préparait leurs mystérieuses
[20] entreprises en chef tout-puissant et incontesté. Je le fis
venir chez moi et je l'interrogeai. Notre conversation dura
bien trois heures, tant j'avais de peine à pénétrer son surprenant
charabia. Quant à lui, le pauvre diable, il faisait
des efforts inouïs pour être compris, inventait des mots,
[25] gesticulait, suait de peine, s'essuyait le front, soufflait,
s'arrêtait et repartait brusquement, quand il croyait avoir
trouvé un nouveau moyen de s'expliquer.
Je devinai enfin qu'il était fils d'un grand chef, d'une
sorte de roi nègre des environs de Tombouctou. Je lui
[30] demandai son nom. Il répondit quelque chose comme
Chavaharibouhalikhranafotapolara. Il me parut plus
simple de lui donner le nom de son pays: «Tombouctou.»
Et, huit jours plus tard, toute la garnison ne le nommait
plus autrement.
Mais une envie folle nous tenait de savoir où cet ex-prince
africain trouvait à boire. Je le découvris d'une
[5] singulière façon.
J'étais un matin sur les remparts, étudiant l'horizon,
quand j'aperçus dans une vigne quelque chose qui remuait.
On arrivait au temps des vendanges, les raisins
étaient mûrs, mais je ne songeais guère à cela. Je pensai
[10] qu'un espion s'approchait de la ville, et j'organisai une
expédition complète pour saisir le rôdeur. Je pris moi-même
le commandement, après avoir obtenu l'autorisation
du général.
J'avais fait sortir, par trois portes différentes, trois
[15] petites troupes qui devaient se rejoindre auprès de la vigne
suspecte et la cerner. Pour couper la retraite à l'espion,
un de ces détachements avait à taire une marche d'une
heure au moins. Un homme resté en observation sur les
murs m'indiqua par signe que l'être aperçu n'avait point
[20] quitté le champ. Nous allions en grand silence, rampant,
presque couchés dans les ornières. Enfin, nous touchons
au point désigné; je déploie brusquement mes soldats, qui
s'élancent dans la vigne, et trouvent.... Tombouctou
voyageant à quatre pattes au milieu des ceps et mangeant
[25] du raisin, ou plutôt happant du raisin comme un chien
qui mange sa soupe, à pleine bouche, à la plante même,
en arrachant la grappe d'un coup de dent.
Je voulus le faire relever; il n'y fallait pas songer, et je
compris alors pourquoi il se traînait ainsi sur les mains
[30] et sur les genoux. Dès qu'on l'eut planté sur ses jambes
il oscilla quelques secondes, tendit les bras et s'abattit
sur le nez. Il était gris comme je n'ai jamais vu un
homme être gris.
On le rapporta sur deux échalas, il ne cessa de rire
tout le long de la route en gesticulant des bras et des
jambes.
C'était là tout le mystère. Mes gaillards buvaient au
[5] raisin lui-même. Puis, lorsqu'ils étaient saouls à ne plus
bouger, ils dormaient sur place.
Quant à Tombouctou, son amour de la vigne passait
toute croyance et toute mesure. Il vivait là-dedans à la
façon des grives, qu'il haïssait d'ailleurs d'une haine de
[10] rival jaloux. Il répétait sans cesse:
--Les gives mangé tout le raisin, capules!
Un soir on vint me chercher. On apercevait par la
plaine quelque chose arrivant vers nous. Je n'avais point
pris ma lunette, et je distinguais fort mal. On eût dit un
[15] grand serpent qui se déroulait, un convoi, que sais-je?
J'envoyai quelques hommes au-devant de cette étrange
caravane qui fit bientôt son entrée triomphale. Tombouctou
et neuf de ses compagnons portaient sur une sorte
d'autel, fait avec des chaises de campagne, huit têtes
[20] coupées, sanglantes et grimaçantes. Le dixième turco
traînait un cheval à la queue duquel un autre était attaché,
et six autres bêtes suivaient encore, retenues de la même
façon.
Voici ce que j'appris. Étant partis aux vignes, mes
[25] Africains avaient aperçu tout à coup un détachement
prussien s'approchant d'un village. Au lieu de fuir, ils
s'étaient cachés; puis, lorsque les officiers eurent mis pied
à terre devant une auberge pour se rafraîchir, les onze
gaillards s'élancèrent, mirent en fuite les uhlans qui se
[30] crurent attaqués, tuèrent les deux sentinelles, plus le
colonel et les cinq officiers de son escorte.
Ce jour-là, j'embrassai Tombouctou. Mais je m'aperçus
qu'il marchait avec peine. Je le crus blessé; il se mit à
rire et me dit:
--Moi, povisions pou pays.
C'est que Tombouctou ne faisait point la guerre pour
[5] l'honneur, mais bien pour le gain. Tout ce qu'il trouvait,
tout ce qui lui paraissait avoir une valeur quelconque,
tout ce qui brillait surtout, il le plongeait dans sa poche!
Quelle poche! un gouffre qui commençait à la hanche et
finissait aux chevilles. Ayant retenu un terme de troupier,
[10] il l'appelait sa «profonde,» et c'était sa profonde, en effet!
Donc il avait détaché l'or des uniformes prussiens, le
cuivre des casques, les boutons, etc., et jeté le tout dans
sa «profonde» qui était pleine à déborder.
Chaque jour, il précipitait là-dedans tout objet luisant
[15] qui lui tombait sous les yeux, morceaux d'étain ou pièces
d'argent, ce qui lui donnait parfois une tournure infiniment
drôle.
Il comptait remporter cela au pays des autruches, dont
il semblait bien frère, ce fils de roi, torturé par le besoin
[20] d'engloutir les corps brillants. S'il n'avait pas eu sa
profonde, qu'aurait-il fait? Il les aurait sans doute
avalés.
Chaque matin sa poche était vide. Il avait donc un
magasin général où s'entassaient ses richesses. Mais où?
[25] Je ne l'ai pu découvrir.
Le général, prévenu du haut fait de Tombouctou, fit
bien vite enterrer les corps demeurés au village voisin,
pour qu'on ne découvrit point qu'ils avaient été décapités.
Les Prussiens y revinrent le lendemain. Le maire et sept
[30] habitants notables furent fusillés sur-le-champ, par
représailles, comme ayant dénoncé la présence des Allemands.
L'hiver était venu. Nous étions harassés et désespérés.
On se battait maintenant tous les jours. Les hommes
affamés ne marchaient plus. Seuls les huit turcos (trois
avaient été tués) demeuraient gras et luisants, et vigoureux,
[5] toujours prêts à se battre. Tombouctou engraissait
même. Il me dit un jour:
--Toi beaucoup faim, moi bon viande.
Et il m'apporta en effet un excellent filet. Mais de
quoi? Nous n'avions plus ni boeufs, ni moutons, ni chèvres,
[10] ni ânes, ni porcs. Il était impossible de se procurer
du cheval. Je réfléchis à tout cela après avoir dévoré
ma viande. Alors une pensée horrible me vint. Ces
nègres étaient nés bien près du pays où l'on mange des
hommes! Et chaque jour tant de soldats tombaient
[15] autour de la ville! J'interrogeai Tombouctou. Il ne voulut
pas répondre. Je n'insistai point, mais je refusai désormais
ses présents.
Il m'adorait. Une nuit, la neige nous surprit aux
avant-postes. Nous étions assis par terre. Je regardais
[20] avec pitié les pauvres nègres grelottant sous cette
poussière blanche et glacée. Comme j'avais grand froid, je
me mis à tousser. Je sentis aussitôt quelque chose s'abattre
sur moi, comme une grande et chaude couverture.
C'était le manteau de Tombouctou qu'il me jetait sur les
[25] épaules.
Je me levai et, lui rendant son vêtement:
--Garde ça, mon garçon; tu en as plus besoin que moi.
Il répondit:
--Non, mon lieutenant, pou toi, moi pas besoin, moi
[30] chaud, chaud.
Et il me contemplait avec des yeux suppliants.
Je repris:
--Allons, obéis, garde ton manteau, je le veux.
Le nègre alors se leva, tira son sabre qu'il savait rendre
coupant comme une faulx, et tenant de l'autre main sa
large capote que je refusais:
[5]--Si toi pas gadé manteau, moi coupé; pésonne
manteau.
Il l'aurait fait. Je cédai.
Huit jours plus tard, nous avions capitulé. Quelques-uns
d'entre nous avaient pu s'enfuir. Les autres allaient
[10] sortir de la ville et se rendre aux vainqueurs.
Je me dirigeais vers la place d'Armes où nous devions
nous réunir quand je demeurai stupide d'étonnement devant
un nègre géant vêtu de coutil blanc et coiffé d'un
chapeau de paille. C'était Tombouctou. Il semblait
[15] radieux et se promenait, les mains dans ses poches, devant
une petite boutique où l'on voyait en montre deux
assiettes et deux verres.
Je lui dis:
--Qu'est-ce que tu fais?
[20] Il répondit:
--Moi pas pati, moi bon cuisiné, moi fait mangé colonel,
Algéie; moi mangé Pussiens, beaucoup volé, beaucoup.
Il gelait à dix degrés. Je grelottais devant ce nègre en
coutil. Alors il me prit par le bras et me fit entrer.
[25] J'aperçus une enseigne démesurée qu'il allait pendre devant
sa porte sitôt que nous serions partis, car il avait quelque
pudeur.
Et je lus, tracé par la main de quelque complice, cet
appel:
CUISINE MILITAIRE DE M. TOMBOUCTOU
ANCIEN CUISINER DE S. M. L'EMPEREUR.
Artiste de Paris.--Prix modérés. Malgré le désespoir qui me rongeait le coeur, je ne pus [5]m'empêcher de rire, et je laissai mon nègre à son nouveau commerce. Cela ne valait-il pas mieux que de le faire emmener prisonnier? Vous venez de voir qu'il a réussi, le gaillard. [10] Bézières, aujourd'hui, appartient à l'Allemagne. Le restaurant Tombouctou est un commencement de Revanche.
EN MER
A Henry Céard
On lisait dernièrement dans les journaux les lignes
suivantes:
Boulogne-sur-Mer, 22 janvier.--On nous écrit:
«Un affreux malheur vient de jeter la consternation
[5] parmi notre population maritime déjà si éprouvée depuis
deux années. Le bateau de pêche commandé par le
patron Javel, entrant dans le port, a été jeté à l'Ouest et
est venu se briser sur les roches du brise-lames de la jetée.
«Malgré les efforts du bateau de sauvetage et des lignes
[10] envoyées au moyen du fusil porte-amarre, quatre hommes
et le mousse ont péri.
«Le mauvais temps continue. On craint de nouveaux
sinistres.»
Quel est ce patron Javel? Est-il le frère du manchot?
[15] Si le pauvre homme roulé par la vague, et mort peut-être
sous les débris de son bateau mis en pièces, est celui
auquel je pense, il avait assisté, voici dix-huit ans maintenant,
à un autre drame, terrible et simple comme sont
toujours ces drames formidables des flots.
[20] Javel aîné était alors patron d'un chalutier.
Le chalutier est le bateau de pêche par excellence.
Solide à ne craindre aucun temps, le ventre rond, roulé
sans cesse par les lames comme un bouchon, toujours dehors,
toujours fouetté par les vents durs et salés de la
[25] Manche, il travaille la mer, infatigable, la voile gonflée,
traînant par le flanc un grand filet qui racle le fond de
l'Océan, et détache et cueille toutes les bêtes endormies
dans les roches, les poissons plats collés au sable, les crabes
lourds aux pattes crochues, les homards aux moustaches
[5] pointues.
Quand la brise est fraîche et la vague courte, le bateau
se met à pêcher. Son filet est fixé tout le long d'une grande
tige de bois garnie de fer qu'il laisse descendre au moyen
de deux câbles glissant sur deux rouleaux aux deux bouts
[10] de l'embarcation. Et le bateau, dérivant sous le vent et
le courant, tire avec lui cet appareil qui ravage et dévaste
le sol de la mer.
Javel avait à son bord son frère cadet, quatre hommes
et un mousse. Il était sorti de Boulogne par un beau
[15] temps clair pour jeter le chalut.
Or, bientôt le vent s'éleva, et une bourrasque survenant
força le chalutier à fuir. Il gagna les côtes d'Angleterre;
mais la mer démontée battait les falaises, se ruait
contre la terre, rendait impossible l'entrée des ports. Le
[20] petit bateau reprit le large et revint sur les côtes de France.
La tempête continuait à faire infranchissables les jetées,
enveloppant d'écume, de bruit et de danger tous les abords
des refuges.
Le chalutier repartit encore, courant sur le dos des flots,
[25] ballotté, secoué, ruisselant, souffleté par des paquets d'eau,
mais gaillard, malgré tout, accoutumé à ces gros temps qui
le tenaient parfois cinq ou six jours errant entre les deux
pays voisins sans pouvoir aborder l'un ou l'autre.
Puis enfin l'ouragan se calma comme il se trouvait en
[30] pleine mer, et, bien que la vague fût encore forte, le
patron commanda de jeter le chalut.
Donc le grand engin de pêche fut passé par-dessus bord,
et deux hommes à l'avant, deux hommes à l'arrière, commencèrent
à filer sur les rouleaux les amarres qui le tenaient.
Soudain il toucha le fond, mais une haute lame
inclinant le bateau, Javel cadet, qui se trouvait à l'avant
[5] et dirigeait la descente du filet, chancela, et son bras se
trouva saisi entre la corde un instant détendue par la
secousse et le bois où elle glissait. Il fit un effort désespéré,
tâchant de l'autre main de soulever l'amarre, mais
le chalut traînait déjà et le câble roidi ne céda point.
[10] L'homme crispé par la douleur appela. Tous accoururent.
Son frère quitta la barre. Ils se jetèrent sur la corde,
s'efforçant de dégager le membre qu'elle broyait. Ce
fut en vain. «Faut couper», dit un matelot, et il tira de
sa poche un large couteau, qui pouvait, en deux coups,
[15] sauver le bras de Javel cadet.
Mais couper, c'était perdre le chalut, et ce chalut valait
de l'argent, beaucoup d'argent, quinze cents francs; et il
appartenait à Javel aîné, qui tenait à son avoir.
Il cria, le coeur torturé: «Non, coupe pas, attends, je
[20] vas lofer.» Et il courut au gouvernail, mettant toute la
barre dessous.
Le bateau n'obéit qu'à peine, paralysé par ce filet qui
immobilisait son impulsion, et entraîné d'ailleurs par la
force de la dérive et du vent.
[25] Javel cadet s'était laissé tomber sur les genoux, les
dents serrées, les yeux hagards. Il ne disait rien. Son
frère revint, craignant toujours le couteau d'un marin:
«Attends, attends, coupe pas, faut mouiller l'ancre.»
L'ancre fut mouillée, toute la chaine filée, puis on se
[30] mit à virer au cabestan pour détendre les amarres du
chalut. Elles s'amollirent, enfin, et on dégagea le bras
inerte, sous la manche de laine ensanglantée.
Javel cadet semblait idiot. On lui retira la vareuse et
on vit une chose horrible, une bouillie de chair dont le
sang jaillissait à flots qu'on eût dit poussés par une pompe.
Alors l'homme regarda son bras et murmura: «Foutu.»
[5]Puis, comme l'hémorragie faisait une mare sur le pont
du bateau, un des matelots cria: «Il va se vider, faut
nouer la veine.»
Alors ils prirent une ficelle, une grosse ficelle brune et
goudronnée, et, enlaçant le membre au-dessus de la
[10] blessure, ils serrèrent de toute leur force. Les jets de sang
s'arrêtaient peu à peu; et finirent par cesser tout à fait.
Javel cadet se leva, son bras pendait à son côté. Il le
prit de l'autre main, le souleva, le tourna, le secoua. Tout
était rompu, les os cassés; les muscles seuls retenaient ce
[15] morceau de son corps. Il le considérait d'un oeil morne,
réfléchissant.. Puis il s'assit sur une voile pliée, et les
camarades lui conseillèrent de mouiller sans cesse la blessure
pour empêcher le mal noir.
On mit un seau auprès de lui, et, de minute en minute, il
[20] puisait dedans au moyen d'un verre, et baignait l'horrible
plaie en laissant couler dessus un petit filet d'eau claire.
--Tu serais mieux en bas, lui dit son frère. Il descendit,
mais au bout d'une heure il remonta, ne se sentant
pas bien tout seul. Et puis, il préférait le grand air. Il
[25] se rassit sur sa voile et recommença à bassiner son bras.
La pêche était bonne. Les larges poissons à ventre
blanc gisaient à côté de lui, secoués par des spasmes de
mort; il les regardait sans cesser d'arroser ses chairs
écrasées.
[30] Comme on allait regagner Boulogne, un nouveau coup
de vent se déchaîna; et le petit bateau recommença sa
course folle, bondissant et culbutant, secouant le triste
blessé.
La nuit vint. Le temps fut gros jusqu'à l'aurore. Au
soleil levant on apercevait de nouveau l'Angleterre, mais,
[5] comme la mer était moins dure, on repartit pour la France
en louvoyant.
Vers le soir, Javel cadet appela ses camarades et leur
montra des traces noires, toute une vilaine apparence de
pourriture sur la partie du membre qui ne tenait plus à
[10] lui.
Les matelots regardaient, disant leur avis.
--Ça pourrait bien être le Noir, pensait l'un.
--Faudrait de l'eau salée là-dessus, déclarait un autre.
On apporta donc de l'eau salée et on en versa sur le
[15] mal. Le blessé devint livide, grinça des dents, se tordit
un peu; mais il ne cria pas.
Puis, quand la brûlure se fut calmée: «Donne-moi ton
couteau», dit-il à son frère. Le frère tendit son couteau.
--«Tiens-moi le bras en l'air, tout drait, tire dessus.»
[20] On fit ce qu'il demandait.
Alors il se mit à couper lui-même. Il coupait doucement,
avec réflexion, tranchant les derniers tendons avec cette
lame aiguë, comme un fil de rasoir; et bientôt il n'eut plus
qu'un moignon. Il poussa un profond soupir et déclara:
[25] «Fallait ça. J'étais foutu.»
Il semblait soulagé et respirait avec force. Il recommença
à verser de l'eau sur le tronçon de membre qui lui
restait.
La nuit fut mauvaise encore et on ne put atterrir.
[30] Quand le jour parut, Javel cadet prit son bras détaché
et l'examina longuement. La putréfaction se déclarait.
Les camarades vinrent aussi l'examiner, et ils se le
passaient de main en main, le tâtaient, le retournaient, le
flairaient.
Son frère dit: «Faut jeter ça à la mer à c't'-heure.»
Mais Javel cadet se fâcha: «Ah! mais non, ah! mais non.
[5] J'veux point. C'est à moi, pas vrai, puisque c'est mon
bras.»
Il le reprit et le posa entre ses jambes.
--Il va pas moins pourrir, dit l'aîné. Alors une idée
vint au blessé. Pour conserver le poisson quand on tenait
[10] longtemps la mer, on l'empilait en des barils de sel.
Il demanda: «J'pourrions t'y point l'mettre dans la
saumure?»
--Ça, c'est vrai, déclarèrent les autres.
Alors on vida un des barils, plein déjà de la pêche des
[15] jours derniers; et, tout au fond, on déposa le bras. On
versa du sel dessus, puis on replaça, un à un, les poissons.
Un des matelots fit cette plaisanterie: «Pourvu que je
l'vendions point à la criée.»
Et tout le monde rit, hormis les deux Javel.
[20] Le vent soufflait toujours. On louvoya encore en vue
de Boulogne jusqu'au lendemain dix heures. Le blessé
continuait sans cesse à jeter de l'eau sur sa plaie.
De temps en temps il se levait et marchait d'un bout à
l'autre du bateau.
[25] Son frère, qui tenait la barre, le suivait de l'oeil en
hochant la tête.
On finit par rentrer au port.
Le médecin examina la blessure et la déclara en bonne
voie. Il fit un pansement complet et ordonna le repos.
[30] Mais Javel ne voulut pas se coucher sans avoir repris son
bras, et il retourna bien vite au port pour retrouver le
baril qu'il avait marqué d'une croix.
On le vida devant lui et il ressaisit son membre, bien
conservé dans la saumure, ridé, rafraîchi. Il l'enveloppa
dans une serviette emportée à cette intention et rentra
chez lui.
[5] Sa femme et ses enfants examinèrent longuement ce
débris du père, tâtant les doigts, enlevant les brins de sel
restés sous les ongles; puis on fit venir le menuisier pour
un petit cercueil.
Le lendemain l'équipage complet du chalutier suivit
[10] l'enterrement du bras détaché. Les deux frères, côte à
côte, conduisaient le deuil. Le sacristain de paroisse
tenait son cadavre sous son aisselle.
Javel cadet cessa de naviguer. Il obtint un petit
emploi dans le port, et, quand il parlait plus tard de son
[15] accident, il confiait tout bas à son auditeur: «Si le frère
avait voulu couper le chalut, j'aurais encore mon bras,
pour sûr. Mais il était regardant à son bien.»
LES PRISONNIERS
Aucun bruit dans la forêt que le frémissement léger de
la neige tombant sur les arbres. Elle tombait depuis midi,
une petite neige fine qui poudrait les branches d'une
mousse glacée qui jetait sur les feuilles mortes des fourrés
[5] un léger toit d'argent, étendait par les chemins un immense
tapis moelleux et blanc, et qui épaississait le silence illimité
de cet océan d'arbres.
Devant la porte de la maison forestière, une jeune
femme, les bras nus, cassait du bois à coups de hache sur
[10] une pierre. Elle était grande, mince et forte, une fille des
forêts, fille et femme de forestiers.
Une voix cria de l'intérieur de la maison:
--Nous sommes seules, ce soir, Berthine, faut rentrer,
v'là la nuit, y a p't-être bien des Prussiens et des loups qui
[15] rôdent.
La bûcheronne répondit en fendant une souche à grands
coups qui redressaient sa poitrine à chaque mouvement
pour lever les bras.
--J'ai fini, m'man. Me v'là, me v'là, y a pas de crainte;
[20] il fait encore jour.
Puis elle rapporta ses fagots et ses bûches et les entassa
le long de la cheminée, ressortit pour fermer les auvents,
d'énormes auvents en coeur de chêne, et rentrée enfin, elle
poussa les lourds verrous de la porte.
[25] Sa mère filait auprès du feu, une vieille ridée que l'âge
avait rendue craintive:
--J'aime pas, dit-elle, quand le père est dehors. Deux
femmes ça n'est pas fort.
La jeune répondit:
--Oh! je tuerais ben un loup ou un Prussien tout de
même.
Et elle montrait de l'oeil un gros revolver suspendu
[5] au-dessus de l'âtre.
Son homme avait été incorporé dans l'armée au commencement
de l'invasion prussienne; et les deux femmes
étaient demeurées seules avec le père, le vieux garde
Nicolas Pichon, dit l'Échasse, qui avait refusé obstinément
[10] de quitter sa demeure pour rentrer à la ville.
La ville prochaine, c'était Rethel, ancienne place forte
perchée sur un rocher. On y était patriote, et les bourgeois
avaient décidé de résister aux envahisseurs, de s'enfermer
chez eux et de soutenir un siège selon la tradition de la
[15] cité. Deux fois déjà, sous Henri IV et Louis XIV, les
habitants de Rethel s'étaient illustrés par des défenses
héroïques. Ils en feraient autant cette fois, ventrebleu!
ou bien on les brûlerait dans leurs murs.
Donc, ils avaient acheté des canons et des fusils, équipé
[20] une milice, formé des bataillons et des compagnies, et ils
s'exerçaient tout le jour sur la place d'Armes. Tous,
boulangers, épiciers, bouchers, notaires, avoués, menuisiers,
libraires, pharmaciens eux-mêmes manoeuvraient à
tour de rôle, à des heures régulières, sous les ordres de M.
[25] Lavigne, ancien sous-officier de dragons, aujourd'hui
mercier, ayant épousé la fille et hérité de la boutique de M.
Ravaudan, l'aîné.
Il avait pris le grade de commandant-major de la place,
et tous les jeunes hommes étant partis à l'armée, il avait
[30] enrégimenté tous les autres qui s'entraînaient pour la
résistance. Les gros n'allaient plus par les rues qu'au pas
gymnastique pour fondre leur graisse et prolonger leur
haleine, les faibles portaient des fardeaux pour fortifier
leurs muscles.
Et on attendait les Prussiens. Mais les Prussiens ne
paraissaient pas. Ils n'étaient pas loin, cependant; car
[5] deux fois déjà leurs éclaireurs avaient poussé à travers
bois jusqu'à la maison forestière de Nicolas Pichon,
dit l'Échasse.
Le vieux garde, qui courait comme un renard, était venu
prévenir la ville. On avait pointé les canons, mais
[10] l'ennemi ne s'était point montré.
Le logis de l'Échasse servait de poste avancé dans la
forêt d'Aveline. L'homme, deux fois par semaine, allait
aux provisions et apportait aux bourgeois citadins des
nouvelles de la campagne.
[15] Il était parti ce jour-là pour annoncer qu'un petit
détachement d'infanterie allemande s'était arrêté chez lui
l'avant-veille, vers deux heures de l'après-midi, puis était
reparti presque aussitôt. Le sous-officier qui commandait
parlait français.
[20] Quand il s'en allait ainsi, le vieux, il emmenait ses deux
chiens, deux molosses à gueule de lion, par crainte des
loups qui commençaient à devenir féroces, et il laissait
ses deux femmes en leur recommandant de se barricader
dans la maison dès que la nuit approcherait.
[25] La jeune n'avait peur de rien, mais la vieille tremblait
toujours et répétait:
--Ça finira mal, tout ça, vous verrez que ça finira mal.
Ce soir-là, elle était encore plus inquiète que de coutume:
--Sais-tu à quelle heure rentrera le père? dit-elle.
[30]--Oh! pas avant onze heures, pour sûr. Quand il dîne
chez le commandant, il rentre toujours tard.
Et elle accrochait sa marmite sur le feu pour faire la
soupe, quand elle cessa de remuer, écoutant un bruit vague
qui lui était venu par le tuyau de la cheminée.
Elle murmura:
[5]--V'là qu'on marche dans le bois, il y a ben sept-huit
hommes, au moins.
La mère, effarée, arrêta son rouet en balbutiant:
--Oh! mon Dieu! et le père qu'est pas là!
Elle n'avait point fini de parler que des coups violents
[10] firent trembler la porte.
Comme les femmes ne répondaient point, une voix forte
et gutturale cria:
--Oufrez!
Puis, après un silence, la même voix reprit:
[15]--Oufrez ou che gasse la borte!
Alors Berthine glissa dans la poche de sa jupe le gros
revolver de la cheminée, puis, étant venue coller son
oreille contre l'huis, elle demanda:
--Qui êtes-vous?
[20] La voix répondit:
--Che suis le tétachement de l'autre chour.
La jeune femme reprit:
--Qu'est-ce que vous voulez?
--Che suis berdu tepuis ce matin, tans le pois, avec mon
[25] tétachement. Oufrez ou che gasse la borte.
La forestière n'avait pas le choix; elle fit glisser vivement
le gros verrou, puis tirant le lourd battant, elle
aperçut dans l'ombre pâle des neiges, six hommes, six
soldats prussiens, les mêmes qui étaient venus la veille.
[30] Elle prononça d'un ton résolu:
--Qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci?
Le sous-officier répéta:
--Che suis berdu, tout à fait berdu, ché regonnu la
maison. Che n'ai rien manché tepuis ce matin, mon
tétachement non blus.
Berthine déclara:
[5]--C'est que je suis toute seule avec maman, ce soir.
Le soldat, qui paraissait un brave homme, répondit:
--Ça ne fait rien. Che ne ferai bas de mal, mais fous
nous ferez à mancher. Nous dombons te faim et te
fatigue.
[10] La forestière se recula:
--Entrez, dit-elle.
Ils entrèrent, poudrés de neige, portant sur leurs casques
une sorte de crème mousseuse qui les faisait ressembler à
des meringues, et ils paraissaient las, exténués.
[15] La jeune femme montra les bancs de bois des deux côtés
de la grande table.
--Asseyez-vous, dit-elle, je vais vous faire de la soupe.
C'est vrai que vous avez l'air rendus.
Puis elle referma les verrous de la porte.
[20] Elle remit de l'eau dans la marmite, y jeta de nouveau
du beurre et des pommes de terre, puis décrochant un
morceau de lard pendu dans la cheminée, elle en coupa
la moitié qu'elle plongea dans le bouillon.
Les six hommes suivaient de l'oeil tous ses mouvements
[25] avec une faim éveillée dans leurs yeux. Ils avaient posé
leurs fusils et leurs casques dans un coin, et ils attendaient,
sages comme des enfants sur les bancs d'une école.
La mère s'était remise à filer en jetant à tout moment
des regards éperdus sur les soldats envahisseurs. On n'entendait
[30] rien autre chose que le ronflement léger du rouet
et le crépitement du feu et le murmure de l'eau qui
S'échauffait.
Mais soudain un bruit étrange les fit tous tressaillir,
quelque chose comme un souffle rauque poussé sous la
porte, un souffle de bête, fort et ronflant.
Le sous-officier allemand avait fait un bond vers les
[5] fusils. La forestière l'arrêta d'un geste, et souriante:
--C'est les loups, dit-elle. Ils sont comme vous, ils
rôdent et ils ont faim.
L'homme incrédule voulut voir, et sitôt que le battant
fut ouvert, il aperçut deux grandes bêtes grises qui
[10] s'enfuyaient d'un trot rapide et allongé.
Il revint s'asseoir, en murmurant:
--Ché n'aurais pas gru:
Et il attendit que sa pâtée fût prête.
Ils la mangèrent voracement, avec des bouches fendues
[15] jusqu'aux oreilles pour en avaler davantage, des yeux
ronds s'ouvrant en même temps que les mâchoires, et des
bruits de gorge pareils à des glouglous de gouttières.
Les deux femmes, muettes, regardaient les rapides
mouvements des grandes barbes rouges; et les pommes de
[20] terre avaient l'air de s'enfoncer dans ces toisons
mouvantes,
Mais comme ils avaient soif, la forestière descendit à la
cave leur tirer du cidre. Elle y resta longtemps; c'était
un petit caveau voûté qui, pendant la révolution, avait
[25] servi de prison et de cachette, disait-on. On y parvenait
au moyen d'un étroit escalier tournant fermé par une
trappe au fond de la cuisine.
Quand Berthine reparut, elle riait, elle riait toute seule,
d'un air sournois. Et elle donna aux Allemands sa cruche
[30] de boisson.
Puis elle soupa aussi, avec sa mère, à l'autre bout de la
Cuisine.
Les soldats avaient fini de manger, et ils s'endormaient
tous les six, autour de la table. De temps en temps un
front tombait sur la planche avec un bruit sourd, puis
l'homme, réveillé brusquement, se redressait.
[5] Berthine dit au sous-officier:
--Couchez-vous devant le feu, pardi, il y a bien d'la
place pour six. Moi je grimpe à ma chambre avec
maman.
Et les deux femmes montèrent au premier étage. On
[10] les entendit fermer leur porte à clef, marcher quelque
temps; puis elles ne firent plus aucun bruit.
Les Prussiens s'étendirent sur le pavé, les pieds au feu,
la tête supportée par leurs manteaux roulés, et ils ronflèrent
bientôt tous les six sur six tons divers, aigus ou
[15] sonores, mais continus et formidables.
Ils dormaient certes depuis longtemps déjà quand un
coup de feu retentit, si fort, qu'on l'aurait cru tiré contre
les murs de la maison. Les soldats se dressèrent aussitôt.
Mais deux nouvelles détonations éclatèrent, suivies de
[20] trois autres encore.
La porte du premier s'ouvrit brusquement, et la forestière
parut, nu-pieds, en chemise, en jupon court, une
chandelle à la main, l'air affolé. Elle balbutia:
--V'là les Français, ils sont au moins deux cents. S'ils
[25] vous trouvent ici, ils vont brûler la maison. Descendez
dans la cave bien vite, et faites pas de bruit. Si vous faites
du bruit, nous sommes perdus.
Le sous-officier, effaré, murmura:
--Che feux pien, che feux pien. Par où faut-il
[30] tescendre?
La jeune femme souleva avec précipitation la trappe
étroite et carrée, et les six hommes disparurent par le petit
escalier tournant, s'enfonçant dans le sol l'un après l'autre,
à reculons, pour bien tâter les marches du pied.
Mais quand la pointe du dernier casque eut disparu,
[5] Berthine rabattant la lourde planche de chêne, épaisse
comme un mur, dure comme de l'acier, maintenue par des
charnières et une serrure de cachôt, donna deux longs
tours de clef, puis elle se mit à rire, d'un rire muet et ravi,
avec une envie folle de danser sur la tête de ses prisonniers.
[10] Ils ne faisaient aucun bruit, enfermés là-dedans comme
dans une boite solide, une boite de pierre, ne recevant
que l'air d'un soupirail garni de barres de fer.
~-Berthine aussitôt ralluma son feu, remit dessus sa
marmite, et refit de la soupe en murmurant:
[15]--Le père s'ra fatigué cette nuit.
Puis elle s'assit et attendit. Seul, le balancier sonore
de l'horloge promenait dans le silence son tic-tac régulier.
De temps en temps la jeune femme jetait un regard sur
le cadran, un regard impatient qui semblait dire:
[20]--Ça ne va pas vite.
Mais bientôt il lui sembla qu'on murmurait sous ses
pieds. Des paroles basses, confuses, lui parvenaient à
travers la voûte maçonnée de la cave. Les Prussiens
commençaient à deviner sa ruse, et bientôt le sous-officier
[25] remonta le petit escalier et vint heurter du poing la
trappe. Il cria de nouveau:
--Oufrez.
Elle se leva, s'approcha et, imitant son accent:
--Qu'est-ce que fous foulez?
[30]--Oufrez.
--Che n'oufre pas.
L'homme se fâchait.
--Oufrez ou che gasse la borte.
Elle se mit à rire:
--Casse, mon bonhomme, casse, mon bonhomme!
Et il commença à frapper avec la crosse de son fusil
[5] contre la trappe de chêne, fermée sur sa tête. Mais elle
aurait résisté à des coups de catapulte.
La forestière l'entendit redescendre. Puis les soldats
vinrent, l'un après l'autre, essayer leur force, et inspecter
la fermeture. Mais, jugeant sans doute leurs tentatives
[10] inutiles, ils redescendirent tous dans la cave et
recommencèrent à parler entre eux.
La jeune femme les écoutait, puis elle alla ouvrir la
porte du dehors et elle tendit l'oreille dans la nuit.
Un aboiement lointain lui parvint. Elle se mit à siffler
[15] comme aurait fait un chasseur, et, presque aussitôt, deux
énormes chiens surgirent dans l'ombre et bondirent sur elle
en gambadant. Elle les saisit par le cou et les maintint
pour les empêcher de courir. Puis elle cria de toute sa force:
--Ohé père!
[20] Une voix répondit, très éloignée encore:
~-Ohé Berthine!
Elle attendit quelques secondes, puis reprit:
--Ohé père!
La voix plus proche répéta:
[25]--Ohé Berthine!
La forestière reprit:
--Passe pas devant le soupirail. Y a des Prussiens
dans la cave.
Et brusquement la grande silhouette de l'homme se
[30] dessina sur la gauche, arrêtée entre deux troncs d'arbres.
Il demanda, inquiet:
--Des Prussiens dans la cave. Qué qui font?