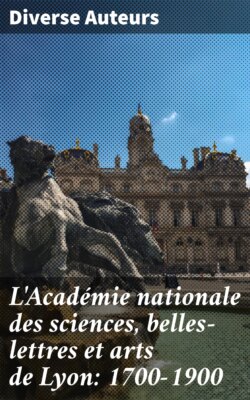Читать книгу L'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon: 1700-1900 - Diverse Auteurs - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
ОглавлениеTable des matières
Mais c’est surtout en ouvrant des concours et en décernant des prix que l’Académie put faire rayonner le plus heureusement son influence autour d’elle. Elle fut en cela puissamment aidée par de généreux donateurs, comme Christin, en 1756; par Adamoli, en 1763, qui créèrent des fondations importantes. En 1760, le prix Christin fut partagé entre trois mathématiciens, Bernouilli fils, Jeannerot et l’abbé Bossut.
A partir de cette époque, l’Académie mit chaque année au concours des questions d’intérêt général ou d’un très vif intérêt particulier.
Ainsi, en 1762, on demande un nouveau procédé pour décreuser la soie sans altérer ni sa qualité ni son lustre.
La question de la mouture du blé est toujours à l’ordre du jour: en 1763, on mit au concours la construction des moulins la plus avantageuse pour le produit et la moins nuisible à la navigation.
En 1764, on demanda les moyens les plus convenables pour moudre les blés nécessaires à la subsistance de Lyon, avec plans, cartes et devis.
Puis on aborda une question qui restera longtemps à l’étude et qui est encore pendante depuis près de cent trente-cinq ans: indiquer les moyens les plus faciles et les moins dispendieux de procurer à la ville de Lyon la meilleure eau, et d’en distribuer une quantité suffisante dans tous les quartiers. Ce sujet, mis au concours en 1765, renouvelé les années suivantes, n’aura de solution qu’en 1770, avec Ferregeau, qui indique une solution; mais ce sujet sera encore remis à l’étude.
En 1777, on demande les perfectionnements de la teinture en noir sur la soie; on constate déjà qu’on a porté en France cette teinture à sa plus grande perfection.
En 1778, on mit au concours des questions de travaux publics: le moyen de garantir les canaux et leurs écluses de tout atterrissement de sable ou de gravier.
En 1780, on demande les moyens les moins dispendieux et les plus durables d’entretenir le pavage de la ville de Lyon.
En 1784, on met en discussion le parallèle entre les voûtes surbaissées et les voûtes en plein-cintre.
En 1785, on met à l’étude la direction des aérostats.
En 1793, on propose de propager les manufactures de lainages pour parer aux chômages des autres industries.
En 1794, on propose la description géographique et minéralogique du département de Rhône-et-Loire.
On revient encore sur la question des moulins, et on demande les moyens les plus sûrs et les moins dispendieux de mettre les moulins et autres usines sur rivières à l’abri des interruptions pendant les gelées (1793).
Lors du rétablissement de l’Académie en 1800, le prince Lebrun, troisième consul, lui offrit un prix de 1000 francs. que la Compagnie décida d’employer en récompenses ou encouragements aux inventeurs de quelque procédé utile aux manufactures lyonnaises.
L’œuvre ancienne des concours fut reprise; on demande alors des procédés pour extraire, fixer, aviver les couleurs que peuvent fournir les substances simples indigènes non encore connues en teinture.
En 1804, on met à l’étude la cause des atterrissements de la rive occidentale du Rhône à Lyon, les moyens de les détruire et de les empêcher à l’avenir.
En 1807, l’Académie est consultée sur la nature des pierres à recommander pour le pavage de la ville; on demande les pavés plats en granit au lieu des galets ronds. On demande aussi la réfection du nivellement des chaussées.
En 1811, on repropose la question des eaux potables, question déjà traitée par Ferregeau en 1775; on la remettra à l’étude en 1825; puis on la retirera.
En 18 19, on met au concours l’étude des émanations insalubres dégagées des marais et de l’infection de l’air.
En 1822 et 1823, on repropose la question du décreusage de la soie.
En 1827, on donne en sujet la mise de la Guillotière à l’abri des inondations.
En 1829, l’Académie étudia la réfection de l’éclairage de la ville; elle propose une usine à gaz, des gazomètres, un réseau de conduites; mais une Compagnie se forma alors pour entreprendre ces travaux.
En 1833, on reprend l’étude de la question des eaux nécessaires à Lyon pour les habitants, l’assainissement de la ville et les besoins de l’industrie..
En 1835, apparaît une question très actuelle, la forme des rails et des roues de voilures de chemin de fer, pour diminuer les frottements et parcourir sans danger avec de grandes vitesses les courbes de petit rayon.
En 1838, on met au concours la géologie d’un ou plus d’un canton du Rhône et, en 1839, on propose l’histoire de de la soie.
A partir de 1840, les concours se multiplient, soit sur les fonds des donations, soit sur allocations spéciales. Nous ne rappellerons que ceux qui tombent dans les travaux de notre première section.
En 1844, on demande quels sont les avantages et les inconvénients qui peuvent résulter pour la ville de Lyon de l’établissement des chemins de fer.
En 1847, deux médailles du prince Lebrun furent décernées pour l’invention des freins destinés à prévenir ou amoindrir les chocs des trains sur les chemins de fer.
En 1854, dans un concours relatif aux aqueducs romains, fut décernée une médaille d’or de 1000 francs.
En 1855, la découverte de propriétés tinctoriales dans l’enveloppe du sorgho fut approuvée par l’Académie.
En 1856, on ouvrit un concours de poésie qui avait pour sujet le premier puits artésien créé dans le Sahara.
En 1857, on donna un prix à des perfectionnements et à des inventions introduits dans l’application de la vapeur.
En 1860, on mit au concours l’histoire de l’exploitation des gîtes métallifères du Lyonnais et du Beaujolais.
En 1867, l’Académie choisit pour sujet de concours l’éloge d’Ampère, l’indication des conséquences de ses découvertes, et, en particulier, l’étude théorique et pratique de la télégraphie sous-marine.
En 1863, une récompense honorifique est décernée à M. Verguin pour sa belle découverte du rouge d’aniline ou fuchsine.
En 1865, la médaille du prince Lebrun est attribuée à M. Seeligmann pour la découverte de la chryséine, belle couleur jaune pour la soie, la laine, le chanvre, la sparterie.
Dans la même séance, une médaille d’or est décernée à MM. Faisan et Locard, auteurs d’une belle carte géologique du Mont-d’Or lyonnais.
En 1866, trois découvertes furent présentées à l’Académie: le propulseur Salmon, un nouvel appareil plongeur du lieutenant Charpy; enfin l’appareil de M. Charles Emmanuel, un instrument appelé pantographe, destiné à remplacer le théodolithe et l’équatorial dans les observations astronomiques.
Dans la période de 1870 à 1890, l’Académie récompensa avec les médailles du prince Lebrun, des appareils destinés au filage, au dévidage, à la pesée des soies, à l’exécution des tissus, etc.
Mais, avec la suppression des subventions autrefois accordées par les pouvoirs publics, l’Académie a dû renoncer à encourager par des récompenses pécuniaires les travaux d’érudition et les ouvrages de l’esprit qui se produisent en dehors du cadre de ses fondations.