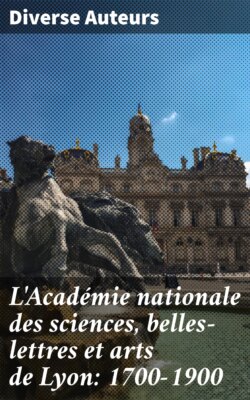Читать книгу L'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon: 1700-1900 - Diverse Auteurs - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
au commencement du XVIII siècle.
ОглавлениеTable des matières
CLAUDE BROSSETTE
L’ACADÉMIE DE LYON
au commencement du XVIIIe siècle.
Si Lyon subit, au plus haut degré, l’influence du grand mouvement littéraire de la Renaissance, tant sont nombreux, à cette époque, les poètes et les écrivains dont notre histoire locale a gardé le souvenir, on ne saurait néanmoins, comme on l’a fait à plusieurs reprises, affirmer qu’il a existé dans notre ville, une Académie établie à Fourvière, dès les premières années du XVIe siècle, et qui aurait disparu pendant les guerres de religion, pour se reconstituer sous le règne de Henri IV, sans laisser plus de souvenir de son existence que de ses travaux.
Depuis longtemps déjà, la critique moderne, examinant avec plus d’attention les documents dont on avait essayé de se prévaloir, a démontré que la réunion de Fourvière n’avait pu être, si elle a existé, qu’une réunion fortuite et momentanée de quelques amis, qu’il était impossible de considérer comme une Académie.
La seule et véritable Académie, qui ait existé dans notre ville est, en effet, l’Académie fondée en 1700, et dont est célébré aujourd’hui le second centenaire.
A ce moment, plusieurs autres Académies de province existaient déjà, et presque toutes avaient tenu à s’affilier aux grandes Académies de Paris.
L’Académie de Lyon, au contraire, se contenta de se placer, à son origine, sous le patronage littéraire du grand législateur du Parnasse français pendant le règne de Louis XIV, Boileau-Despréaux.
Ce patronage, qui l’honorait à juste titre, et dont on retrouve un souvenir vivant dans le buste en marbre du poète, donné par Brossette à la bibliothèque de Lyon, lui suffit.
Et lorsque, trente-deux ans plus tard, le poète Louis Racine, devenu l’un de ses membres, proposera de la faire agréger à l’Académie des Belles-Lettres de Paris, elle déclinera cet honneur, jugeant alors suffisant l’appui qu’elle devait à la haute protection de la Maison de Villeroy, qui ne lui fit jamais défaut.
Ses débuts furent bien modestes pourtant, car, lorsqu’elle fut fondée au commencement de l’année 1700, elle ne comptait que sept membres, sept amis, qu’avaient réunis, à la fois, une affection mutuelle et une communauté de goût pour les sciences et les lettres.
Mais, chez tous, ce goût était ardent et sincère et, dès le premier jour, cette réunion de lettrés et de savants se considéra comme formant une véritable Académie. Ainsi la qualifie, d’ailleurs, Brossette, dans la lettre qu’il écrivait à Boileau, le 10 avril 1700, pour lui annoncer la création de la nouvelle Compagnie.
Après l’avoir prévenu de l’envoi du Recueil des pièces du procès que les avocats et les médecins avaient été obligés de soutenir au Conseil, pour faire reconnaître la noblesse dont ils avaient toujours joui paisiblement jusqu’à cette époque, il ajoutait:
«La noblesse littéraire, dont je viens de vous parler, me donne la pensée de vous apprendre que, depuis le commencement de cette année, nous avons formé ici des assemblées familières, pour nous entretenir des Sciences et des Belles-Lettres un jour de chaque semaine. La Compagnie n’est pas nombreuse, nous ne sommes que sept: mais nous avons cru qu’un plus grand nombre nous embarrasserait. Toutes sortes de sujets peuvent être, tour à tour, la matière de nos conférences: la physique, l’histoire civile et l’histoire naturelle, les mathématiques, les langues, les lettres humaines, etc. Les deux premières assemblées furent employées à examiner si la démonstration que Descartes nous donne de l’existence de Dieu est une suffisante démonstration. A la fin de chaque assemblée, nous déterminons le jour et le sujet de l’assemblée suivante, et chacun y apporte ses mémoires et ses réflexions; je puis dire que souvent on épuise la matière avant que de la quitter. Tout cela se fait en assez bon ordre, suivant les règles que nous nous sommes prescrites.
«Si je ne craignais pas de vous déplaire, je ferais la folie de vous les envoyer, mais j’aurais un scrupule légitime de vous embarrasser d’une bagatelle, comme l’est notre petite Académie: cela peut devenir pourtant plus considérable avec le temps; vous savez mieux que personne, vous, Monsieur, à qui le mystère et la destinée des grandes affaires sont confiés, vous savez, dis-je, que les plus grandes choses ont presque toujours une faible origine.
«C’est suivant cette pensée que j’ai fait une devise pour notre Académie naissante (car comment une Académie pourrait-elle se passer d’une devise?).
«Voilà donc la devise de la nôtre:
«Un arbre sur le tronc et sur les branches duquel sont gravés les noms des académiciens, avec ces mots: Dum crescet, nomina crescent.»
Puis Brossette donne à Boileau la liste des six autres membres, qui composent, avec lui, la nouvelle Académie. Cette liste est la suivante:
1° M. Laurent Dugas, alors président au Présidial, et devenu, plus tard, président à la Cour des Monnaies et prévôt des Marchands de la ville de Lyon.
2° M. Antoine de Serres, seigneur de Charly, aussi conseiller au Présidial.
3° Camille Falconnet, médecin, fils d’Echevin: «Nous n’avons, dit Brossette, personne qui le passe, ni peut-être qui l’égale en esprit, en science, en livres et en mérites.»
4° Le père Jean de Saint-Bonnet, jésuite, «philosophe et mathématicien», et créateur de l’Observatoire, qui subsiste encore au Lycée de Lyon.
5° Le père Fellon, aussi jésuite, auteur de deux poèmes, l’un sur l’Aimant, l’autre sur le Café, que Brossette envoya à Boileau, qui lui en fit les plus grands éloges.
5° Louis de Puget, fils d’un procureur du roi, au siège présidial de Lyon. «C’est sans doute, écrit encore Brossette, le premier magnétiste du monde.
«Rien n’est plus agréable que les expériences qu’il fait sur l’aimant, rien de plus poli que ses manières, et rien n’est plus curieux que son cabinet, qui est visité de tous les savants qui passent à Lyon.»
Si on ajoute à ces noms celui du correspondant de Boileau lui-même, qui fut pendant trente-neuf ans secrétaire de l’Académie, nous connaissons tous ceux qui formaient la Compagnie à son origine.
Mais, comme le disait fort bien Brossette à Boileau, «les plus grandes choses ont souvent la plus faible origine». Ne sait-on pas, d’ailleurs, qu’à l’origine l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ne se composait que de quatre membres?
Quoi qu’il en soit, Boileau, auquel Brossette faisait connaître ainsi la naissance de la nouvelle Académie, répondait, dès le 2 juin 1700, dans les termes les plus flatteurs:
«Je suis ravi, dit-il, de l’Académie qui se forme en votre ville. Elle n’aura pas grand’peine à surpasser en mérite celle de Paris, qui n’est maintenant composée, à deux ou trois hommes près, que des gens du plus vulgaire mérite et qui ne sont grands que dans leur propre imagination. C’est tout dire qu’on y opine du bonnet contre Homère et contre Virgile, et surtout contre le bon sens, comme contre un ancien, beaucoup plus ancien qu’Homère et que Virgile. Ces messieurs y examinent présentement l’Aristippe de Balzac, et tout cet examen se réduit à lui faire quelques misérables critiques sur la langue, qui est juste l’endroit par où cet auteur ne pèche point. Du reste, il n’y est parlé ni de ses bonnes, ni de ses méchantes qualités. Ainsi, monsieur, si dans la vôtre il y a plusieurs gens de votre force, je suis persuadé que, dans peu, ce sera à l’Académie de Lyon qu’on appellera des jugements de l’Académie de Paris. Pardonnez-moi ce petit trait de satire.»
Oui, sans doute, on devait le lui pardonner aisément, quand on songe que, si cette appréciation était flatteuse pour l’Académie de Lyon, elle était inspirée aussi par l’irritation que lui causait la regrettable querelle des anciens et des modernes, soulevée par Perrault, et au cours de laquelle Boileau se montra toujours le plus vaillant champion de la cause des auteurs anciens.
Or, il connaissait bien l’opinion que professaient à cet égard les membres de l’Académie de Lyon, et ses éloges n’ont pas une autre cause.
Car peu de jours après (15 juillet 1700), Brossette lui écrivait:
«Afin que vous le sachiez, notre Académie lutte autant quelle peut contre le mauvais goût du siècle, et nous tenons toits pour l’antiquité. Ce que vous me mandez au sujet de messieurs de l’Académie française est fort agréable; la prévention qu’ils ont en faveur de leur siècle, et peut-être de leur mérite particulier, les a portés d’abord à critiquer les anciens; ensuite, l’impuissance où ils ont été d’abaisser ces grands hommes, a contraint ces messieurs à faire semblant de les mépriser. Cela est plus tôt fait que de s’amuser à les attaquer dans les formes, contre un homme comme vous, qui les défend avec trop d’avantage et de succès.»
Cette conformité de vue devait suffire déjà, pour attirer à la nouvelle Académie toutes les sympathies de l’illustre poète, alors même que la Compagnie ne se serait pas placée, en quelque sorte, dès ses débuts, sous son haut patronage.
Car dans cette même lettre, Brossette lui écrivait encore:
«J’ai fait part à notre petite Académie de la dernière lettre que vous m’avez écrite, dans laquelle vous avez la bonté de vous informer comment vont nos assemblées.
«Toute la Compagnie a été extrêmement touchée de l’honneur que vous lui faites par une attention si obligeante: elle m’a recommandé tout précisément de vous bien témoigner sa reconnaissance, mais comment pourrais-je vous en bien marquer toute l’étendue? Je ne saurais faire mieux qu’en comparant les sentiments de tous ces messieurs à ceux que vous savez que j’ai sur votre compte.
«Je puis vous assurer, monsieur, qu’il n’est aucun endroit au monde, où vous soyez plus estimé, et si je l’ose dire, plus aimé, que le lieu de nos assemblées. L’endroit où nous les tenons est le cabinet de l’un de nos académiciens; nous y sommes au milieu de cinq à six mille volumes, qui composent une bibliothèque aussi choisie qu’elle est nombreuse. Voilà un secours bien prompt et bien agréable pour des conférences savantes.»
Le possesseur de cette belle bibliothèque était Camille Falconnet, l’un des fondateurs de la nouvelle Académie, qu’il quitta beaucoup trop tôt, pour se rendre à Paris, où il devint médecin consultant du roi .
Mais, à ce moment, on ne pouvait prévoir une aussi haute fortune, et Brossette était loin d’y songer, quand il ajoutait dans la même lettre:
«Comme nous sommes tous bons amis, nos assemblées respirent un certain air de liberté et de sérieux qui nous les fait aimer, qui les rend agréables, et qui fait que nous les trouvons toujours trop courtes, quoiqu’elles soient ordinairement très longues. La dernière conférence fut employée à entendre la lecture d’un poème latin sur la musique.
«Il est du même auteur que les deux poèmes, que je vous envoyai l’année dernière, sur l’aimant et le café.
«Ce poème sur la musique n’est pas encore dans sa perfection, et quand l’auteur, qui est un de nos académiciens, l’aura achevé, je vous en enverrai une copie. Vous y trouverez de la force, de la douceur, une noble imitation des anciens.»
Comme on le sait, l’auteur de ce poème latin était le père Thomas-Bernard Fellon, jésuite, né à Avignon, le 12 juillet 1672, auquel on doit aussi plusieurs ouvrages ascétiques.
L’offre de l’envoi de ce poème latin sur la musique fut bien accueillie de Boileau, car le 29 juillet 1700, il répondait à Brossette:
«Je suis charmé du récit que vous me faites de votre Assemblée académique, et j’attends avec grande impatience le poème sur la musique, qui ne sçaurait être que merveilleux, s’il est de la force des deux que j’ai déjà lus. Faites bien mes compliments à vos illustres confrères, et dites-leur bien que c’est à des lecteurs comme eux que j’offre mes écrits: doliturus si placeant spe deterius nostra. On travaille actuellement à une nouvelle édition de mes ouvrages; je ne manquerai pas de vous l’envoyer sitost qu’elle sera faicte.»
Toute cette correspondance témoigne de l’activité des membres de la Compagnie, et de l’intérêt qu’ils portaient aux questions les plus diverses.
Ainsi s’écoula l’année 1700. Pendant les vacances, on cessa de se réunir. Mais, dès le commencement de l’année 1701, l’Académie reprend ses travaux.
Le 2 janvier 1701, Brossette écrit ainsi à Boileau:
«Nous recommençâmes hier nos assemblées, qui avoient été interrompues depuis les vacances.»
Dans cette réunion, il fut donné lecture de l’Ode sur la prise de Namur. Dans cette Ode, Boileau ayant parlé de la plume blanche que le roi portait toujours à l’armée, Brossette fit remarquer, en citant un passage d’Eusèbe, que les Egyptiens avaient autrefois un dieu, appelé Cneph, qui portait aussi sur sa tête une plume royale.
L’observation communiquée à Boileau fut loin de lui déplaire:
«Il n’y a rien de plus joli que votre remarque sur le dieu Cneph, écrivait-il le 18 janvier 1701, et je ne saurais assez vous remercier de cette autorité, que vous me donnez pour la métamorphose de la plume du roi en Astre.»
A quoi Brossette répondait, à son tour, le 5 février 1701.
«Je suis bien aise que la remarque de la plume royale du dieu Cneph vous ait pu faire plaisir. Quand je ne devrais que cela à nos Assemblées académiques, je les aimerais beaucoup; nous les continuons avec assez d’exactitude et, quoique nous ne soyons pas plus de sept personnes, je puis dire que nos conférences sont assez bien remplies. Les dernières ont été employées à examiner l’hypothèse de M. Descartes pour expliquer les effets de l’aimant; elle a été bien défendue contre l’opinion de MM. Huygens, Hartsoeker et quelques autres, qui n’admettent qu’un seul cours de la matière magnétique. Ces conférences ont été tenues au sujet d’un écrit composé ces jours passés sur l’aimant, par M. de Puget, l’un de nos académiciens, pour répondre à quelques objections qui lui ont été faites par un physicien de Paris contre l’hypothèse de M. Descartes. Je vous prépare une copie de ce petit traité, pour vous l’envoyer à la première occasion; vous y trouverez autant de force et d’exactitude qu’on en peut souhaiter. Aussi ce M. de Puget est peut-être l’homme du monde qui connaît mieux l’aimant. Il est renommé et cité pour tel par la plupart des physiciens de ce temps...
«Ce que vous trouverez dans l’écrit, que je vous ferai tenir dans peu de jours, pourra vous confirmer dans la pensée avantageuse où vous êtes, que nous ne perdons pas tout à fait le temps dans nos conférences et qu’elles ne sont pas employées à examiner s’il faut dire: Il a extrêmement d’esprit, etc.; ce n’est pas que nous négligions la pureté du langage, mais nous n’en faisons pas le sujet principal de nos entretiens.»
Dès le premier jour, Boileau, flatté de l’attention qu’on lui porte, s’est attaché à la nouvelle Société naissante. Il s’intéresse à ses travaux, et s’il arrive que son correspondant Brossette oublie de lui parler d’elle, il l’interroge à son sujet: «Votre nouvelle Académie, dans quel état est-elle?» lui écrit-il à plusieurs reprises.
Et quand il est renseigné, il applaudit à ses progrès, et il attache une attention soutenue à tous ses travaux.
Or, cette attention bienveillante est un puissant encouragement pour les membres de la Compagnie, qui lui en témoignent toute leur reconnaissance et partagent le culte que lui avait voué Brossette.
Près de trois ans s’écoulent ainsi.
Boileau, à qui Brossette envoie le tableau des expériences magnétiques faites par de Puget sur le double courant de l’aimant, en est émerveillé :
«Si votre Académie, écrit-il le 16 mai 1701, produit souvent de pareils ouvrages, je doute que la nôtre, avec tout cet amas de proverbes qu’elle a entassés dans son dictionnaire, puisse lui estre mise en parallèle ni me fasse mieux concevoir, à la lettre A, ce que c’est que la vertu de l’aimant, que je l’ay conceu par vostre tableau.»
Assurément, de pareils travaux étaient bien faits pour jeter quelque éclat sur la nouvelle Compagnie. Mais le nombre de ses membres était insuffisant pour assurer sa prospérité croissante.
A la fin de l’année 1701, le père Fellon quitte Lyon, pour aller enseigner dans une autre ville.
L’année suivante, le père de Saint-Bonnet meurt victime d’un accident, en surveillant la construction de l’Observatoire, placé sur la façade de l’église du Collège de la Trinité (juillet 1702).
Puis, bientôt après, Falconnet, chez lequel se sont tenues, depuis son origine, les réunions hebdomadaires de l’Académie, est appelé à Paris où il devient médecin consultant du roi et membre de l’Académie des Inscriptions. — Réduite à cinq membres, la Compagnie cesse pendant quelque temps de se réunir.
Mais heureusement, en 1704, M. de Trudaine est nommé intendant du Gouvernement de Lyon.
A peine arrivé dans notre ville, il exprime le désir de fonder une Académie et, tout heureux d’apprendre qu’elle existe, il la reconstitue aussitôt et lui fournit un lieu de réunion dans son hôtel.
Huit membres alors sont nommés, qui viennent donner à la Compagnie une force toute nouvelle:
C’est d’abord un savant astronome, M. Villemot, curé de la Guillotière.
Puis le père de Colonia, dont les travaux sur l’histoire de Lyon sont toujours consultés.
Cheinet, conseiller à la Cour des Monnaies et savant mathématicien.
Laurent Pianello de la Valette, ancien prévôt des Marchands, possesseur d’une riche bibliothèque, dans laquelle ont été retrouvés les manuscrits de la Mure et de Guichenon,
L’abbé de Gouvernet, homme d’esprit, et auteur de réflexions morales sur la Genèse.
Pierre Aubert, avocat, qui céda sa riche bibliothèque à la ville de Lyon.
Gabriel de Glatigny, avocat général à la Cour des Monnaies.
Et Mahudel, médecin, savant antiquaire, qui se rendit en 1717 à Paris, où il devint aussi membre de l’Académie des Inscriptions.
Pendant tout le séjour de Trudaine à Lyon, l’Académie fut florissante, et, désormais, rien ne pouvait arrêter son essor. Quand ce dernier fut nommé intendant de Bourgogne, en 1710, la Compagnie se réunit chez le président Dugas, jusqu’en 1717, où l’archevêque, François-Paul de Neuville, lui donna asile dans son palais archiépiscopal.
Jusqu’à ce moment, l’Académie n’avait observé qu’une seule règle, l’obligation pour chaque membre de la Compagnie de l’entretenir, à son tour, d’un sujet laissé à son choix .
Une fois installée à l’archevêché, elle adopta un règlement plus circonstancié, et le nombre de ses membres, qui n’était alors que de douze, fut porté à vingt-cinq.
Ainsi constituée, l’Académie vit accourir dans son sein tout ce que Lyon comptait de notabilités, dans le clergé, la magistrature et le barreau . Et, c’est alors que, grâce à la haute protection du maréchal de Villeroy, des lettres patentes du mois d’août 1724 vinrent confirmer officiellement l’existence de la Compagnie, en lui donnant le titre d’Académie des Sciences et des Lettres.
Puis, deux ans plus tard, un acte consulaire du 7 mars 1726 vint témoigner de l’intérêt que lui portait le corps municipal, qui lui accorda une salle de l’Hôtel de Ville pour y tenir ses séances, en attendant le jour où il lui alloue une subvention annuelle de 150 jetons (mars 1735 ).
Dès ce jour, l’Académie revêtait en quelque sorte un caractère public, et il ne lui manquait plus que le titre d’Académie des Beaux-Arts. Ce titre, elle le prit, le jour où la Société des Beaux-Arts, créée en 1713, et autorisée, elle aussi, en 1724, fut réunie à l’Académie des Sciences et des Lettres, par de nouvelles lettres patentes de juin 1758.
A ce moment, le nombre de ses membres fut porté à 40, et l’Académie se trouva complètement constituée. Elle embrassait, en effet, par ses travaux, tout l’ensemble des connaissances humaines; elle pouvait donc accueillir dans ses rangs tous ceux qui, dans un ordre élevé, avaient donné la mesure d’un grand talent ou rendu des services distingués à la science.
Par le tableau des œuvres les plus importantes qui lui sont dues, on peut se convaincre que, pendant tout le cours du XVIIIe siècle, rien ne vint entraver les progrès incessants de la Compagnie. Les quarante années qui précèdent la Révolution furent surtout une période brillante de son histoire. C’est alors qu’après avoir compté le poète Louis Racine au nombre de ses membres, elle reçoit successivement Voltaire, Reynal, Thomas et Ducis, avec un éclat dont le souvenir n’était point encore oublié, quand elle disparut, dans la tourmente révolutionnaire, avec tous les autres grands corps savants.
Mais si l’Académie a vécu ainsi pendant près d’un siècle, il importe de savoir à quelles études se livraient ses membres, surtout à son origine, et quelle part elle a prise au mouvement scientifique et littéraire du commencement du siècle dernier. Une société savante ne se recommande, en effet, à l’attention publique, que par l’importance et l’éclat de ses travaux.
Or, si modestes que soient ses débuts, ils ne furent ni sans intérêt, ni sans valeur.
Mais si, pendant les premières années de son existence, la Compagnie ne s’était assujettie à aucun règlement rigoureux, elle avait négligé aussi de tenir des procès-verbaux réguliers de ses séances. Cet usage paraît bien avoir été adopté en 1714. Malheureusement, ses premiers comptes rendus sont fort incomplets.
Pour connaître ce que furent ses travaux avant l’année 1736, nous sommes obligés de recourir à deux recueils de lettres, l’un qui renferme la correspondance de Claude Brossette avec Boileau, et le second, celle du président Laurent Dugas avec M. Bottu de Saint-Fonds, admis dans la Compagnie dès l’année 1702, mais qui était le plus souvent retenu loin de Lyon, par ses fonctions de lieutenant particulier au bailliage de Villefranche.
Le premier de ces recueils nous est connu déjà. Et nous savons comment Brossette instruit assez régulièrement Boileau de tout ce qui se passe au sein de l’Académie. Dans le domaine scientifique, il lui fait part ainsi des découvertes de de Puget; dans celui des lettres, il lui offre les ouvrages publiés récemment par ses membres, tels que les poèmes latins de l’un des deux pères jésuites faisant partie de la Compagnie.
Ce ne sont là, sans doute, que des essais, ou des œuvres de gracieuse fantaisie, que le grand poète loue et encourage. Mais plus tard, par la correspondance du président Dugas, on embrasse mieux, dans leur ensemble, les travaux de la Compagnie. On voit alors que l’Académie ne se désintéressait d’aucune des questions pouvant appeler l’attention des esprits éclairés. Les plus hauts sujets de la métaphysique font, dès l’origine, l’objet de ses études. C’est ainsi que Brossette nous apprend que ses deux premières séances sont consacrées à l’examen de la démonstration de l’existence de Dieu, faite par Descartes. Mais les sciences physiques et mathématiques l’occupent aussi à maintes reprises. Puis, à la suite de l’histoire générale et des institutions anciennes, elle s’attache, avec une attention soutenue, à l’histoire de Lyon, et particulièrement à l’étude des inscriptions antiques retrouvées, chaque jour dans notre sol, et qui devaient former, un jour, les éléments des premières pages des annales de notre ville. De même, lorsqu’une découverte lui est signalée, soit en mécanique, soit dans l’industrie, elle s’empresse, chaque fois, de charger une Commission d’en examiner l’importance et la portée .
Les premiers membres de la Compagnie ne sont pas animés, en effet, d’un simple esprit de curiosité, et si, dans le domaine des sciences, ils n’ont guère dépassé, sans qu’on puisse leur en faire un reproche, le niveau des connaissances de leur temps, dans le domaine des lettres, au contraire, ils se sont tous pénétrés profondément des auteurs de l’antiquité, et nous sommes loin, aujourd’hui, de les égaler dans la connaissance des langues, tant anciennes que modernes.
Cette année même, une enquête, qui a fait quelque bruit, a révélé que les études classiques avaient baissé partout, et qu’à de très rares exceptions, on ne connaît que bien imparfaitement le latin, et à peine le grec.
Mais il n’en est point ainsi chez nos Académiciens des premiers temps de la Compagnie.
Le président Dugas non seulement connaît assez l’italien, l’espagnol et l’anglais, pour lire les bons auteurs qui ont écrit dans chacune de ces langues, mais il possède aussi toutes les langues savantes, le latin, le grec et même l’hébreu. Il. écrit en latin comme dans sa langue maternelle. Il lit Homère à livre ouvert, et c’est à peine si, au cours de cette lecture, il éprouve de loin en loin quelque hésitation.
Dans une de ses lettres à M. Bottu de Saint-Fonds, il écrit ainsi un jour:
«Les défenseurs d’Homère gâtent plus sa cause qu’ils ne la défendent. Au fond, il est impossible de répondre aux raisons que M. Terrasson et les autres disent contre ce poète. Mais qu’a besoin de défense celui qui se soutient si bien par lui-même. Homère, malgré toutes leurs démonstrations, charmera toujours ceux qui peuvent le lire dans sa langue naturelle. Je vous parle selon votre expérience et la mienne, je ne suis point assez habile pour lire le grec aussi couramment que le français; plusieurs choses m’arrêtent souvent en chemin. Mais j’éprouve à l’égard d’Homère la même chose qu’à l’égard des tragédies de Racine, je ne m’ennuie jamais de le relire. N’est-ce pas, encore un coup, ce qu’on peut dire de mieux à son avantage.»
Et celui, à qui il écrit ainsi, Bottu de Saint-Fonds, est loin de lui être inférieur. Car si le président Dugas se complaît à lire Homère dans le texte original avec son fils, le fils de Bottu de Saint-Fonds lit, avec son père, Thucydide. Puis ce dernier, lui aussi, connaît non seulement l’italien et l’espagnol, le latin et le grec, mais encore l’hébreu. Et voici ce qu’il écrit à son ami Dugas:
«Vous ne serez pas surpris de ce que je prie Dieu en italien, puisque vous-même vous le priez bien en espagnol... J’ai donc cru pouvoir suivre votre exemple et j’ai disposé toutes mes occupations de ces vacances de manière que je puisse faire deux choses à la fois.
«Ainsi, le matin, je fais ma méditation dans une Imitation italienne; l’après-dîner, je fais ma lecture spirituelle dans l’espagnol de Grenade; Elien m’apprend du grec et de jolis traits d’histoire; les lettres de Sénèque me font lire du latin et de la morale; mon psautier hébreu est également pour l’Écriture et l’hébreu; j’apprends du français et je ne sais combien de belles choses dans les journaux des savants, etc. Voilà un petit et cætera où il y a de la vanité ; j’ai fait comme ces seigneurs qui, après avoir mis tous leurs titres: seigneur d’ici, seigneur de là, mettent encore: et d’autres places...»
On comprend, dans une certaine mesure, que l’on pût autrefois, au cours des études classiques, se pénétrer plus qu’aujourd’hui de la connaissance des langues, l’enseignement scientifique laissant alors une plus large place à celui des lettres.
Mais ce qui s’explique plus difficilement, c’est que ces savants légistes, ces graves magistrats, si attachés aux devoirs de leurs fonctions, aient pu trouver assez de loisirs, pour qu’il leur fût permis de chercher, dans la lecture des auteurs classiques, un délassement de leurs travaux de chaque jour.
Sans doute, alors, on voyageait moins, on était moins préoccupé par les affaires publiques. Mais tous ces grands personnages sont très répandus dans le monde, et souvent les affaires auxquelles ils doivent veiller sont très multipliées. Aux fonctions de prévôt des marchands, que remplit le président Dugas, viennent s’ajouter encore celles de commandant de la ville pendant l’absence du gouverneur, qui appartint pendant plus d’un siècle à la famille de Villeroy, mais qui était le plus souvent retenu à la Cour par ses fonctions.
Pourtant, c’est ce même magistrat qui, après chaque séance de l’Académie, prend encore la plume pour instruire son parent et ami, Bottu de Saint-Fonds, des communications faites à la Compagnie.
Ainsi avons-nous, avec des appréciations parfois assez piquantes, un tableau bien vivant de l’Académie, pendant plus d’un quart de siècle. Or, ce tableau nous apprend que ce n’est pas seulement à des travaux littéraires que se livrent les premiers membres de la Compagnie, mais que, sur les sujets les plus divers, ils donnent aussi la mesure des fortes études classiques qu’ils ont reçues.
Comme savant, de Puget ne se borne pas à ses travaux sur l’aimant et la déclinaison de l’aiguille aimantée, il s’applique aussi à l’étude de l’histoire naturelle. A la suite de ses expériences sur la trompe des papillons, il se livre à des recherches sur l’aiguillon des guêpes, que Brossette n’hésite pas à communiquer à Boileau (septembre 1704). Pestalozzi communique à la Compagnie un travail sur les odeurs et le sens de l’odorat (1715), avant de lui présenter une histoire abrégée de la médecine (1731).
Et, plus tard, Trollier retracera un tableau de l’origine et des progrès de l’astronomie, dans lequel il n’a garde d’oublier les travaux de l’abbé Gabriel Mouton, qui fut, comme on le sait, l’un des précurseurs du système métrique (30 mars 1734).
L’étude des mœurs et des institutions des peuples anciens tient aussi une grande place dans les travaux de la Compagnie. Pendant que l’avocat Aubert se livre à des recherches sur les Vestales (1715), et que de Fleurieu communique une étude sur l’origine et le progrès du luxe chez les Romains, en démontrant ses funestes conséquences pour la République (1719). Brossette écrit un mémoire sur les jeux séculaires des Romains (1717), et un autre sur le droit italique (1718). Colonia étudie à la fois la chronologie des Septante, et, à maintes reprises, nos inscriptions anciennes. Lainé, savant archéologue, directeur de la Monnaie de Lyon, met à profit les connaissances spéciales qu’il doit à l’exercice de sa charge, pour pénétrer les secrets de la fabrication des monnaies romaines et déterminer la valeur exacte du sesterce (1723).
C’est qu’en effet l’étude des antiquités a, dès le premier jour, appelé l’attention des membres de l’Académie. A peine est-elle fondée, que Brossette fait connaître à Boileau, comme une découverte d’une haute importance, celle du Taurobole retrouvé à Saint-Irénée et dont l’inscription nous apprend qu’il fut consacré, en l’année 160, pour obtenir des dieux la conservation des jours de l’empereur Antonin le Pieux (12 février 1705).
Lainé étudie aussi une médaille de l’empereur Probus et vient éclairer un sujet, offrant d’autant plus d’intérêt pour nous, qu’un grand nombre des monnaies de ce prince ont été frappées dans l’atelier monétaire de Lyon (1730). Lui aussi essaie, avant et après tant d’autres, et de même que l’avocat Pierre Aubert (1715), de déterminer le sens de la formule sub asciâ, inscrite sur nos tombeaux gallo-romains (1730). Il signale, en outre, à la Compagnie, chaque découverte de monuments épigraphiques faite à Lyon, dans le quartier de Saint-Irénée. Et le président Dugas, faisant part de ces communications à son parent, de Saint-Fonds, s’empresse d’ajouter: «Tout ce qui est antique mérite attention et est du ressort de l’Académie. » (28 avril 1731.)
Si plusieurs des membres de la Compagnie se livrent à des travaux d’histoire générale, comme l’abbé Tricaud, chanoine d’Ainay, qui disserte sur l’incertitude de l’histoire (1729), ou recherche en quel sens les empereurs romains prenaient la qualité et le titre de pontifes (1733), et comme aussi M. de Glatigny, qui traite un jour des mœurs, coutumes et religion des anciens Gaulois et surtout des Druides (1733); d’autres, au contraire, consacrent leurs loisirs à l’histoire lyonnaise. Tel est Brossette, auteur de l’Éloge historique de la ville de Lyon; tel est surtout le père de Colonia, qui après avoir communiqué à l’Académie ses recherches sur la Légion Fulminante (1714), lui donne lecture de divers chapitres de son Histoire littéraire de Lyon, et de ses Recherches sur les antiquités de notre ville, deux ouvrages publiés depuis, mais auxquels il faut ajouter son important travail, demeuré inédit, sur l’Origine et les preuves du Grand Jubilé de Lyon, dont l’étude a été poursuivie jusqu’à nos jours, à l’occasion du dernier jubilé de 1886.
A tous ces travaux viennent se joindre de nombreuses études de morale ou de philosophie. Un mémoire sur la Charité chrétienne, communiqué par M. de Regnaud (1730), un jour que Louis Racine assistait à la réunion de la Compagnie, inspire à ce dernier une observation fort juste: c’est que les peuples païens, loin d’exercer la charité, regardaient les pauvres comme haïs des dieux, ce qui explique comment les civilisations antiques n’avaient su ménager, pour les malheureux, ni hôpitaux, ni établissements de bienfaisance d’aucune sorte. Un mémoire sur les préjugés, de M. Noyel (1730), un autre sur la sympathie, de M. Rey (1731), révèlent aussi chez les deux auteurs un esprit d’observation digne d’estime. Mais ces travaux sont loin de s’élever à la hauteur d’une dissertation du père Lombard sur l’emploi que l’homme doit faire de sa raison (1732). Un traité des principes de la morale naturelle, d’un savant allemand, Maischel, est aussi à noter parmi les mémoires de philosophie communiqués à la Compagnie, à cette époque (1719). Mais il est fort à présumer que ce sujet, traité à la manière allemande, ne parut pas d’une clarté suffisante; car le président Dugas ne put s’empêcher d’observer que «la matière était fort abstraite et fort métaphysique» .
L’admission de Maischel dans les réunions de l’Académie, nous montre qu’elle accueillait avec bienveillance les savants étrangers venant séjourner dans notre ville. Maischel en fut du moins reconnaissant. Car, quinze ans plus tard, devenu professeur d’histoire et d’éloquence à l’Université de Tubingue, il faisait hommage à la Compagnie du discours latin qu’il avait prononcé à la fin de son rectorat, et, la remerciant de nouveau de l’accueil qu’il avait reçu, il ajoutait qu’«il mettait la nation française au-dessus de toutes les autres pour l’humanité et la politesse envers les étrangers» (4 février 1735).
Cet hommage, rendu à notre pays par un Allemand du XVIIIe siècle, ne méritait-il pas d’être rappelé ici?
Fréquemment, on a répété qu’au siècle dernier les Académies de province comptaient surtout des poètes parmi leurs membres, parce que tout le monde, à cette époque, se piquait de faire des vers.
Cette appréciation, fort juste vers le milieu du XVIIIe siècle, l’est moins peut-être pour les premières années de l’existence de notre Académie. A cette époque, on lit peu de vers dans ses réunions, et les pères jésuites, qui versifient avec une facilité remarquable, le font généralement en latin.
Vainement M. du Perron présente un jour un travail sur la versification (1733), les plus féconds de nos poètes au siècle dernier, les Bordes, les Vasselier, ne font pas encore partie de l’Académie.
N’oublions pas toutefois qu’à cette même époque et avant de prononcer l’oraison funèbre du maréchal de Villars, «vive, animée, pleine de grands traits et digne du héros, » le père Folard produisait deux tragédies, Œdipe et Thémistocle, et que le président Dugas déclare, dans une de ses lettres, qu’il préfère cette dernière au Brutus de Voltaire (6 février 1731).
Mais ce qui domine, dans le domaine des lettres, ce sont les travaux de critique et les études littéraires.
Ainsi, le secrétaire Brossette écrit un mémoire sur le vaudeville (1719), Cheinet étudie Cicéron comme poète (1727), le président Dugas, savant helléniste, après avoir écrit un travail sur la rhétorique d’Aristote (1733), communique ses recherches sur l’origine, les progrès et la décadence de la langue grecque (1735). Un autre jour, c’est son fils, Pierre Dugas, qui traite du merveilleux dans les poèmes épiques, sujet que Chateaubriand lui-même n’a pas dédaigné d’étudier au commencement de ce siècle. Louis Racine, admis membre honoraire, compare l’Andromaque de son père avec celle d’Euripide. Bottu de Saint-Fonds, retenu par ses fonctions à Villefranche et devenu membre honoraire depuis 1724, adresse un jour à la Compagnie un éloge de Plutarque, puis, quelque temps après, une étude sur Pindare, «qui charma, dit le président Dugas, le petit nombre des académiciens qui assistaient à la séance» (30 mai 1731).
La lecture d’une parodie du premier acte du Brutus de Voltaire, par M. de Billy, suivie quelque temps après d’un travail de M. de Fleurieu sur l’origine et la nature des parodies, provoque, un autre jour, une observation fort juste de M. de Faramant, qui déclare tout haut que «la meilleure qualité des parodies est d’être courtes» (3 mars 1733).
Enfin, d’autres travaux témoignent encore de l’importance qu’on donnait, à cette époque, à la littérature dramatique. C’est ainsi que M. de Fleurieu traite des personnages de théâtre (1730), et Aubert du nœud et du dénouement des pièces dramatiques (1731).
De tous ces travaux, un petit nombre a été publié ; d’autres existent encore parmi les manuscrits de l’Académie. Plusieurs forment même de gros volumes. Telle est la dissertation historique et critique sur le Grand Jubilé de l’Église de Saint-Jean de Lyon, qui ne comprend pas moins de 396 pages in-4°. Mais ils ne témoignent pas seuls de l’activité qui régnait au sein de l’Académie. Quand les dissertations écrites faisaient défaut, on discourait librement dans les réunions de la Compagnie sur les sujets les plus divers, et ces échanges de vues ne manquaient jamais d’intérêt, si bien qu’un jour le président Dugas laisse échapper cette réflexion, en écrivant à de Saint-Fonds:
«Il n’y a pas eu de discours; la réunion s’est passée en causeries. Cela vaut mieux qu’un discours médiocre. » (13 avril 1734.)
Telle fut l’Académie à son origine et tels furent ses premiers travaux.