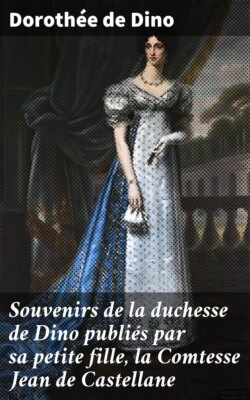Читать книгу Souvenirs de la duchesse de Dino publiés par sa petite fille, la Comtesse Jean de Castellane - Dorothée de Dino - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
Si ces Souvenirs avaient été publiés au moment où ils furent écrits, et que, selon la mode d'alors, on eût voulu expliquer l'œuvre par le titre, celui-ci méritait d'être choisi: «Dorothée ou le malheur des trop grands biens.»
Le pays des fortunes les plus soudaines et les plus extraordinaires fut, au XVIIIe siècle, la Russie. L'autocratie créatrice du jeune empire n'avait pas voulu se limiter, même par une loi qui réglât la transmission du pouvoir. Le tsar désignait à son gré son héritier. Mais s'il mourait sans avoir rien dit, force était de suppléer à ce silence, les principaux serviteurs du souverain défunt choisissaient le souverain nouveau: l'excès de l'omnipotence aboutissait à abandonner aux sujets la création de l'autorité. Gela arriva dès la mort de Pierre le Grand. Remettre la couronne à sa veuve Catherine parut au conseil de l'empire garder le pouvoir pour lui-même: ainsi commença le règne des impératrices. Cinq se succédèrent sur le trône durant les trois quarts du XVIIIe siècle. Mais le bénéfice ne fut pas pour ceux qui les avaient élevées. Ces souveraines ne se trouvèrent pas faites pour le veuvage qui leur avait valu le trône. L'expérience des vieux serviteurs avait trop de rides, les impératrices préférèrent les mérites que le temps enlève aux mérites que le temps apporte. Toutes-puissantes, elles ignoraient les obstacles accordés d'ordinaire comme sauvegardé à la vertu tentée, et il leur suffisait de désirer pour avoir déjà obtenu. Des sujets jeunes et beaux rendirent le service d'état que leur demandait l'amour, et l'amour prêta ses ailes à leur fortune. À défaut de vertu, l'orgueil chez ces souveraines souffrait de leurs faiblesses: il précipita la prodigalité des titres, des honneurs, des richesses, entassés comme pour amoindrir la distance entre elles et leurs favoris[1]. Rien n'était obstacle dans un État qui avait pour seule constitution la constitution de ces voluptueuses. Ainsi se forma une aristocratie contraire à la structure normale de la noblesse, qui est fille du temps. Cette noblesse d'origine fut, en Russie, dominée par de jeunes envahisseurs qui usurpaient d'un coup les plus hautes dignités, certains encore peuple par les rudesses primitives, les énergies solitaires, les férocités impitoyables qu'une aristocratie traditionnelle dissout dans l'élégance de ses mœurs et la solidarité de ses intérêts. Ces audaces cruelles trouvèrent leur emploi contre Pierre III, Paul Ier, et la vie amoureuse des impératrices prépara la mort tragique des empereurs.
Des favoris, le premier par la date, la durée, l'éclat et les éclipses de sa fortune fut Jean de Biren. C'était un petit compagnon, né en Courlande. Cette contrée, unie à la Pologne par un lien fédératif, vivait libre sous des ducs nationaux. Un d'eux, au début du XVIIIe siècle, avait épousé une nièce de Pierre le Grand, Anne, et mourut le jour de ses noces, laissant le duché à sa veuve. Jean occupait à la chancellerie de Mittau un emploi modeste; une affaire de service lui donna un jour accès près de sa souveraine, à celle-ci la rencontre inspira, une bienveillance bientôt passionnée. Biren gouvernait depuis dix ans le duché et la duchesse, quand elle fut, en 1730, à la mort de Catherine, appelée au trône de Russie. Biren la suivit en maître. Dans ce pays, aux mœurs encore asiatiques, le pouvoir donnait la richesse, avec les présents des protégés et les dépouilles des adversaires: vingt mille exils en Sibérie et douze mille exécutions pourvurent avec surabondance à la sûreté de l'État et à la fortune de Biren. De la souveraineté il ne lui manquait guère que le titre. L'impératrice, renonçant pour lui à la Courlande, le fit élire par la diète de la province: en 1737 il devint duc de Courlande. Enfin, libérale pour lui jusque dans la mort, Anne lui confia par testament la régence de la Russie, c'est-à-dire le pouvoir absolu durant la minorité de Pierre III, alors au berceau. Mais en 1741 il est surpris par une conspiration de palais, et, de tout ce qu'il possédait, rien ne lui est laissé que la vie. C'était assez pour qu'il recommençât, étape par étape, son retour vers ses biens perdus. Il mit à les recouvrer le même temps qu'il avait mis à les conquérir: vingt-trois ans. En 1762, son épée, la même qui lui avait été prise en 1741, lui fut rendue, et l'année suivante la Courlande. Mais ce qui ne pouvait lui être rendu c'était la confiance et la joie. Il avait trop éprouvé la fragilité des choses. Ce que l'amour lui avait offert, la haine le lui avait ôté, l'arbitraire le lui restituait, un nouveau caprice pouvait le lui reprendre, et tout lui serait ravi par la mort, déjà proche derrière la vieillesse. En 1769, il abdiqua en faveur de son fils aîné, et en 1772 acheva sa vie, ayant trouvé au fond des prospérités la tristesse.
Son fils aîné Pierre recueillit l'héritage, mais non le désenchantement. Il avait les aptitudes d'un prince médiatisé, n'aimait pas le travail qui vole du temps au repos, se plaisait aux honneurs sans obligations et à l'inconstance des joies. Le mariage même ne l'avait pas fixé: après deux unions courtes, stériles et rompues par le divorce, il épousa, en 1779, une de ses sujettes, la comtesse de Médem, que désignaient à son choix «sept cents ans d'une noblesse sans tache». Sept cents ans de noblesse sont jolis à voir dans un visage de vingt ans, et, cette fois, le duc avait trouvé la compagne de sa vie mondaine. Mittau, quoique placé sur la route de Berlin à Pétersbourg, et bien fourni de nouvelles, était à l'écart des amusements. Malgré la loi qui interdisait aux souverains de quitter le duché, le couple princier prit son vol vers le soleil, passa en Italie les années 1784 et 1785, et se prépara en Allemagne un établissement. Le duc acheta en Silésie le fief de Sagan, qui avait été à Wallenstein; en Bohême, en Saxe, en Prusse de grandes terres; à Berlin, le palais que Frédéric II avait bâti pour sa sœur Amélie. Ses séjours dans ses domaines ne lui laissaient pas le temps de rentrer dans ses États. Il vivait heureux loin de ses sujets, passionné pour les objets d'art. Les plus beaux à ses yeux étaient les quatre filles que lui avait données sa troisième femme, et qui grandissaient autour de lui. La dernière, née le 24 août 1793, était Dorothée.
Il était temps qu'elle vint au monde pour naître fille de souverain. On touchait au dernier partage de la Pologne et Catherine II voulait la Courlande. Le duc fut heureux de vendre ce qu'il ne pouvait conserver. Un capital de deux millions de roubles, soit huit millions de francs, une pension de vingt-cinq ducats, soit deux cent cinquante mille francs, lui payèrent l'abandon de sa principauté, et dès lors il ne fut plus qu'un oisif de marque, certain d'avoir gagné à accroître sa richesse en diminuant ses devoirs. À Berlin, l'existence des Courlande demeurait presque royale; les égards que leur témoignait la maison régnante de Prusse étaient devenus de l'amitié; la reine Louise s'était liée avec la duchesse; le prince Louis-Ferdinand, qui devait finir à Iéna, était le compagnon des filles aînées; sa sœur, la princesse Radziwill, avait voulu être la marraine de la petite Dorothée. Mais la résidence principale des Courlande était Sagan. Le domaine était immense, le château magnifique, digne de Wallenstein et de ses rêves. Quelques meubles du grand homme rappelaient son passage, qui avait laissé à cette demeure la majesté de l'histoire. C'était de l'histoire aussi que «toutes ces curiosités de l'Asie qui avaient été offertes à mon grand-père durant sa régence», et qui, «avec les tableaux et les marbres apportés d'Italie par le prince Pierre», remplissaient de «magnifiques inutilités» les appartements nombreux et tous habités. De Silésie, de Berlin, de Prague, de Dresde, les visiteurs se succédaient, mêlant leur va-et-vient au groupe des gentilshommes qui vivaient à demeure dans la familiarité du maître. Des demoiselles d'honneur, escorte permanente, entouraient aussi la duchesse. Les grandes chasses, les longs repas, les redoutes et les bals étaient pour le travail; pour le repos «une troupe de comédiens assez passables, des chanteurs italiens et de bons musiciens attachés à la maison de mon père». C'était à peu près l'existence qu'on menait dans les petites cours d'Allemagne. Mais celles-ci, pauvres pour la plupart, étaient réduites à un mince apparat de surface; l'on enfonçait à Sagan dans une profondeur d'opulence, qui, inférieure aux ressources, était encore de la modestie.
Cette splendeur fut pour Dorothée la première vision, et laissa dans ses yeux un éblouissement; il lui parut avoir commencé par vivre un conte de fée. Elle y jouait son rôle, et était elle-même pour la compagnie le plaisir d'un instant lorsque, habillée et parée, elle passait de mains en mains et de caresses en caresses. C'est alors qu'elle rencontrait sa mère. Celle-ci se devait à ses hôtes, à leurs plaisirs où elle trouvait le sien; elle n'avait pas de temps pour cette petite fille dont elle connaissait moins l'âme que les toilettes. Telle est la misère de la richesse: l'or sépare ceux qu'il comble. L'oisiveté, plus que le travail, dissocie les familles; souvent leur vie commune est ruinée à proportion que s'accroît leur fortune, et les enfants les plus abandonnés ne sont pas toujours ceux des pauvres. Malgré tous les privilèges du rang et du luxe, au foyer de cette fête perpétuelle et de cette hospitalité attentive pour tous, la petite princesse grandissait, solitaire, oubliée, aux mains d'une vieille Anglaise.
Cette gouvernante avait pour principes que la santé se fortifie par l'eau froide, et l'intelligence par le fouet; tour à tour, elle trempait et fessait son élève. L'eau froide que l'élève jugeait barbare est aujourd'hui réhabilitée. Le fouet le sera peut-être à son tour. Il se trouvera des novateurs pour élever ce châtiment à la dignité de sport, combattre la superstition de l'épidémie intangible, flétrir la barbarie qui emprisonne et courbe sur d'inintelligents pensums les jeunes corps faits pour le grand air et l'exercice, et préférer le châtiment court, inoffensif et sain, grâce auquel le sang circule plus vite. Mais l'Anglaise, fille d'une race insatiable, battait sans mesure. Et ce traitement cruel déconcertait comme un illogisme la petite princesse. Elle se sentait une part vivante et inséparable de la puissance sociale qu'elle voyait chaque jour consacrée par les empressements et les respects unanimes. Et elle était livrée à des subalternes, maltraitée sans qu'en sa personne nul de ses proches se sentît atteint, sans que surtout sa mère connût les humiliations infligées à sa fille. Les jeunes ont une divination infaillible de ce qui leur est dû. Sans l'avoir appris de personne, la petite victime savait que la présence des mères est un droit pour leurs enfants s'ils souffrent. L'absence de la mère fut à la fille l'épreuve qui blesse l'ordre naturel des choses, la douleur qui vient d'où l'on attendait la joie, la surprise où il y a de la trahison. Quelle plainte secrète dans ces lignes: «Si, tout en aimant beaucoup ma mère, en rendant justice à ses rares qualités, en la prisant bien haut, en la mettant bien à part, je ne suis jamais arrivée avec elle à des relations précisément filiales, j'en attribue la première cause à ce temps d'oppression dont ma jeune tête lui faisait intérieurement quelques reproches.» Cette déception n'a pas seulement tari la source des confiances sans réserve entre la fille et la mère. Si la plus parfaite des tendresses est indifférente et lointaine, qu'espérer des autres affections? Une défiance universelle désenchante cette âme d'enfant. L'oiseau noir de la mélancolie ramené d'exil par Jean de Biren, et qui n'a pas trouvé où se poser sur les agitations bruyantes du duc Pierre, habite la chambre de Dorothée oubliée, et assombrit de la même ombre les derniers jours de l'aïeul et les premières années de la petite-fille. Mais en celle-ci, non assouplie encore par la discipline des désillusions, les instincts de justice et de bonheur se dressent en révolte. Elle oppose aux mauvais traitements sa mauvaise volonté, pousse en sauvageon, n'écoute rien, n'apprend rien. À sept ans, elle ne connaissait pas l'alphabet et savait seulement désobéir en trois langues, «le français que, dit-elle, j'avais attrapé au salon; l'allemand, qui m'arriva par l'antichambre, et l'anglais, que j'apprenais à travers les gronderies et les coups».