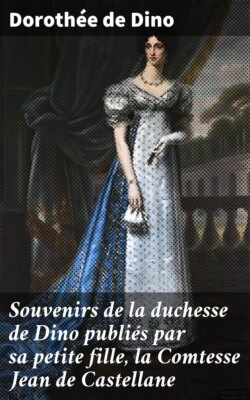Читать книгу Souvenirs de la duchesse de Dino publiés par sa petite fille, la Comtesse Jean de Castellane - Dorothée de Dino - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеTable des matières
On connaît l'étonnante amitié qui lia quelque temps le prince Czartoryski à Alexandre. Après le partage de la Pologne, Czartoryski, descendant des Jagellons, riche, jeune, populaire, pouvait devenir le chef d'une révolte nationale: il avait été appelé à Pétersbourg, nommé aide de camp du grand-duc héritier, et ainsi, sous apparence d'honneur, gardé à vue. Il supportait depuis quelque temps son sort de vaincu, sans se plaindre ni oublier, lorsque Alexandre s'ouvrant au compagnon dont il désirait faire un ami, s'était dit désireux de rendre l'indépendance à la Pologne et de supprimer le pouvoir absolu en Russie. Ces confidences, qui annonçaient la générosité du futur maître et réveillaient l'espoir le plus cher du patriote, avaient acquis à Alexandre tout le dévouement de Czartoryski. Elles n'étaient pas pour surprendre chez l'élève de Laharpe, elles ne furent pas oubliées quand Alexandre devint empereur. Aussitôt Czartoryski, Paul Stroganov, Novossilltzov et Koutchoubey, élevés à l'occidentale comme lui, formèrent son conseil secret. Ce pouvoir occulte dura deux ans et demi, et, pendant la première année, délibéra quarante-six fois sous la présidence de l'empereur. Tandis que les ministres en titre continuaient les pratiques de l'autocratie ancienne, lui étudiait les moyens de la détruire: il faut lire dans l'ouvrage du grand-duc Nicolas les procès-verbaux et les rapports du conciliabule où l'empereur conspirait contre sa propre autorité. Au bout d'un an, la nouveauté du plaisir était passée, les embarras des réformes avaient apparu, et Alexandre se détachait de la liberté politique. Non qu'en la promettant il eût été de mauvaise foi. Il avait une imagination vive que séduisaient les nobles entreprises, et un caractère indolent que les difficultés lassaient: il obéissait tout à tour à ces instincts contraires en abandonnant les projets dont, après l'examen, il désespérait, pour s'attacher avec une ardeur neuve à d'autres desseins dont, au premier regard, il voyait seulement la beauté. Il était moins double que successif. Quand il abandonna le rêve de la liberté politique, il resta attaché aux compagnons de son premier espoir, en renonçant à se servir de leurs idées voulut se servir d'eux, et plaça Czartoryski aux affaires étrangères. Celui-ci espérait que, pour la Pologne du moins, l'empereur restait constant. À ses yeux, l'intérêt essentiel de la Pologne était qu'il ne se fît aucun accord entre la France et la Russie. Leur entente empêcherait, en effet, la France, le pays le plus intéressé à la renaissance de la Pologne, de réclamer à la Russie l'acte réparateur; la Pologne ne pourrait donc plus compter que sur la justice spontanée de ses spoliateurs, et ceux-là sont rares que leur conscience réveille dans le silence. La guerre entre la Russie et la France était la grande chance de la Pologne. La France devrait s'en faire la libératrice, dès l'ouverture des hostilités, afin de tourner contre la Russie l'effort du peuple opprimé; à la paix, afin de n'assurer par la résurrection de ce peuple un allié perpétuel contre les agrandissements moscovites; et la certitude de ces périls presserait la Russie bien conseillée de prendre les devants, de délivrer elle-même la Pologne, pour la neutraliser. C'est afin d'introduire dans la politique russe ces règles fondamentales que Czartoryski avait accepté les affaires étrangères. D'ailleurs il était convenu qu'il ne recevrait ni traitement, ni décorations, et que s'il ne pouvait servir utilement sa patrie, il quitterait le ministère. Si ceux qui connaissent les hommes d'État déclarent ce désintéressement invraisemblable, je répondrai que cela se passait il y a plus d'un siècle et dans un pays encore peu civilisé.
Quand Piattoli arriva à Saint-Pétersbourg, le ministre reçut avec les plus affectueux égards cet ami de la Pologne, qui avait souffert pour elle; il l'établit dans sa propre maison. Les négociations retinrent l'envoyé deux années; en aucun pays ce n'est beaucoup pour obtenir justice. Comment à son hôte, l'abbé n'eût-il pas parlé de celles pour qui il était venu, et dont l'absence faisait sa peine, sa duchesse et son incomparable élève? Comment ses lettres auraient-elles tari sur le prince, sa bonté, son dévouement, l'importance de sa tâche, la grandeur probable de sa destinée? Quoi d'étonnant si dans sa tête et dans son cœur, s'échauffe le projet d'unir la jeune fille qu'il aime davantage à l'homme qu'il admire le plus? Il a un portrait de la jeune élève, il l'a prêté au prince, qui ne le rendit jamais. Il fait copier une miniature du prince et l'envoie à Dorothée. Le prince a trente-quatre ans, vingt-trois de plus que la fillette et pourrait être son père; mais le portrait de Dorothée est si joli, et plus encore la vision de l'être toujours charmant et toujours nouveau que lui présente l'enthousiasme de l'abbé! Pour elle, elle est encore à cette adolescence où les disproportions d'âge n'occupent pas. Il s'agit bien d'années, quand elle pense à cette victime assez noble pour inspirer attachement au chef de la race spoliatrice, à cette volonté assez loyale pour ne trahir aucun de ses devoirs contraires, à ce paladin qui prépare la gloire de son maître par la délivrance de sa patrie. Le prince lui apparaît comme un héros et les héros sont toujours jeunes. C'est une belle effigie du devoir qu'elle admire en regardant la miniature; c'est à une existence vouée au salut d'un peuple qu'elle voudrait unir la sienne; c'est le grand homme qu'elle aime, car elle aime. Ainsi commence et grandit entre deux êtres qui ne se sont jamais vus, le plus délicat, le plus pur, le plus exquis des sentiments.
Tandis que ce rêve les charme, l'œuvre de fer et de sang s'accomplit en Europe. Czartoryski avait poussé à la guerre entre la Russie et la France et venait d'adhérer à la troisième coalition. La campagne de 1805, soutenue par l'Autriche et la Russie, mène en Allemagne Alexandre et son ministre jusqu'à Austerlitz. Même après cette bataille qui décide l'Autriche à la paix et décourage la Prusse de se mêler à la guerre, la Russie demeure aussi intraitable que l'Angleterre, et apprête un nouvel effort en 1806. Il laisse peu de temps pour résoudre les autres affaires. Si celles de la duchesse ne sont pas brusquées, il n'y a guère de chance qu'elles arrivent à terme et, pour obtenir vite d'Alexandre, la grâce d'une femme vaut mieux que les raisons d'un homme. Piattoli indique à la duchesse un moment où elle est sûre de voir l'empereur, et la prie de venir à Pétersbourg. Elle y arrive à la fin de juin 1806.
«L'empereur la trouva, ce qu'elle était en effet, belle, aimable, et grande dame autant que personne au monde.» Donc la cause était bonne, elle fut gagnée en deux mois. Quand la duchesse repartit «enchantée de l'amitié qu'Alexandre lui avait témoignée», elle comptait s'arrêter six semaines en Courlande et regagner Berlin dès octobre. Mais durant ces six semaines, la Prusse, poussée par la Russie, avait déclaré la guerre à la France; en octobre l'armée de Frédéric était détruite et Berlin occupé par nos troupes. Avant qu'elles y pénètrent, Dorothée et sa gouvernante rejoignent la duchesse hors d'atteinte des Français. Les Souvenirs racontent cette épidémie de la peur qui atteint alors les personnes les moins exposées; les foules fugitives, sans bagages, sans ressources, entassées sur des charrettes, suppliant aux relais pour obtenir des chevaux; la course à la frontière où il n'y a pas d'ennemis, jalonnée par les passages de la reine, du roi, du prince royal, que le désastre sépare et emporte, membres épars de la monarchie vaincue. Dorothée, à une halte dans un village près de Starzard, apprend l'entrée de Napoléon à Berlin. Dans l'auberge, contre un mur, elle avise «une mauvaise gravure représentant Bonaparte Premier Consul. L'arracher de son cadre, lui couper en effigie le nez et les oreilles, fut l'affaire d'un instant». Tel fut, après Iéna, le seul acte de vigueur que puisse enregistrer l'histoire du vaincu.
L'héroïne rejoignit sa mère en Courlande, et avec toute apparence d'y rester plus qu'elle ne désirait. Les Russes, arrivant au secours de leurs alliés, manœuvraient dans l'est de la Prusse pour refouler l'invasion française, et la route de Berlin passait par le pays où déjà grondait le canon de Pultusk, où allait bientôt retentir celui d'Eylau, d'Heilsberg et de Friedland. La jeune fille s'installa avec sa mère à Mittau.
Là, elle put contempler une autre détresse, plus ancienne et plus grande que celle des Hohenzollern. Louis XVIII et sa cour habitaient le château où la duchesse de Courlande avait régné. Construit dans le style de Versailles, entouré de jardins magnifiques, mais atteint par deux incendies, le vaste édifice était maintenant déchu comme ses hôtes. Ils n'en habitaient pas la totalité. Une caserne et un hôpital militaire se partageaient la masse de l'édifice: une aile moins délabrée avait été mise à la disposition de Louis XVIII. La cour d'honneur était divisée en deux, une partie réservée au prétendant, une partie aux soldats malades, et dans l'hôpital se succédaient par convois, depuis la guerre, les Français blessés et prisonniers, évacués sans ordre ni secours. Quel spectacle: une ruine de palais offerte à la ruine d'une race, une ombre de Versailles hantée par des ombres de Bourbons, et ces fantômes royaux, pour qui vivent seulement les choses mortes, rejoints au fond de l'Europe par la réalité, envahis dans leur émigration par la France nouvelle, exposés jusque sur l'asile étranger où la légitimité abrite ses derniers espoirs au démenti de Français qui combattent, souffrent et meurent pour un autre maître et sous un autre drapeau. Dorothée vit surtout, avec la curiosité attentive et souvent cruelle de l'enfance, toutes les laideurs qu'il y a dans la disgrâce. Elle n'est pas tendre pour ce petit monde, jaloux, fier et gueux, en quête de maigres faveurs et «d'un bon dîner». Elle respecte seulement l'archevêque de Reims, «le seul des serviteurs du roi qui conservât de la dignité dans le malheur», et l'abbé Edgeworth qui allait mourir victime de sa charité pour nos prisonniers. Elle a pour la reine une répulsion physique:
«Je n'ai jamais vu une femme plus laide ni plus sale. Ses cheveux gris, coupés en hérisson, étaient couverts d'un mauvais chapeau de paille tout déchiré. Son visage était long, maigre et jaune. Sa taille petite et grosse soutenait, je ne sais comment, un jupon sale, sur lequel flottait un petit mantelet de taffetas noir tout en loques. Elle me fit peur la première fois que je la vis.»
Chez le duc d'Angoulême, tout en dévotions et en chasses, elle trouve l'insignifiance. Seuls la duchesse d'Angoulême et le roi l'intéressent. Madame Royale secourt nos prisonniers français, il est interdit de parler devant elle de nos revers, et Dorothée admire «la fille de Louis XVI proscrite, le cœur déchiré par d'affreux souvenirs, cédant à la pitié envers des Français… Que l'auréole du malheur lui seyait bien! J'avais souvent l'honneur de la voir, d'abord, chez ma mère où elle ne venait jamais sans me demander, à la promenade où elle me rencontrait quelquefois, dans son intérieur où elle m'admettait avec bonté, mais plus souvent encore à dîner chez le roi».
Du roi, elle raconte la bienveillance souriante: «Il me prenait sur ses genoux, m'embrassait, me nommait, à cause de mes yeux noirs, sa petite Italienne, me questionnait sur mes études, me faisait mille grâces.» À Mittau, elle l'a vu assez souvent pour connaître «par combien d'attentions éloignées ce roi sait montrer sa faveur». En 1822, à Paris, elle a éprouvé jusqu'à quel don d'ignorer les personnes il sait pousser l'indifférence: elle laisse tomber de sa plume une goutte d'amertume, l'amertume de ceux qui se rappellent contre ceux qui oublient. «Jamais le roi ne m'a témoigné le moindre souvenir de ses anciennes bontés, lorsque je passe maintenant comme une ombre deux fois l'année devant son fauteuil.»
À Mittau, sa grande joie fut la présence de Piattoli. Il était revenu lui aussi de Pétersbourg. «J'allais souvent causer dans sa chambre et il bornait ses leçons à diriger le choix de mes lectures et à me faire rendre compte des impressions qui m'en étaient restées. D'ailleurs, que de questions, n'avais-je pas à faire sur le prince Czartoryski?» Tout ce qu'elle apprend lui plaît; même qu'il craigne de n'être pas assez jeune. Elle répond qu'elle a quinze ans et les goûts de l'âge mûr, elle empreint de gravité sa conversation et ses manières, elle «met ses soins à se vieillir», et à cette coquetterie ses jours s'écoulent délicieux.
L'été de 1807 commençait, apportant, outre la joie à une jeune fille, la paix au continent. Alexandre, après Friedland, était las de la lutte contre la France, et préparait le traité de Tilsitt. C'était, par l'amitié des deux empereurs, le concours de la France retiré à la Pologne, le sort de cette nation remis à la générosité russe, la ruine de la politique soutenue par le prince Czartoryski. Déjà il avait quitté le ministère et voulut se rapprocher de Tilsitt, non plus par l'espoir de changer, mais par la hâte de connaître ce qui se préparait. Le désir de voir la jeune princesse de Courlande le poussait aussi vers Mittau. Il y resta trois semaines, logé chez la duchesse.
«Je sentis pour la première fois de l'embarras et une extrême timidité lorsqu'en entrant, à l'heure du dîner, dans le salon de ma mère, je vis le prince, et qu'à table, ma place se trouva à côté de la sienne.» Il était sombre. Le pressentiment que trois campagnes désastreuses avaient blessé à mort la confiance d'Alexandre dans le conseiller de la guerre, et que perdre l'amitié de l'empereur était devenir inutile à la Pologne, mettait sur un visage toujours un peu triste une ombre dure, et creusait aux plis de la bouche, facilement dédaigneuse, comme des cicatrices de désenchantement. Elle comprit qu'il souffrait, que cette souffrance était noble, elle l'en admira davantage et, pour le comprendre, n'eut pas besoin qu'il parlât. Car l'étrange amoureux ne lui disait rien et se contentait de la regarder. Attiré par ce charme de jeunesse, il se défendait contre lui-même, songeait sans cesse aux deux âges si différents, «Tandis que nous étions silencieusement à nous observer et à nous deviner, le traité de Tilsitt fut rendu public, l'empereur traversa Mittau pour retourner dans la capitale, il s'arrêta chez ma mère, fut charmant pour elle et pour moi et m'aurait complètement enchanté si je ne lui avais trouvé de la froideur pour le prince Adam.» Le prince suivit son maître à Pétersbourg. La veille de son départ, il s'adressa pour la première fois à la jeune fille, et la pria avec insistance de revenir à Berlin par Varsovie.
C'était, comme les sages, dire beaucoup en peu de mots. À Varsovie habitait la mère du prince, pour laquelle il professait un culte. Elle avait une de ces volontés impérieuses qui imposent volontiers aux autres les bonheurs qu'elles ont choisis pour eux. Depuis longtemps elle élevait près d'elle, pour son fils, une jeune parente et portait in petto cette bru, un peu comme les papes les cardinaux qu'il est trop tôt pour déclarer. Le prince devinait ce désir, voulait s'y soustraire sans désobéir, et comptait sur la visite et la grâce de Dorothée pour vaincre la mère après le fils. Dorothée fut aussitôt prête au voyage, mais elle ne pouvait l'entreprendre seule, et ce n'était pas peu d'embarras que ce détour dans une région ravagée par la guerre. La duchesse ne s'en soucia point; Piattoli était de nouveau à Pétersbourg, mademoiselle Hoffmann ne se connaissait en routes que sur la carte du pays de Tendre. Dorothée dut, en décembre 1807, rentrer droit à Berlin.
Elle quittait à Mittau des infortunes royales, elle les retrouva à Memel où la famille de Prusse attendait le bon plaisir de Napoléon. Celles-ci lui étaient plus chères. Elle passa un jour dans cette ville auprès de sa marraine, la princesse Louise, «nous pleurâmes ensemble sur son frère et sur les malheurs de la patrie». Elle pleura aussi avec la reine: dans un long portrait elle juge la femme malheureuse avec le plus respectueux enthousiasme et la femme belle avec l'exacte justice qui, rendue par une jolie femme, est encore de l'affection.
«Le jour où je la vis, hélas! pour la dernière fois à Memel, elle avait une robe très simple de mousseline blanche et portait à son cou un rang de perles. Je les admirais.—Oui, me dit-elle, je me suis permis de les conserver. Les perles, en Allemagne, signifient des larmes, elles peuvent me servir de parure.»
Puis la tristesse de la route se prolonge à travers un pays naguère peuplé et riche, où maintenant règne la dévastation. «Des villages entiers étaient déserts, d'autres réduits en cendres, les petites croix des cimetières semblaient plus pressées; la disette et une horrible épidémie régnaient dans ces malheureuses contrées; les hommes, les animaux mouraient avec une rapidité effrayante.» C'est la grande misère au pays de Prusse. Les désastres que la jeune fille contemple lui annoncent ceux qu'elle ignore: elle est en Prusse une grande propriétaire, que reste-t-il de ses domaines? Elle arrive à Berlin: dans son palais, elle est réduite à «une mauvaise chambre au fond d'une seconde cour»; c'est à grand'peine qu'elle obtient deux pièces pour elle, pour la duchesse deux, et de celles qu'en d'autres temps occupaient les femmes de service. Elle souffre avec une sensibilité exaspérée les calamités générales qui lui apportent des épreuves personnelles, et chacune de ses douleurs accroît son aversion contre les Français auteurs de tous ces maux. Elle se vêt de noir, évite les rapports avec le vainqueur, entr'ouvre sa porte aux plus Allemands de ses anciens familiers, à ceux qui pleurent leur défaite et ne l'acceptent pas. La duchesse arrive quelques semaines après sa fille, et dans des sentiments tout contraires. Ses intérêts, presque tous en Russie, sont en sûreté, l'alliance d'Alexandre avec Napoléon comble les vœux d'une femme attachée à l'un par une tendre reconnaissance, à l'autre par un enthousiasme croissant. Elle fraye avec la société française.
Ainsi passèrent les premiers mois de 1808. Dorothée aurait cette année quinze ans. On s'avisa que l'on avait oublié, parmi tant d'affaires, la première communion. Cette cérémonie, en Allemagne, précède l'entrée d'une jeune fille dans le monde. Mademoiselle Hoffmann était trop attachée aux pratiques de la bonne société pour ne pas mettre son élève en règle avec les usages. La tristesse nationale, qui suspendait les distractions, permit de trouver, sans trop de regrets, les heures préparatoires à la cérémonie. Un pasteur vint, par leçons de deux heures, deux fois par semaine, durant trois mois, apprendre à la jeune fille qu'elle était chrétienne. Ce fut à peu près cinquante heures, l'étendue de deux jours: il n'est pas d'art d'agrément qui n'exige plus d'apprentissage. Même à une fille qui avait appris à lire en une semaine, le pasteur n'avait pas le temps d'exposer la religion. Quelques lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament et, sans aucun examen des dogmes par où les Églises diffèrent, un abrégé des doctrines morales «qui auraient pu convenir également à un calviniste, à un catholique et à un grec» remplissent ce peu d'heures. Et ce peu fut assez pour entr'ouvrir à la jeune conscience un infini où se perdaient sa petite existence, les avantages dont elle était fière et les bonheurs qui l'avaient occupée jusque-là. Elle se trouva assez pénétrée par ce premier rayon d'une lumière nouvelle pour que le pasteur changeât quelque chose au rite ordinaire des cérémonies. Dans le culte luthérien, la confirmation précède la communion et est précédée elle-même de certaines formules que l'impétrant récite par cœur. Le pasteur voulut que Dorothée rédigeât elle-même sa profession de foi. «Elle montrait, disent les Souvenirs, le désir d'un jeune cœur d'être agréable à Dieu qu'il commençait à connaître.» Le vendredi saint avait été choisi pour la solennité. Selon l'usage de ce jour, tous les assistants étaient en deuil et ils étaient nombreux; les serviteurs, les amis, les curieux formaient une foule devant laquelle la jeune princesse prononça son petit discours. Elle n'était pas encore assez élevée au-dessus de la terre pour ne pas s'apercevoir qu'il fut bien accueilli, ne pas prendre plaisir aux pleurs de l'assistance. Quelque complaisance pour son personnage survit dans ces mots: «Tout Berlin voulait me voir et m'entendre.» Mais quand elle se sentit engagée parmi les fidèles, c'est-à-dire appelée à accepter la vie non comme «une carrière heureuse et brillante», mais comme une lutte pénible et perpétuelle, son impression profonde fut une détresse, une crainte, une angoisse telles que vers la fin de la cérémonie, elle perdit connaissance.
Heureuse l'âme où la loi divine commande dès que l'intelligence s'éveille. Comme à cette âme l'impératif du devoir se révèle en même temps que l'attrait du plaisir, elle commence en équilibre, elle reconnaît comme l'ordre nécessaire cette jouissance imparfaite et fragile de tout, ses renoncements sont aussi vieux que ses espoirs, elle sait que, surtout quand il s'agit de bonheur, nous devons rester sur notre faim. Mais si toutes les faveurs de ce monde comblent une jeune vie sans que la pensée de Dieu les tempère, si elles sont goûtées avec plénitude et avec avidité, comme le seul bien de l'existence, et si dans cette existence où l'habitude de se satisfaire est prise, Dieu apparaît en retard, pour révéler le vide des plaisirs et la loi des renoncements, il semble un maître cruel. La découverte du devoir est, pour l'être avide et charmé du présent, la désillusion la plus décevante. Elle est l'interdit jeté sur tous les bonheurs, le carême qui met fin au bal costumé, et présente le cilice et les cendres. Le premier appel de la vérité religieuse entendu à quinze ans par une jeune fille jusque-là païenne, privilégiée de la vie et tout aux bonheurs humains, devait retentir à son oreille comme un ordre de captivité impitoyable. Il était naturel qu'après en avoir d'un premier regard contemplé la tristesse, elle s'échappât vite dans l'oubli. Et c'est longtemps après, quand tous les bonheurs cueillis se fanèrent entre ses mains, quand toutes ses fleurs de printemps s'effeuillèrent dans son automne, qu'elle devait sentir la douceur consolatrice des croyances immortelles, et que, la terre devenant pour elle la prison, elle chercha plus loin l'espérance.
Le lendemain de cette première communion, la duchesse annonça son départ. Ses sympathies françaises s'étaient affirmées à Berlin, de façon à refroidir son ancien attachement aux souverains de Prusse et à rendre sa situation fausse à leur prochain retour. Elle allait donc s'établir dans ses propriétés de Saxe, à Löbikau, où elle attendrait Dorothée, où les prétendants viendraient vite, et d'où, sa fille mariée, elle partirait pour connaître enfin la terre promise, la France. À l'été de 1808, en effet, Dorothée rejoint sa mère. Le château de la duchesse, comme elle l'avait prévu, se remplit d'épouseurs princiers et, en les nommant, les Souvenirs prennent un petit air d'almanach Gotha. La plupart pauvres n'en sont que plus résolus, et comme leur naissance leur donne droit à l'indiscrétion, ils s'installent à demeure pour se déclarer, se surveiller, se desservir et se faire des alliés. «Le médecin, la demoiselle d'honneur, les amis, les connaissances, tous étaient employés, chacun d'eux était dans les intérêts d'un de mes amoureux.» Mais, comme à Berlin, à Löbikau l'existence de la mère et de la fille se rapproche et ne se confond pas. Chacune est chez elle. «J'habitais un joli pavillon quarré, placé au milieu d'un parc charmant, à une demi-lieue du château de ma mère.» Et son plaisir est de «se rendre invisible» aux soupirants. Elle va chez sa mère aux heures où ils ne peuvent forcer la porte; quand sa mère les lui amène au pavillon, elle les accueille «sans se montrer flattée ni touchée», se fait, pour les décourager, volontairement «insensible et dédaigneuse». Elle s'étonne qu'ils s'obstinent; elle ignore la persévérance qu'il y a dans un soupirant dont le cœur est plein et la bourse vide, et elle les voudrait plus nombreux encore pour que le prince Adam apprît à la fois leur recherche et leur insuccès.
Le prince Adam savait par Piattoli installé à Löbikau. Il écrivit à l'abbé qu'il allait de Varsovie conduire sa mère aux eaux de Bohême, et que de là il viendrait avec elle demander la main de Dorothée. Mais, s'il était constant, sa mère l'était aussi pour sa bru préférée; elle se défia d'une guérison qui la mettrait sur le chemin d'autres fiançailles, et remit à l'année suivante la cure et la demande.