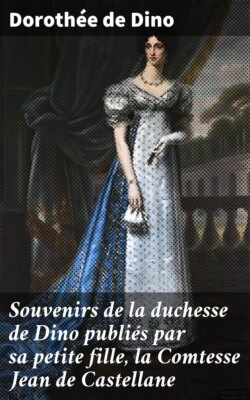Читать книгу Souvenirs de la duchesse de Dino publiés par sa petite fille, la Comtesse Jean de Castellane - Dorothée de Dino - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
Pour cette petite fille s'instruire était apprendre ce qu'elle voulait, de qui elle voulait, et quand elle voulait. Vivre était agir comme elle voulait.
Le palais de Berlin, où depuis la mort de son père elle est revenue, lui appartient. Ce n'est pas elle qui habite chez sa mère, mais la mère qui habite chez sa fille, et non avec elle. La demeure s'étend assez vaste pour que plusieurs familles y tiennent à l'aise, chacune dans ses appartements. La duchesse occupe une partie de l'édifice, et Dorothée une autre. «Je savais beaucoup trop que la maison m'appartenait, que j'étais servie par mes gens, que mon propre argent payait mes dépenses, et qu'enfin mon établissement était complètement séparé du sien. J'allais le matin lui baiser la main, de temps en temps elle venait dîner chez moi. C'est à quoi se bornaient nos rapports.»
La duchesse vivait pour ce groupe de quelque cent personnes qui, perdu dans la masse de deux milliards d'êtres humains, croit exister seul et s'appelle le monde. À Berlin, elle avait, par sa richesse, son rang et l'amitié de la famille royale, toutes facilités pour se choisir une petite cour dans la grande. Mais un irrespirable ennui émanait de cette noblesse toute gourmée de préséances: cette société vivait trop en gradins pour laisser place au plain-pied d'une compagnie. Frédéric II s'était délassé de l'apparat cérémonieux par les parties fines où il s'encanaillait d'esprit avec quelques familiers, instruits et gais sans être nés. L'air léger et joyeux qui soufflait de France, quelques-uns, en Allemagne, l'avaient respiré, mais demeuraient épars: la cour, la bourgeoisie, les lettrés vivaient, chacun à son étage, dans Berlin terne, hiérarchique, superposé. Deux ou trois salons de riches Juives étaient les seuls où l'on tentât de réunir cette dispersion. Elles n'appartenaient à aucune classe, il leur était moins difficile de nouer des rapports avec toutes, et les gens de diverse origine résistaient moins à se rencontrer chez elles, comme en pays étranger. Ce qu'elles essayaient, la duchesse l'imposa. Il ne lui suffisait pas de s'ennuyer en bonne compagnie. Elle aimait la conversation, il lui fallait l'esprit des autres pour frotter le sien contre, et faire des étincelles. À l'élite des visiteurs étrangers et de la noblesse berlinoise, tout naturellement groupés dans son salon, elle mêla des savants, des littérateurs, des artistes. C'était pour elle une élégance originale et une couronne de plus que devenir égalitaire au profit de l'intelligence; écrivains, poètes, musiciens, lui surent gré de leur ouvrir une aristocratie jusque-là fermée; les nobles consentirent, parce qu'elle était princesse, à frayer chez elle avec des roturiers. Elle fut donc, selon son désir, l'attrait et l'arbitre d'une société qui ne ressemblait à aucune autre, éclipsait toutes les autres, faisait une petite révolution, et dans Berlin rappelait Paris par les élégances des mœurs anciennes et les amusements des idées nouvelles.
Rien de tel, pour soutenir la conversation, que de renverser et de reconstruire la société. La duchesse avait aimé d'abord la philosophie du XVIIIe siècle pour l'agrément que le doute et le rire ajoutaient aux entretiens, et savait gré à la France de lui avoir fait ces joies. Lorsque les rêves humanitaires finirent en tragédies sanglantes, la majesté d'un peuple debout pour défendre son sol, puis la plénitude de sa victoire débordée sur l'Europe cachaient à la spectatrice lointaine les tyrannies par les conquêtes, elle ne voyait les crimes qu'à travers les gloires. Et quand, aux limites du passé et de l'avenir, s'éleva, maître de la paix et de la guerre, arbitre de l'Europe comme de la France, l'homme incomparable qui semblait préparé de longtemps par les siècles et prêt à fonder pour des siècles une société où se réconcilieraient les âges, la duchesse s'éleva elle-même de la philosophie à l'enthousiasme et, dans ce salon cosmopolite, régna l'influence française.
Dorothée ne paraissait guère dans ces réunions. La précocité de son intelligence lui eût rendu intéressants quelques-uns parmi les causeurs, mais ils ne songeaient pas à partager leurs attentions, toutes à la mère. Elle n'est là qu'une petite fille: elle n'a qu'une porte à franchir et rentre chez elle grande dame. Elle y trouve presque chaque jour un mot de sa marraine qui l'appelle au palais Radziwill, là elle ne partage avec personne l'attention, les caresses, les gâteries, et connaît la douceur d'un foyer familial. Souvent invitée au palais royal, elle s'associe aux jeux du prince héritier: elle est son aînée d'un an et goûte l'autorité de l'âge. Mais c'est surtout chez elle que tout se meut autour d'elle et pour elle. Là, mademoiselle Hoffmann, en cela seulement vestale, entretient le feu sacré d'une admiration toujours égale, et enveloppe son élève de l'attachement un peu subalterne qui, dans la communauté des existences, consacre la hiérarchie des rangs. Elle exalte en son élève le besoin des éloges; accepter les flatteries de ceux à qui serait dénié le droit de critique est l'illogisme des grands hommes, comment n'eût-il pas été celui d'une petite fille? Seule la duchesse aurait pu remettre tout en équilibre par la mesure dans les éloges et l'autorité dans les reproches. Faute qu'elle revendique la place, elle la laisse à l'institutrice, qui préfère ne pas s'amoindrir en partageant avec la mère, et, dans l'existence à part où elle retient son élève, insinue ses propres relations. Ce n'étaient pas des amitiés ancillaires: mademoiselle Hoffmann cherchait et méritait la familiarité d'esprits cultivés. Elle les avait rencontrés dans la bourgeoisie de Berlin «pleine de savoir et de talent», dit Dorothée, qui ajoute: «ce n'était pas une société où par mon rang je fusse naturellement placée.» Ces visiteurs entrés par la petite porte ne pénétraient pas en égaux. Parmi eux l'enfant était «toujours et à une grande distance la première». Il fallait qu'elle eût beaucoup de sens pour ne pas le perdre avec des gens qui, de sa cuisine à ses fantaisies, trouvaient tout parfait: et ses fantaisies ne valaient toujours pas sa cuisine. Ainsi elle avait à Tannée sa loge au théâtre, où deux acteurs régnaient alors, madame Unzelmann et Iffland qui parut à madame de Staël n'avoir pas d'égal en France. Dorothée jugea qu'ils l'intéresseraient même hors de leurs rôles. Mademoiselle Hoffmann n'avait rien à refuser à son élève et, d'après les Souvenirs, «Iffland n'avait rien à refuser à mademoiselle Hoffmann». Les deux acteurs deviennent donc familiers chez la petite princesse; elle délibère avec eux sur les costumes, les programmes, ils lui récitent et lui font déclamer des vers. Par la parfaite convenance de leur attitude ils eussent été à leur place partout, «excepté chez une jeune personne»: Dorothée l'écrit à vingt-neuf ans, mais personne ne lui avait dit au moment utile. Elle les adopte et les impose, familiarités imprudentes qui lui en préparent une illustre. Ces deux interprètes de Schiller avaient communiqué à Dorothée leur enthousiasme pour le poète. Celui-ci voulut voir sa jeune admiratrice, et, depuis, «Schiller ne s'arrêta pas à Berlin sans qu'il me fit l'honneur de venir chez moi». D'autres écrivains eurent envie de se plaire où il se plaisait. Jean de Müller, Humboldt que Dorothée avait rencontrés chez sa mère, Ancillon, qu'elle avait conquis au palais royal, l'astronome Bode qui, pour elle, laissait un instant ses étoiles accoutumées, vinrent en habitués chez une fillette. Et elle se rend cette justice: «Je n'ai jamais mieux fait les honneurs chez moi que lorsque j'avais treize ans.»
C'était un salon comme celui de la duchesse, avec un caractère non moins original et tout opposé. Car le sentiment qui remplissait le cœur de la jeune fille était le culte de l'Allemagne où elle était née, dont les souverains l'aimaient, dont les hommes illustres la recherchaient, dont les chefs-d'œuvre l'avaient émue, dont les vertus simples la charmaient, dont elle parlait avec perfection la langue. Elle avait voulu se rapprocher de ceux qui pensaient comme elle. Cette visible préférence leur apportait le plus délicat des hommages, puisque la jeune Courlandaise se faisait leur par son choix, et était pour sa patrie adoptive une espérance et un rayon de printemps. Ainsi le salon dont elle était la petite reine groupait, en face de l'humanisme cosmopolite et de l'influence française qui triomphaient chez sa mère, les partisans les plus fidèles de la culture et de la puissance allemandes.
C'était l'éclatante défaite de Piattoli par mademoiselle Hoffmann. Ni les relations un peu inférieures, ni les familiarités avec les acteurs, ni la préférence exclusive pour l'Allemagne n'auraient été approuvées de ce délicat, si attentif aux formes, et si ami de la France. Comment le gouverneur s'était-il laissé battre? Parce qu'il était absent. Et c'est la richesse qui avait fait à Dorothée ce nouveau dommage. En 1804, la Russie devait encore les indemnités promises pour la cession de la Courlande, les obtenir était difficile. Pour l'emporter sur l'inertie du pouvoir, qui dans tous les pays se plaît aux paiements retardés, et en Russie avait pour loi la volonté du monarque, il fallait, auprès du prince, des protections. À ce moment le ministre des affaires étrangères à Saint-Pétersbourg était le prince Adam Czartoryski. L'abbé l'avait beaucoup connu, la duchesse pensa à Piattoli comme négociateur. Sans doute, c'était interrompre, au moment où ils prenaient le plus d'importance, ses soins auprès de Dorothée qui atteignait onze ans. Mais, entre l'éducation d'une fille, fût-elle Dorothée, et le recouvrement d'une créance nécessaire à la splendeur familiale, pouvait-on hésiter? Le bon Piattoli avait donc quitté, les larmes aux yeux, son élève et pris la route de Pétersbourg.