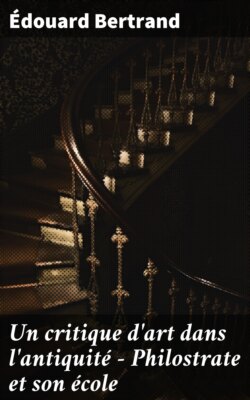Читать книгу Un critique d'art dans l'antiquité - Philostrate et son école - Édouard Bertrand - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Histoire du débat que Philostrate a suscité en Allemagne.
ОглавлениеPhilostrate a-t-il, dans ses descriptions, retracé de véritables tableaux qu’il avait sous les yeux, ou doit-on reconnaître que ses peintures sont inventées et sa galerie imaginaire? S’il a eu pour modèles de véritables tableaux, avec quel degré d’exactitude les a-t-il reproduits, et quelle est la mesure de la confiance qu’on peut lui accorder? Tel est le problème que se sont posé les érudits allemands et qu’on rencontre tout de suite en abordant Philostrate. On en comprend toute l’importance, et l’on ne s’étonnera pas de l’ardeur qui a régné dans la discussion. Il s’agit de savoir si Philostrate peut servir à l’histoire de l’art. Dans la disette où nous sommes de documents, un ouvrage tel que le sien est extrêmement précieux si on peut en tirer de sûrs renseignements sur la peinture des anciens. Par exemple, l’esthétique se demande jusqu’à quel point l’art peut introduire dans ses représentations l’affreux et l’horrible. Lessing examinant ce point dans son Laokoon va jusqu’à rechercher si ce qui répugne à nos sens mêmes, ce qui en offense la délicatesse, le dégoûtant peut devenir en quelque degré un élément d’une œuvre d’art. Telle est l’autorité du goût des anciens dans ces questions qu’on serait heureux de connaître ici leur pratique, sinon leur doctrine. Or, nous trouvons dans Philostrate plusieurs tableaux où l’horrible s’offre à nous: l’horrible dans l’art a donc été connu des Grecs. Attendez! disent les Allemands; ce tableau est-il authentique? Peut-on le considérer comme un document sérieux pour l’histoire de l’art?
Il faut donc vérifier les titres de Philostrate à notre créance et s’assurer de sa sincérité. Pour cela, l’Allemagne s’est livrée à une enquête qui dure depuis près d’un siècle: tâche difficile, puisque le principal moyen de contrôle manque aux investigations, savoir les tableaux mêmes décrits par le rhéteur. Les anciens citent bien quelques tableaux de maîtres dont les sujets répondent à ceux des Images; mais que prouve la conformité des sujets relativement à l’identité des peintures? En l’absence des tableaux mêmes avec lesquels on eût confronté les descriptions du sophiste, tous les moyens ont été tentés par les savants pour découvrir la vérité dans cette question. Une polémique s’est engagée entre eux, vive, acharnée même, avec les péripéties les plus curieuses et les plus piquants conflits d’opinions. Avant d’aller plus loin, il nous paraît intéressant d’en dire un mot. Nous allons donc en retracer sommairement l’origine et les principales phases; car il est impossible de toucher aujourd’hui à Philostrate sans considérer le problème posé et discuté par la science allemande.
La question qui devait tant passionner les érudits au-delà du Rhin et à laquelle les archéologues français sont restés jusqu’ici étrangers est pourtant née en France. C’est vers la fin du dix-huitième siècle qu’elle a surgi. Comme l’antiquité, la renaissance avait cru à Philostrate. Même au dix-huitième siècle de grands savants, Winckelman, Lessing, Visconti n’avaient pas conçu le moindre soupçon sur l’authenticité des Images, lorsque le comte de Caylus, dans un de ses ouvrages, la révoqua tout à coup en doute , se fondant sur cette observation que l’unité manque à plusieurs de ces prétendus tableaux du rhéteur. Malgré la négation de Caylus, Torkil Baden (1792) reste fidèle à la croyance établie, et porte dans l’appréciation de Philostrate un esprit de sagesse et de mesure vraiment remarquable. Il ne touche qu’à quelques points; mais rien de plus judicieux que sa critique, de plus varié que ses aperçus, tous fins et ingénieux. Avec Heyne le doute se réveille (1796). Esprit éminemment critique, il examine, discute, agite diverses questions, mais ne conclut rien. Sa pensée reste pleine d’incertitude; un désir la domine: celui de dégager le sujet de chaque tableau des ornements dont il lui semble surchargé et qu’il appelle «un fard de rhéteur». En 1818 la question que Heyne avait laissée indécise est reprise par Gœthe qui la tranche en poète. Pour lui, la sincérité de Philostrate est hors de doute: il croit à ses tableaux et les admire avec enthousiasme. Ce que Heyne avait essayé en critique, il l’entreprend en artiste, remplaçant la sagacité qui analyse par l’intuition qui devine. Il s’empare des descriptions de Philostrate, et les refait à sa mode, sans en modifier le fonds, mais en dégageant, en restituant le tableau. A Weimar, on songe même à publier les Images avec planches; mais des circonstances particulières arrêtent l’entreprise.
L’autorité de Philostrate, amoindrie par Heyne, s’était donc relevée, grâce à l’admiration d’un juge tel que Goethe, lorsqu’elle rencontre un nouvel appui dans deux savants éminents: les conclusions du poète se trouvaient acceptées par l’érudition philologique et archéologique. En 1825, Jacobs et Welcker mettant au service du rhéteur tout ce qu’ils ont de science expliquent les-Images par un intéressant commentaire. Au nom du texte scruté et approfondi avec le dernier soin, au nom des monuments les plus divers savamment et ingénieusement rapprochés des descriptions, ils rendent un arrêt favorable au rhéteur.
La science allemande avait admis ce verdict, et, sur la foi de Gœthe et de Welcker, l’opinion dominante était pour l’authenticité des Tableaux, lorsqu’un nouvel érudit, Friederichs , émit en 1860 un sentiment tout à fait contraire aux idées reçues, et prétendit démontrer que tout est faux dans Philostrate. Une affirmation aussi absolue ne pouvait manquer de susciter une réplique. C’est Brunn qui répondit , et qui pour défendre Philostrate dépensa autant d’érudition que Friederichs pour l’attaquer. Le rhéteur grec avait donc rencontré à la fois un adversaire et un défenseur également ardents et convaincus; le débat relatif aux Tableaux avait atteint son plus haut degré de vivacité et de passion. Chacun des deux critiques a des principes tout différents: l’un part des idées, l’autre, des faits; le premier invoque la théorie de l’art et s’appuie sur les principes de Lessing; l’autre, avec Welcker dont il ne fait, dit-il, que développer les idées et suivre les indications, en appelle à l’autorité des monuments, déclarant que la question de Philostrate ne peut être résolue que par «l’archéologie pratique».
En terminant son ouvrage, Brunn avait signalé des points de vue nouveaux pour la solution de la question. Ce sont ces indications que recueille en 1867 un nouvel archéologue, Matz . Les deux méthodes théorique et empirique ayant été successivement appliquées celui-ci les laisse de côté pour en suivre une nouvelle. Il se tourne vers les sources écrites et interroge toute cette partie de la littérature dans laquelle se rangent les descriptions de Philostrate, rapprochant et discutant les textes, opposant quelquefois le rhéteur à lui-même et le confondant par lui. La méthode manque à la critique de Matz qui est embarrassée et confuse; ses conclusions ne sont pas aussi nettes que celles de ses deux prédécesseurs; on voit plutôt ce qu’il refuse à Philostrate que ce qu’il lui accorde. Ce qui peut être dégagé, en somme, de son argumentation, c’est ceci, que vu l’impossibilité où l’on est de distinguer dans les descriptions controversées la part du peintre et celle du rhéteur, Philostrate ne peut être consulté avec sûreté ni servir aux progrès de l’histoire de l’art. C’est aussi l’opinion que formule Nemitz qui, en 1878, essaie de résumer ce long débat et prétend poser avec impartialité les dernières conclusions.