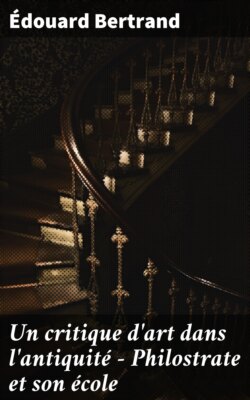Читать книгу Un critique d'art dans l'antiquité - Philostrate et son école - Édouard Bertrand - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Les deux principaux adversaires: Friederichs et Brunn. — Opinion de Welcker.
ОглавлениеNous ne nous proposons pas de prendre part nous-même à ces combats de l’érudition archéologique, car notre dessein est de nous placer dans notre étude de Philostrate à un autre point de vue que les Allemands. Toutefois, comme nous louerons dans ce dernier le critique d’art, il nous importe de ne pas laisser entièrement sans réponse les inculpations diverses dont il a été l’objet; et, comme, d’autre part, les attaques les plus hardies et les plus violentes dirigées contre lui sont parties de Friederichs, c’est la critique de ce dernier que nous allons considérer et discuter, opposant à ses vues étroites et à sa vicieuse méthode les larges aperçus et la triomphante réfutation de Brunn.
Friederichs s’est créé un certain idéal de l’art grec, en prenant cet art à sa meilleure époque; et c’est d’après cet idéal qu’il juge tous les tableaux de Philostrate. Aussitôt qu’il trouve dans une de ses descriptions un détail qui n’y répond pas et qui contredit les principes de l’art tels qu’il les conçoit dans leur pureté et leur intégrité, l’œuvre est condamnée, le tableau n’est pas ouvrage de peintre, mais invention de rhéteur: il n’a pas pu ni dû exister. Telle est la méthode de Friederichs.
On ne peut nier qu’elle n’exige beaucoup de science; malheureusement, elle est fausse et stérile. Et d’abord cette critique dogmatique n’est plus conforme à la doctrine de notre temps; on a reconnu combien elle était étroite, sujette à l’erreur et à l’esprit de système. Ce type, en effet, auquel vous rapportez toutes les œuvres possibles, est-il bien le véritable exemplaire dé la beauté ? D’ailleurs, cette beauté même, n’a-t-elle pas des manifestations diverses, non seulement selon la différence des nations et des siècles, mais aussi, dans la même nation, à différentes époques? Ne voit-on pas que le génie déconcerte à chaque instant les règles et qu’on ne peut, d’après ce qu’il a inventé, prévoir ce qu’il créera un jour?
En supposant que cette méthode fut bonne, est-on certain de posséder le type de l’art grec, de connaître tout ce que cet art a osé, et quelles limites il n’a pas voulu franchir? Les monuments qu’il est permis d’interroger, nombreux sans doute, sont-ils suffisants pour déterminer ses lois avec une sûreté infaillible? Et s’il est à craindre que quelque nouvelle découverte n’amène des cas nouveaux, peut-on être sûr des principes d’après lesquels on juge; peut-on en vertu de ces principes rendre des sentences irrévocables?
Enfin, si l’on admet le type connu avec pieine certitude, on peut à la rigueur déterminer la valeur de l’œuvre en la rapportant au goût du meilleur siècle de l’art; mais quelles inductions est-il possible d’en tirer relativement à son authenticité ? C’est pourtant ce que prétend Friederichs. En effet, de ce qu’une œuvre n’est pas conforme aux principes du grand art, est-ce une raison de conclure qu’elle n’a pas existé ? L’art dans l’antiquité a eu des époques diverses. La période d’Alexandre et de ses successeurs a été la plus brillante; la période romaine est une décadence. Il est à supposer qu’un certain nombre des tableaux décrits par Philostrate appartiennent à des temps où le vrai goût s’était altéré. Jugez de leur valeur, si vous le voulez, d’après les principes qui régissaient l’art alors que le grand goût était florissant, mais ne les condamnez pas comme des œuvres qui n’ont existé que dans l’imagination d’un rhéteur.
Cette critique n’est pas seulement vicieuse par la méthode; elle est inintelligente. Rien de plus mesquin et de plus étroit qu’elle. Elle prend tout au pied de la lettre: c’est une fâcheuse interprète d’une œuvre poétique. Malheur au mot un peu osé, au terme métaphorique! Elle s’acharne sur ce mot, le discute et le condamne; tout ce qui est goût et sentiment lui est étranger. Elle a encore le défaut d’être passionnée; elle a un parti pris contre Philostrate; ce n’est plus un jugement, c’est un réquisitoire âpre et violent. Le critique accuse et dénonce le coupable devant le tribunal des érudits: c’est un véritable faussaire. Ces tableaux qu’il prétend décrire, qu’il donne pour vrais, ne sont que des créations mensongères.
Heureusement, la fourbe se trahit souvent, et une critique attentive n’a pas de peine à la surprendre. Ainsi, Philostrate, n’entend absolument rien à l’art. On pourrait lui supposer au moins quelques notions de la peinture, puisqu’il se mêle d’en parler, qu’il en professe l’amour, qu’il l’a étudiée dans la société d’un habile artiste dont il a fait, à cet effet, son hôte pendant quatre ans; nullement: il ignore tout, même les premières lois. Inventeur de tableaux, il les compose en dépit de tous les principes du bon sens et de toutes les règles. Il confond les conditions de la peinture et de la poésie; il substitue à chaque instant les images de l’une à celles que l’autre réclame, et prétend rendre visible pour les yeux ce qui ne l’est que pour l’imagination. Il crée des personnages que l’artiste ne saurait montrer sur la toile, des sujets impossibles, contraires à toutes les conditions de l’art. Il viole grossièrement les principes les plus essentiels, celui de l’unité par exemple, accumule dans un même tableau ce qui appartient à diverses actions ou à différents moments de la même action, c’est-à-dire qu’il confond plusieurs tableaux en un seul. Ainsi, sa mauvaise foi n’a d’égale que son ignorance, qui est lourde et grossière.
Soit, direz-vous; mais au moins a-t-il une certaine connaissance de l’art grec. Erreur complète! Il n’entend rien aux attributs par lesquels cet art caractérise les figures des dieux et des héros, rien aux personnifications dont il use si souvent, rien à ses habitudes. 11 lui prête des sujets qu’il n’a pu traiter et qui répugnent à son génie. Il faut que ce soit un moderne qui lui enseigne ce que c’est que cet art, quels sont ses principes, ses traditions; un moderne qui en a plus appris en déchiffrant des débris mutilés que lui, un ancien, en contemplant les œuvres elles-mêmes dans leur belle intégrité.
Pourtant, c’était un homme instruit que ce Philostrate; il connaissait les poètes, il les aimait, il s’en souvient et les cite souvent. C’est ce qui l’a perdu! Il les cite trop; ce sont leurs inventions qu’il présente comme siennes, leurs expressions dont il se pare; il faut renvoyer à Homère, à Pindare, à Eschyle, à Euripide, à Théocrite tout ce qu’il leur a ravi: il n’est riche que de leurs dépouilles! Laissez-nous, du moins, le rhéteur, l’homme d’esprit. Oui, le rhéteur, si vous voulez, mais un rhéteur misérable, habile artisan de vaines phrases, qui revêt tout de la même parure oratoire, gâte ses récits par de malencontreuses amplifications, et, dans la description d’un tableau, qui demanderait un dessin juste et précis, prodigue les plus grossières couleurs.
Nous n’exagérons rien: c’est avec ce ton, avec cette passion que Friederichs attaque Philostrate, et nous n’avons résumé ses griefs que pour montrer toute la vivacité du débat. Brunn répondit, comme nous l’avons vu. La défense fut en raison de l’attaque. Celle-ci avait été hardie; l’autre fut vigoureuse. Brunn était d’autant plus animé à la réplique que Friederichs montrant un parti pris violent blessait les convictions de son adversaire, et détruisait l’autorité d’un ouvrage dont ce dernier s’était servi avec la plus grande confiance, dans son travail sur les peintres anciens.
C’étaient, du reste, deux esprits bien différents, et faits pour se heurter: l’un souvent chimérique dans ses théories, l’autre positif dans ses vues; l’un, systématique, assujétissant tout à ses idées, l’autre partant toujours des données de l’expérience; le premier, borné à un petit nombre de principes dont il poursuit avec âpreté l’application; le second, ouvert, fécond en aperçus de toute sorte et accueillant tous les enseignements des faits. L’esprit vif et judicieux de Brunn a été agacé par la critique si partiale de Friederichs. Il a du savoir, des idées, il défend sa foi et son intérêt le plus cher: de là une polémique vive, animée et riche en saillies; une discussion solide, abondante en faits, et nourrie par une érudition qui n’est surprise sur aucun point.
Nous ne suivrons pas Brunn dans toute son argumentation. Il nous suffira de dire qu’il rappelle Friederichs avec vivacité et autorité à l’étude du texte et des monuments: à un examen approfondi de l’un, que souvent il n’a pas compris, et à une diligente investigation des autres, qu’il doit recueillir dorénavant d’une manière plus complète et consulter avec plus de soin. Quant à lui, c’est surtout aux monuments qu’il s’attache, et c’est des faits révélés par eux qu’il tire les principaux arguments dont il accable son adversaire. Sa conviction profonde est que Philostrate a décrit de véritables tableaux. Il a adopté pleinement l’opinion de celui qu’il reconnaît comme son maître dans cette question, de Welcker. Ce dernier ne proclame pas seulement sa foi entière dans la sincérité de Philostrate, il manifeste le plus vif enthousiasme pour ses tableaux parmi lesquels «il y en a un assez grand nombre qui semblent atteindre à la plus brillante époque de l’art sinon par le travail, dont nous ne sommes pas juges, du moins par l’invention. En les supposant inférieurs par la facilité du pinceau à beaucoup d’autres, on peut dire que si l’on considère le talent et l’art, l’élégance, l’abondance de l’invention, l’élévation, la simplicité (car différentes sont les qualités de ces diverses peintures), il n’y a rien de supérieur à ces tableaux parmi les œuvres qui nous sont connues de la belle époque. Il s’en trouve qui rappellent à la pensée les œuvres d’Apelle, d’Aristide, de Zeuxis, d’Apollodore, connues d’autre part. D’autres révèlent une époque postérieure. Mais de mauvais et de. tout à fait méprisables, il n’y en a point.»
Telle est l’opinion d’un homme considérable dans la science, dont nous oserons opposer l’autorité et la compétence à celles de Friederichs. Cet éclatant hommage rendu par Welcker à Philostrate, Brunn se plaît à le confirmer. Il loue ces œuvres décrites par le rhéteur dont «un nombre considérable nous surprend véritablement par la profondeur de l’intelligence poétique et par l’éclat de la représentation artistique resplendissant dans la description .» Il loue enfin l’art du rhéteur lui-même que la controverse n’a pas du tout rayé, comme le voulait Friederichs, du nombre de ceux qui ont écrit sur l’art, mais à qui elle a assuré parmi eux une place glorieuse.
Les dernières paroles de Brunn ne sont pas seulement une conclusion; elles dégagent aussi dans la question un nouvel aspect. C’est celui que nous nous proposons d’envisager. En effet, les travaux de la critique allemande semblent avoir donné tous les fruits qu’on en pouvait espérer. Il est nécessaire maintenant de changer le point de vue. Telle qu’elle est posée, la question paraît insoluble, si l’on veut une solution rigoureuse: les données précises manquent au problème. L’ouvrage de Philostrate peut servir à des discussions sans fin. La découverte de nouveaux monuments, tout en éclaircissant des points nouveaux, ne suffira pas pour trancher le débat d’une manière décisive. Quant à nous, nous nous contentons pour le moment de la solution à laquelle l’érudition est arrivée. Que la vérité des tableaux de Philostrate soit parfaitement démontrée pour les uns, qu’il reste encore des doutes à cet égard dans l’esprit des autres, ceci ne saurait nous préoccuper.
Laissant, en effet, de côté le problème archéologique, nous ne voulons voir que la question de goût. C’est moins encore le tableau lui-même que nous avons en vue que l’interprétation du tableau, moins l’œuvre de l’artiste que celle du critique. Le premier assurément garde pour nous un bien vif intérêt, mais ce qui nous charme également c’est la manière dont le critique le voit, le décrit et l’explique. Ce point de vue change complètement les choses. Du moment que c’est le critique que nous voulons étudier, on comprendra que Philostrate puisse à ce titre justement revendiquer notre éloge pour ce qui lui a valu de la part des Allemands de graves reproches. De quoi, en effet, le blâment-ils? De ne s’être pas contenté de la description sèche et aride de l’œuvre d’art, d’y avoir mêlé ses impressions et ses lectures, en un mot, de ne pas avoir été un simple interprète, mais un homme de goût. Il a lu les poètes, et s’en souvient volontiers: sera-ce un grief à nos yeux? On n’a pas craint de lui faire un crime de connaître Homère et Pindare, Euripide et Théocrite. Fait-il quelque emprunt à l’un de ces poètes à propos du tableau qu’il décrit? Les érudits allemands voient là une falsification, un mensonge: tout ce qui est invention de style et érudition agréable est condamné par eux impitoyablement. Pour nous, nous ne saurions le trouver coupable d’avoir eu de l’esprit et de l’imagination. Que si, par hasard, il ajoute quelques traits tirés de son propre fonds au tableau qu’il décrit, pourvu qu’il le fasse avec savoir , que l’œuvre n’en soit ni faussée ni altérée dans la conception artistique, nous n’en voudrons pas au critique.
Nous nous rencontrons sur ce point avec le vieux traducteur, Biaise de Vigenère, qui le premier avait émis un soupçon sur l’authenticité des tableaux, mais s’en console en artiste. «Si les tableaux descripts par Philostrate ont esté à la vérité peints tous tels autrefois et exécutez de colore-mens, et qu’il n’aye fait que discourir là dessus pour en laisser au temps advenir la mémoire, prévoyant que leur duree ne pouvait estre si longue comme des statues de bronze ou de marbre dont l’estoffe est bien plus permanente et solide que n’est la toile ne le bois: ou bien que ce soyent quelques nouveaux sujects dressez par luy à l’imitation des antiques (comme il est bien plus vraysemblable) il ne nous en doit pas beaucoup chaloir. Quoy que ce soit en cette si grande et plantureuse variété de lieux communs les peintres ont de quoy pescher à souhait beaucoup de belles fantaisies, les mesler, desguiser et diversifier .»
Ajoutons à ces paroles que le profit n’est pas seulement pour les peintres, qu’il y a encore dans ces descriptions un autre genre d’intérêt pour les modernes, s’il est vrai qu’il soit curieux de voir une œuvre d’art interprétée par un ancien. Du reste, bien des choses qui dans ce que nous allons dire rehausseront le talent du critique contribueront en même temps à confirmer sa sincérité.