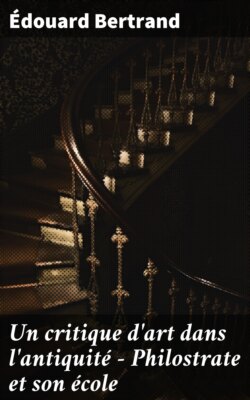Читать книгу Un critique d'art dans l'antiquité - Philostrate et son école - Édouard Bertrand - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sincérité de Philostrate. — Sa préface.
ОглавлениеTout en rendant justice à la rare sagacité et à la vaste érudition de la critique allemande qui a répandu tant de lumière sur toutes les questions relatives à l’étude de Philostrate, on peut lui reprocher un tort grave, celui d’avoir méconnu le but que se proposait l’écrivain, et de lui avoir demandé plus, ou plutôt tout autre chose que ce qu’il promet lui-même. Il est important, selon nous, de se mettre tout de suite au vrai point de vue; et c’est celui qu’a choisi l’auteur lui-même. Philostrate est et ne veut être qu’un rhéteur. Après avoir composé différents ouvrages sur son art, il conçoit un jour l’idée d’un livre dont le caractère sera nouveau. Destiné comme les autres à la jeunesse, ce livre lui offrira des compositions d’un genre piquant. Ce sont encore des modèles de beau style, mais le sujet en est neuf; il s’agit de tableaux décrits par un connaisseur. Voilà l’ouvrage que Philostrate s’est proposé d’écrire. C’est, à vrai dire, un livre d’agrément; et l’on voudrait que ce fut un catalogue raisonné d’œuvres d’art, un manuel d’archéologie! N’est-il pas évident que la prétention est injuste, et qu’en voulant à tout prix trouver dans cet écrit ce qui n’y est pas, on risque de méconnaître ce qui s’y trouve?
Philostrate, du reste, a pris soin lui-même de bien nous renseigner sur ce point dans sa préface, et il suffit de la lire attentivement pour se rendre compte de ce qu’il a fait, et voulu faire. Il annoncé d’une manière très nette la nature de son ouvrage. Il n’est question ici, dit-il, ni des artistes ni de leur histoire. Que se propose-t-il donc? Non pas seulement de décrire des tableaux, mais d’apprendre aux jeunes gens, en leur présentant des descriptions soignées, «à bien s’exprimer et à goûter les belles choses ». Voilà ce qu’il dit en termes fort précis, qui ne peuvent donner lieu à aucune équivoque. C’est à la fois une leçon de style et de goût; la première sera donnée par le rhéteur et la seconde par l’artiste. Insistons, en particulier, pour le moment, sur cette dernière. Dans la vie d’Apollonius, Philostrate nous apprend lui-même ce qu’il entend par «les belles choses» ; ce sont les œuvres des grands maîtres, celles des Zeuxis, des Polygnote et des Euphranor. Ce qu’il y admire surtout, c’est l’effet, le relief, la vérité . Tout en enseignant aux jeunes gens le beau langage, c’est donc aussi sur ces parties de l’art qu’il veut les instruire. Est-il vraisemblable que, pour leur donner sur ce point une utile leçon, il se soit avisé de composer lui-même des tableaux? Quoi? Pour leur apprendre à goûter ce qui est beau en peinture, il créera des tableaux fictifs, œuvre de fantaisie et d’imagination! Aux vivants exemples, il préférera de froids modèles! Dira-t-on que Philostrate reconnaît lui-même avoir inventé ses tableaux? Si l’on regarde de près le passage qui semble prêter à cette supposition, on verra qu’il y a équivoque, et que le rhéteur n’entend parler en cet endroit que de la forme de son ouvrage, non du fond même. Il a donné à ses descriptions le caractère d’un entretien. Ce sont en quelque sorte des conférences faites sur des tableaux à des jeunes gens. Il aurait pu choisir un autre genre d’exposition, plus dogmatique, plus méthodique peut-être; il a préféré s’adresser à un auditoire. Il l’interroge et lui répond; il tient compte de ses impressions. Quoique le critique parle seul, on devine effectivement une conversation dont il a laissé subsister les traces sans conserver le dialogue proprement dit.
Du reste, cette espèce de mise en scène est conforme à l’origine que Philostrate attribue à son travail. Ici, les faits se présentent, et nous ne sommes plus réduits à l’interprétation d’un texte et aux inductions. Philostrate nous apprend l’occasion de son livre. Est-il donc possible de révoquer en doute tous les faits qu’il raconte, faits si précis et si bien circonstanciés? Tout n’est-il pas naturel: ce voyage à Naples, ce séjour chez un riche particulier, cette maison qui est décrite, cette galerie de tableaux qu’elle renferme? Pourquoi supposer que tout ce récit n’est que pure invention? Si les tableaux sont imaginaires, pourquoi tous ces détails? Il est à croire que dans la société à laquelle ce livre était destiné bien des personnes avaient vu Naples et pouvaient vérifier ou démentir ces faits. Remarquons qu’il s’agit d’une riche maison; cet édifice à trois ou quatre étages, ce vaste portique d’où la vue s’étend au loin sur la mer, les marbres qui le décorent, tout prouve l’opulence d’un particulier qui devait être connu.
Si Philostrate voulait se mettre en frais d’imagination, que ne plaçait-il dans un horizon plus reculé la scène et les personnages? La fiction eût été plus acceptable. Mais on voit que tout ce qu’il dit n’est pas un cadre inventé à plaisir pour l’agrément de l’ouvrage; tout a un caractère de vérité. Ce jeune enfant, le fils de son hôte, âgé de dix ans et déjà avide de s’instruire, qui suit d’un regard curieux Philostrate se promenant dans la galerie et admirant les tableaux, est-ce un personnage inventé ? Sont-ils inventés aussi ces jeunes gens qui voudraient entendre le sophiste déclamer en public, qui le pressent d’accéder à leur désir et que celui-ci satisfait enfin en leur expliquant les tableaux qui garnissent la galerie de son hôte? Tout est dit simplement, naturellement, sans enjolivement de style. Or, si Philostrate avait voulu par là donner de l’intérêt à son ouvrage et ménager l’illusion, s’il avait conçu tout cela comme une mise en scène, il n’eût pas manqué de soigner davantage le tableau, lui qui déploie tant d’esprit en inventant des tours variés pour rendre ses descriptions plus agréables. Il ne faut donc voir dans tout ce début de l’ouvrage qu’une simple préface où l’auteur nous instruit effectivement de la véritable origine de son livre. C’est bien une galerie de tableaux qu’il a décrite, et les tableaux ne sont pas plus imaginaires que la galerie elle-même, que le portique qui la renfermait, que le riche particulier possesseur de tant de belles œuvres. Ces œuvres ne sont pas, il est vrai, accompagnées de renseignements précis. Mais il est dit que ces tableaux ont été judicieusement choisis, qu’ils sont dus à des artistes distingués et qu’on les a disposés avec goût sur la muraille. Plus de détails sur ce point n’entraient pas dans le dessein du rhéteur..
Si donc le point de départ de l’ouvrage est bien la description d’œuvres véritables, pourquoi supposer que l’auteur changeant par la suite le caractère de son travail aura mêlé le faux au vrai, et mis dans sa collection, à côté des tableaux réels, des tableaux imaginaires? Si l’on ne veut pas admettre que la galerie en question ait renfermé tant de tableaux de prix, ce qui est très possible, n’est-il pas naturel de penser que Philostrate a accru son ouvrage de la description d’autres œuvres artistiques? Pourquoi n’aurait-il pas ajouté quelques-unes de celles qu’il avait vues dans ses nombreux voyages? Il est même vraisemblable que les circonstances qu’il décrit ont été seulement la première origine de son ouvrage. Le jour où il s’est promené avec les jeunes gens dans la galerie, il en a conçu l’idée et en a recueilli les premiers éléments. Ensuite, il a enrichi la matière; le nombre des tableaux s’est multiplié, les esquisses primitives sont devenues plus soignées, plus finies; l’auteur en respectant la forme première de l’œuvre lui a donné un tout autre développement. C’est ainsi que naissent les livres .
Sans sortir de la seule préface, on trouve donc dans ce que l’auteur dit lui-même de son ouvrage et des circonstances où il s’est produit un témoignage de sa sincérité. A ces preuves on pourrait ajouter bien des inductions. Parmi les tableaux de Philostrate il y en a plus d’un d’une très belle invention artistique. Comment supposer un simple rhéteur, dans la complète décadence de l’art, imaginant de tels chefs- d’œuvre? N’est-ce pas plus difficile encore que d’admettre leur authenticité ? Il n’avait nul besoin d’ailleurs de tirer des tableaux de son imagination, lorsque dans les édifices publics et les galeries privées tant de peintures s’offraient à ses regards, lorsqu’il est constant que sa mémoire devait lui en représenter un grand nombre, en sorte qu’il lui était certainement plus aisé de se rappeler que d’inventer. N’est-ce pas de souvenir que Lucien décrit en traits si nets et si précis le tableau de la Centauresse de Zeuxis? Et puis, quel intérêt pouvaient avoir des tableaux de rhéteur placés en regard de ces Zeuxis, de ces Protogène, de ces Apelle qui tapissaient les galeries d’amateurs?
Si nous interrogeons les descriptions elles-mêmes, nous y trouverons encore différents indices d’authenticité. Par exemple, certaines observations sont nécessairement empruntées à la vue directe du tableau et en supposent la présence. Il y a tel détail technique, telle combinaison pittoresque qui ne saurait avoir été inventée par le critique. Enfin celui-ci n’affirme pas toujours, lorsqu’il interprète le tableau; il cherche à saisir la pensée de l’artiste et le sens de sa composition; il conjecture, il voit à demi, il devine. Il déclare quelque part qu’il prend le sujet tel qu’il est donné. Sa tâche, dit-il, n’est pas de le discuter et de le juger, mais d’examiner le tableau. Il n’est donc que l’interprète de l’œuvre, il n’en est pas l’inventeur .
Mais revenons à la préface pour en tirer une dernière preuve. Qu’y voyons-nous, en effet? Que Philostrate n’est pas un simple lettré, qu’il connaissait, en définitive, la peinture dont il raisonne fort bien, qu’il l’avait même étudiée, puisqu’il avait fait son hôte et son ami d’un peintre distingué, et cela pendant quatre années; qu’il est impossible, par conséquent, qu’un tel homme ait donné de vaines amplifications de rhéteur pour des compositions artistiques: mensonge tout à fait indigne de son savoir. Voyons donc quelles étaient ses connaissances en matière d’art. Nous apprendrons à mieux apprécier l’œuvre en constatant la parfaite compétence de celui qui l’avait entreprise.