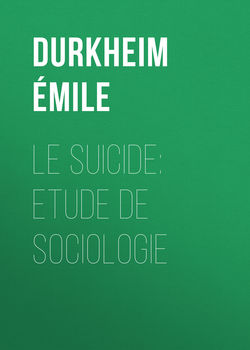Читать книгу Le Suicide: Etude de Sociologie - Durkheim Émile - Страница 9
LIVRE PREMIER
CHAPITRE I
IV
ОглавлениеPuisque les suicides d'aliénés ne sont pas tout le genre, mais n'en représentent qu'une variété, les états psychopathiques qui constituent l'aliénation mentale ne peuvent rendre compte du penchant collectif au suicide, dans sa généralité. Mais, entre l'aliénation mentale proprement dite et le parfait équilibre de l'intelligence, il existe toute une série d'intermédiaires: ce sont les anomalies diverses que l'on réunit d'ordinaire sous le nom commun de neurasthénie. Il y a donc lieu de rechercher si, à défaut de la folie, elles ne jouent pas un rôle important dans la genèse du phénomène qui nous occupe.
C'est l'existence même du suicide vésanique qui pose la question. En effet, si une perversion profonde du système nerveux suffit à créer de toutes pièces le suicide, une perversion moindre doit, à un moindre degré, exercer la même influence. La neurasthénie est une sorte de folie rudimentaire; elle doit donc avoir, en partie, les mêmes effets. Or elle est un état beaucoup plus répandu que la vésanie; elle va même de plus en plus en se généralisant. Il peut donc se faire que l'ensemble d'anomalies qu'on appelle ainsi soit l'un des facteurs en fonction desquels varie le taux des suicides.
On comprend, d'ailleurs, que la neurasthénie puisse prédisposer au suicide; car les neurasthéniques sont, par leur tempérament, comme prédestinés à la souffrance. On sait, en effet, que la douleur, en général, résulte d'un ébranlement trop fort du système nerveux; une onde nerveuse trop intense est le plus souvent douloureuse. Mais cette intensité maxima au delà de laquelle commence la douleur varie suivant les individus; elle est plus élevée chez ceux dont les nerfs sont plus résistants, moindre chez les autres. Par conséquent, chez ces derniers, la zone de la douleur commence plus tôt. Pour le névropathe, toute impression est une cause de malaise, tout mouvement est une fatigue; ses nerfs, comme à fleur de peau, sont froissés au moindre contact; l'accomplissement des fonctions physiologiques, qui sont d'ordinaire le plus silencieuses, est pour lui une source de sensations généralement pénibles. Il est vrai que, en revanche, la zone des plaisirs commence, elle aussi, plus bas; car cette pénétrabilité excessive d'un système nerveux affaibli le rend accessible à des excitations qui ne parviendraient pas à ébranler un organisme normal. C'est ainsi que des événements insignifiants peuvent être pour un pareil sujet l'occasion de plaisirs démesurés. Il semble donc qu'il doive regagner d'un côté ce qu'il perd de l'autre et que, grâce à cette compensation, il ne soit pas plus mal armé que d'autres pour soutenir la lutte. Il n'en est rien cependant et son infériorité est réelle; car les impressions courantes, les sensations dont les conditions de l'existence moyenne amènent le plus fréquemment le retour sont toujours d'une certaine force. Pour lui, par conséquent, la vie risque de n'être pas assez tempérée. Sans doute, quand il peut s'en retirer, se créer un milieu spécial où le bruit du dehors ne lui arrive qu'assourdi, il parvient à vivre sans trop souffrir; c'est pourquoi nous le voyons quelquefois fuir le monde qui lui fait mal et rechercher la solitude. Mais s'il est obligé de descendre dans la mêlée, s'il ne peut pas abriter soigneusement contre les chocs extérieurs sa délicatesse maladive, il a bien des chances d'éprouver plus de douleurs que de plaisirs. De tels organismes sont donc pour l'idée du suicide un terrain de prédilection.
Cette raison n'est même pas la seule qui rende l'existence difficile au névropathe. Par suite de cette extrême sensibilité de son système nerveux, ses idées et ses sentiments sont toujours en équilibre instable. Parce que les impressions les plus légères ont chez lui un retentissement anormal, son organisation mentale est, à chaque instant, bouleversée de fond en comble et, sous le coup de ces secousses ininterrompues, elle ne peut pas se fixer sous une forme déterminée. Elle est toujours en voie de devenir. Pour qu'elle pût se consolider, il faudrait que les expériences passées eussent des effets durables, alors qu'ils sont sans cesse détruits et emportés par les brusques révolutions qui surviennent. Or la vie, dans un milieu fixe et constant, n'est possible que si les fonctions du vivant ont un égal degré de constance et de fixité. Car vivre, c'est répondre aux excitations extérieures d'une manière appropriée et cette correspondance harmonique ne peut s'établir qu'à l'aide du temps et de l'habitude. Elle est un produit de tâtonnements, répétés parfois pendant des générations, dont les résultats sont en partie devenus héréditaires et qui ne peuvent être recommencés à nouveaux frais toutes les fois qu'il faut agir. Si, au contraire, tout est à refaire, pour ainsi dire, au moment de l'action, il est impossible qu'elle soit tout ce qu'elle doit être. Cette stabilité ne nous est pas seulement nécessaire dans nos rapports avec le milieu physique, mais encore avec le milieu social. Dans une société, dont l'organisation est définie, l'individu ne peut se maintenir qu'à condition d'avoir une constitution mentale et morale également définie. Or, c'est ce qui manque au névropathe. L'état d'ébranlement où il se trouve fait que les circonstances le prennent sans cesse à l'improviste. Comme il n'est pas préparé pour y répondre, il est obligé d'inventer des formes originales de conduite; de là vient son goût bien connu pour les nouveautés. Mais quand il s'agit de s'adapter à des situations traditionnelles, des combinaisons improvisées ne sauraient prévaloir contre celles qu'a consacrées l'expérience; elles échouent donc le plus souvent. C'est ainsi que, plus le système social a de fixité, plus un sujet aussi mobile a de mal à y vivre.
Il est donc très vraisemblable que ce type psychologique est celui qui se rencontre le plus généralement chez les suicidés. Reste à savoir quelle part cette condition tout individuelle a dans la production des morts volontaires. Suffit-elle à les susciter pour peu qu'elle y soit aidée par les circonstances, ou bien n'a-t-elle d'autre effet que de rendre les individus plus accessibles à l'action de forces qui leur sont extérieures et qui seules constituent les causes déterminantes du phénomène?
Pour pouvoir résoudre directement la question, il faudrait pouvoir comparer les variations du suicide à celles de la neurasthénie. Malheureusement, celle-ci n'est pas atteinte par la statistique. Mais un biais va nous fournir les moyens de tourner la difficulté. Puisque la folie n'est que la forme amplifiée de la dégénérescence nerveuse, on peut admettre, sans sérieux risques d'erreur, que le nombre des dégénérés varie comme celui des fous et substituer, par conséquent, la considération des seconds à celle des premiers. Ce procédé aura, de plus, cet avantage qu'il nous permettra d'établir d'une manière générale le rapport que soutient le taux des suicides avec l'ensemble des anomalies mentales de toute sorte.
Un premier fait pourrait leur faire attribuer une influence qu'elles n'ont pas; c'est que le suicide, comme la folie, est plus répandu dans les villes que dans les campagnes. Il semble donc croître et décroître comme elle; ce qui pourrait faire croire qu'il en dépend. Mais ce parallélisme n'exprime pas nécessairement un rapport de cause à effet; il peut très bien être le produit d'une simple rencontre. L'hypothèse est d'autant plus permise que les causes sociales dont dépend le suicide sont elles-mêmes, comme nous le verrons, étroitement liées à la civilisation urbaine et que c'est dans les grands centres qu'elles sont le plus intenses. Pour mesurer l'action que les états psychopathiques peuvent avoir sur le suicide, il faut donc éliminer les cas où ils varient comme les conditions sociales du même phénomène; car quand ces deux facteurs agissent dans le même sens, il est impossible de dissocier, dans le résultat total, la part qui revient à chacun. Il faut les considérer exclusivement là où ils sont en raison inverse l'un de l'autre; c'est seulement quand il s'établit entre eux une sorte de conflit, qu'on peut arriver à savoir lequel est déterminant. Si les désordres mentaux jouent le rôle essentiel qu'on leur a parfois prêté, ils doivent révéler leur présence par des effets caractéristiques, alors même que les conditions sociales tendent à les neutraliser; et inversement, celles-ci doivent être empêchées de se manifester quand les conditions individuelles agissent en sens inverse. Or les faits suivants démontrent que c'est le contraire qui est la règle:
1° Toutes les statistiques établissent que, dans les asiles d'aliénés, la population féminine est légèrement supérieure à la population masculine. Le rapport varie selon les pays, mais, comme le montre le tableau suivant, il est, en général, de 54 ou 55 femmes pour 46 ou 43 hommes:
Koch a réuni les résultats du recensement effectué dans onze États différents sur l'ensemble de la population aliénée. Sur 166.675 fous des deux sexes, il a trouvé 78.584 hommes et 88.091 femmes, soit 1,18 aliénés pour 1.000 habitants du sexe masculin et 1,30 pour 1.000 habitants de l'autre sexe[29]. Mayr de son côté a trouvé des chiffres analogues.
Tableau IV[30]
Part de chaque sexe dans le chiffre total des suicides.
On s'est, demandé, il est vrai, si cet excédent de femmes ne venait pas simplement de ce que la mortalité des fous est supérieure à celle des folles. En fait, il est certain que, en France, sur 100 aliénés qui meurent dans les asiles, il y a environ 55 hommes. Le nombre plus considérable de sujets féminins recensés à un moment donné ne prouverait donc pas que la femme a une plus forte tendance à la folie, mais seulement que, dans cette condition comme d'ailleurs dans toutes les autres, elle survit mieux que l'homme. Mais il n'en reste pas moins acquis que la population existante d'aliénés compte plus de femmes que d'hommes; si donc, comme il semble légitime, on conclut des fous aux nerveux, on doit admettre qu'il existe à chaque moment plus de neurasthéniques dans le sexe féminin que dans l'autre. Par conséquent, s'il y avait entre le taux des suicides et la neurasthénie un rapport de cause à effet, les femmes devraient se tuer plus que les hommes. Tout au moins devraient-elles se tuer autant. Car même en tenant compte de leur moindre mortalité et en corrigeant en conséquence les indications des recensements, tout ce qu'on en pourrait conclure, c'est qu'elles ont pour la folie une prédisposition sensiblement égale à celle de l'homme; leur plus faible dîme mortuaire et la supériorité numérique qu'elles accusent dans tous les dénombrements d'aliénés se compensent, en effet, à peu près exactement. Or, bien loin que leur aptitude à la mort volontaire soit ou supérieure on équivalente à celle de l'homme, il se trouve que le suicide est une manifestation essentiellement masculine. Pour une femme qui se tue, il y a, en moyenne, 4 hommes qui se donnent la mort (V. Tableau IV, ci-dessus). Chaque sexe a donc pour le suicide un penchant défini, qui est même constant pour chaque milieu social. Mais l'intensité de cette tendance ne varie aucunement comme le facteur psychopathique, qu'on évalue ce dernier d'après le nombre des cas nouveaux enregistrés chaque année ou d'après celui des sujets recensés au même moment.
2° Le tableau V permet de comparer l'intensité de la tendance à la folie dans les différents cultes.
Tableau V[31]
Tendance à la folie dans les différentes confessions religieuses.
On voit que la folie est beaucoup plus fréquente chez les juifs que dans les autres confessions religieuses; il y a donc tout lieu de croire que les autres affections du système nerveux y sont également dans les mêmes proportions. Or, tout au contraire, le penchant au suicide y est très faible. Nous montrerons même plus loin que c'est la religion où il a le moins de force[32]. Par conséquent, dans ce cas, le suicide varie en raison inverse des états psychopathiques, bien loin d'en être le prolongement. Sans doute, il ne faudrait pas conclure de ce fait que les tares nerveuses et cérébrales pussent jamais servir de préservatifs contre le suicide; mais il faut qu'elles aient bien peu d'efficacité pour le déterminer, puisqu'il peut s'abaisser à ce point au moment même où elles atteignent leur plus grand développement.
Si l'on compare seulement les catholiques aux protestants, l'inversion n'est pas aussi générale; cependant elle est très fréquente. La tendance des catholiques à la folie n'est inférieure à celle des protestants que 4 fois sur 12 et encore l'écart entre eux est-il très faible. Nous verrons, au contraire, au tableau XVIII[33] que, partout, sans aucune exception, les premiers se tuent beaucoup moins que les seconds.
3° Il sera établi plus loin[34] que, dans tous les pays, la tendance au suicide croît régulièrement depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse la plus avancée. Si, parfois, elle régresse après 70 ou 80 ans, le recul est très léger; elle reste toujours à cette période de la vie deux et trois fois plus forte qu'à l'époque de la maturité. Inversement, c'est pendant la maturité que la folie éclate avec le plus de fréquence. C'est vers la trentaine que le danger est le plus grand; au delà il diminue, et c'est pendant la vieillesse qu'il est, et de beaucoup, le plus faible[35]. Un tel antagonisme serait inexplicable si les causes qui font varier le suicide et celles qui déterminent les troubles mentaux n'étaient pas de nature différente.
Si l'on compare létaux des suicides à chaque âge, non plus avec la fréquence relative des cas nouveaux de folie qui se produisent à la même période, mais avec l'effectif proportionnel de la population aliénée, l'absence de tout parallélisme n'est pas moins évidente. C'est vers 35 ans que les fous sont le plus nombreux relativement à l'ensemble de la population. La proportion reste à peu près la même jusque vers 60 ans; au delà elle diminue rapidement. Elle est donc minima quand le taux des suicides est maximum et, auparavant, il est impossible d'apercevoir aucune relation régulière entre les variations qui se produisent de part et d'autre[36].
4° Si l'on compare les différentes sociétés au double point de vue du suicide et de la folie, on ne trouve pas davantage de rapport entre les variations de ces deux phénomènes. Il est vrai que la statistique de l'aliénation mentale n'est pas faite avec assez de précision pour que ces comparaisons internationales puissent être d'une exactitude très rigoureuse. Il est cependant remarquable que les deux tableaux suivants, que nous empruntons à deux auteurs différents, donnent des résultats sensiblement concordants.
Tableau VI
Rapports du suicide et de la folie dans les différents pays d'Europe.
Ainsi les pays où il y a le moins de fous sont ceux où il y a le plus de suicides; le cas de la Saxe est particulièrement frappant. Déjà, dans sa très bonne étude sur le suicide en Seine-et-Marne, le docteur Leroy avait fait une observation analogue. «Le plus souvent, dit-il, les localités où l'on rencontre une proportion notable de maladies mentales en ont également une de suicides. Cependant les deux maxima peuvent être complètement séparés. Je serais même disposé à croire qu'à côté de pays assez heureux… pour n'avoir ni maladies mentales ni suicides… il en est où les maladies mentales ont seules fait leur apparition». Dans d'autres localités c'est l'inverse qui se produit[38].
Morselli, il est vrai, est arrivé à des résultats un peu différents[39]. Mais c'est d'abord qu'il a confondu sous le titre commun d'aliénés les fous proprement dits et les idiots[40]. Or, ces deux affections sont très différentes, surtout au point de vue de l'action qu'elles peuvent être soupçonnées d'avoir sur le suicide. Loin d'y prédisposer, l'idiotie paraît plutôt en être un préservatif; car les idiots sont, dans les campagnes, beaucoup plus nombreux que dans les villes, tandis que les suicides y sont beaucoup plus rares. Il importe donc de distinguer deux états aussi contraires quand on cherche à déterminer la part des différents troubles névropathiques dans le taux des morts volontaires. Mais, même en les confondant, on n'arrive pas à établir un parallélisme régulier entre le développement de l'aliénation mentale et celui du suicide. Si, en effet, prenant comme incontestés les chiffres de Morselli, on classe les principaux pays d'Europe en cinq groupes d'après l'importance de leur population aliénée (idiots et fous étant réunis sous la même rubrique), et si l'on cherche ensuite quelle est dans chacun de ces groupes la moyenne des suicides, on obtient le tableau suivant:
On peut bien dire qu'en gros, là où il y a beaucoup de fous et d'idiots, il y a aussi beaucoup de suicides et inversement. Mais il n'y a pas entre les deux échelles une correspondance suivie qui manifeste l'existence d'un lien causal déterminé entre les deux ordres de phénomènes. Le second groupe qui devrait compter moins de suicides que le premier en a davantage; le cinquième qui, au même point de vue, devrait être inférieur à tous les autres est, au contraire, supérieur au quatrième et même au troisième. Si enfin, à la statistique de l'aliénation mentale que rapporte Morselli, on substitue celle de Koch qui est beaucoup plus complète et, à ce qu'il semble, plus rigoureuse, l'absence de parallélisme est encore beaucoup plus accusée. Voici, en effet, ce que l'on trouve[41].
Une autre comparaison faite par Morselli entre les différentes provinces d'Italie est, de son propre aveu, peu démonstrative[42].
5° Enfin, comme la folie passe pour croître régulièrement depuis un siècle[43] et qu'il en est de même du suicide, on pourrait être tenté de voir dans ce fait une preuve de leur solidarité. Mais ce qui lui ôte toute valeur démonstrative, c'est que, dans les sociétés inférieures, où la folie est très rare, le suicide, au contraire, est parfois très fréquent, comme nous l'établirons plus loin[44].
Le taux social des suicides ne soutient donc aucune relation définie avec la tendance à la folie, ni, par voie d'induction, avec la tendance aux différentes formes de la neurasthénie.
Et en effet, si, comme nous l'avons montré, la neurasthénie peut prédisposer au suicide, elle n'a pas nécessairement cette conséquence. Sans doute, le neurasthénique est presque inévitablement voué à la souffrance s'il est mêlé de trop près à la vie active; mais il ne lui est pas impossible de s'en retirer pour mener une existence plus spécialement contemplative. Or, si les conflits d'intérêts et de passions sont trop tumultueux et trop violents pour un organisme aussi délicat, en revanche, il est fait pour goûter dans leur plénitude les joies plus douces de la pensée. Sa débilité musculaire, sa sensibilité excessive, qui le rendent impropre à l'action, le désignent, au contraire, pour les fonctions intellectuelles qui, elles aussi, réclament des organes appropriés. De même, si un milieu social trop immuable ne peut que froisser ses instincts naturels, dans la mesure où la société elle-même est mobile et ne peut se maintenir qu'à condition de progresser, il a un rôle utile à jouer; car il est, par excellence, l'instrument du progrès. Précisément parce qu'il est réfractaire à la tradition et au joug de l'habitude, il est une source éminemment féconde de nouveautés. Et comme les sociétés les plus cultivées sont aussi celles où les fonctions représentatives sont le plus nécessaires et le plus développées, et qu'en même temps, à cause de leur très grande complexité, un changement presque incessant est une condition de leur existence, c'est au moment précis où les neurasthéniques sont le plus nombreux, qu'ils ont aussi le plus de raisons d'être. Ce ne sont donc pas des êtres essentiellement insociaux, qui s'éliminent d'eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas nés pour vivre dans le milieu où ils sont placés. Mais il faut que d'autres causes viennent se surajouter à l'état organique qui leur est propre pour lui imprimer cette tournure et le développer dans ce sens. Par elle-même, la neurasthénie est une prédisposition très générale qui n'entraîne nécessairement à aucun acte déterminé, mais peut, suivant les circonstances, prendre les formes les plus variées. C'est un terrain sur lequel des tendances très différentes peuvent prendre naissance selon la manière dont il est fécondé par les causes sociales. Chez un peuple vieilli et désorienté, le dégoût de la vie, une mélancolie inerte, avec les funestes conséquences qu'elle implique, y germeront facilement; au contraire, dans une société jeune, c'est un idéalisme ardent, un prosélytisme généreux, un dévouement actif qui s'y développeront de préférence. Si l'on voit les dégénérés se multiplier aux époques de décadence, c'est par eux aussi que les États se fondent; c'est parmi eux que se recrutent tous les grands rénovateurs. Une puissance aussi ambiguë[45] ne saurait donc suffire à rendre compte d'un fait social aussi défini que le taux des suicides.