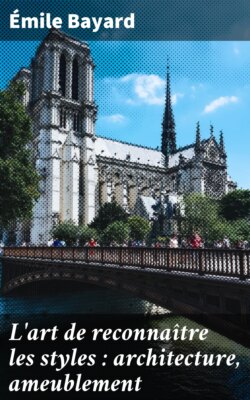Читать книгу L'art de reconnaître les styles : architecture, ameublement - Emile Bayard - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Des Styles. — Physionomie générale
ОглавлениеLes styles sont le souvenir esthétique des époques à travers les cultes divers de la Beauté.
La pensée des siècles dort dans ces pierres, dans ces meubles, en un mot dans ces choses qui survivent aux générations, comme autant de témoins de leurs mœurs et de leurs aspirations idéales.
Aussi bien, les caprices de la mode sont éphémères, tandis que l’immuable Beau, qui ne peut s’improviser, est éternel, et c’est la marque d’une éternité que nous saluons dans les styles, l’essor d’une épuration, d’une synthèse, nées de l’effort humain, à travers ses tâtonnements jusqu’à la trouvaille.
Et cette trouvaille, véritable écriture des peuples, ne varie ses formes à chaque civilisation qu’autant que les idées de cette civilisation renouvellent leur originalité.
D’autre part, la recherche originale des styles fut inconsciente chez ceux qui s’y employèrent, tout comme elle émane d’une succession de personnalités et non d’une seule initiative, s’aiguisant d’âge en âge jusqu’au chef-d’œuvre anonyme.
Les styles se créent, en architecture, comme les espèces nouvelles dans la nature végétale et animale. Dans le monde végétal et animal, c’est par l’hérédité et l’adaptation que les espèces nouvelles viennent à naître.
Par l’hérédité, ce qui était habituel chez les parents devient un caractère permanent chez les descendants; et, par l’adaptation, l’accord qui s’établit entre l’individu et le milieu où il était placé et qui est une condition nécessaire de son existence, l’organisme se modifie; car l’adaptation au milieu, en développant tel organe par l’exercice auquel on l’oblige et en atrophiant tel autre par le repos qu’on lui impose, finit, à la longue, par laisser des traces permanentes dans la constitution organique de l’individu.
Une nouvelle espèce ou une nouvelle variété de l’espèce, selon le cas, est de la sorte, créée. Ainsi la théorie animale de Darwin s’étend-elle, d’une manière imprévue autant que rationnelle, à la vie idéale et animée, si l’on peut dire, des styles, qui naissent de la tradition historique, de l’adaptation aux besoins, aux sentiments, aux connaissances caractéristiques d’une société nouvelle.
Parmi ces éléments divers, la tradition historique, que nous avons citée tout d’abord, n’est pas le moins important.
L’architecture, en effet (et nous ne perdons toujours point de vue le mobilier, d’architecture connexe), est l’art traditionnel par excellence. La peinture et la sculpture trouvent partout, autour d’elles, en dehors d’elles, des motifs d’inspiration, des sujets d’interprétation; mais l’architecture, en dehors de l’homme, ne trouve que la matière brute, l’argile de sa sculpture, la palette de sa peinture, mais pas un «motif».
Elle emprunte à la nature lorsqu’elle se fait sculpteur ou peintre, lorsqu’elle décore, lorsqu’elle revêt d’une robe attrayante et significative ses membres de pierre, de bois ou de métal.
L’architecture, pour naître et se développer, veut le concours d’un peuple, d’une race, d’une civilisation, et des efforts persistants pendant des siècles: à ce prix, l’architecture conquiert un style.
D’où il résulte que ce suc mémorable déterminé par les styles ne peut être goûté que dans le recul des années, seules susceptibles de mettre au point et d’envisager la caractéristique d’une manifestation générale.
Lorsque le roi Soleil prit place dans un fauteuil de son époque, il ignora certainement qu’il s’asseyait dans un fauteuil Louis XIV et cependant notre heure ne craint pas d’inaugurer un «art nouveau» que la postérité trouvera probablement fort présomptueux.
Voilà toute la différence entre un style et la prétention au style, entre une beauté à la mode et la beauté véritable, sans préjuger néanmoins d’efforts intéressants qui portent peut-être en eux le germe de la manifestation typique de nos jours.
L’étude des styles donc réclame une attention progressive, car elle porte sur une succession d’intelligences dont les étapes de pureté sont autant de nuances délicates à déterminer. La moindre pierre, la moindre moulure de jadis a son éloquence, son parfum; le toucher même, chez les connaisseurs, éprouve la caresse de certains reliefs élimés par l’âge et que le subterfuge du faux ne saurait égaler.
De telle sorte que l’éducation des styles, qui se débat parmi un passé éloquent de lignes, de courbes, de rinceaux, de colonnes, de mascarons, etc., est d’une complexité passionnante et d’une troublante interrogation.
Quelle joie d’avoir deviné un rébus, d’avoir donné un âge à une église! d’avoir offert le siège qu’il convient à la dame de ses pensées lointaines! d’avoir enfin évoqué le cadre exact de son rêve ancien!
Or, l’intelligence des styles commence à l’architecture, référence la plus éternelle, témoignage le plus évident que les siècles aient laissé ; si tant est que la pierre a tenu tête davantage à la fin des choses en résistant, de toute la force de sa matière, au caprice des temps.
De telle sorte que la Beauté antique, malgré ses ruines, ne veut pas mourir dans le souvenir des hommes, et ce sont des débris que nous interrogerons tout d’abord, non à la façon scientifique des archéologues, mais en artistes.
Or ces débris parlent une civilisation, évoquent des manières d’être et de penser, toute la formule enfin de leur temps.
Les connaisseurs, qui prétendent déterminer, au goût, des miels différents, parce qu’ils disent reconnaître dans ces miels les diverses fleurs butinées, ne goûtent cependant qu’un miel.
Aussi bien, ce miel n’est que l’essence, la formule d’une quantité d’aromes dont, néanmoins, la saveur varie au caprice des calices ou choisis ou adoptés par l’habitude des abeilles.
Notre aspect physique se modifie pareillement suivant l’élégance avec laquelle nous corrigeons cet aspect. Notre politesse d’aujourd’hui n’est point celle d’hier; il y eut des époques languissantes, efféminées, comme des époques rudes et mâles.
Ces différences sont palpables dans les styles.
Le confort, l’hygiène, qui n’ont rien de commun avec la câlinerie et la morbidesse du boudoir, ont trempé notre corps au lieu de l’aveulir.
Plus de souplesse en réalité, plus de vigueur, plus de masculinité aussi, à tel point que nous avons inventé le féminisme, qui nous dispensera singulièrement de la galanterie devant la concurrence du beau sexe dénaturé.
Nous verrons au XVIIIe siècle, des hommes efféminés dont les hommes de l’âge de pierre eussent rougi, et, les femmes de ce siècle de grâce furent, en revanche, exquises, parce qu’elles avaient trouvé leur cadre favorable.
Il s’ensuit, de ces états d’âme opposés, des décors différents, des meubles autres. Des frivolités naissent au bout des doigts futiles, de même que des mains rudes se crispent sur des armes farouches aux divers âges, suivant que la civilisation est quiète ou troublée.
Comment des meubles délicats eussent-ils pu complaire à des guerriers? L’image d’un Gaulois assis dans une bergère est plaisante, et l’on sourit à l’idée non moins gaie d’une Mme de Pompadour couchée sur un dolmen!
La démarche de l’homme primitif était massive, ses mœurs n’étant point policées, et ses muscles d’acier s’accommodaient exactement d’un confortable provisoire et rustique, tandis que la tranquillité, l’oisiveté et la douceur de vivre, à la remorque de la richesse, dictaient à la demeure des raffinements de luxe.
Et, si le pittoresque en art a son attrait, son caractère, le luxe a plutôt aidé à l’essor de l’art, qui est bien l’expression la plus inutile chez les êtres incultes et la plus indispensable à la pensée cultivée.
Le pittoresque, d’autre part, ne peut être embelli que par l’art, car il est souvent incommode et insalubre; son caractère d’ailleurs réside dans sa grossièreté séduisante, en son âpreté où l’on chercherait vainement un objet esthétique, tandis que, dans un salon de bon goût, luxueux, le geste n’a que l’embarras du choix pour saisir un bibelot rare et l’œil, pareillement, se grise de beauté artistique.
Et cet objet esthétique et cette beauté sont la flatterie évidente d’une époque, car, malgré leur foi et leur idéal, les artistes sont obligés sinon pour vivre, du moins pour plaire, de répondre aux goûts et à l’esprit de leur époque, de telle sorte que leurs œuvres suivent au lieu de conduire et épousent finalement les idées, les caprices et les habitudes qui les encensent sur l’heure.
Le peintre L. David ne continua pas l’art de son délicieux cousin F. Boucher, parce que l’esprit politique avait changé et que les amours «nourris de roses et de lait», chers au traducteur de la grâce par excellence, venaient de s’évanouir soudain, leur nuage de poudre de riz étant crevé par le glaive gréco-romain brandi par le farouche classique.
FIG. 1. — Acanthe épineuse naturelle.
Toujours est-il que si les «amours» avaient été encore en faveur sous David, et que les courtisanes royales eussent continué leurs sourires au peintre de Brutus, David se fût sans doute contenté de poursuivre la gloire de Boucher.
Aussi bien, si David se montra cruel vis-à-vis de Louis XVI, dont il refusa de terminer le portrait et dont il vola la mort comme membre de la Convention, son républicanisme, exalté sous la Révolution, s’inclina singulièrement devant la couronne de Napoléon empereur, qui le nomma son premier peintre.
Toutes ces anomalies nous prouvent que le courant des idées mène seul les hommes de l’art et leur œuvre, interrompu par les uns, repris par les autres, tour à tour. Il s’ensuit que nous nous trouvons souvent en présence de styles baroques, devant des styles de fin de siècle, de transition, etc.
FIG. 2. — Acanthe grecque.
Ce sont là les marques d’un élan réprimé, détourné, au caprice de la politique, du goût, de la flatterie artistique et commerciale. On détermine une date presque, à l’aspect d’une moulure interrompue, à l’observation d’une torsade inachevée.
C’est la pensée d’un geste qui s’abrège, échouant ou changeant d’intention, que nous indiquent ces riens endormis dans les styles et ces riens sont tantôt le fruit d’un retour au passé que l’on éprouve subitement le besoin de célébrer, parce que ce passé est héroïque, alors que l’on est veule, à moins, au contraire, que ce passé ne se trouve en concordance d’idées avec un présent.
Nous verrons le casque grec, le glaive romain, exhumés sous le premier Empire par ce même L. David, dictateur des arts, suggestionnant Percier et Fontaine, architectes, et, au second Empire, nous assisterons à une banalité dans les styles, écœurante, parce que l’originalité, l’esprit d’adaptation même, triomphants en somme, sous Napoléon Ier, avaient sombré dans l’impersonnalité bourgeoise.
Les époques plates et sans intérêt ont eu les styles qu’elles méritaient. Les événements, les grands bouleversements, les nobles luttes, les hautes aspirations de la foi et de l’idéal ont laissé seuls leurs traces dans le passé qui est le témoin des moindres tressaillements du monde.
FIG. 3. — Acanthe romaine.
Et ces témoins, répétons-le, sont les styles, uniques survivants de l’effort des hommes et des hommes eux-mêmes.
Les écrivains sont reconnaissables à leur facture, à la formule de leur pensée ou style. Autant d’écrivains, autant de styles, à moins qu’ils ne manquent d’originalité, auquel cas ils copient la manière des autres, ou bien ils l’adaptent, et les styles, dans leur longue évolution, n’ont pas fait autre chose.
Nous en arrivons à l’étymologie du mot style: du grec στυλoς et du latin stylus, qui désignaient le poinçon usité jadis pour écrire sur les tablettes de cire.
Or, d’aucuns ont employé souvent le mot caractère comme synonyme du mot style. C’est une confusion à éviter pour les raisons suivantes. Nous venons de voir que les anciens écrivaient sur des tablettes ou abaques chargées de cire ou même simplement de poussière, et que de là était dérivé le mot style et même stylet. Le stylet ou style, c’était donc la plume des anciens, et les figures tracées par le στυλος sur l’abaque ou la tablette s’appelaient en grec χαραϰτἠρ. Ces étymologies vont nous permettre d’établir la distinction capitale qui sépare les deux mots style et caractère.
FIG. 4. — Acanthe Renaissance.
Le style formait comme un prolongement de la main obéissant à la volonté de l’écrivain ou dessinateur; c’était l’homme lui-même se manifestant dans sa pensée ou sa sensibilité. Si le style c’est l’homme, suivant Buffon, le caractère était, au contraire, la manifestation visible. Le style c’était donc la cause, le caractère c’était l’effet; le style signifiait la pensée, tandis que le caractère reflétait l’expression physique de cette pensée.
Cette explication du mot style, contrasté avec le mot caractère, peut contribuer à faire comprendre la double signification du mot style, suivant qu’on l’emploie avec ou sans adjectif, c’est-à-dire dans son sens relatif ou dans son sens absolu.
FIG. 5. — Acanthe Louis XIII.
Les hommes d’une même famille, région ou race, se distinguent les uns des autres par des accidents qui accusent leur individualité ; mais tous satisfont aux conditions organiques qui caractérisent l’espèce humaine.
Un homme pris isolément est vulgaire ou cultivé, maigre ou gras; un homme enfin peut toujours avoir son qualificatif. L’homme pas. L’homme, c’est une abstraction, c’est l’idéal, c’est l’absolu, l’être sans individualité.
Un homme, un individu vit pendant un espace de temps relativement limité ; l’homme, l’être abstrait, idéal, durera aussi longtemps que l’espèce humaine.
FIG. 6. — Acanthe Louis XIV.
«Une œuvre de style», c’est-à-dire la manifestation de l’idéal, contient donc essentiellement dans son expression, la généralité et la durée.
Une œuvre d’un style familier ou gracieux revêt au contraire forcément un caractère d’individualité et une durée limitée.
La simplicité seule peut exprimer la généralité et l’éternité, qui sont aussi la grande morale. Sans simplicité dans la pensée et l’exécution, «pas d’œuvre de style».
Voilà donc le sort singulier qui guettait ce mot de style; il en arriva à donner son nom à la fois à la qualité la plus spirituelle de la pensée et de la littérature et au stylet (ou porte-plume), c’est-à-dire qu’il subit le sort du style lui-même, s’épurant de déduction en déduction, se filtrant à travers les époques au point de devenir l’idéal d’une chose matérielle.
Et de fait nous verrons au cours de notre travail sinon toujours une épuration, car l’inspiration fut généralement issue de la Nature admirable, du moins toujours une interprétation, jusqu’à même une dénaturation, d’une grande qualité artistique.
Car le but de l’art n’est pas la photographie, expression de la vérité quelconque, mais bien la traduction de cette vérité.
Qu’est-ce donc que la stylisation? L’art de dénaturer avec goût un modèle de la nature; l’art de profiter spirituellement des éléments naturels et d’augmenter leur sens décoratif.
FIG. 7. — Acanthe Louis XV.
Voyez la feuille d’acanthe (fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), clé des styles à travers les âges! Voyez quelle stylisation extraordinaire elle a inspirée!
La feuille d’acanthe du chapiteau corinthien des Grecs, stylisée d’après l’acanthe épineuse naturelle; l’acanthe molle chère aux Romains qui en usèrent et même en abusèrent; l’acanthe large de la Renaissance après l’acanthe profondément simplifiée et modifiée du style roman.
Cette acanthe que bannit le style ogival et qui s’atrophie sous Louis XIII et devient lourde et massive à l’exemple de ce style lui-même.
De même que sous Louis XIV nous verrons ce motif décoratif prendre de la solennité dans la raideur et que nous le remarquerons sous Louis XV tordu et enroulé, mais moins excessivement que sous la Régence précédente.
L’acanthe, enfin, simplifiée sous Louis XVI, moins élégante et moins hardie.
Voyez les métamorphoses de la palmette (fig. 8 et 9), voyez toutes les fleurs enfin, reconnaissables sous leur masque, sous leur divine altération!
Les palmettes assyrienne (fig. 8), égyptienne, grecque, romaine, si différentes les unes des autres! La demi-palmette pour orner les encoignures, la palmette dorique (fig. 9) réservée aux corniches de cet ordre et que nous retrouverons sous le premier Empire et même sous le second!
C’est là le style, cette métamorphose d’après le modèle inspirateur, et notre originalité présente, qui revient à la représentation florale telle qu’elle embaume, c’est-à-dire telle qu’elle est, retourne simplement en arrière, puisque les anciens débutèrent par où nous finissons.
N’oublions pas que le style est une essence, le fruit de toute une expérience, et que ce n’est pas le moindre mérite d’un parfum que celui de nous laisser deviner le calice d’où il émane.
Les romans, qui n’égarent pas la pensée au delà des mots, passent indifférents dans la mémoire, un dessin, dont le sentiment est enclos dans une ligne trop exacte, n’émeut pas.
FIG. 8. — Palmette assyrienne.
FIG. 9. — Palmette dorique.
Les «effets» d’un violoniste, lorsqu’ils ne tiennent qu’à son archet, ne portent pas; tous les exécutants en sont là, leur instrument n’intéresse pas, c’est leur âme.
Toutes ces qualités impalpables relèvent du style. Point d’art sans style et point de style quand on le cherche. Le style c’est l’esprit que l’on ne peut acquérir, c’est le don, c’est le parfum naturel, tandis que la stylisation est une recherche matérielle, l’acheminement vers une trouvaille, à travers les péripéties d’un rébus.
Qu’importe-t-il donc de connaître premièrement, pour dévoiler un à un le mystère des styles? Les types d’architecture, qui sont la trace des pas dans les neiges d’antan.
FIG. 10. — Ordre dorique grec.
Le botaniste reconnaît un arbre à sa feuille; l’archéologue distingue la nature d’un sol à sa matière, l’artiste découvre un style en analysant les caractères de sa beauté.
Mais quel retour en arrière il faut effectuer, lorsque l’on veut interroger des ruines, des débris! Ils savent tant de choses ces ruines et ces débris, et leur silence est si obstiné !
Puis tout à coup, les voici trahis! On sait leur âge! On connaît leurs auteurs!
Pourtant il ne faudrait point exagérer cette science des styles, au point de s’imaginer qu’ils sont tous divers. Non, les branches des arbres s’appellent toutes des branches et tous les styles ont une base, en réalité, tangible.
Ils appartiennent seulement à une grande famille dont la paternité n’est point toujours aisée à découvrir, à travers des croisements, des mésalliances et tant de morts.
Bref, lorsque nous aurons examiné les types d’architecture, nous franchirons seulement le seuil des temples, des abbayes, des cathédrales et des maisons, pour y étudier les meubles, qui sont en somme des petits monuments d’architecture.
Car, en matière de décor, toutes les manifestations d’une époque sont solidaires; elles ont le même esprit, le même air de famille; au surplus, ne fallait-il pas que les meubles s’harmonisassent avec leur décor?
Ne séparons donc point l’architecture du mobilier, et aussi bien nous aurons souvent recours également à ces deux bases pour reconnaître jusqu’aux moindres objets.
Le plan de notre travail, dès lors, se précise; pour atteindre le but pratique que nous poursuivons, il importe de remonter aux sources mêmes de la personnalité.
FIG. 11. — Ordre toscan.
Au fur et à mesure de notre excursion dans le passé jusqu’à nos jours, nous noterons des formes, des formules, des ornementations, etc., caractéristiques, qui établiront notre jugement en le gardant, autant que possible, des lacunes préjudiciables.
FIG. 12. — Ordre dorique romain.
Ainsi, de déduction en déduction, aucun maillon de la chaîne n’ayant été sauté, arriverons-nous à saisir la communion des styles, leur contagion, leur échange, leur fusion, non sans toutefois que jamais ils ne faillissent à leur nuance d’originalité.
Revisons maintenant le principe esthétique général des styles et leur rapport avec les formes géométriques constructives.
Les Grecs ont montré une grande prédilection pour la combinaison de la ligne droite, et l’ont adoptée comme type de l’architecture, d’une simplicité, d’une unité et d’une noblesse parfaites.
Les Égyptiens ne connaissaient guère, dans leurs masses, que le triangle et le quadrilatère de ces façades principales, par le triangle des frontons limitant et fermant les combles.
De même que les Grecs, les Égyptiens emploient la plate-bande comme forme constructive fondamentale, à l’exclusion de tout autre système, pour franchir les baies ou ouvertures dans les murs et couvrir les espaces superficiels.
Rome, moins délicate de goût, plus sensible à l’utilité et à la richesse matérielle qu’à l’harmonie calme précédente, encline d’autre part à l’imitation des Étrusques, mais avec de plus grands développements, ajoute l’arc de cercle aux diverses combinaisons rectilignes des arts païen, égyptien et grec.
Le système constructif romain est d’un genre mixte, un mélange de plates-bandes et d’arcs de cercles. Aussi, dans les styles byzantin et romain, avec le byzantin surtout, l’arc de cercle domine dans les baies, dans le couronnement, dans le dôme des édifices.
Leur élément constructif est le plein cintre qui se transforme plus tard en ogive dans les styles qui leur succèdent, tant en Occident qu’en Orient.
FIG. 13. — Ordre ionique grec.
On recherche ensuite, tant en Occident qu’en Orient, les arcs ogivaux et les formes aiguës; on semble se délecter dans les aspérités et les pointes et l’on multiplie le détail jusqu’à la surabondance.
Quant au style de la Renaissance, il adopte avec une faveur exceptionnelle une des dernières formes créées par le style gothique, celle de l’ellipse, qui apparaît d’abord comme la forme constructive permettant d’exécuter de larges baies, comme les portes d’églises, par exemple, en les surmontant d’une ogive en accolade, ogive non plus de forme constructive, mais simplement décorative.
FIG. 14. — Ordre corinthien.
La Renaissance, malgré qu’elle ait accepté l’arc plein cintre, préfère d’abord l’arc sous-baissé et même surhaussé dont l’ellipse est le type récent géométrique, repoussant ainsi l’arc ogive et pointu.
La forme elliptique, aussi calme que le plein cintre, plus douce et plus riche encore que l’ogive, plus variée et plus nuancée que tous deux, semble être, enfin, l’un des traits significatifs de l’architecture moderne.
De cet accord entre les besoins de l’âme et les sentiments de l’esprit, entre les facultés rationnelles et la sensibilité esthétique, naquit le style d’architecture, solidaire, répétons-le, de celui du mobilier.
Et cette communion, impulsivement, arrache un cri du cœur. Ainsi, en apercevant la merveilleuse dentelle de pierre qui orne la façade de la cathédrale de Tours, Henri IV s’écria: «Ventre Saint-Gris! les beaux joyaux que voilà ! Il n’y manque plus que des écrins!» Et Vauban, frappé d’admiration en présence de l’énorme tour octogone qui domine la cathédrale de Coutances, s’exclama: «Quel est le sublime fou qui a osé lancer dans les airs un pareil monument?»
C’est Michel-Ange encore qui a dit, en parlant des portes de l’église de Saint-Jean de Florence: «Elles sont si belles qu’elles devraient servir de portes au Paradis.»
Dès les temps le plus reculés, l’homme éprouva le besoin d’instituer une règle de beauté.
C’est ainsi que les Égyptiens et les Grecs eurent des canons plastiques, et les Grecs encore régirent l’ordonnance architecturale par des types esthétiques dits: ordres.
FIG. 15. — Ordre composite.
Le style égyptien fut hiératique et symbolique, plutôt une formule après avoir connu l’indépendance, tandis que le style grec libéré de toute contrainte, malgré les canons d’ailleurs singulièrement différents à chaque génie, se mesurait superbement avec la nature.
Sans nous arrêter aux canons de la plastique, qui sortent de notre cadre, nous aborderons les ordres (fig. 10, 11, 12, 13,14 et 15) d’architecture, frères aînés des styles.
Les ordres parlent en effet la même langue muette que les styles, et leur fascination séculaire les associe encore étroitement; au surplus, tel ordre perce souvent sous tel style d’où la nécessité d’examiner tout d’abord soigneusement les ordres.
Les ordres, au nombre de cinq, s’intitulent dorique, ionique, et corinthien (ordres grecs), puis toscan (dérivé du dorique grec) et composite (ordre romain), sans compter qu’il existe un ordre dorique et un ordre ionique particuliers aux Romains assez différents de ceux des Grecs.
Le lecteur, au cas présent d’instruction élémentaire et pratique des styles, n’aura qu’à examiner sur la gravure les caractéristiques de ces ordres entre eux, qu’à se pénétrer de leurs différences, pour être suffisamment documenté.
N’oublions pas qu’aucun point de détail n’est négligeable dans notre étude, pour ne point perdre le fil de l’utilité que nous cherchons.
Voici pourquoi nous cheminerons dans le lointain passé, à perle de vue même, non sans errer complaisamment dans l’hypothèse et la poésie, à défaut de démêler une certitude qui, d’ailleurs, au delà de l’art, nous indiffère présentement.
Aussi bien devons-nous nous imprégner de la pensée générale de l’édification humaine par respect pour les styles qui sont son parfum.
Nous laisserons ensuite à la légende le soin de nous initier à la vénération miraculeuse de l’art.
«Un grand nombre d’artistes qui eurent de la célébrité dans la première partie du moyen âge étaient des évêques ou des saints. On aurait craint de laisser peindre ou sculpter les images offertes à la vénération des fidèles par des mains indignes d’un si pieux ministère; la légende de Hugues de Moutier en est la preuve.
«Placé dès son enfance dans une abbaye de Bénédictins pour y apprendre les principes de l’art, Hugues s’en échappa et mena une vie peu régulière; réintégré plus tard dans son couvent, il fut chargé de sculpter un crucifix; mais le Christ ne voulut pas être représenté par des mains si profanes, et Hugues fut frappé d’une grave maladie.
«D’autre part, une tradition du IXe siècle rapporte que Tutilon, bénédictin de Saint-Gall, qui jouissait d’une grande renommée de talent et de piété, était en train de sculpter dans la ville de Metz une image de la Vierge, quand tout à coup on vit des traits de feu sortir des mains de la statue; deux anges, sous forme de pèlerins, parurent devant l’artiste et lui demandèrent si la Vierge était sa sœur ou sa parente pour qu’il pût la représenter si bien.
«La Madone se trouva le lendemain entourée de beaux abbés en relief et dorés, et on pensa que c’était la Vierge elle-même qui avait ajouté cet ornement à son portrait en signe de satisfaction.» (René MÉNARD, Histoire des Beaux-Arts.)
Une légende encore à propos de l’admirable cathédrale de Cologne, inachevée, et dont le nom de son auteur demeure inconnu par la faute du démon, cette fois, triomphant de l’art...
L’archevêque Conrad, désireux de bâtir la plus belle église du monde, n’approuva tout d’abord aucun des plans qui lui étaient soumis, et comme un concurrent, désolé d’avoir été évincé, s’allait jeter dans le Rhin, le diable lui apparut sous les traits d’un vieillard et lui offrit le plan de la cathédrale actuelle en échange de son âme. L’architecte demanda à réfléchir et vint consulter l’archevêque à cet effet, qui sans doute lui conseilla de procéder comme il fit, c’est-à-dire qu’il arracha des mains du diable le fameux plan et lui présenta au même moment une relique de sainte Ursule dont il s’était muni.
FIG. 16. — Menhir.
Se sentant impuissant à lutter contre la relique, le diable furieux, non sans avoir, préalablement, déchiré d’un coup de griffe une partie du plan, s’écria: «La cathédrale que tu me voles ne sera jamais achevée et ton nom demeurera inconnu» Et de fait l’architecte, n’ayant jamais pu reconstituer la partie qui manquait au dessin, en mourut de désespoir. Mais, après cette diversion poétique, nous retournerons sans plus tarder à la réalité.
FIG. 17. — Dolmen.
FIG. 18. — Cromlec’̕̕̕̕̕̕h.
Aux époques les plus reculées, des menhirs (fig. 16) ou pierres debout (alignées ou non), des dolmens (fig. 17) (ou pierres supportant en manière de table une autre pierre), des cromlec’hs (fig. 18) (ou menhirs rangés en cercles), des lichavens (ou trilithes affectant la forme d’une porte, sorte de dolmens privés de leurs parois latérales et dépouillés du tumulus de terre qui les recouvrait primitivement) chantent une sorte de style primaire ressortant plutôt de l’intérêt archéologique qu’artistique.
Nous passerons donc rapidement sur ces manifestations rudimentaires, non sans avoir noté leur signification et leur aspiration probables. Ces significations viennent compléter le principe général esthétique des styles précédemment envisagés.
Le geste primaire du sublime, de la grandeur et du calme semble indiqué par le monolithe géant et se poursuivre dans les assemblages de pierres simples jusqu’à l’impression d’immensité que donnent les pyramides d’Égypte, par exemple, à l’égal des hautes montagnes.
«Dans l’imagination des Athéniens, l’Acropole était aussi haut placée que l’Olympe, et le séjour des dieux mêmes était une montagne de la Thessalie.»
D’autre part, si les temples grecs sont toujours élevés sans être jamais hauts, «si leur fronton doucement abaissé domine la falaise ou la mer, c’est que les Grecs estimaient que les divinités de la fable avaient consenti à descendre parmi les hommes, de sorte que ceux-ci n’avaient point à s’élever jusqu’à elles».
Mais là ne s’arrête point le rapport de la pensée expansive avec la soif et l’élan d’édification humains.
Après le délire des surfaces, nous voyons en effet, dans les temples de l’Inde, celui de la profondeur; dans les églises chrétiennes celui de la hauteur, et celui de la longueur dans les temples égyptiens.
«Les Grecs seuls ont gardé une sorte d’équilibre dans les trois dimensions (largeur double de la hauteur et longueur double de la largeur).»
Aussi bien étaient-ce ces derniers qui devaient donner à l’art son équilibre et sa base, fixer supérieurement le geste sublime de la Beauté, tracer enfin la voie des styles.
Pourtant il serait injuste de méconnaître l’influence évidente des arts de l’Orient et de l’art égyptien sur l’art grec; d’ailleurs, répétons-le, l’art est issu au début de tous les idéals à la fois; d’abord chef-d’œuvre anonyme et indirect, au hasard du chaos des civilisations, ensuite recueilli, déduit, filtré, perfectionné, mis au point par le génie des Grecs, qui lui donnèrent enfin une ordonnance dont on s’accorde à déclarer l’originalité exemplaire.
Originalité imperturbable, hallucinante, dont les siècles demeureront à jamais étonnés.
Originalité non d’improvisation, mais, au contraire, d’un raisonnement magnifique, au point qu’elle reste un modèle éternel, si tant est qu’une harmonie demeure essentiellement harmonieuse dans le rythme invariable de la nature.
Mais n’anticipons pas et, au prochain chapitre, nous poursuivrons notre voyage à travers l’antiquité.