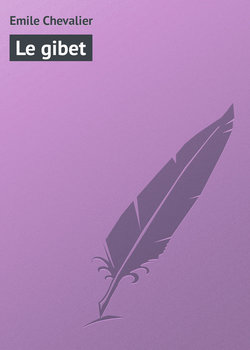Читать книгу Le gibet - Emile Chevalier - Страница 3
Émile Chevalier
LE GIBET
III. Formation d’un état américain
ОглавлениеOn sait assez, en Europe, avec quelle rapidité fabuleuse augmente la population dans la plupart des cités des États-Unis; ainsi celle de New-York a plus que doublé durant les dix dernières années; aujourd’hui, en y joignant Brooklyn, son faubourg naturel, on peut, sans exagération, la porter à près d’un million d’âmes; Buffalo, qui n’existait pas au commencement de ce siècle, en compte actuellement plus de cent mille; et Chicago, simple poste de commerce indien en 1831, devenu ville et possédant cinq mille habitants en 1840, en renferme à présent deux cent mille environ dans son enceinte. Et ce ne sont pas là des exceptions: presque toutes les métropoles de l’Amérique septentrionale peuvent s’enorgueillir de progrès aussi remarquables.
Mais ce que l’on sait généralement moins, c’est la merveilleuse activité qui change, dans cinq ou six ans, une portion considérable, – disons grande comme la France, par exemple, – du désert américain en une contrée fertile, sillonnée de chemins de fer, de routes, de canaux et parsemée de villages florissants. La transformation tient du prodige. D’un été à l’autre, ce territoire de chasse inculte, que seul le mocassin de l’Indien ou du trappeur blanc avait foulé jusque-là, ce territoire, hérissé de forêts vierges ou perdu sous d’interminables prairies mouvantes (rolling prairies), – semblables aux ondes de la mer, – est devenu méconnaissable. Les arbres centenaires sont tombés sous la hache du bûcheron; le feu a nivelé le sol; avec le mélancolique Peau-Rouge, les bêtes fauves ont fui vers le Nord, pour faire place à l’envahissante civilisation de l’homme blanc; plus de wigwam en cuir; peu de huttes en branchages; mais partout des cabanes en troncs d’arbres croisés les uns sur les autres; partout des constructions naissantes; partout la propriété individuelle qui se substitue à la propriété commune; voici des bornes, voici des clôtures de rameaux; ici commence à pousser une haie; un mur s’élève là-bas! Déjà, au milieu de ce groupe de maisonnettes, blanchies à la chaux, et sur le bord de cette belle rivière où fume et ronfle un bateau à vapeur, amarré à une grossière charpente, quai provisoire, déjà j’aperçois monter vers le ciel un bâtiment de grave et simple physionomie. C’est un temple chrétien; chaque dimanche, les hommes y viendront prier et remercier l’Être suprême; chaque soir les enfants y viendront apprendre à être hommes. Le village est au berceau encore, mais demain il sera formé; il aura son école, son académie, son institut; je ne parie pas de son commerce, car il est très prospère. Les enseignes, que je vois au front des maisons, ce bruit de forge, ce mouvement près du steamboat, cette gare de railway que l’on construit à côté, l’annoncent éloquemment. Mais après-demain, le village aura reçu son incorporation. Il prendra le nom de cité, et cité complète, ma foi: vous y trouverez dix hôtels de premier ordre, vingt journaux, deux ou trois banques, des églises pour divers cultes, des salles de lecture, des collèges, des promenades, des édifices publics, toutes les choses nécessaires à la vie policée, sans parler d’une foule de lignes télégraphiques, qui vous mettront en rapport immédiat avec toutes les parties habitées du Nouveau Monde.
Nouveau; oui, il l’est, car là s’établit, s’agrandit une société nouvelle, qui n’a rien de nos préjugés, rien de nos conventions, et que vainement nous cherchons à prendre pour modèle de nos théories politiques. Le Nouveau Monde suit sa destinée. Il a une civilisation complètement différente de la civilisation européenne, parce qu’il n’en a ni le passé, ni les traditions indéracinables.
Ici, l’homme repose sur la famille; là, il n’a d’appui qu’en Dieu et en lui-même. Ses liens de parenté il les a brisés, il les brise en émigrant. Aussi a-t-il, en général, une croyance plus sincère, plus absolue dans l’Éternel. Seul, à qui demanderait-il du courage, des consolations, sinon au Créateur de toutes choses? Sa foi politique, qu’on ne l’oublie pas, il la puise dans sa foi religieuse. C’est ce qui fait la force de la première; c’est ce qui fait que tous les ébranlements donnés, dans les États du Nord, au moins au gouvernement républicain, ne parviendront pas à le renverser. L’égalité règne sans partage, parce que, indépendamment du manque d’ascendants, chaque colon a eu, et a, sur cette terre neuve, besoin, en arrivant, de confondre son intelligence, ses forces et ses travaux avec ceux de ses voisins.
Ceci me ramenant sur mes pas, je me permettrai quelques pages d’observations sur la colonisation dans l’Amérique septentrionale; aussi bien pourront-elles être de quelque utilité à certains esprits inquiets que pousse le désir d’aller tenter fortune dans l’autre hémisphère.
Je le dis tout d’abord: en principe, je ne suis pas opposé à l’émigration. D’ailleurs, elle est une nécessité ou une fatalité, comme il plaira. La surabondance de la population, sur un point quelconque du globe, amène le débordement. C’est une règle de physique élémentaire. En outre l’histoire des races humaines et des civilisations nous apprend que l’homme marche sans cesse à la conquête du sol; car, comme toute chose, le sol est soumis à la triple loi de Jeunesse, Maturité, Vieillesse. Après avoir longtemps fécondé la végétation, l’humus s’épuise et cesse de produire. Il faut des siècles pour qu’il recouvre ses puissances premières. Les steppes de l’Asie, les déserts de l’Afrique l’attestent, sans mentionner la campagne de Rome et les environs de Madrid, jadis si fertiles, aujourd’hui peu productifs, surtout les derniers, devenus presque un désert.
Aussi, quand le rendement de sa terre n’est plus en rapport avec ses besoins, l’homme la quitte, il en va chercher une autre. On vient réclamer à l’Amérique le suc nourricier de ses immenses territoires. Il faut avouer qu’elle est prête à recevoir des millions de nouveaux individus et à leur accorder un bien-être matériel dont ils ne jouissent pas toujours en Europe. Mais à quel prix? Voyous un peu. Un homme seul fera peu ou rien en Amérique; je parle du cultivateur, car c’est à lui que je m’intéresse. Les artisans ont des chances plus ou moins heureuses. Le tailleur de pierre, le maçon, le serrurier, le mécanicien, le fondeur peuvent se tirer d’affaires, et, avec de l’économie, amasser, en quelques années, un joli pécule; mais, s’ils ne connaissent pas l’anglais, ils courent grand risque de végéter misérablement. C’est le lot à peu près inévitable des gens ayant des professions dites libérales. Quant au Canada, où la langue française est partiellement en usage, il offre si peu de ressources que les habitants passent chaque année par milliers aux États-Unis, où ils trouvent de meilleurs salaires et une liberté d’action plus large. La désertion est telle, dans les rangs de la race franco-canadienne, que la législature en a pris de l’inquiétude et s’occupe de trouver un remède à ce mal incurable, suivant moi, tant que la forme du gouvernement n’aura pas subi de modifications radicales. La dette publique frappe de près de 2000 francs, chaque tête d’habitant. Les droits sur les importations sont de 58 à 100 pour cent. Les vins, eau-de-vie, par exemple, sont cotés 100 pour cent à la douane. Les taxes municipales sont en proportion. À Montréal, une simple chambre, recevant l’eau par des tuyaux de l’aqueduc, paie au-delà de 35 francs par an au trésor de la ville. Je laisse à juger!
Revenant au cultivateur, répétons qu’un homme seul n’a que faire en Amérique. S’il est décidé à émigrer, ce doit être avec sa famille. Plus cette famille sera nombreuse, plus il sera en état de prospérer. Mais, avant de partir, avant de dire adieu à ce cher foyer dont nous ne nous éloignons jamais sans un profond serrement du cœur il aura dû compter ses forces, calculer ses capacités, soumettre à un examen sévère ses facultés physiques, morales et celles des êtres destinés à l’accompagner. Il ne va point à une terre de Chanaan, qu’il y songe, et l’exode une fois ouvert ne devra plus se fermer pour lui! S’il n’est pas doué d’une constitution robuste, pouvant résister à toutes les intempéries; s’il ne sait commander à la faim, à la soif; s’il n’est prêt à accepter gaiement les plus rudes fatigues du corps, à exposer un cœur inaccessible aux plus foudroyantes émotions, si, en un mot, il ne porte sur sa poitrine le triple airain dont parle le poète, qu’il se garde de franchir l’Atlantique! Le dénuement, la mort l’attendent au-delà.
J’irai plus loin, et dirai franchement au cultivateur alléché par les récits des pseudo-trésors que l’on trouve à chaque pas en Amérique: – Si voulant venir ici vous y vouliez venir avec l’idée de retourner quelque jour en Europe, croyez-moi, n’abandonnez pas le toit de vos pères, votre champ, vos amis. Vous lâcheriez la proie pour l’ombre. J’ai personnellement exploré le pays du 30° latitude jusqu’au 65°, c’est-à-dire depuis la Nouvelle-Orléans jusqu’au-delà du lac d’Arthabaska, sur le territoire de la compagnie de la baie d’Hudson, et j’ai vu beaucoup de Français, beaucoup de malheureux: – malheureux, parce qu’ils songeaient constamment à rentrer dans leur patrie. Cette pensée, cette aspiration les paralysait.
En Amérique, pour réussir, vous êtes tenu d’apporter une santé à toute épreuve, une invincible ardeur au travail, des muscles d’acier, un esprit inflexible comme le bronze, une volonté qui ne s’oublie jamais. Sachez que vos habitudes, vos usages, votre nourriture, votre habillement changeront complètement. Vous renoncerez au vin, à la bière et aux spiritueux, à moins que vous ne vouliez vous empoisonner avec cet extrait d’orge étiqueté whiskey, ou ce composé délétère baptisé gin, qui l’un et l’autre renferment des quantités considérables de strychnine. Ces horribles breuvages sont un fléau pour l’Amérique. Aussi les effroyables calamités qu’ils engendrent à toute heure ont-elles provoqué des mesures législatives, comme les lois de tempérance et d’abstinence. Le malheureux adonné à ces boissons est bientôt atteint du delirium tremens qui l’emporte avec la rapidité de l’éclair. Fortuné est-il quand, dans un accès de surexcitation nerveuse, il ne s’est pas déshonoré par un crime. Gens de la campagne, qui venez défricher les plaines de l’Amérique, condamnez-vous à l’eau et commencez une réforme en mettant le pied sur le paquebot transocéanique. Vous ne sauriez vous habituer trop tôt aux privations.
On peut s’embarquer dans les ports de France, mais il vaut mieux se rendre d’abord à Liverpool où, pour 160 francs, un vapeur transporte et nourrit un passager jusqu’à New-York ou Québec. La compagnie des bateaux de la ligne anglo-américaine fournit tout, à l’exception de la literie… Si vous prenez la ligne canadienne, le meilleur marché, en débarquant à, Québec, un steamboat conduit pour cinq francs à Montréal; de là il est facile de gagner, à un prix très modique, la partie du Canada ou des États-Unis où l’on désire planter sa tente. Ce n’est pas une métaphore. La tente, puis la hutte, sont les demeures premières du colon, car du séjour dans les villes ou même dans les villages, il n’en faut pas parler, à moins que l’on n’apporte avec soi de gros capitaux.
Mais j’imagine que vous ayez acheté pour quelques francs une étendue de terrain cent fois plus grande que votre village de France et que vous soyez entré en jouissance de ce superbe domaine[2]; c’est ordinairement une forêt vierge, ce que l’on appelle terre en bois debout, ou une savane. Commencez par construire votre cabane. Elle formera un carré. Les murailles seront composées de troncs d’arbres couchés horizontalement les uns sur les autres, avec des entailles à chaque bout pour les emboîter. La glaise remplira les interstices. Quelques voliges constitueront le toit. À défaut de plancher, ce seront des branchages. Le sol à l’intérieur sera battu comme l’aire d’une grange. Une petite fenêtre à quatre carreaux en parchemin, puis en verre, l’éclairera. Avec des ais ou des rameaux de sapin vous ferez votre lit. Un poêle en fonte, une marmite, des écuelles, un banc, vos malles, voilà le mobilier. La farine de maïs, le porc, le bœuf salé, les pommes de terre (patates) sont chargés de vous sustenter, pendant les premières années au moins. À peine organisé, vous vous mettrez au travail. Il faut faire la guerre à la forêt. On y porte le feu. En détruisant les herbes, les lichens, les plantes de toutes espèces, les arbustes, l’incendie amoncelle sur le sol des couches de cendre qui en stimuleront les capacités productives, dès qu’il aura reçu des semences. Mais ce ne sera guère que dans cinq ans qu’il paiera le colon de ses labeurs et de ses déboursés.
Suivons pas à pas les progrès de celui-ci.
Notre homme prend possession de sa terre le 1er mai 1864, par exemple. Le 24 juin, il pourra avoir défriché, c’est-à-dire abattu avec sa cognée tous les arbres demeurés debout après l’incendie, et planté de pommes de terre deux acres. Le 24 août, il aura découvert six autres acres. Il mettra autant de temps pour empiler le bois, afin de le brûler. Mais, comme l’entassement (loggins) s’opère ordinairement en un jour, en faisant un bee (prononcez bie), ce qui consiste à appeler à son aide tous les voisins, et comme il doit naturellement rendre à chacun d’eux un jour pour semblable assistance, cet échange de travail le mènera jusque vers le 24 octobre. Je lui accorde ensuite jusqu’au 1er décembre pour couper son bois de chauffage, et le laisse passer l’hiver, saison qu’il emploiera à préparer du bois de construction en un chantier au milieu de la forêt, dans un rayon de 30 à 40 lieues ou même plus de chez lui. Son travail lui sera payé sur le pied de 60 fr. par mois, nourriture comprise. Au chantier, il demeurera jusqu’à la fin de mars. Ainsi, il aura gagné 240 fr. Le bois de ses huit acres de terre aura produit 480 boisseaux de cendre, et, en admettant qu’il n’ait ni le temps ni les ustensiles nécessaires pour transformer ses cendres en potasse, il pourra les vendre de 2½ à 3 sous le boisseau, et réalisera ainsi de 60 à 70 fr. Or, en ajoutant ces 60 aux 240 fr. déjà gagnés au chantier, il sera possesseur de 300 fr., somme suffisante pour payer le porc, la farine et le thé (boisson en usage), dont il aura besoin pendant les sept mois finissant au 1er mai 1865, sans mettre en ligne de compte les économies de farine qu’il lui sera facile de faire au moyen de ses pommes de terre. En revenant de son chantier, le 1er avril 1865, il pourra, dans les parties tempérées de l’Amérique septentrionale, défricher 2 acres, lesquels, avec les 2 acres défrichés le printemps précédent et les 6 acres défrichés pendant l’été, lui donneront 10 acres de terre propre à la culture et environ 120 boisseaux de cendre, valant de 15 à 17 fr. Il sèmera sur cette terre trois acres de blé, cinq d’avoine et deux de pommes de terre. Son blé lui donnera en moyenne 20 boisseaux par acre, desquels il tirera aisément 12 quarts ou barils de farine. En défalquant de cette quantité 6 quarts qui, avec les pommes de terre, seront consacrés à son usage personnel, il aura un surplus de six quarts. Chaque quart vaut, à bas prix, 35 fr. Le colon se fera donc environ 210 fr. avec les 6. En retranchant de cette somme 80 fr. pour le porc, il lui restera autant que je lui ai alloué pour la première année. Maintenant, le voici approvisionné pour jusqu’à novembre 1865, et il a en caisse 175 fr. Les cinq acres d’orge produisent 175 boisseaux, valant, disons 2 fr. chacun, ce qui lui donne 350 fr. pour le tout. Le rendement de ses quatre acres de pommes de terre, ou deux acres chaque année, devra être d’environ 800 boisseaux. Nous lui en céderons la moitié pour la consommation domestique et l’élevage de deux ou trois porcs. Il aura donc un excédant de 400 boisseaux. En les mettant au minimum à 1 fr. le boisseau, sa récolte lui rapportera 400 fr.
Ainsi, avec les cendres, la farine, l’avoine et les pommes de terre, il se sera fait 925 fr. Déduisons à présent, de cette somme, 165 fr. pour le sel, le poisson fumé, le thé et la semence, et on trouvera encore, au crédit de notre colon, une balance de 760 fr.; voilà assurément un beau résultat, mais nous avons compté avec le beau temps et tous les avantages possibles, qu’on ne l’oublie pas!
Admettons que l’été de 1865 ait été passé aussi industrieusement et aussi favorablement que celui de 1864. Le colon ne peut plus retourner au chantier. Il faut qu’il batte, fasse moudre son grain et défriche encore. Il devra avoir, au mois de juin suivant, vingt acres prêts à recevoir la semence. Sa terre exigera le labour, sa petite famille une vache. Une paire de bœufs lui coûtera 400 fr., une charrue avec la chaîne 80 fr., la vache 100 fr., ce qui réduira ses 760 à 180 fr., somme affectée aux dépenses accidentelles. Je n’alloue rien pour le savon et la chandelle, parce que le premier se fabrique habituellement à la ferme avec les cendres et les rebuts de graisse. Quant à l’éclairage, on peut, en commençant, se servir de torches de pin sec ou de cèdre; rarement les colons achètent du sucre. Ils en font eux-mêmes, l’érable leur fournissant, en abondance, les matières saccharines nécessaires. Je puis affirmer, par expérience et sans crainte d’être démenti, que le sucre d’érable est meilleur et plus hygiénique que le sucre de canne ou de betterave. Le sirop qui découle de cet arbre si précieux, forme une boisson très agréable; c’est aussi un remède contre une foule de maladies. La préparation du sucre est d’une simplicité patriarcale et n’entraîne presque aucun déboursé. Chaque habitant peut faire le sien. Il est des gens qui exploitent en grand cette industrie et réalisent des bénéfices considérables.
La troisième année, le colon ou squatter, comme on l’appelle, fera naturellement de plus gros profits. À son fonds il ajoutera quelques moutons, un cheval et quelques têtes de gros bétail. En 1867, il sera, Dieu aidant, en état de payer, avec intérêt et sans gêne, le capital qui lui aura été prêté en 1864, ou de rentrer dans ses avances. Sans doute cet aperçu a un côté séduisant. Mais je n’ai point fait la part de la grêle, de la gelée, des pluies continues, de la sécheresse, de la mouche hessoise qui, depuis quelques années, fait d’affreux ravages dans l’Amérique du Nord. Et la maladie de la pomme de terre; et la concurrence; et la difficulté des voies de communication et six mois d’hiver avec des froids de 20° à 30° Réaumur; et des chaleurs tropicales en été; et des bouleversements atmosphériques qui, en quelques heures, quelques minutes parfois, font varier le thermomètre de 10 à 20 degrés et les mille incommodités qui assaillissent l’émigrant sur la terre étrangère!
Je terminerai cette exposition en répétant à mes compatriotes de ne pas se laisser prendre aux promesses décevantes des agents d’émigration qui parcourent la France pour racoler nos bons et laborieux campagnards. L’Amérique est incontestablement un beau pays, très productif. Quelques Européens y ont promptement acquis des richesses énormes. Mais sur cent Français qui cherchent à en faire le théâtre de leur fortune, il y en a quatre-vingts qui meurent littéralement de besoin, ou repassent à la mère-patrie, quinze qui végètent, trois qui se tirent d’affaire et deux qui réussissent… quelquefois.
Tous ces malheureux contribuent puissamment, néanmoins, à la colonisation du Nouveau-Monde. Ils en furent les premiers pionniers, depuis la découverte du Saint-Laurent par Jacques Cartier, en 1534; aujourd’hui encore on les voit marcher à la tête de la civilisation, au défrichement du désert américain. Partout ils ont transplanté dans les États de l’Ouest notre gaieté, notre esprit d’aventures, nos dénominations de localités. Ils s’étaient établis dans le Michigan, le Wisconsin, l’Ohio, l’Illinois, le Mississipi, le Missouri, la Californie, le Minnesota, bien avant l’arrivée des Anglo-Saxons; dès 1851, ils se jetaient en nombreuses caravanes dans le Kansas! Et quels singuliers colons que ceux-là! Il y avait des médecins, des avocats, des notaires, des professeurs, des gens de lettres, des hommes de cape et d’épée, jusqu’à des prêtres qui avaient jeté le froc aux orties! Un des premiers journaux fut rédigé en français et publié à Leavenworth, capitale en espérance, riche à l’heure qu’il est de sept ou huit mille habitants, appelée à en avoir cent dans un quart de siècle! L’intéressant tableau qu’il y aurait à peindre!… Mais nous devons nous arrêter pour reprendre le fil de notre récit.