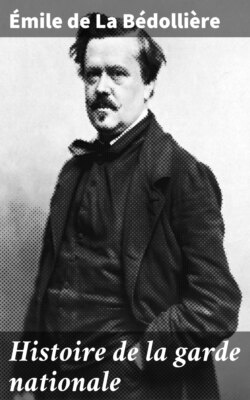Читать книгу Histoire de la garde nationale - Emile de La Bédollière - Страница 4
CHAPITRE II.
ОглавлениеJuillet 1789. — Réunion des troupes autour de Paris. — Mirabeau demande l’établissement des gardes bourgeoises. — Motions de Bonneville et de Bancal des Issarts. — Paris demande le rétablissement des gardes bourgeoises — Création du Comité permanent de la milice parisienne. — Délibérations des districts. — Organisation de la milice. — Premier état-major. — Attaque et prise de la Bastille.
Les députés réunis à Versailles, au mois de janvie 1789, ne tardèrent pas à manifester l’intention d’outrepasser les volontés royales, et d’étendre les réformes au-delà des mesures financières. Le 17 juin, ils se constituèrent en Assemblée nationale, et la cour, vaincue dans les luttes parlementaires, résolut de combattre le mouvement par la violence. Louis XVI, dans sa déclaration du 23 juin, annonça «qu’il entendait conserver l’ancienne distinction des trois ordres, les droits féodaux et seigneuriaux, l’exemption des charges pour les deux premiers ordres de l’État.» Afin de prévenir toute résistance, des masses considérables s’approchèrent de Paris. Trente-cinq mille hommes, sous les ordres du baron de Besenval, manœuvrèrent entre Versailles et la capitale; trois régiments Suisses vinrent camper au Champ-de-Mars, avec huit cents hussards et dragons; cinq autres régiments s’établirent à Saint-Denis. Des batteries furent placées au pont de Sèvres, à Saint-Cloud, à Meudon, à Montmartre et à Passy. Les hussards de Bouillon et de Nassau occupèrent l’orangerie de Versailles, où ils reçurent la visite du comte d’Artois, de la reine, et de madame de Polignac.
Pendant la séance du 8 juillet, Mirabeau entretint l’Assemblée nationale de ces dispositions militaires; il peignit avec éloquence les dangers qu’elles présageaient, les alarmes et l’indignation qu’elles éveillaient dans tous les cœurs, et conclut: «à ce que S. M. fût suppliée de rassurer ses fidèles sujets, en donnant des ordres pour le prompt renvoi des troupes et l’établissement de gardes bourgeoises dans les deux villes de Paris et de Versailles, attendu qu’il pouvait être convenable de pourvoir provisionnellement au maintien du calme et de la tranquillité.»
Cette seconde partie de la motion fut écartée; mais cependant elle répondait au vœu général des Parisiens. Dès le 26 juin, M. de Bonneville avait proposé aux électeurs des soixante districts de voter une somme destinée aux frais d’équipement de la garde bourgeoise régénérée. Le 10 juillet, Bancal des Issarts renouvela cette proposition. Il demanda aux électeurs, réunis à l’hôtel de ville, «qu’il fût voté une adresse pour exprimer le désir de voir reconstituer la garde bourgeoise;
«Qu’il en fût délibéré dans les districts;
«Que l’assemblée des électeurs nommât un comité de vingt-quatre membres, afin de s’occuper des moyens d’assurer la tranquillité publique.»
Pendant que les représentants de la Cité cherchaient à régulariser l’administration, Paris entier se souleva. Le renvoi du ministre Necker, l’imprudente attaque du prince de Lambesc, les préparatifs menaçants des troupes, exaspéraient la population. Le cri aux armes partit du palais royal, et retentit de district en district; les boutiques d’armuriers furent pillées; au milieu de l’agitation générale, l’assemblée des électeurs fut animée du double sentiment de l’ordre et de la liberté. Elle sentit la nécessité d’opposer une force imposante au mauvais vouloir ministériel; d’un autre côté elle craignit de voir des armes entre les mains d’hommes de toute classe et de toute espèce. En conséquence elle envoya des commissaires dans tous les postes où des citoyens armés s’étaient déjà réunis, «pour les prier, au nom de la patrie, de suspendre tout attroupement et toute voie de fait;» puis elle adressa la requête suivante à l’Assemblée nationale:
«L’assemblée des électeurs de la ville de Paris, ne pouvant se dissimuler que la présence d’un grand nombre de troupes dans cette capitale et aux environs, loin de calmer les esprits et d’empêcher les émotions populaires, ne sert, au contraire, qu’à donner des alarmes plus vives aux citoyens, et à occasionner des attroupements dans tous les quartiers, demeure convaincue que le seul et vrai moyen qu’elle puisse proposer dans une pareille circonstance, pour ramener la tranquillité, serait de rétablir la garde bourgeoise;
«Que cette garde est suffisante pour prévenir tous les dangers;
«Qu’elle est même nécessaire, et que les habitants de cette ville ont d’autant plus de raison de désirer de se garder eux-mêmes, que tout récemment la plupart des villes de Languedoc viennent d’y être autorisées par les ordres du ministre, et que les communes voisines ont de même armé leurs bourgeois pour la police des marchés.
«Par tous ces motifs, l’assemblée a arrêté de supplier, par l’entremise de ses députés, l’Assemblée nationale de procurer au plus tôt à la ville de Paris l’établissement de la garde bourgeoise.»
Cet arrêté fut lu le lendemain, 13 juillet, à l’Assemblée nationale par le député de Paris Guillotin, et les conclusions en furent appuyées par Le Pelletier de Saint-Fargeau et Chapelier. «Le sang coule, dit ce dernier; des troupes ennemies et étrangères assiégent un peuple bon et fidèle; les propriétés ne sont pas en sûreté ; il n’y a que la garde bourgeoise qui puisse remédier à tous ces malheurs.» Une députation fut nommée pour aller exposer au roi les vœux de l’Assemblée nationale. Le président, Lefranc de Pompignan, archevêque de Vienne, représenta à Louis XVI la situation alarmante des esprits, la nécessité de rétablir la tranquillité publique dans Paris en éloignant promptement les soldats et en établissant une milice bourgeoise. Le roi, abusé sur l’état des choses par la faction aristocratique qui l’entourait, répondit: «Je vous ai fait déjà connaître mes intentions sur les mesures que les désordres de Paris m’ont forcé de prendre; c’est à moi seul de juger de leur nécessité, et je ne puis à cet égard apporter aucun changement. Quelques villes se gardent elles-mêmes; mais l’étendue de cette capitale ne permet pas une surveillance de ce genre.» L’Assemblée s’indigna, mais elle ne se découragea point; elle déclara «qu’elle ne cesserait d’insister sur l’éloignement des troupes et sur l’établissement des gardes bourgeoises.»
Dès le matin du même jour, 13 juillet, une population immense assiégeait l’hôtel de ville en demandant des armes. A dix heures, le tocsin sonnait dans toutes les églises; les tambours, dans les différents quartiers, appelaient les citoyens, qui se rassemblaient sur les places et dans les jardins publics. Divers corps se formaient sous les titres de volontaires du Palais-Royal, des Tuileries, de la Basoche, de l’Arquebuse, etc. Sur la motion d’Ethis de Corny, procureur du roi de la ville, les électeurs nommèrent un comité permanent de la sûreté publique et de la milice parisienne. Des députés de tous les districts apportèrent à l’hôtel de ville leur adhésion, et déposèrent sur le bureau le résultat de leurs délibérations. Il est bon de citer ici quelques-uns de ces documents, qui sont, pour ainsi dire, les actes de naissance de la garde nationale, et où l’on voit pour la première fois apparaître cette glorieuse qualification.
Le district des Grands-Augustins statue: «que provisoirement, et pour la garde seulement de la nuit prochaine, chaque citoyen fera sentinelle devant la porte de sa maison.»
Le district des Enfants-Rouges commet des députés «pour prendre à l’hôtel de ville les mesures nécessaires à l’organisation de la garde municipale.»
Le district de Sainte-Élisabeth «a établi dans son sein une garde bourgeoise composée de citoyens connus, et rédigé un règlement provisoire pour les citoyens qui composeront cette GARDE NATIONALE.»
Le district Saint-Eustache arrête:
«De former une garde bourgeoise pour la sûreté et la garde publique de Paris;
«De communiquer sur-le-champ cette résolution aux régiments des gardes-françaises, des gardes suisses et autres corps de militaires-citoyens, pour les engager à se réunir à la milice bourgeoise.»
Le district de la Sorbonne arrête «que tous les citoyens vrais patriotes, en état de porter les armes, établiront des patrouilles qui veilleront jour et nuit à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte à la sûreté des personnes et des biens de tous les citoyens.»
Le district de Saint-Méry arrête:
«Qu’une garde bourgeoise sera établie et composée des chefs de maison, pères de famille et autres habitants exerçant profession publique, sans aucune distinction d’ordres, d’états et de qualités, nobles ou non nobles, même des jeunes gens attachés à MM. les notaires, procureurs, négociants et autres qui voudraient s’enrôler.»
Dans l’après-midi fut affiché l’arrêté qui constituait la garde nationale . Il était conçu en ces termes:
«La notoriété des désordres et des excès commis par plusieurs attroupements ayant déterminé l’assemblée générale à rétablir sans délai la milice parisienne, il a été ordonné ce qui suit:
«Le fond de la milice sera de quarante huit mille hommes; l’enregistrement fait dans les soixante districts sera de deux cents hommes pour le premier jour, et ainsi successivement pendant les trois jours suivants.
«Les soixante districts, réduits en seize quartiers, formeront seize légions, qui porteront le nom de chaque quartier. Il y aura douze légions composées de quatre bataillons, et quatre de trois bataillons. Chaque bataillon de huit cents hommes se subdivisera en quatre compagnies.
L’état-major général se composera d’un commandant général des seize légions, d’un commandant en second, d’un major général et d’un aide-major.
«L’état-major de chaque légion comprendra un commandant en chef, un commandant en second, un major, quatre aides-majors, un adjudant.
«Chaque compagnie sera commandée par un capitaine en premier, un capitaine en second, deux lieutenants et deux sous-lieutenants.
«Le comité permanent nommera aux différents postes et emplois; les officiers seront choisis par les districts.
«La cocarde sera bleue et rouge, aux couleurs de la municipalité ; tout homme trouvé avec cette cocarde, sans avoir été enregistré dans l’un des districts, sera remis à la justice du comité permanent.
«Le quartier de la milice sera toujours à l’hôtel de ville.
«Il y aura seize corps-de-garde principaux et soixante corps-de-garde correspondants.
«Les patrouilles seront postées partout où le besoin sera.
«Les armes prises dans les corps-de-garde y seront laissées par chaque membre de la milice parisienne, à la fin de leur service; les officiers en seront responsables.
«D’après cette composition arrêtée par le corps de la milice parisienne, chaque citoyen admis à défendre ses foyers, voudra bien, tant que les circonstances l’exigeront, s’astreindre à faire son service tous les quatre jours.»
A dix heures du soir, MM. Delavigne, président des électeurs, et Agier, électeur, apportèrent au comité permanent la déclaration de l’Assemblée nationale.
«Nos députés, dit M. Delavigne, ne doutent pas plus que vous qu’il faut des gardes bourgeoises pour ramener l’ordre et maintenir la sûreté. Les ministres qui obsèdent et trompent le meilleur des rois, montrent encore une opposition bien marquée à l’établissement de ces milices, mais le vœu de l’Assemblée nationale, consigné dans ses arrêtés, n’en est pas moins décidé pour que les milices bourgeoises soient établies. En douterez-vous encore, messieurs, lorsque je vous dirai qu’un des députés m’a remis, avant de partir, la note que voici, écrite de sa main: M. Dupont, conseiller d’Etat, chevalier de l’ordre de Vaza, et son fils, agé de dix-huit ans, demeurant rue du Petit-Musc, n° 17, demandent à être compris au rôle de la milice bourgeoise, si elle est établie.»
La nuit se passa paisiblement, grâce à l’activité des citoyens enrôlés, on désarma un nombre considérable de particuliers sans aveu. Mais l’initiative que prenait chaque district, le défaut d’ordre et de discipline, firent sentir la nécessité de donner immédiatement des chefs à la nouvelle garde. Le duc d’Aumont, désigné par les électeurs, ayant fait une réponse évasive, et demandé vingt-quatre heures pour se décider, le comité permanent choisit pour commandant en chef le marquis de la Salle d’Offemond, lieutenant-colonel du bataillon de Vermandois; pour commandant en second, M. Du Saudray, chevalier de Saint-Louis, ci-devant aide-maréchal-général-des-logis du roi; pour majors, MM. Caussidière et Souet d’Ermigny.
Cependant la multitude se portait vers la Bastille. On supposait que cette forteresse recélait un dépôt d’armes considérable; elle pouvait foudroyer le faubourg Saint-Antoine, une partie des boulevards et du quartier Saint-Paul. C’était d’ailleurs, en quelque sorte, la représentation architecturale du despotisme, et depuis plusieurs années, le projet de la détruire avait été mis en avant . La garnison de la Bastille ne se composait que de quatre-vingt-deux soldats invalides, deux canonniers de la compagnie de Monsigny, trente-deux suisses du régiment de Salis-Chamade, commandés par Louis de Flue, lieutenant de grenadiers; mais les munitions étaient plus que suffisantes; elles consistaient en boulets de calibre, quatre cents biscayens, quatorze coffrets de boulets sabottés, quinze cents cartouches et deux cents barils de poudre. Il y avait quinze pièces de canon sur les plates-formes, et trois autres vis-à-vis le grand pont-levis. On avait placé sur les remparts six fusils portant chacun une livre et demie de mitraille, et désignés sous le nom d’amusettes du comte de Saxe.
En outre, le gouverneur De Launay avait fait monter sur les tours six charetées de pavés, dechenets, de vieux boulets et de vieilles ferrailles. On avait réparé les ponts-levis, enlevé les garde-fous, entaillé les embrasures, pratiqué des meurtrières; et les Suisses, à l’instigation du gouverneur, juraient de faire feu sur les invalides, si ceux-ci refusaient d’obéir.
A midi, une bande désarmée se groupe autour du pont-levis de l’avancé, en criant: «Laissez-nous entrer! donnez-nous des armes et des munitions.»
De Launay ordonne de baisser le pont, le fait relever aussitôt que la députation est dans la première cour, et ouvre un feu roulant sur des malheureux qu’il a mis dans l’impossibilité de fuir. De toutes parts on crie! «Trahison! à bas la troupe!» Louis Tournay, ancien soldat au régiment Dauphin, monte sur le toit du corps-de-garde attenant à l’avancé, et brise avec une hache les supports du pont-levis. L’attaque commence, quinze ble-sés sont recueillis dans les maisons de la rue de la Cerisaie; un jeune homme atteint d’une balle au bras, un garde-française expirant sur un brancard, sont conduits au comité permanent, auquel on demande de décréter le siège, tandis que d’autres citoyens vont chercher du renfort en racontant dans Paris la perfidie du gouverneur. Le siège de la Bastille, qui n’était que le rêve de quelques hommes, devient une pensée générale. Soulevée par les récits des premiers assaillants, la population entière s’ébranle; ouvriers, soldats, pompiers, journaliers des campagnes, femmes, abbés, capucins, grossissent l’armée assiégeante, les uns avec des carabines, d’autres avec des arquebuses à rouet, des massues, des haches, des javelots, des lames de sabre emmanchées au bout de perches. En moins d’une heure, on a pénétré dans la cour du gouvernement, et l’on échange des coups de fusil avec les chefs suisses postés derrière le pont-levis de la grande cour.
Une députation du comité s’avance au pied de la forteresse. Elle est composée de MM. Delavigne, Chignard, de l’abbé Fauchet, et de M. Bottidoux, député suppléant des communes de Bretagne. En approchant, ils agitent leurs mouchoirs en signe de paix; néanmoins, la fusillade continue. Trois hommes, frappés mortellement, tombent auprès de M. Delavigne, et c’est au bruit de la mousqueterie, que ce courageux parlementaire fait lecture de la proclamation suivante:
«Le Comité de la Milice parisienne, considérant qu’il ne doit y avoir à Paris aucune force militaire qui ne soit sous la main de la ville, charge les députés de la ville qu’il adresse à M. le marquis de Launay, commandant de la Bastille, de lui demander s’il est disposé à recevoir dans cette place les troupes de la milice parisienne, qui la garderont de concert avec les troupes qui s’y trouvent actuellement, et qui seront aux ordres de la ville.
«Signé : DE FLESSELLES, prévôt des marchands et président du comité ; DELAVIGNE, président des électeurs; MOREAU DE SAINT-MÉRY, président des électeurs, etc.»
La députation se retire sans que le combat ail cessé. Postés au haut des tours, les officiers de l’état-major encouragent eux-mêmes les tirailleurs par leur exemple. Les Suisses, placés dans la cour principale, ont pratiqué une meurtrière dans le tablier du grand pont-levis, et foudroient les assiégeants avec l’un de ces fusils appelés amusettes du comte de Saxe.
Une autre ambassade arrive, tambour battant, précédée d’un drapeau blanc.
Elle a pour mission:
D’engager ceux qui environnent la Bastille à se retirer dans leurs districts respectifs, pour y être promptement incorporés dans la milice;
De rappeler à M. de Launay combien il est important de ne pas exciter l’animosité du peuple, et d’épargner la vie des citoyens;
De le sommer enfin de cesser toute hostilité, et de recevoir les défenseurs de la ville à la garde et dans l’intérieur de la forteresse.»
Les envoyés de la ville sont MM. Ethis de Corny, Francotay, Contans, Joannon fils, Boucheron, de Milly, Poupart de Beaubourg et Piquot de Sainte-Honorine. A leur aspect, on arbore le pavillon blanc sur la plate-forme des tours; les Invalides renversent leurs fusils, élèvent leurs chapeaux; leur attitude fait espérer un accommodement.... Mais soudain plusieurs coups de feu retentissent: une balle sillonne l’épaulette de M. Poupart de Beaubourg; une autre perce le chapeau d’un député. «Retirez-vous, crie-t-on à M. Francotay; vous voyez bien que la trahison est manifeste.
— C’est plutôt à vous de vous retirer, répond l’électeur, vous vous sacrifiez inutilement. Attendez, et trois cents gardes françaises vont arriver avec cinq pièces de canon. Si vous restez ici, ils ne pourront pénétrer dans cette cour encombrée.
— Nous n’avons pas besoin de renfort!... Laissez-nous, nous périrons ou nous mangerons tous ces b..... là !
— Mais à quoi bon vous exposer?
— Nous épargnons de la besogne aux gardes françaises; si nous sommes tués, nos corps serviront à combler le fossé !»
Francotay s’éloigne plein d’admiration pour ce noble dévouement. Les assiégeants, furieux, amènent trois voitures de paille et s’en servent pour mettre le feu aux bâtiments de la cour du gouvernement. Les flammes dévorent l’hôtel de De Launay, quand on voit déboucher de la rue Saint-Antoine un détachement de grenadiers de Ruffeville, commandé par le sergent-major Wargnier, des fusiliers de la compagnie de Lubersac, sous les ordres du sergent de grenadiers La Barthe, et une troupe de bourgeois armés que dirige Hulin, ancien officier au service de Genève, employé à la buanderie de la Reine . Un canon, plaqué en argent, présent du roi de Siam à Louis XIV, un mortier, quatre pièces de quatre, sont mis en batterie par les gardes-françaises.
Serré d’aussi près, ne voyant pas arriver les secours promis par MM. de Bezenval et de Flesselles, le gouverneur prend la résolution de s’ensevelir sous les ruines de la forteresse; il saisit la mèche de l’un des canons braqués dans la grande cour, et va droit à la Sainte-Barbe. «Vous ne passerez pas, lui dit le sous-officier Ferrand, en lui présentant la baïonnette. De Launay insiste: «N’avancez pas, s’écrie Ferrand, ou je vous tue comme un chien.» Le gouverneur, éperdu, recule, et descend à la Tour de la Liberté, où sont déposées les poudres introduites au château dans la nuit du 12 au 13; mais Bécard, autre sous-officier, l’oblige à se retirer, et prévient un acte de démence qui aurait fait sauter la Bastille, les maisons voisines et une partie du faubourg Saint-Antoine.
De Launay revient dans la grande cour: «Nous allons être égorgés, dit-il aux soldats; remontons sur les tours, et mitraillons ces misérables.» Mais la garnison est lasse de combattre; elle hésite, elle refuse de verser le sang plus longtemps. On bat donc la chamade; le drapeau blanc est arboré sur la tour de la Bassinière. M. de Flue, commandant des Suisses, harangue les assaillants à travers un créneau, et leur tend un billet écrit au crayon, en disant: «Nous voulons bien nous| rendre si l’on promet de ne pas massacrer la troupe; nous désirons sortir avec les honneurs de la guerre.»
Le jeune Réoles, mercier près l’église Saint-Paul, s’aventure sur une planche jetée en travers du fossé, prend le papier et le remet à Élie, ancien officier au régiment de la Reine-infanterie, l’un des directeurs du siège. Élie, imposant silence à ses compagnons, lit à haute voix: «Nous avons vingt milliers de poudre; nous ferons sauter la garnison et tout le quartier si vous n’acceptez pas la capitulation.
— Foi d’officier, nous l’acceptons! dit Élie; baissez vos ponts!
Au bout de quelques minutes on baissa le petit pont-levis de passage, puis le grand pont. Il était alors cinq heures trois quarts. Arné, de Dôle, grenadier aux gardes françaises, pénètre le premier dans la place, et les assiégeants se précipitent sur ses traces. La garnison avait déposé les armes le long du mur; à droite étaient les invalides, à gauche les Suisses, couverts de sarreaux de toile. Ils ôtent leurs chapeaux, battent des mains, et crient: Bravo! Les premiers entrés fraternisent avec eux; malheureusement quelques soldats placés sur les plates -formes tirent plusieurs coups de fusil, et les survenants, qui ignorent la capitulation, se ruent sur les invalides, qui auraient tous péri sans l’intervention généreuse des gardes françaises. Le canonnier Asselin tombe expirant; par une fatale erreur, Bécard, celui qui a sauvé le quartier d’une explosion, reçoit deux coups d’épée; et un coup de sabre qui lui abat le poignet. On va porter dans les rues cette main à laquelle tant de citoyens doivent leur salut. La multitude aveuglée prend Bécard pour un canonnier, l’entraîne à la Grève avec Asselin, et les pend à la potence de fer d’une lanterne, au coin de la maison d’un épicier.
Pendant qu’on brise les portes massives des prisons, qu’on enlève de la chapelle un tableau représentant saint Pierre aux liens, qu’on visite les souterrains, qu’on pénètre dans les cachots, le gouverneur paraît, la tête nue, vêtu d’un frac gris, sans insignes militaires, et tenant une canne à épée dont il essaye de se percer. Le grenadier Arné la lui arrache; le grenoblois Cholat, marchand de vin rue des Noyers-Saint-Jacques, fait prisonnier le commandant désarmé. Quelques minutes après, les vainqueurs prennent le chemin de l’hôtel de ville. Élie, porté en triomphe, est en possession des clefs de la Bastille, et brandit son épée, au bout de laquelle il a mis la capitulation. Maillard, fils d’un huissier à cheval au Châtelet de Paris, tient le drapeau de la Bastille. Derrière eux marche un jeune homme nommé Guigon, montrant au bout de sa baïonnette le recueil des règlements de la place, volumineux registre scellé d’une agrafe de fer. Puis vient M. de Launay, protégé par Hulin, Arné, et par de l’Épine, clerc de maître Morin, procureur au parlement. Autour et à la suite de ce groupe principal se meut une foule compacte, bruyante, animée par l’exaltation de la victoire et la soif de la vehgeance. Des cris de mort retentissent aux oreilles du gouverneur; des mains s’avancent pour lui arracher les cheveux; des épées, des baïonnettes sont dirigées vers sa poitrine. «Messieurs, dit-il à ses gardes, vous m’avez promis de ne pas m’abandonner; restez avec moi jusqu’à l’hôtel de ville.» Cependant l’Épine reçoit sur la tête un coup de crosse heureusement amorti par son chapeau; Hulin, épuisé des efforts qu’il a faits pour défendre le prisonnier, tombe anéanti sur un banc. Aussitôt le gouverneur est assailli par une multitude de furieux. Meurtri de coups de crosse, sanglant et mutilé, il murmure d’une voix éteinte: «Mes amis, tuez-moi, tuez-moi sur-le-champ; ne me faites pas languir.» Il tombe; on lui coupe la tête, et on l’élève au bout d’une pique avec cet écriteau: DE LAUNAY, GOUVERNEUR DE LA BASTILLE, PERFIDE ET TRAITRE ENVERS LE PEUPLE.
Delosme Salbray, major de la Bastille, fut également massacré sur la Grève, vis-à-vis l’arcade Saint-Jean, malgré les efforts du marquis de Pelleport, dont il avait été le consolateur pendant une captivité de cinq années M. de Miray, aide-major, M. Pierson, capitaine de la compagnie des Invalides, furent tués, l’un rue des Tournelles, l’autre sur le Port-au-blé.
La clameur publique accusait le prévôt des marchands: il avait envoyé la compagnie du district des Mathurins chercher des armes aux Chartreux, à l’Arsenal et dans d’autres maisons où il n’y en avait point. Il avait annoncé au comité permanent que M. de Pressoles, intéressé à la manufacture de Charleville, allait lui expédier douze mille fusils, et les caisses estampillées artillerie, qu’on supposait contenir cet envoi, étaient remplies uniquement de chiffons, de copeaux et de bouts de chandelles. M. de Flesselles s’était constamment opposé aux mesures prises par les électeurs, et l’on avait trouvé dans la poche du gouverneur le billet suivant: «J’amuse les Parisiens avec des cocardes et des promesses; tenez bon jusqu’à ce soir, et vous aurez du renfort. DE FLESSELLES.»
Au moment où les héros du siège entrèrent dans la grande salle de l’hôtel de ville, le prévôt des marchands était en butte aux reproches des électeurs. «Puisque je suis suspect à mes concitoyens, dit-il, il est indispensable que je me retire.» Il sortit, en effet, accompagné de plusieurs personnes, auxquelles il parlait de très-près et avec beaucoup d’agitation: «Messieurs, disait-il, vous verrez chez moi quelles ont été mes raisons; quand vous serez à la maison je vous expliquerai tout cela.» Il cherchait à s’entourer de son escorte comme d’une sauvegarde: mais au coin du quai Pelletier, un jeune homme lui crie: «Traître, tu n’iras pas plus loin!» et d’un coup de pistolet dans l’oreille il renverse le complice de de Launay.
Dans la nuit, les troupes royales se replièrent sur Sèvres; toutefois, comme on redoutait encore une attaque, le tocsin sonnait sans interruption dans toutes les paroisses; bourgeois et ouvriers étaient en armes. Le brasseur Santerre avait été nommé par le peuple commandant-général du faubourg Saint-Antoine. Les gardes françaises qui avaient refusé de rentrer dans leurs casernes étaient répartis dans les couvents de Sainte-Geneviève, des Feuillants de la place Vendôme, des Jacobins de la rue Saint-Honoré, et se tenaient prêts à marcher au premier signal. Un grand nombre de rues étaient barricadées, des pierres avaient été montées dans les maisons, les fenêtres étaient ouvertes et illuminées, et l’on entendait les patrouilles crier par intervalles: «Ne vous couchez pas; soignez vos lampions, nous avons besoin de voir très-clair cette nuit.» Cependant les plombiers fondaient des balles et des lingots, les armuriers fabriquaient des piques; une batterie de canons occupait la terrasse des Tuileries. Paris semblait un immense atelier, un camp formidable, où chacun se préparait au combat, mais plein de confiance et de courage, paraissant moins craindre qu’attendre avec impatience et désirer l’approche de l’ennemi.