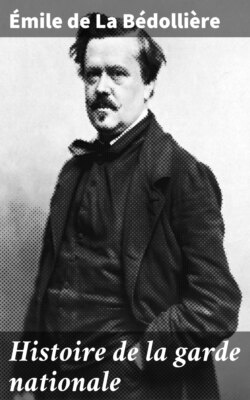Читать книгу Histoire de la garde nationale - Emile de La Bédollière - Страница 6
CHAPITRE IV.
ОглавлениеJournées des 5 et 6 octobre 1789. — Revues passées par Louis XVI et La Fayette. — Règlement pour le service des postes. — Projet d’un bataillon de vétérans. — Affiliations et fédérations. — Journée du 30 mai 1790, à Draguignan et à Lyon. — Fête nationale du 14 juillet 1790.
Malgré tant de manifestations patriotiques, l’aristocratie vaincue n’avait pas perdu tout espoir; des souscriptions s’ouvraient dans la noblesse et le clergé pour faciliter l’accomplissement d’une contre-révolution; Louis XVI devait se retirer à Metz, d’où il aurait révoqué toutes ses concessions. Quinze cents uniformes verts à parements rouges avaient été commandés. Les compagnies du centre, dont les soldats avaient autrefois partagé avec les gardes-du-corps le service du château, demandèrent à aller reprendre leurs postes, afin de surveiller les projets et les actes de la cour. La Fayette comprima ce mouvement, mais craignant de n’être pas toujours obéi, il avertit du danger le comte d’Estaing, commandant de la garde nationale de Versailles.
Celui-ci rassemble à la hâte son état-major, lui communique la lettre du général parisien, et l’on décide qu’on demandera au roi un renfort de mille hommes. Sur quarante-deux compagnies dontla garde nationale de Versailles était composée, vingt-huit désavouent cette requête; néanmoins, le régiment de Flandre, mandé par les ministres, s’avance à marches forcées. Il entre à Versailles avec deux pièces de canon, huit barils de poudre, six caisses de balles, un caisson de mitraille et six mille neuf cent quatre-vingt-six cartouches. On le conduit sur la place d’armes, où il prête serment en présence des officiers de la garde nationale; mais bientôt il dévoile ses véritables intentions. Dans les banquets des 1er et 3 octobre, des gardes-du-corps, des gardes-suisses, des dragons, des grenadiers du régiment de Flandre, boivent à la santé du roi, et rejetant avec dédain celle de la nation, arborent la cocarde blanche, foulent aux pieds les trois couleurs, et lancent des imprécations contre l’Assemblée nationale.
Ces nouvelles surprennent Paris au milieu d’une famine cruelle et d’un malaise universel. Le peuple s’émeut; les femmes sont les premières, le 4 octobre, à former des groupes sur la place de Grève, chamarrées de rubans et munies de lances, de fourches, de bâtons, de fusils et de pistolets. Elles veulent entrer à l’hôtel de ville, et appellent à grands cris le maire et les représentants de la Commune. M. d’Ermigny, aide-major-général de la garde nationale, ne pouvant se décider à employer la force contre des femmes, imagine de leur céder la place, et de leur confier la garde de l’hôtel. En effet, elles s’emparent de tous les postes, ne laissent approcher que des personnes de leur sexe, et repoussent les hommes armés de piques et de bâtons, qui cherchent à occuper la Maison commune; mais leur zèle est infructueux. L’attroupement grossit, envahit les cours, brise les portes, enlève un amas de piques, de hallebardes et de fusils, et allume des torches, pour brûler les papiers de la Commune. Sans le courage de trois compagnies de grenadiers, qui parviennent à faire évacuer l’hôtel de ville, les archives et peut-être l’édifice tout entier devenaient la proie des flammes.
Cependant, aux sons du tocsin et de la générale, les bataillons se rassemblent sur les places de chaque district. La majorité des compagnies du centre paraît sur la place de Grève, où elles sont accueillies par les plus vives acclamations. «Ce ne sont pas des applaudissements que nous vous demandons, s’écrient les soldats; la nation est insultée, prenez les armes, et venez avec nous recevoir les ordres des chefs.» Des détachements de tous les districts se rangent successivement sur la place; une députation de grenadiers se présente à La Fayette: «Mon général, dit l’un d’eux, nous ne vous croyons pas un traître, mais nous nous croyons trahis par le gouvernement. Le peuple est malheureux; la source du mal est à Versailles; il faut aller chercher le roi et l’amener à Paris. Nous ne pouvons tourner nos baïonnettes contre des femmes qui nous demandent du pain. Nous irons à Versailles exterminer le régiment de Flandre et les gardes-du-roi qui ont osé fouler aux pieds la cocarde nationale.»
La Fayette hésite; il harangue les grenadiers, leur rappelle le serment qui les lie à la nation, à la loi et au roi; mais sa voix se perd au milieu des cris sans cesse renouvelés: «Du pain! à Versailles!» Il espère encore maîtriser le mouvement, mais «l’impulsion était irrésistible. La garde nationale, tout entière, était alors sous les armes, et la garde nationale, tout entière, partageait le vœu public .» Vers cinq heures du soir, le Conseil de ville prend cet arrêté : «Vu les circonstances et le désir du peuple, et sur la représentation faite par M. le commandant général, qu’il lui est impossible de s’y refuser, l’Assemblée autorise M. le commandant général et même lui ordonne de se transporter à Versailles. En même temps, elle lui recommande la sûreté de la ville; déclare que, pour le surplus, elle s’en rapporte à sa prudence; nomme quatre membres de l’Assemblée pour l’accompagner, et arrête qu’elle ne se séparera que lorsqu’elle sera assurée de la tranquillité de la capitale, et qu’elle aura reçu des nouvelles de Versailles.»
La Fayette était à cheval, à la tête de l’état-major, attendant les ordres du pouvoir civil. En les recevant, dit Prudhomme , il change de couleur et promène un regard douloureux sur la brillante armée et sur le peuple qui remplissait la place. Il détache aussitôt, pour former l’avant-garde, trois compagnies de grenadiers et une de fusiliers avec trois pièces de canon. Sept à huit cents hommes, armés de fusils, de piques ou de bâtons, marchent en éclaireurs, sous les ordres de M. Collard, lieutenant de la troupe non soldée du district Saint-Germain-l’Auxerrois.
A cinq heures sept minutes, la garde nationale débouchait par le quai Pelletier sur trois rangs. Le corps d’armée mit quarante minutes à défiler, salué par d’unanimes applaudissements. Quelques citoyens en uniforme, qui étaient parmi les curieux, furent accablés d’injures; on leur lança même des pierres, notamment sur la terrasse des Tuileries. «Le peuple, ajoute à ce sujet Prudhomme, ne songeait pas que si l’on eût dégarni Paris de toute la garde nationale, les aristocrates qu’il renferme dans son sein auraient sûrement fait quelque tentative.»
«La bonne contenance de nos guerriers, malgré la pluie, la fatigue de tout le jour, l’incertitude où ils étaient de trouver des subsistances et des logements, communiquait à toutes les âmes une joie martiale. Allez, bravez le trépas; vous portez avec vous le destin de la France; nos cœurs vous suivent; secourez notre roi; sauvez nos députés; soutenez la majesté nationale: quatre cent mille bras sont prêts à vous applaudir ou à vous venger.»
Plusieurs groupes, composés en majorité de femmes, avaient précédé le corps d’armée. L’un d’eux fut admis chez le roi; un autre entra à l’Assemblée nationale; un troisième déboucha sur la place d’armes, dirigé par le garde national Brunout. Ce chef s’approcha de M. de Savonnières, lieutenant des gardes-du-corps, et le somma de quitter la cocarde blanche; celui-ci ne répondit qu’en tirant son sabre; mais au moment même une balle lui fracassa l’épaule. Le coup partait du poste où la milice de Versailles s’était retranchée; elle pouvait craindre des représailles de la part des compagnons du blessé ; toutefois, elle fit si bonne contenance, que les gardes-du-corps n’osèrent entamer les hostilités.
Le comte d’Estaing était au château. M. de Gouvernet, commandant en second, avait pris place dans les rangs de la garde du roi. Lecointre, lieutenant colonel de la première division, s’empare de l’autorité ; fait annoncer au son du tambour l’approche des Parisiens, en invitant chaque citoyen de Versailles à leur donner l’hospitalité. Puis, suivi d’un aide-de-camp et d’un aide-major, il s’avança hardiment vers les gardes-du-corps, rangés en bataille devant le château. «Le peuple se croit en danger, dit-il, et nous désirons savoir ce qu’on doit attendre de vous. — Monsieur, répond un officier, nous oublions le traitement fait à l’un des nôtres, et nous ne sommes animés que du désir de vivre en bonne intelligence.» Après avoir fait part à la milice de ces dispositions pacifiques, Lecointre apostrophe les officiers du régiment de Flandre, qui s’écrient: «Jamais nous n’avons eu l’intention de faire du mal aux bourgeois;» et les soldats, pour gage de leurs sentiments, délivrent aux volontaires nationaux une assez grande quantité de cartouches.
Un moment après, les Parisiens arrivent, et à la lueur des torches, se rangent en bataille sur la place d’armes. La Fayette entre dans le cabinet du roi. «Sire, lui dit-il, la commune de Paris, instruite que votre auguste personne n’est pas en sûreté, nous envoie vous offrir ses services.» Louis XVI fait une réponse affectueuse, et déclare qu’il se verra avec satisfaction protégé par la milice parisienne. En effet, une partie des gardes nationaux se distribue dans les postes extérieurs du château; d’autres, cédant à des invitations réitérées, vont loger chez les habitants; quelques-uns, harassés de fatigue et trempés de pluie, se réfugient dans les églises. Le calme semble rétabli; mais, vers cinq heures et demie, une bande armée s’élance vers le château et menace de l’envahir. Un garde-du-corps tire un coup de fusil par une fenêtre et tue un garde national, fils d’un sellier de Paris. Aussitôt la foule pénètre dans les appartements: trois gardes-du-corps sont saisis et décapités; et tous auraient péri victimes de la fureur populaire, si Lafayette n’était sorti du cabinet du roi en criant: Grâce! et si la garde nationale, accourant à la hâte, n’avait répété le même cri. C’est ce que constata plus tard le Comité des Recherches, chargé de faire une enquête sur les événements des 5 et 6 octobre.
«Le forfait exécrable qui a souillé le château de Versailles, dans la matinée du mardi 6 octobre, n’a eu pour instruments que des bandits, qui se sont mêlés et confondus parmi les citoyens. Le comité ne rappellera point tous les excès auxquels ces brigands se sont livrés, et qu’ils auraient multipliés sans doute s’ils n’avaient été arrêtés par les troupes nationales destinées à réprimer les désordres et à assurer la tranquillité du roi et de l’Assemblée nationale. Elles remplissaient à leur arrivée cet objet sacré, dont elles s’étaient fait la loi par le serment de fidélité et de respect pour le roi, qu’elles avaient renouvelé à leur entrée à Versailles. Placées à l’extérieur du château, dans les postes que le roi avait ordonné de leur confier, elles s’occupèrent à y maintenir le bon ordre. Tout paraissait calme, grâce à leur zèle et aux dispositions sages de leur commandant; la confiance et l’harmonie régnaient partout; on ne parlait que de reconnaissance, d’amour et de fraternité, lorsque, entre cinq et six heures de la matinée du mardi, une troupe de ces bandits armés, accompagnés de quelques femmes et d’hommes déguisés en femmes, fit, par des passages intérieurs du jardin, une irruption soudaine dans le château, força les gardes-du-corps en sentinelle dans l’intérieur, enfonça les portes, se précipita vers l’appartement de la reine, massacra quelques-uns des gardes qui veillaient à sa sûreté et pénétra dans ses appartements, que Sa Majesté avait eu à peine le temps de quitter pour se retirer auprès du roi. La fureur de ces assassins ne fut réprimée que par les gardes nationales, qui, averties de ce carnage, accoururent de leurs postes extérieurs pour les repousser, et arrachèrent de leurs mains d’autres gardes-du-corps qu’ils allaient immoler.»
En empêchant cette mémorable expédition de dégénérer en massacre, la garde nationale en assura les résultats. Louis XVI sanctionna la constitution commencée et consentit à fixer son séjour à Paris; et la faction rétrograde, surveillée désormais par des forces redoutables, dut renoncer momentanément à ses projets.
Dès les premiers jours de son arrivée, le 18 octobre, Louis XVI passa en revue une division de la garde nationale, dans l’avenue des Champs-Élysées; il s’y rendit à pied, malgré la pluie, escorté de cinq cents gardes d’honneur, sans armes, de la troupe non soldée, et parcourut les rangs, accompagné de La Fayette. Dans une seconde revue, qui eut lieu le 20 novembre, le commandant général recommanda aux citoyens la bonne intelligence entre eux et la régularité du service. Il annonça qu’on avait à craindre de nouveaux troubles, et que tous les volontaires nationaux devaient se tenir prêts à prendre les armes au signal donné par trois coups de canon que tireraient des batteries établies sur le terre-plein du Pont-Neuf. On mit en vigueur un règlement rédigé par le comité militaire de la municipalité. On y déterminait avec soin le service journalier des postes, détachements et patrouilles, les formalités auxquelles étaient astreintes les gardes montantes et descendantes. On peut juger, par les extraits suivants, que les obligations imposées aux soldats-citoyens étaient alors plus rigoureuses qu’aujourd’hui.
«Une sentinelle ne pourra jamais quitter ses armes, même dans sa guérite. Elle ne pourra ni dormir, ni s’asseoir, lire, chanter, siffler, manger, ni fumer. Elle se promènera portant l’arme au bras, sans s’éloigner du poste de plus de trente pas.
«Les soldats et les bas-officiers de la troupe non soldée s’absenteront une heure pour prendre le repos, avec l’agrément du commandant du poste. Le soldat ou bas-officier non soldé qui aura été absent plus d’une heure sera puni par un tour de service de plus.
«Tout soldat ou bas-officier soldé qui s’absentera du poste sans permission sera envoyé à la salle de discipline pour quatre jours. Celui qui quittera le poste sans y revenir, y sera mis pour quinze jours, au pain et à l’eau.
«Lorsque deux patrouilles se rencontreront de nuit, celui des deux commandants qui découvrira le premier l’autre patrouille criera: Qui vive? On lui répondra: Patrouille. Il criera: Quel bataillon? On lui répondra le nom du bataillon. Alors il ajoutera: Halte là, avance qui a l’ordre. A l’instant les commandants des deux patrouilles s’approcheront l’un de l’autre, chacun ayant deux fusiliers deux pas en arrière; celui qui aura été sommé de s’avancer donnera à l’autre la moitié du mot d’ordre, et en recevra l’autre moitié.
«Les patrouilles arrêteront tous ceux qui, après neuf heures en hiver et dix heures en été, porteront des paquets, des malles et des meubles, à moins qu’ils ne justifient sur-le-champ et évidemment de la propriété desdits effets ou d’une destination non suspecte; en un mot toutes personnes qui commettraient ou seraient accusées d’avoir tenté de commettre quelques actions contraires à l’ordre et à la sûreté publique .»
Chargée en outre de dissiper les attroupements, d’arrêter les contrebandiers, d’appréhender au corps les colporteurs d’imprimés non autorisés par la Ville, la garde nationale y suffisait à peine. Un vieillard de de soixante-quatre ans, M. Callières de l’Étang, avocat au parlement et caporal du bataillon des Cordeliers, proposa d’échauffer le zèle des citoyens découragés en formant une troupe de vétérans, dont l’exemple enflammerait la jeunesse et la virilité. Il demanda à l’assemblée de son district, le 24 novembre 1789, qu’il fût créé un bataillon de cinq cent quarante vieillards, tous âgés de plus de soixante ans; que chaque district fournît un contingent de neuf vieillards, et que leur drapeau eût pour devise: Dulce et decorum est pro patriâ mori. «Je réponds, ajouta le motionnaire, de la facilité de former ce bataillon. Je me suis déjà assuré d’un bon nombre de vieux patriotes, qui sont impatients de voir agréer leurs services. Quant à moi, qui sens sur ma tète le poids de soixante-quatre années, je vous prends à témoins si, dans ces funestes révolutions, l’ardeur et les forces ont manqué à votre caporal!» L’assemblée générale du district des Cordeliers, présidée par Danton, adhéra à la motion, qu’elle fit imprimer à ses frais, en exprimant la certitude «qu’une pareille institution était faite pour imposer aux ennemis de la régénération française et pour les ramener dans le sein de leurs frères.»
Ce but, auquel aurait médiocrement contribué le bataillon de vétérans projeté, fut atteint par les affiliations et fédérations qui se succédèrent depuis le mois de novembre 1789 jusqu’au 14 juillet 1790. Rouen, le Havre, Clermont-Ferrand, Lyon, et beaucoup d’autres villes, fraternisèrent avec Paris, par lettres et par députations.
L’adresse des Lyonnais, l’une des plus énergiques, peut donner une idée des intentions qui présidaient à ces démarches: «La milice de Lyon, dont l’existence est si ancienne, a juré et vous renouvelle ici son serment de rester invariablement unie à ses principes, de braver avec vous tous les dangers qui menacent la Constitution et ses intrépides défenseurs. Tels sont les sentiments de vos frères, de vos amis, de vos émules, les gardes nationaux de la ville de Lyon. Ils y persisteront jusqu’à leur dernier soupir, et ils ne regretteront pas la vie, si leurs derniers regards ont vu périr enfin cette aristocratie intolérable et si justement abhorrée .»
Les jeunes gens des villes de Bretagne et de Normandie signèrent un pacte, par lequel ils s’engageaient, «de concert avec les Parisiens, à soutenir, par la force des armes, l’œuvre sacrée et difficile de la liberté. La seule ville de Laval se soumit à fournir soixante mille livres pour les frais du voyage de l’armée, s’il fallait venir à Paris exterminer les ennemis de la liberté .» En Dauphiné, douze mille six cent cinquante soldats citoyens se rassemblèrent sur les bords du Rhône, le 29 novembre, et prêtèrent serment en ces termes: «Nous, soldats citoyens de l’une et l’autre rive du Rhône, réunis fraternellement pour le bien de la chose publique, jurons à la face du ciel, sur nos cœurs et sur nos armes consacrées à la défense de l’État, de rester à jamais unis; abjurant toute distinction de province; offrant nos bras et nos fortunes à la patrie, pour le soutien des lois émanées de l’Assemblce nationale; jurons de nous donner mutuellement toute assistance pour remplir des devoirs aussi sacrés:
«Jurons de voler au secours de nos frères de Paris, ou de toute autre ville de France qui serait en danger pour la cause de la liberté.»
Le 13 décembre, on vit sous les murs de Montélimart six mille gardes nationaux, représentant les milices du Vivarais, de la Provence et du Languedoc. Ils jurèrent «à Dieu et à la patrie de veiller jusqu’à la mort à l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, et de se porter à cet effet tous les secours nécessaires :» Draguignan eut sa fédération le 30 mai 1790. On écrivait de cette ville à Camille Desmoulins . «Nous venons d’assister au spectacle imposant d’une confédération des gardes nationaux des districts de Draguignan et Avignon, dans la plaine de Valbourges. Huit mille citoyens soldats étaient sous les armes, et plus de vingt mille spectateurs embellissaient l’amphithéâtre des coteaux voisins. Après la messe, célébrée avec tout l’appareil militaire, le bruit du canon annonce la prestation du serment. Il est prononcé par le général. Les officiers et les volontaires levèrent la main, et comme si ce geste sacré n’était pas assez manifeste, tous les chapeaux sont élevés subitement au bout des armes, et l’explosion de mille et mille voix frappe les airs; l’armée de frères quitte les rangs, se confond avec la foule des spectateurs; on s’embrasse, on se répand dans les bosquets d’alentour; chaque arbre ombrage un festin; on dirait les noces de la Liberté.»
Lyon eut sa fédération le même jour. Cinquante mille hommes, divisés en vingt-huit bataillons, se rangèrent en bataille au Grand-camp (plaine des Brotteaux). Leurs drapeaux, comme ceux des Parisiens, portaient différents emblèmes; c’était Hercule assommant un aristocrate; la Belle Cordière offrant ses vers à la Liberté ; Minerve présentant à un voyageur le livre de la Constitution; le Saint-Esprit dans un nimbe tricolore; un garde national veillant sur la tour de Pierre Size, etc. Près de deux cent mille spectateurs, retenus par un simple ruban tricolore, environnaient la plaine des Brotteaux, au milieu de laquelle s’élevait un monticule, couronné par une statue de la Liberté. Le piédestal, formé par un faisceau de colonnes, reposait sur un autel où quatre ecclésiastiques officièrent simultanément. Une salve d’artillerie annonça l’élévation. Après la messe, le général en chef, Dervieux de Villars, gravit le rocher, et prononça d’une voix éclatante la formule du serment, et les troupes nationales, disposées en double carré, firent entendre comme un seul cri, ces mots: «Nous le jurons!»
De semblables cérémonies eurent lieu à Tours, à Clermont, à Metz, à Lille, à Dijon, à Bar-le-Duc, à Tarascon. Louis XVI fit dire à l’Assemblée nationale, par le ministre de la guerre, La Tour-du-Pin, le 4 juin, «qu’il approuvait ces associations fraternelles.» Le lendemain, Bailly, maire de Paris, à la tête d’une députation de la commune, proposa un pacte fédératif de tous les Français. La capitale, dit-il, a reçu de toutes parts des gages d’amitié et des promesses de secours. La commune de Paris s’est empressée de rendre hommage à ces promesses et ces témoignages d’amitié ; elle a adhéré à plusieurs de ces fédérations; elle est jalouse d’en proposer une à son tour. Toutes nos sections se sont réunies pour un même sentiment et pour un seul vœu, c’est celui d’une fédération générale de tous les départements, celui de ne plus former qu’une garde nationale, animée d’un même esprit pour défendre la liberté publique, pour faire respecter les lois de l’empire et l’autorité légitime du monarque. On admire partout le zèle, le courage et le patriotisme de la garde nationale. Nous en pouvons juger par l’armée parisienne; on voit que c’est la vertu civique qui lui a fait prendre les armes, et en observant la composition et la tenue de ce corps qui a crû tout-à-coup au milieu de nous, on reconnaît un général citoyen qui commande une armée de citoyens.
«Nous proposons à nos frères de venir, par députés des districts et des départements, se réunir à nous, dans nos murs, en votre présence, et d’ajouter au serment civique, déjà prêté par tous les Français, celui d’être tous inséparablement unis, de nous aimer toujours et de nous secourir, en cas de nécessité, d’un bout du royaume à l’autre; et nous proposons que cette réunion, que cette fédération générale soit jurée le 14 juillet prochain, que nous regardons tous comme l’époque de la liberté ; ce jour sera destiné à jurer de la défendre et de la conserver.»
Sans attendre la décision de l’Assemblée nationale, la Commune avait expédié une adresse dans tous les départements. «Venez, leur disait-on, chers et braves amis; dix mois sont à peine écoulés depuis l’époque mémorable où des murs de la Bastille conquise s’élança un cri soudain: «Français! nous sommes libres;» qu’au même jour, un cri plus touchant se fasse entendre: «Français! nous sommes frères!»
Déjà, au mois de mai, les villes d’Arras et d’Orléans avaient sollicité une fédération générale; le côté droit l’avait fait ajourner; cette fois, il ne put que céder à l’entraînement de la majorité, et un décret fut rendu, sur le rapport de Talleyrand, conformément aux vœux exprimés par Bailly. Les gardes nationales furent convoquées dans chaque district , pour élire six hommes sur cent; ceux-ci auraient à choisir, dans la totalité des gardes nationales, un député sur deux cents, qui se rendrait à Paris aux frais du district. Chaque régiment de l’armée devait être représenté par un officier, un bas-officier et quatre des plus anciens soldats, grenadiers, chasseurs, fusiliers ou tambours.
Dans la même séance, La Fayette dissipa les alarmes qu’avaient inspirées les projets de quelques flatteurs, qui rêvaient pour lui le titre de commandant général des gardes nationales du royaume. «Par l’organisation des gardes nationales, s’écria-t-il, la liberté française est assurée à jamais; mais il ne faut pas qu’à cette grande idée d’une nation tranquille sous ses drapeaux civiques, puisse se mêler un jour de ces combinaisons individuelles qui compromettraient l’ordre public, peut-être même la Constitution. Je crois, messieurs, qu’au moment où l’Assemblée nationale et le roi impriment aux confédérations un si grand caractère, où toutes vont se réunir ici par députés, il convient de décréter que personne ne pourra avoir un commandement de gardes nationales dans plus d’un département .» Des applaudissements universels accueillirent ce discours, et le principe fut immédiatement adopté.
Pour faire un corps homogène de la grande armée patriotique, l’Assemblée nationale ordonna qu’on supprimerait toutes les compagnies spéciales: clercs de bazoche, compagnie de l’Arquebuse, chevaliers de l’Arc et de Saint-Jean de Latran; que leurs drapeaux seraient déposés aux voûtes des églises principales, pour y demeurer consacrés à l’union, à la concorde, à la paix; que tous les chefs de citoyens actifs s’inscriraient, à l’âge de dix-huit ans, sur des registres spéciaux, en qualité de gardes nationales.
Déjà s’était constitué un régiment des Enfants de Paris, composé, non de jeunes gens de dix-huit ans, mais d’enfants de douze à treize ans au plus. Il vint, le soir du samedi, 12 juin, offrir à l’Assemblée nationale ses hommages et ses dons patriotiques. Tous ces petits soldats étaient en uniforme etparfaitement équipés. Leur orateur, qui n’avait que huit ans, débita sans se troubler une harangue emphatique: «Nos-seigneurs, disait-il, nous sommes cette génération destinée à recueillir les fruits de vos augustes travaux... Vous ne verrez pas sans attendrissement les enfants de cette capitale... Nous vous supplions de nous permettre de porter les armes, pour concourir à la garde de l’héritier présomptif du trône, à la garde de ce prince que le ciel destine à être le père de son peuple, et non l’esclave des flatteurs. Nos mains innocentes jurent, dans le temple de la liberté, de ne jamais porter les armes que pour elle, d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi, de maintenir un jour de tout notre pouvoir la Constitution du royaume.»
«C’est pour vous surtout, répliqua le président, que la Révolution sera heureuse; pour vous, qui perdrez bientôt le souvenir des troubles qui ont accompagné sa naissance, pour jouir des biens qu’elle doit perpétuer .» Tel était l’esprit du temps: confiance illimitée dans l’avenir, rêves de bonheur et de stabilité. Il semblait que les bases sociales dussent être à jamais fixées par la fédération. On y préludait avec enthousiasme, en multipliant les fêtes partielles, les revues, les adresses, les banquets. On remarqua celui que donnèrent les gardes nationaux du bataillon de Henri IV à la compagnie du centre, le 13 juin, au grand salon de Vaugirard. Après le repas, ils firent entrer dans le jardin, et placer à table plus de deux cents pauvres, qui furent successivement remplacés par d’autres; et, pendant qu’ils dînaient, on fit, à leur bénéfice, une quête abondante. M. Caries, commandant du bataillon, reçut le lendemain la lettre suivante, qui n’est pas la pièce la moins honorable des fastes de la garde nationale.
«Paris, 14 juin 1790.
«Je n’ai pu apprendre sans attendrissement, monsieur, la conduite tenue hier par votre bataillon. Déjà, la Garde Nationale avait donné de grands exemples de patriotisme et de valeur; mais les soldats citoyens que vous commandez ont bien prouvé, dans la journée d’hier, que le véritable courage est inséparable de la bienfaisance et de l’humanité.
«La place à laquelle la confiance publique m’a élevé m’impose la douce obligation de prendre aux pauvres un intérêt particulier; je ne puis être insensible au bonheur qu’ils éprouvent, ou aux maux dont ils sont soulagés; et dans ce moment je ne résiste pas au plaisir de vous charger de faire agréer aux soldats citoyens de votre bataillon les sentiments de ma plus vive reconnaissance.
«Après avoir recouvré et maintenu la liberté publique, il est beau de voir la Garde Nationale faire un si noble usage du prix de sa conquête; et il était naturel de retrouver les pères des pauvres sous le drapeau du bataillon de Henri IV.
«J’ai l’honneur d’être, etc.
«Le Maire de Paris,
«BAILLY.»
Pendant un mois, Paris entier ne s’occupa que des préparatifs de la grande fête patriotique. La municipalité publia une instruction où elle en faisait ressortir le véritable caractère.
«Quoique le décret de l’Assemblée nationale n’appelle au pacte fédératif que les gardes nationales du royaume, la confédération ne sera pas moins celle de tous les Français. Dans l’esprit de la constitution et dans l’état d’un peuple libre, tout citoyen doit être soldat; c’est sous ces deux rapports que tous les Français vontse réunir pour le maintien de la constitution.»
Dix commissaires municipaux et cent vingt délégués des sections furent chargés de régler le cérémonial de la grande journée. Quatre emplacements leur étaient proposés: la plaine de Saint-Denis, la plaine de Grenelle, la plaine des Sablons, et le Champ de Mars. Ils choisirent ce dernier; et quinze mille ouvriers furent employés à le niveler; mais on reconnut bientôt qu’ils seraient insuffisants. Alors la population se mit à l’œuvre. Les bataillons accoururent, portant la pioche et la pelle, précédés de leurs tambours, et répétant la chanson nouvelle de Çà ira. Des femmes, ouvrières, bourgeoises, modistes, dames de la halle, dames de la cour, marchaient pêle-mêle dans les rangs. Les laboureurs des villages voisins arrivèrent, sous la conduite de leurs maires. Les invalides, les collégiens, les moines de différents ordres, les corps de métiers, les élèves de l’école vétérinaire et de l’académie de peinture, les acteurs, les journalistes, les facteurs de la poste, formèrent une armée de cent cinquante mille terrassiers. «On voyait, attelés au même chariot, une bénédictine, un invalide, un juge, une nymphe de l’Opéra; les plus jolies filles de Paris, vêtues de robes blanches élégamment rattachées par des ceintures et des rubans aux couleurs nationales, allaient, venaient, chargeaient, piochaient, roulaient, traînaient, et à l’aide de quelques aides officieux, arrivaient au haut des talus, d’où elles redescendaient avec rapidité pour charger de nouveaux matériaux et de nouvelles terres .» En vingt jours, la surface irrégulière du Champ de Mars fut aplanie; une enceinte circulaire établie et entourée de talus; un arc de triomphe élevé à l’entrée principale; un pont de bateaux jeté sur la Seine, et un vaste amphithéâtre adossé à l’École militaire.
Les fédérés, à mesure qu’ils arrivèrent, firent vérifier leurs pouvoirs à l’hôtel de ville, et reçurent une médaille portant ces mots: Confédération nationale. Manuel, administrateur de la police, avait inscrit les noms des citoyens qui étaient jaloux de loger leurs frères . La concurrence fut ardente: c’était à qui recevrait les nouveaux venus; à qui leur ferait les honneurs de la ville. L’Assemblée nationale avait disposé pour eux de toutes les places des tribunes. Louis XVI leur avait ouvert tous les établissements dépendant de la couronne. Les théâtres jouaient pour eux à l’envi des pièces de circonstance: le Réveil d’Épiménide, avec une scène nouvelle; le Chêne patriotique; la Famille patriote, ou la Fédération; le Camp du Champ de Mars; la Fête du grenadier au retour de la Bastille.
Le 13 juillet, la commune de Paris offrit un oriflamme aux représentants des troupes, et quatre-vingt-trois bannières aux députés des départements. Ceux-ci allèrent en corps saluer l’Assemblée, qui vota des remerciments pour les services que tous les gardes nationaux du royaume avaient rendus à la liberté et à la Constitution.
Le 14, dès le point du jour, les fédérés s’échelonnèrent de la Porte Saint-Martin à la Bastille.
Le cortège se mit en marche à sept heures du matin, par les rues Saint-Denis, la Ferronnerie et Saint-Honoré. Il s’ouvrait par un détachement de la garde nationale à cheval, et une compagnie de grenadiers; puis venaient successivement les électeurs de 1789, une compagnie de volontaires; les représentants de la commune; le comité militaire; une compagnie de chasseurs; les tambours de la ville; les présidents des soixante districts; les députés de la commune pour la fédération; les soixante administrateurs de la municipalité ; un corps de musique et de tambours; le bataillon des enfants; les drapeapx de la garde parisienne; un bataillon de vétérans, organisé tout exprès pour la cérémonie, suivant le plan de M. Caillères de l’Etang; les députés des quarante-deux premiers départements, par ordre alphabétique; le porte-oriflamme; les députés des troupes de ligne; les députés de la marine; les députés des quarante-un derniers départements; une compagnie de chasseurs volontaires, et une compagnie de cavalerie. A la place Louis XVI, l’Assemblée nationale, présidée par M. de Bonnay, se plaça entre les enfants et les vétérans, et l’immense convoi prit la route du Champ de Mars, où l’attendaient cent soixante mille spectateurs.
Au centre de l’enceinte, sur un stylobate carré , était posé un autel de forme cylindrique, devant lequel se rangèrent en demi-cercle les doyens d’âge des départements et des troupes. A trois heures et demie, l’évêque d’Autun, assisté des soixante aumôniers de la garde nationale, officia, et bénit les drapeaux. Puis La Fayette, que le roi avait nommé major de la fédération, tenant de la main droite son épée, dont il appuyait fortement la pointe sur l’autel, dit, au milieu du plus religieux silence: «Je jure d’être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi;
De maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi;
De protéger, conformément aux lois, la sûreté des personnes et des propriétés; la libre circulation des grains et subsistances dans l’intérieur du royaume, et la perception des contributions publiques, sous quelque forme qu’elles existent;
De demeurer uni à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité 1»
Tous les fédérés s’écrièrent: Je le jure! et saisis d’un transport subit, s’élancèrent sur les marches de l’autel, pour voir de près La Fayette, pour l’embrasser, lui serrer les mains. «Cette effusion de tendresse, dit Camille Desmoulins , pensa lui coûter la vie: étouffé par les caresses, il était devenu plus blanc que son cheval.» C’était le héros du jour, l’idole de la France constitutionnelle.
L’Assemblée nationale prêta serment. Le roi, placé sous un dais près de l’école militaire, se leva, et tendit le bras droit vers l’autel, en disant: «Moi, roi des Français, je jure à la nation d’employer tout le pouvoir qui m’est délégué par la loi constitutionnelle de l’État, à maintenir la Constitution, et à faire exécuter les lois.»
Des salves d’artillerie annoncèrent la fin de la fête. Le commandant général, en se retirant, fut abordé par la femme d’un imprimeur, qui avait récemment publié un libelle intitulé : Vie privée de Blondinet, général des Bluets. Elle se jeta aux pieds de La Fayette, qui la releva, et lui promit la grâce de son mari. Les fédérés présents applaudirent; car l’oubli des injures, le sentiment de la fraternité, étaient dans tous les cœurs. Les repas, les illuminations, les danses, les concerts, se prolongèrent pendant plusieurs jours; et les poètes exercèrent leur verve pour célébrer l’alliance qui venait d’être scellée .
On avait remarqué les vêtements disparates des fédérés: ce fut l’objet d’un rapport de Lechapelier, au nom du comité de Constitution; et l’Assemblée décréta, le 19 juillet:
«Il n’y aura qu’un seul et même uniforme pour toutes les gardes nationales. En conséquence, tous les citoyens français admis dans les gardes nationales ne pourront porter d’autre uniforme que celui qui va être prescrit.
«Habit bleu de roi, doublure blanche; parements et revers écarlate; le passe poil blanc; collet blanc et passe-poil écarlate; épaulettes jaunes ou en or; la manche ouverte à trois boutons; les poches en dehors en trois pointes (sur le bouton il sera écrit: district de... ); le retroussis de l’habit écarlate. Sur l’un des retroussis, il sera écrit, en lettres jaunes ou en or, le mot de constitution, et sur l’autre retroussis, le mot liberté.»