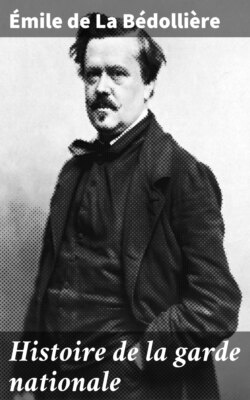Читать книгу Histoire de la garde nationale - Emile de La Bédollière - Страница 5
CHAPITRE III.
ОглавлениеLa Fayette est nommé commandant général. — Son début. — Origine du drapeau tricolore. — Journée du 17 juillet 1789. — Premiers uniformes. — Les brigands. — Femmes montant la garde. — Anecdotes diverses. — Décret du 10 août 1789. — Formation de la garde soldée et non soldée. — Premiers officiers. — Louis-Philippe capitaine. — Drapeaux des districts. — Bénédiction des drapeaux à Notre-Dame,
Deux jours après, les électeurs nommèrent M. de La Fayette commandant général de la garde parisienne. Son buste, hommage des Etats-Unis à la municipalité, décorait la grande salle de l’hôtel-de-ville. Plusieurs membres du comité permanent ayant représenté qu’il fallait mettre un homme éminent à la tête de la milice, le président, Moreau de Saint-Méry, désigna ce buste, sans prononcer un seul mot. L’assemblée se rappela aussitôt les opinions libérales de La Fayette, sa conduite en Amérique, son opposition au parti de la cour, et il fut choisi à l’unanimité pour remplacer M. de La Salle.
Homme de prudence et de modération, il apportait dans ses nouvelles fonctions, moins un patriotisme fougueux qu’un esprit d’ordre et de conciliation. Il en donna des preuves dès le premier jour, en se rendant à l’hôtel de ville pour prendre possession de son grade; il vit une foule immense qui se dirigeait vers le carrefour Bétizy.
«Qu’y a-t-il donc? demanda-t-il.
— Ce n’est rien, lui répondit-on; c’est un abbé qu’on va pendre.»
Le commandant général s’élança au milieu des groupes, et aperçut un pauvre ecclésiastique dont les habits étaient lacérés, et qui avait déjà au cou la corde fatale. On prétendait que c’était l’abbé Roi, connu par son exagération aristocratique. La Fayette l’interrogea, le reconnut pour l’abbé Cordier, et parvint à le conduire à la Grève. Là, la victime désignée prouva son identité, et ceux qui avaient voulu le lanterner le reconduisirent en triomphe. A peine à l’hôtel de ville, La Fayette raconta ce qui s’était passé, et en tira la conclusion qu’il était urgent de fortifier le plus promptement possible la milice parisienne, à laquelle il proposa de conserver le titre de garde nationale, déjà adopté par quelques districts. Il demanda aussi qu’on ajoutât les couleurs de la monarchie à celles de la ville; et de cette combinaison naquit le drapeau tricolore, amalgame de symboles passés, qui devait guider les peuples vers l’avenir.
Louis XVI avait cédé ; il congédiait les troupes, il rappelait Necker, et il venait à Paris sanctionner la révolution. Le 17 juillet, la garde nationale se mit sous les armes pour le recevoir. Deux cent mille hommes se rangèrent en triple haie, depuis la barrière de Passy jusqu’à la Grève. Ils étaient armés de fusils, de piques, de mousquets, de dards, de fourches, de de pioches, de faulx, de toutes sortes de ferrailles attachées à des bâtons. On remarquait dans leurs rangs, le fusil sur l’épaule et le sabre à la main, des femmes, des jeunes filles, des moines, des capucins. Les Mathurins du quartier latin portaient la bannière de leur ordre en guise de drapeau de district. Louis XVI eut à traverser ces masses silencieuses, d’où s’élevait seulement par intervalles le cri de: Vive le roi! Quatre officiers de la garde nationale tenaient les boutons des portières du carrosse royal, autour duquel caracolait M. de La Fayette, en frac uni, le chapeau orné d’un panache et de la cocarde de la milice de Paris. Au moment où Louis XVI descendait de voiture, le maire de Paris, Bailly, lui présenta cette cocarde, en disant: «Sire, Votre Majesté veut-elle accepter le signe distinctif des Français?» Le roi la prit, la plaça à son chapeau, et monta l’escalier de l’hôtel de ville sous une voûte d’épées entrelacées. Assis sur le trône qu’on lui avait préparé, il s’empressa de dire à ceux qui l’environnaient: «Messieurs, je suis très-satisfait; j’approuve l’établissement de la garde bourgeoise; mais la meilleure manière de me prouver votre attachement, est de rétablir la tranquillité, et de remettre entre les mains de la justice ordinaire les malfaiteurs qui seront arrêtés. M. Bailly, instruisez l’Assemblée de mes intentions. Je suis bien aise que vous soyez maire, et que M. de La Fayette soit commandant général!»
Ces paroles, reproduites par Bailly, excitèrent des applaudissements; et lorsque le roi parut à la fenêtre et qu’on s’aperçut qu’il portait la cocarde, toute défiance cessa; l’air retentit de vivats qui se mêlaient au bruit de l’artillerie, aux sons de la musique, aux fanfares des trompettes, au frôlement des drapeaux balancés, au cliquetis des armes entrechoquées. L’arrivée du roi avait été sinistré ; son départ pour Versailles fut un triomphe. Ses chevaux et sa voiture étaient parés de cocardes nationales; celle qu’il avait acceptée était placée à côté de lui, en dehors de la portière. Les gardes nationaux criaient avec enthousiasme Vive le roi! et renversaient leurs armes en signe de paix. Le roi lui-même abattit le fusil d’un de ceux qui bordaient la haie. D’autres tiraient en l’air pour manifester leur allégresse. Les journaux du temps évaluent à plus de vingt mille le nombre des coups de fusil qui partirent sur les quais dans la soirée du 17 juillet.
A cette journée de joie succédèrent des scènes d’horreur. Foulon et Berthier furent massacrés le 23 juillet. La Fayette, dont la voix avait été méconnue en cette circonstance, écrivit à Bailly: «Le peuple n’a pas écouté mes avis; le jour qu’il manque à la confiance qu’il m’avait promise, je dois quitter un poste où je ne peux plus être utile.» Néanmoins les supplications des électeurs le déterminèrent à retirer sa démission. Il s’occupa activement de régulariser le service. Dès le 3 août, un grand nombre de citoyens étaient revêtus d’uniformes . Les soixante districts firent tour à tour bénir leurs drapeaux dans leurs paroisses respectives. Le 9 août, dans l’après-dîner, dit le Journal de Prudhomme, plusieurs districts, tels que ceux de Saint-Roch, des Petits-Pères, se montrèrent au Palais-Royal et en d’autres lieux, au bruit des tambours et d’une musique guerrière, drapeaux déployés, et l’on remarqua l’ordre et l’ensemble de ces nouveaux soldats-citoyens.»
Toutes les villes imitèrent successivement l’exemple de la capitale. Versailles eut, dès le 14 juillet, une milice nombreuse, dont le commandement fut confié au prince de Poix.
Necker, à son retour, le 30 juillet, fut reçu par les milices de Sèvres et de Viroflay. A Saint-Germain-en-Laye, cinq ou six cents jeunes gens se réunirent en milice, quoiqu’ils fussent sans armes. Des environs de Paris le mouvement gagna les provinces. Des terreurs paniques, jointes à de justes sujets de crainte, hâtèrent l’armement de la France entière. On répandit le bruit que des brigands parcouraient les campagnes, coupaient les blés en vert et rançonnaient la population. On signala leur présence, au nombre de plusieurs milliers, à Montmorency, à Rouen, à Lusignan, aux environs de Soissons . Ces fausses alarmes se propagèrent dans toutes les provinces. A Beaucaire, le 30 juillet, sur les six heures du matin, le courrier apporte la nouvelle qu’une armée de brigands dévaste la province; plusieurs personnes montent sur les ruines du château et s’écrient avec effroi qu’elles aperçoivent l’avant-garde de la bande, et que la ville de Tarascon, située de l’autre côté du Rhône, est devenue la proie des flammes. On s’apprêtait à couper le pont, lorsqu’on reconnaît dans les prétendus bandits les Tarasconais, qui, également effrayés par de fausses nouvelles, venaient chercher asile sur la rive droite du fleuve.
On a attribué à Mirabeau l’idée de rallier les esprits et d’improviser une force publique en supposant un danger imminent; mais, si l’on examine les écrits du temps, on reconnaîtra que cette appréhension fut spontanée, et qu’elle vint naturellement de l’effervescence populaire. Les brigands étaient simplement les paysans, les anciens serfs, exaspérés par de longues souffrances et trop disposés à se venger par des violences. Brigand, dans les documents de cette époque, désigne quiconque commet des excès. Ce sont des brigands qui brûlent les barrières de Paris, des brigands qui dévastent la maison de Saint-Lazare ; ce sont des brigands qui détruisent les archives seigneuriales . Les électeurs siégeant à l’hôtel de ville, les journalistes, des députés de l’Assemblée nationale, répètent tant de fois cette qualification de brigands, que l’on conçoit aisément l’inquiétude universelle. Elle amena, malgré son exagération, les plus heureux résultats. Partout la classe moyenne se souleva pour sauver la liberté du désordre. Partout les milices rendirent d’éminents services. Elles s’opposèrent autant que possible aux vengeances particulières et au pillage des châteaux, protégèrent la circulation des grains, firent des perquisitions chez les ennemis de la révolution, et dissipèrent les bandes tumultueuses. La garde nationale de Paris, pendant les mois d’août et de septembre 1789, déploya un zèle infatigable. Non-seulement les hommes rivalisaient d’ardeur, mais on voyait dans les rangs des enfants, des femmes revêtues du costume masculin. Elles étaient même commandées de garde, s’il faut admettre comme authentique le billet suivant, que rapporte le journal des Révolutions de Paris :
«District de l’abbaye Saint-Germain-des-Près.
«Mademoiselle Dubief, marchande lingère, rue
«Dauphine, n° 31, montera la garde au corps-de-
«garde, rue Dauphine, au Musée, où elle montera la
«garde à dix heures précises du matin, le 3 août
«1789.
«Signé OUDET, capitaine.»
L’histoire de la garde nationale de Paris, durant cette période, se compose d’une multitude d’incidents peu importants, mais qui attestent l’activité avec laquelle elle s’acquittait de ses devoirs.
Le 25 juillet, elle arrête trois hommes qui se préparaient à incendier un magasin d’épicerie.
Le 28, elle découvre à Vincennes cent vingt-sept hommes armés, qu’elle conduit en prison. Le même jour, les volontaires de la Basoche sont envoyés aux environs de Rouen pour protéger les convois de grains et disperser les brigands.
Le 1er août, le maire de Saint-Denis périt dans une émeute. Les patrouilles bourgeoises repoussent ceux qui apportaient à Paris sa tête ensanglantée, s’avancent jusqu’à Saint-Denis, et arrachent plusieurs citoyens au supplice.
Cent gardes nationaux vont au devant du baron de Bezenval, détenu à Brie-Comte-Bobert, et avec le concours de la milice de cette ville, l’empêchent d’être massacré par des soldats suisses, qui voulaient le couper en treize morceaux en l’honneur des treize cantons.
Le 6 août, le marquis de la Salle, accusé de trahison et menacé de la lanterne, est sauvé par les détachements du district, qui, se formant en carré sur la place de Grève, parviennent à en éloigner les furieux.
Le décret du 10 août lia plus intimement encore les gardes nationales à la cause de l’ordre. Il portait: «que toutes les municipalités du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleraient au maintien de la tranquillité publique;
«Que sur leur simple réquisition, les milices nationales, ainsi que les maréchaussées, seraient assistées de troupes, à l’effet de poursuivre et d’arrêter les perturbateurs du repos public, de quelque état qu’ils pussent être;
«Que tous attroupements séditieux, même sous prétexte de chasse, seraient incontinent dissipés par les milices nationales;
«Que toutes les milices nationales prêteraient serment entre les mains de leur commandant, de bien et fidèlement servir pour le maintien de la paix, pour la défense des citoyens, et contre les perturbateurs.»
Les représentants de la commune de Paris, pour répondre aux intentions de l’Assemblée nationale, chargèrent le commandant général «de prendre les mesures les plus promptes et les plus sûres pour maintenir une police exacte. Elle s’occupa activement d’un réglement militaire, et fixa d’abord les attributions du général en chef. Il devait être élu pour trois ans, par la généralité des citoyens assemblés en district, sur la présentation de trois membres du Conseil de ville. Il pouvait, en cas de contravention à la discipline, ordonner les arrêts, ou condamner les délinquants à huit jours de prison. Il était tenu de faire une fois l’année l’inspection et la revue de la milice bourgeoise.»
Un bureau des gardes nationales fut installé à l’hôtel de ville, pour en achever l’organisation, qu’il basa sur des principes tout différents de ceux qui prévalent aujourd’hui. Au lieu de comprendre dans un vaste cadre tous les citoyens, ou du moins tous ceux qui présentaient quelques garanties, la garde nationale fut un corps de vingt-quatre mille volontaires. Personne n’y fut admis au-delà de ce contingent limité, très-minime relativement au chiffre total des habitants, qui était alors, suivant une statistique exacte, de 980,452 . Notre système actuel, plus libéral et plus démocratique, met sous les armes le quart de la population.
A cette troupe non soldée s’adjoignirent six mille hommes soldés, recrutés presque tous parmi les gardes françaises, que Louis XVI avait autorisés à s’incorporer dans la milice parisienne. La commune décréta que chacun d’eux recevrait vingt sous par jour et porterait une médaille commémorative
Paris fut partagé en six divisions de dix districts chacune. Un commandant était à la tête de chaque division, et l’on établit dans chaque district un bataillon composé de cinq compagnies de cent hommes chaque, dont une, soldée et casernée, fut placée au milieu des quatre bourgeoises, sous le nom de Compagnie du Centre. On créa en dehors de ce cadre un corps de cavalerie et plusieurs compagnies de chasseurs, spécialement chargées de la surveillance des barrières et de l’arrestation des contrebandiers.
La nomination des six commandants fut attribuée à une assemblée de division, formée des représentants des districts. On laissa à ceux-ci l’élection de leurs officiers, et au général en chef la faculté de composer l’état-major. La Fayette nomma major-général M. de Gouvion, son compagnon d’armes en Amérique, et aide-major, M. de La Jarre, qui s’était distingué en Hollande dans les rangs du parti démocratique. Parmi les officiers qui furent élus, nous retrouvons, dans les feuilles du temps, les noms de MM. d’Ormesson, de Montholon, de Saint-Christeau, de Lally Tollendal et du prince Léon; de MM. Dumas, de Bazencourt, de Laleu, de Saint-Vincent, de Vinezac, d’Herbelay, majors de division; du duc d’Aumont, du prince de Salm, de MM. Soufflot, Leclerc, Clermont de Saint-Pallay, de Merville, commandants de bataillon. Les citoyens du district de la Sorbonne, pour témoigner au général La Fayette «leur reconnaissance et leur admiration », conférèrent le grade de sous-lieutenant à son fils, âgé seulement de dix ans. Le duc de Chartres (Louis-Philippe) fut élu par acclamation capitaine d’honneur du district de Saint-Roch. Le 30 août, à deux heures, tous les officiers, au nombre de neuf cents, l’épée à la main, vinrent prêter serment de fidélité à la commune, en présence du général La Fayette et des officiers municipaux .
Les canons et les armes furent distribués à tous les districts; le roi, afin de faciliter l’armement de tous les citoyens, fit présent de six mille fusils à la ville de Paris, et de mille à celle de Versailles. Plusieurs districts ouvrirent des souscriptions publiques pour fournir des uniformes, en stipulant qu’on tairait également le nom de ceux qui donneraient de l’argent, et de ceux qui recevraient des habits . Ce fut le district Saint-André-des-Arts qui se montra le premier, le 24 août, complètement équipé. Un mois après, La Fayette passait en revue aux Champs-Élysées une division tout entière, dont les assistants admiraient l’air martial et la tenue imposante.
Divers particuliers, les membres des communautés religieuses, ou les citoyennes patriotes, offrirent à chaque district son drapeau, enjolivé de symboles variés. Le drapeau de Saint-Étienne-du-Mont, donné par les marguillers de l’église Sainte-Geneviève, représentait la Religion guidant, au milieu des flots orageux, le vaisseau de la liberté. Sur le drapeau de Saint-Jacques-du-Haut-Pas se confondaient des fleurs de lys, des bonnets phrygiens, et au centre était figurée la Bastille, avec ces mots: ex servitute libertas. L’enseigne du district des Jacobins-Saint-Dominique portait une pyramide au milieu des nuages, une palme, un rameau d’olivier, une épée autour de laquelle s’enlaçait un serpent, et pour légende: force et prudence. Tous les drapeaux étaient ornés de même de compositions plus ou moins compliquées, qui se détachaient sur un fond aux couleurs nationales, et qu’expliquaient différentes devises où se reflétaient les sentiments de la population: loi, concorde, liberté ; crains Dieu, honore le Roi; n’obéir qu’à la loi; union et force; patrie, liberté.
Déjà bénis partiellement, les drapeaux des districts le furent encore dans une cérémonie solennelle. Pendant qu’on en faisait les préparatifs, M. Guignard de Saint-Priest, ministre de la maison du roi, disait au général La Fayette: «Le roi m’a prescrit, M. le marquis, d’ordonner qu’on tirât du magasin des Menus, tout ce qui s’y trouve pouvant servir à l’ornement de l’église de Notre-Dame, le jour de la bénédiction des drapeaux. Je me fais honneur de de concourir à la dignité d’une cérémonie où l’on consacrera les drapeaux d’une troupe nationale dont Sa Majesté compte faire usage dans les circonstances importantes de l’État. Le repos actuel de la capitale est une de ces occasions essentielles. S. M. voit avec satisfaction que votre zèle et celui des milices parisiennes s’y consacrent sans réserve, et distingue ce genre de service par dessus tous les autres.»
Le dimanche 27 septembre, la municipalité et l’état-major se rendirent de l’hôtel de ville à Notre-Dame, escortés d’une troupe d’élite et à travers deux haies de soldats. Les six divisions étaient sous les armes. L’abbé Fauchet, après avoir officié, prononça un discours sur les moyens d’assurer la liberté, et tel fut l’enthousiasme qu’il excita, «que nos ennemis mêmes s’émurent à la voix de l’orateur patriote. L’explosion de mille fusils tirés au même instant fit retentir les voûtes sacrées; l’artillerie répondit au dehors, et le serment de vivre et mourir libre, fut le cris unanime de tous les citoyens .»