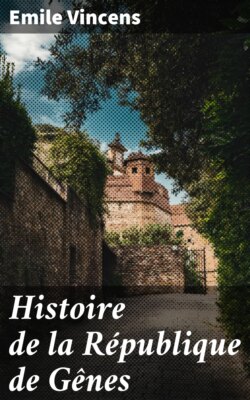Читать книгу Histoire de la République de Gênes - Emile Vincens - Страница 5
ОглавлениеCHAPITRE III.
Les Génois à Césarée.
(1100) Godefroy de Bouillon mourut et Baudouin son frère fut élu pour lui succéder. Ce prince était dans son comté d'Édesse, et il ne lui était pas facile de parvenir sûrement à Jérusalem. L'intrigant patriarche tâchait d'en profiter pour susciter des troubles et un compétiteur au nouveau roi. Il manda au prince d'Antioche de venir prendre le sceptre, mais Bohémond n'était pas en état de répondre à l'invitation. Surpris dans une expédition malheureuse, il était prisonnier chez les Sarrasins. En ce moment une flotte génoise de vingt-huit galères et de huit vaisseaux entra dans le port de Laodicée. Ici nous commençons à trouver pour guide les chroniques contemporaines des Génois. Caffaro, qui les écrivit le premier, était sur la flotte; il rapporte ce qu'il a vu, et, quelques années après, ayant fait hommage de son récit à ses concitoyens, l'approbation du parlement en fit un document authentique.
A Gênes, le premier événement que les annales racontent, c'est la formation d'une compagnie réunie pour expédier une flotte à la terre sainte. Les préparatifs durèrent dix-huit mois, et enfin la flotte était partie au mois d'août 1100. Nous ne savons pas si on recourait à une association aussi générale pour la première fois, ou si c'était le renouvellement d'une précédente société arrivée à son terme; cette dernière opinion est très probable; le nouvel armement semble la suite de celui qui avait déjà porté Embriaco à Joppé, et qui avait fait concourir les Génois au siège de Jérusalem. Mais Caffaro ne commence son récit qu'aux choses où il a pris part. Quoi qu'il en soit, avec dix-huit mois d'efforts, les Génois ne faisaient encore qu'une entreprise de marchands, tandis que nous voyons les Vénitiens, à la même époque, marcher en corps de nation et d'armée, avec leur prince à la tête. C'est, d'un côté, la consistance d'un gouvernement de forme presque monarchique; c'est, de l'autre, la modeste contenance d'une simple commune qui n'a pas de trésor public pour y puiser et qui n'ose pas même attacher au concours spontané de ses concitoyens le sceau de l'autorité nationale.
En arrivant, l'on apprit qu'il n'y avait ni roi à Jérusalem depuis la mort de Godefroy, ni prince à Antioche depuis la captivité de Bohémond. Les Génois prirent d'abord sa principauté sous leur garde; et, secondant un légat du pape qu'ils s'étaient chargés de conduire, ils dépêchèrent à Tancrède, parent de Bohémond, pour le presser de venir prendre le gouvernement d'Antioche, et à Baudouin pour l'encourager à se rendre à sa capitale afin d'y recevoir la couronne. Sur leur invitation, il vint les trouver à Laodicée, et, s'il faut les en croire, il n'accepta le trône qui lui était déféré que sur le serment que les Génois lui firent de l'aider de tout leur pouvoir. Il est certain qu'il se montra favorable pour eux pendant tout son règne. Cependant ce n'est pas sur leur flotte qu'il se mit en chemin vers Jérusalem. Baudouin suivit le rivage par terre jusqu'à Joppé. Il est dit seulement qu'il embarqua sa femme et ses richesses sur les bâtiments qui côtoyaient la rive à sa vue. C'est peut- être toute l'assistance que les Génois lui prêtèrent en ce moment.
Guillaume Embriaco était le consul de la flotte génoise, et, comme nous voyons qu'il n'était pas au nombre des consuls de la compagnie qui l'avait armée, probablement demeurés à Gênes où ils furent aussi les magistrats de la république, il était sans doute leur lieutenant et leur mandataire dans l'expédition. Le nom de consul, commun, dans les villes municipales, aux syndics des professions comme aux magistrats supérieurs, servait, chez les Génois, au dehors comme au dedans, à désigner leurs chefs élus partout où ils avaient à en choisir (1101).
Dès les premiers jours du printemps, la flotte qui avait passé l'hiver à Laodicée, mit à la voile, car la fête de Pâques approchait, et l'on aspirait à voir en ce saint temps Jérusalem et le sépulcre de Jésus- Christ. Le roi Baudouin vint recevoir les Génois au port de Joppé, le seul qui fût alors tenu par les chrétiens. Il les loua et les remercia des services qu'ils venaient rendre à Dieu. Il les conduisit à Jérusalem, ils y furent rendus la veille du grand jour de la résurrection.
Là, ils furent témoins du prodige de la descente du feu sacré sur les lampes du saint sépulcre. Les Génois le voyaient pour la première fois. Caffaro raconte les impressions qu'ils reçurent à ce spectacle avec trop de naïveté et de foi, pour que l'histoire doive craindre de le reproduire dans sa caractéristique simplicité. Il paraît que ce feu céleste descendait comme le sang de saint Janvier coule à Naples; l'opération est aisée ou difficile suivant les temps; quelquefois elle menace même de manquer absolument, d'après certaines circonstances mondaines et politiques qui exigent que le ciel se montre en courroux, surtout quand il doit prendre parti pour ses ministres mécontents. A Jérusalem, le cardinal Maurice, nouveau légat, avait suspendu Daimbert de ses fonctions épiscopales. Le temps des cérémonies pascales était arrivé, et le patriarche humilié frémissait de l'affront de voir passer à d'autres ses attributions les plus solennelles. Il priait, il négociait, enfin il offrit au roi une grande somme d'argent: par ce marché simoniaque il obtint de Baudouin une sorte de pardon, et par lui l'indulgence du légat. On convint des formes suivant lesquelles le patriarche serait admis à se justifier facilement; la suspension fut levée pour lui, et son premier triomphe fut de bénir le chrême du saint jeudi1. Ce ne sont pas ces intrigues que vit ou que voulut nous raconter Caffaro. Tout entier à la dévotion due à ces solennités redoutables, il nous peint ses compatriotes et les chrétiens de tant de nations, pieusement prosternés autour du tombeau du Christ, la veille du jour de Pâques: l'obscurité règne, tous les feux sont éteints en commémoration de la mort et de l'ensevelissement du Sauveur. On attend, on invoque le signe de sa résurrection que doit manifester une flamme nouvelle dans son sépulcre. Mais c'est en vain, le jour finit, la nuit entière se passe et le feu ne paraît point. On priait, on pleurait dans un morne silence interrompu un moment par ce cri douloureux: Seigneur, ayez pitié de nous! L'inquiétude, les murmures étaient au comble. Le légat essaya de les tempérer. Il adressa à la multitude des paroles d'encouragement. «Les miracles, dit-il, sont pour confondre les mécréants; la foi des fidèles n'en a pas besoin.» Cependant à cause des faibles celui-ci se fera. On l'obtiendra du ciel en redoublant les dévotes supplications et les saints exercices. Une procession fut ordonnée; elle quitta l'église en chantant les hymnes de la pénitence, et poussa sa longue marche jusqu'au temple de Salomon. De retour, les voeux de la componction avaient été exaucés. Le légat et le patriarche virent la flamme céleste éclatant dans le saint tombeau. La joie succéda à la douleur. On rendit grâce à Dieu, et, après cet acte solennel, les fidèles allèrent se reposer et se refaire des fatigues de cette pénible attente. Mais pendant ce temps le miracle s'agrandit; l'église de toute part brilla de la céleste lumière. On frappait trois coups sur chaque lampe et elles s'allumaient d'elles-mêmes. Ce prodige se répéta seize fois; et Caffaro s'interrompt pour déclarer à ses compatriotes de Gênes, que c'est ce qu'il a vu; que sans le témoignage de ses yeux, il n'eût pu le croire, et que ce grand prodige doit être tenu pour la chose du monde la plus certaine et la plus incontestable. Ce récit, écrit de conviction, est confirmé par nos autres annalistes des croisades. Le seul Guillaume de Tyr le passe sous silence, soit que, né dans le pays, le miracle répété tous les ans n'eût pour lui rien que de commun, soit qu'ayant traité assez légèrement l'invention de la sainte lance miraculeusement trouvée à Antioche, il n'ait cru avoir qu'à se taire sur le feu sacré. Suivant Guibert de Nogent, l'allocution du légat fut une vive exhortation à abjurer les désordres et à confesser les péchés. Ce jour-là, dit-il, il en fut déclaré de si énormes, que si la pénitence n'y eût remédié, il eût été téméraire d'attendre le feu céleste.
Les actes religieux accomplis, une négociation sérieuse fut ouverte. Les Génois étaient en force; ils pouvaient surtout servir utilement dans le siège des places maritimes, ou plutôt on ne pouvait le tenter sans eux. Mais ils n'étaient point engagés, on n'avait pas le droit d'exiger leur assistance; et, ouvertement venus pour le profit, il leur fallait des dédommagements pour consentir à changer leurs voies mercantiles. La considération des intérêts publics des chrétiens était puissante, mais ne suffisait pas à une compagnie d'armateurs. Suivant un historien2, les Génois demandèrent eux-mêmes la permission de foire quelque conquête sur les Sarrasins; suivant les autres3 le roi envoya des négociateurs sages et insinuants qui parlèrent au consul et aux plus accrédités de la flotte. On les sollicita de ne pas reprendre immédiatement le chemin de l'Italie. On était disposé à leur faire des avantages considérables s'ils voulaient prêter leurs forces à quelques opérations contre l'ennemi; ils répondirent qu'en venant à la terre sainte, leur projet avait été de s'y arrêter quelque temps, d'essayer d'y rendre leur séjour utile à la cause commune et profitable à leur compagnie. Un traité fut bientôt conclu. Le roi consentit à leur assurer, dans toutes les places qui, pendant leur séjour en Syrie, seraient prises par leur secours, le tiers du butin qu'on y trouverait et un quartier de la ville à perpétuité.
La convention s'exécuta d'abord à la conquête d'Arsur. Cette cité maritime fut attaquée par terre et par mer. Après trois jours de résistance elle fut rendue. Les habitants obtinrent de se retirer à Ascalon sans rien emporter avec eux. Leur entière dépouille fut partagée suivant le traité.
On alla mettre le siège devant Césarée. Les habitants envoyèrent d'abord demander pourquoi on les attaquait. Le légat et le patriarche leur firent savoir que leur cité appartenait à saint Pierre, et que ses délégués, chargés de récupérer son héritage, avaient tout droit d'y employer la force. L'entreprise, qui promettait de bien plus riches fruits que celle d'Arsur, était aussi beaucoup plus difficile. Les murailles étaient fortes. Des mâts et des vergues de leurs vaisseaux les Génois construisirent des machines et des tours pour s'élever au-dessus des remparts; mais ces travaux traînaient en longueur ou souffraient des échecs. On se décourageait, on se reprochait la mollesse contractée dans l'hiver de Laodicée. Le vingtième jour du siège, un vendredi (le vendredi est particulièrement vénérable sur la terre même, où à pareil jour le Sauveur monta sur la croix), on assembla toute l'armée. Le patriarche l'exhorta, lui prophétisa la victoire, lui promit les bénédictions célestes et d'abord le pillage. Les Génois répondirent: Fiat! fiat! Les péchés furent confessés, le pain eucharistique distribué, et tous, laissant là les machines, armés d'épées et chargés d'échelles, coururent aux murs. Les assiégés ne purent résister à l'impétuosité de l'assaut. Le courageux Embriaco monta le premier; l'échelle qui l'avait porté se brisa sous le poids de ceux qui le suivaient; un moment il se vit seul sur le rempart et lutta avec un Sarrasin qui s'y trouvait encore. Mais les croisés accoururent, ils s'emparèrent bientôt des portes et poussèrent leurs succès de rue en rue. Les plus riches habitants s'étaient réfugiés dans la mosquée. Ils demandaient la vie au prix de l'abandon de tout ce qu'ils possédaient. Le patriarche, à qui ils firent porter cette humble supplication, ne voulut rien promettre sans l'aveu des Génois, et ceux-ci, se hâtant de le donner, volèrent au pillage, parcoururent la ville entière afin de prendre les hommes, les femmes, et de s'emparer de toutes les richesses. On forçait les maisons, souvent on massacrait ceux qui y étaient réfugiés, on enlevait l'argent, les vases, tout ce qui pouvait s'emporter à l'instant, puis on mettait des gardes à la porte pour que les autres biens ne pussent être détournés. Tout prisonnier était soupçonné d'avoir caché sur soi ou d'avoir avalé son or, et les plus singulières violences étaient prodiguées pour ne pas le perdre. On égorgeait enfin les malheureux pour le retrouver dans leur sein. La plupart des hommes périrent, les jeunes garçons et les femmes furent réservés pour l'esclavage, et, dit un auteur, belles ou laides, on les troquait, on se les revendait sur la place. Ainsi l'esprit mercantile, au milieu de ces horreurs, se maintenait froidement; parmi les combattants il y avait des marchands d'esclaves, et ils faisaient leur métier sans perte de temps et sans distraction4.
A la peinture de cette scène atroce où c'est par la rapacité que la cruauté est inspirée, à ces promptes ventes de captifs au milieu des massacres, il faut bien croire que chacun pillait pour soi. En effet, un auteur du temps qui s'écrie: Combien on trouva d'argent, de vases précieux de toutes formes, c'est ce qui ne saurait s'exprimer, ajoute que beaucoup de pauvres devinrent riches tout à coup. Mais si tout ce qui fut pris en ce premier moment n'entra pas dans la masse des dépouilles publiquement partagées, celles-ci furent encore immenses. Jérusalem, où l'on manquait de tout, se trouva dans l'abondance tout à coup. Sur le tiers du butin qui fut délivré aux Génois, un quinzième fut d'abord mis à part pour les galères: du surplus il en échut à chaque homme 48 sous, monnaie poitevine, et deux livres de poivre, outre l'honoraire du consul ou des capitaines des galères, lequel fut très-considérable, dit Caffaro.
On ne dit nulle part, et il est infiniment peu probable, que le reste de l'armée des croisés ait eu une distribution de poivre5. Il est évident qu'au milieu de ces combattants, les Génois, toujours marchands, ont demandé d'avoir dans leur lot une denrée propre à leur commerce d'importation en Europe. Quand des objets d'une revente lucrative tombaient par le partage ou par le pillage dans les mains des autres guerriers, on peut être certain qu'ils ne tardaient pas à passer dans celles des Génois. Ils avaient l'industrie d'acheter et vendre, de l'argent économisé, des valeurs d'échange, et des vaisseaux pour enlever ce qui devenait leur proie. Il est vraisemblable que, dans ces marchés de captifs dont on nous parlait tout à l'heure, les fantaisies étaient pour les chevaliers, et les bonnes affaires de cet odieux commerce étaient pour les gens de Gênes.
C'est dans le butin de Césarée qu'ils se firent adjuger le fameux vase connu sous le nom de Catino, qu'ils payèrent d'un prix considérable; car ils le crurent fait d'une émeraude d'une grandeur démesurée. Ils y attachèrent une telle valeur qu'un de leurs écrivains des siècles postérieurs, recherchant si le roi Baudouin était en personne au siège de Césarée, affirme, contre l'autorité de Guillaume de Tyr, que ce prince était absent, car s'il eût été là, dit-il, Gênes n'aurait pas obtenu le Catino. Mais ce qui est surprenant, Caffaro ne parle point de l'acquisition de cette merveilleuse émeraude. Ce n'est pas par ce témoin oculaire du sac de Césarée que nous savons que cette relique en provient. C'est l'archevêque de Tyr qui nous apprend qu'elle fut prise et évaluée dans ce partage à une forte somme d'argent. Il ajoute que les Génois la demandèrent pour en faire don à leur église dont elle serait le plus bel ornement. Aujourd'hui, dit-il, ils ont coutume de la montrer comme une merveille aux hommes considérables qui passent par leur ville, et ils s'obstinent à faire croire que ce vase est d'émeraude, parce qu'il en a la couleur6.
CHAPITRE IV.
Établissements des Génois dans la terre sainte.
Chargée de richesses et de précieuses dépouilles, la flotte génoise quitta la Syrie au mois de juillet 1101, et rentra en triomphe dans le port de Gênes au mois d'octobre.
(1102) La compagnie arrivait alors à son terme. Il s'en forma une autre pour quatre ans, et ce mode d'association se renouvela de période en période jusqu'en 1122. On peut juger des profits obtenus dans la première société, d'après l'accroissement des moyens et des forces développés par la seconde: l'une avait fourni vingt-huit galères, l'autre en mit soixante et dix à la mer.
Embriaco fut un des consuls de la société. Mais on ne sait s'il s'embarqua, le consulat n'étant que de quatre membres, tandis que le précédent en avait six. Il est probable qu'aucun des quatre ne s'absenta de Gênes; ils furent, ainsi que leurs prédécesseurs, les consuls de la république comme de la compagnie. L'usage de laisser ces doubles fonctions unies dans les mêmes mains passa généralement en habitude.
L'apparition de la flotte en Syrie y ranima l'espérance, car, dans l'intervalle, les affaires du royaume de Jérusalem avaient couru de grands dangers. On avait perdu la sanglante bataille de Ramla, d'où Baudouin, cru mort ou prisonnier, ne s'échappa que par miracle. Il avait obtenu quelques succès en compensation de ce désastre. Mais l'Égypte envoyait de moment en moment des foules innombrables d'assaillants, et toutes les forces s'épuisaient à les chasser. Quand ils se présentaient en face, la valeur chevaleresque des croisés ne savait ni les compter ni les craindre. Mais les ennemis venaient par mer; les villes nombreuses qui leur restaient sur la côte, tenues par des émirs, leur livraient le passage à l'improviste sur les flancs ou sur les derrières des troupes chrétiennes. Jérusalem même n'était pas a l'abri d'une surprise. L'intérêt de s'emparer des ports de mer, de les ouvrir aux secours, de les fermer aux ennemis, était très-grand pour les croisés; on avait inutilement essayé d'assiéger quelques-unes de ces places. Le succès ne pouvait s'espérer sans le concours des opérations maritimes, et l'on voyait reparaître avec joie le secours des Génois, déjà éprouvé.
Le comte de Toulouse en profita le premier. Il leur persuada d'entreprendre la conquête de Gibel, ville située entre Laodicée et Tortose sa conquête; les Génois désiraient s'acquérir une ville, et le comte voulait écarter de Tortose les Sarrasins qui tenaient Gibel. La ville, vivement attaquée, fut enfin conquise1.
Le roi se hâta de proposer une entreprise bien plus considérable. Il ne s'agissait pas moins que de s'emparer de Ptolémaïs, cette grande et forte cité maritime dont l'ancien nom d'Accon ou d'Acron subsiste toujours dans celui de Saint - Jean - d'Acre (1104). Ici les Génois marchandèrent; les avantages qu'ils avaient obtenus à Césarée ne leur suffirent plus, et leur assistance fut enfin achetée à plus haut prix. Par un traité, dont l'instrument se conserve2, le roi leur concéda à perpétuité le tiers des revenus publics des villes et des ports de Césarée, d'Arsur et d'Accon, ainsi que des conquêtes qui se feraient avec leur concours. Il leur accorde en outre d'amples privilèges; et, comme pour laisser un monument tout à la fois de la jalousie mercantile des Génois et de la faiblesse, en Ligurie, de cette république qui en Syrie dicte des lois, ils font expressément stipuler l'exclusion des navigateurs de Savone, de Noli et d'Albenga, trois bourgs que Gênes voit de ses murs et qu'elle ne pouvait réduire.
Cette convention écrite et jurée, on attaque Ptolémaïs, les galères bloquent le port; les machines génoises, lançant des roches qui écrasent les maisons, secondent le siège mis par terre. Au bout de vingt jours de souffrances, les assiégés sont réduits à capituler. Ils demandent pour chaque famille le libre choix de rester dans la ville ou de se retirer eu emportant leurs effets. Deux historiens rapportent que cette capitulation déplut aux Génois: ils s'opposèrent longtemps à ce que les habitants pussent rien retirer. Cependant le roi et le patriarche, désirant que rien ne retardât la reddition de la place, insistèrent et arrachèrent le consentement de leurs alliés. Alors Baudouin promit par serment aux Sarrasins la libre sortie de leurs personnes et de leurs propriétés mobilières. Sur cette foi, la ville fut ouverte aux chrétiens. Mais, en y entrant, les Génois, furieux de voir emporter des biens qu'ils regardaient comme leur juste proie, se jetèrent sur les vaincus et donnèrent le signal du massacre et du pillage: exemple que la plupart des assiégeants suivirent avec avidité. Le roi, désespéré d'encourir involontairement le reproche de parjure, employa tout son pouvoir à faire cesser les violences. Il voulait en punir les auteurs et les faire charger par ses chevaliers. Le patriarche intervint et réussit, en le calmant, à rétablir la concorde. Guillaume de Tyr ne parle point de cet incident: il raconte la capitulation conclue et exécutée. Plus tard à Tripoli une violation semblable des traités a été imputée à l'avidité des Génois; on ne sait si les auteurs ont confondu, et s'ils ont chargé mal à propos la foi de ce peuple de deux crimes pour un seul méfait.
Si la colère du roi fut excitée, elle ne lui ôta pas le sentiment des services reçus. Non-seulement la convention faite au profit des Génois fut accomplie dans Ptolémaïs, mais Baudouin y donna des maisons et des propriétés aux individus qui s'étaient distingués, suivant les beaux faits et les mérites de chacun3.
(1105) Le traité fait avant la prise de la ville fut renouvelé après la conquête, et il est probable que c'est alors que les concessions obtenues passèrent au nom de la commune de Gênes, de quelque manière que les intérêts des actionnaires de la compagnie aient été indemnisés ou confondus dans ceux du corps de la république. Ces conventions sont écrites en forme de décrets royaux4. Baudouin y reconnaît que Dieu a donné la ville d'Accon à son saint sépulcre par la main de ses fidèles serviteurs les Génois, nation glorieuse qui, venue avec la première armée des chrétiens, a virilement contribué à l'acquisition de Jérusalem, d'Antioche, de Laodicée, de Tortose, qui a conquis pour elle-même Gibel5, Césarée et Arsur, et les a ajoutés au royaume de Jérusalem. C'est pourquoi Baudouin lui concède à perpétuité une rue dans Jérusalem, une autre dans Jaffa, et la troisième partie de Césarée, d'Arsur et d'Accon.
Après chaque expédition, les galères laissaient en Syrie une partie des hommes qu'elles y avaient transportés, et retournaient à Gênes. Chaque printemps ces courses étaient renouvelées. Un de ces armements apporta en Syrie (1109) Bertrand, fils du comte de Toulouse, et les Génois avec lesquels il avait pris passage, s'attachant à ses intérêts, vinrent l'aider à fonder une grande puissance. Le vieux comte était mort sans avoir pu satisfaire sa dernière ambition. Il voulait enlever Tripoli aux ennemis, afin d'en faire le siège d'une principauté respectable. Il avait bâti en face de la ville un château nommé le Mont-Pèlerin; c'est de là qu'il menaçait la place et la tenait en un état continuel de siège ou de blocus. A sa mort, son neveu Jourdain le remplaça d'abord, et continua ses travaux; mais Bertrand vint revendiquer la succession de son père et jusqu'à ses prétentions sur la ville à conquérir. La flotte de Gênes était de soixante et dix galères, comme la précédente; Ansaldo et Hugues, petits-fils ou neveux de Guillaume Embriaco, la commandaient. Toutes ces forces furent à la disposition de Bertrand, qui lui-même conduisait des galères armées dans ses États. Une contestation violente s'éleva d'abord entre les deux cousins. Baudouin s'entremit d'un accord et d'un partage entre eux. Au milieu d'une réconciliation apparente, une querelle entre leurs suivants excita un moment de tumulte, et Jourdain y périt. Bertrand délivré d'un compétiteur, et en possession de toute la succession paternelle, ne pensa plus qu'à presser le siège de sa future capitale. Pendant les préparatifs nécessaires pour y faire concourir Baudouin par terre, et les Génois par mer, les deux Embriaco conduisirent la flotte contre Biblos (le grand Gibel6) et s'en emparèrent. Après cette courte expédition, ils retournèrent devant Tripoli.
Les opérations furent conduites avec grande vigueur, l'appareil des machines génoises n'y fut pas épargné; enfin, les habitants connurent qu'ils ne pouvaient résister plus longtemps. On leur offrit une capitulation favorable, mais ils se méfiaient de la foi de ceux qui avaient saccagé Ptolémaïs, et ils ne voulaient se mettre qu'entre les mains du roi. Ils n'évitèrent pas la violence qu'ils redoutaient. Tandis qu'on réglait dans une conférence la capitulation, à la condition que chaque habitant emporterait de ses biens ce qu'il pourrait en charger sur soi, les Génois coururent sans ordre à la ville, y pénétrèrent et commencèrent le massacre. Tripoli tomba ainsi au pouvoir de Bertrand de Toulouse. Il s'efforça d'arrêter le pillage. Il devait ménager une ville si importante pour lui et si riche, où, dit-on, se trouvaient quatre mille ouvriers en lin, en soie, ou en laine. Suivant un autre récit, on ne maltraita pas les habitants. Ceux qui furent passés au fil de l'épée étaient des étrangers venus pour renforcer la garnison, qui s'étaient cachés en embuscade. Au reste, les écrivains arabes absolvent les Génois du sang versé; on ne fit, disent-ils, qu'user du droit cruel de la guerre.
(1111) Les utiles auxiliaires du nouveau comte de Tripoli l'aidèrent à réunir à sa principauté Béryte et Sarepta. Ils reçurent le prix de tant de services par les établissements qu'ils formèrent dans ce nouvel État. Ces exploits furent les derniers auxquels ils prirent part pendant le règne de Baudouin. On ne les trouve nommés, ni à l'occasion d'un siège mis inutilement devant Tyr, ni à la prise de Sidon où l'assistance par mer fut prêtée par les Vénitiens et par les pèlerins de Norwége.
(1118) Sous Baudouin II, qui succéda à son cousin Baudouin Ier, ce furent encore les Vénitiens qui procurèrent la conquête de Tyr (1118), et qui par cet exploit compensèrent la disgrâce dont le royaume était affligé. Le prince d'Antioche avait perdu la vie avec sept mille combattants dans une bataille (1123). Josselin, comte d'Edesse, était tombé aux mains des ennemis. Le roi lui-même, dans un combat malheureux, fut fait prisonnier. Sa captivité dura dix-huit mois, et quand il en sortit, sa rançon pensa ruiner le royaume.
La conquête de Tyr fut d'un grand prix. La continuité des possessions chrétiennes, sur les bords de la mer, était désormais établie de Laodicée jusqu'aux frontières d'Égypte, avantage immense pour la sûreté du royaume et des navigateurs. Il ne resta plus aux ennemis, en Syrie, d'autre port qu'Ascalon, la position la plus méridionale de ce rivage.
L'acquisition de Tyr eut d'autres conséquences; elle mit en contact, avec des droits semblables, les Vénitiens, les Génois et les Pisans, tandis que la concorde entre ces deux derniers peuples était mal affermie. Ces rivalités furent fatales au maintien des chrétiens dans la terre sainte; pour en faire comprendre la cause et l'occasion, nous nous arrêterons sur le système d'établissements que les Génois avaient fondé les premiers et que l'admission des Vénitiens venait consolider.
Les chevaliers français ou allemands, et les guerriers de la Pouille de race normande, prenaient ou bâtissaient des châteaux, les érigeaient en fief, chacun isolément et pour lui-même. Les Génois ni les Pisans n'avaient rien de pareil. Ils avaient des colonies nationales et marchandes. Il leur fallait moins d'honneurs, point de titres, mais autant d'indépendance, des privilèges solides, en un mot rien de chevaleresque et plus de profit. Les Vénitiens suivirent cet exemple, quoique la présence et la dignité de leur doge et de leurs nobles les fît toucher au rang des princes et des barons. Quoi qu'il en soit, parmi tant de comtes et de seigneurs on n'entend jamais parler d'aucun Génois. Nul d'entre eux ne rapporta dans son pays des titres féodaux de seigneurie; on ne les voit point compter parmi les chevaliers. Guillaume de Tyr appelle les Embriaco de nobles hommes; cet exemple est unique, et nous avons lieu de croire que lui-même il entend exprimer une considération et une importance individuelle plutôt qu'une noblesse proprement dite de rang et de race. Il est même fort remarquable qu'aucun autre nom propre génois ne se trouve dans les annalistes de la croisade. Pas un n'y semble distingué de la nation en général, à la différence de tant de personnages que les historiens nous font connaître individuellement parmi les guerriers des autres pays.
Les décrets de Baudouin Ier, avant et après la prise de Césarée, sont les premiers modèles des privilèges donnés aux auxiliaires navigateurs, libres des engagements ordinaires des croisés. Ces concessions furent élargies par le traité fait à l'occasion du siège de Ptolémaïs. Celles qui furent accordées aux Vénitiens à la prise de Sidon et ensuite de Tyr sont sur le même plan. Le prince d'Antioche, le comte de Tripoli s'y conformèrent en traitant avec les Génois. Les seigneurs de moindre importance suivirent ces exemples à leur tour.
Les privilèges qui constituaient ces sortes de colonies étaient d'abord le don d'une église, d'une enceinte pour y bâtir des magasins, telle qu'a été depuis, à Gênes, le local du Port-Franc. On eut ensuite la propriété d'une rue entière à Jérusalem, à Jaffa, à Accon. Là on était indépendant; et, comme porte le traité des Vénitiens, ces rues étaient possédées avec le même pouvoir que le roi tenait le reste de la ville. La colonie qui habitait ce quartier vivait sous ses propres lois, avec ses usages; et tout autre que ses membres, qui y prenait ou y conservait son domicile, était sujet au même régime. Le consul y était l'unique magistrat; lui seul traitait et répondait pour tous les siens envers le gouvernement local. Des mesures étaient prises pour qu'aucun Génois rebelle ou réfractaire ne pût désavouer l'autorité de son consul; et, au moyen de cette précaution jalouse, ce peuple, qui naguère dans ses traités faisait exclure des ports de la terre sainte ses voisins de Savone, faisait maintenant déclarer Génois, c'est-à-dire dépendant du consulat, tout ce qui habitait la Ligurie, de Vintimille à Porto-Venere.
Un four banal, un bain public, sont accordés aux colons, et il leur est permis d'y admettre les autres habitants en concurrence des établissements privilégiés de même nature appartenant au roi et aux barons dans les autres quartiers de la ville.
Il en est de même de l'usage des poids et des mesures, et des droits levés sous prétexte de ce service public; ou plutôt, il est stipulé que les colons ne connaîtront que leurs propres poids, soit entre eux, soit en vendant aux autres habitants; quand les Génois achètent hors de leur enceinte, alors seulement ils doivent recourir au poids ou à la mesure du roi, et en payer les droits.
Les successions de leurs morts sont réglées suivant les lois de leur métropole. Le consul recueille les biens de ceux qui meurent sans héritiers présents. Si le consul était absent, le gouvernement local s'en rendrait fidèle dépositaire.
Le consul exerce les fonctions judiciaires. Au criminel, le meurtre et le brigandage sont ordinairement seuls réservés à la justice du roi. Au civil, le consul juge entre ses concitoyens suivant leur loi. Pour mieux les protéger dans leurs rapports avec les gens du pays, il est également le juge des contestations où l'un de ses nationaux se défend. Ce n'est que lorsqu'un Génois appelle en justice des sujets du royaume, qu'il est tenu d'aller plaider devant les juges royaux.
Cette application singulière du principe, qui attache la juridiction au juge de celui qui est attaqué, et qui, pour cet effet, reconnaît le consul d'une population étrangère parmi les magistrats territoriaux, fut le premier fondement de l'institution que nous nommons encore le consulat. Ce que l'on avait exigé dans le royaume de Jérusalem fut demandé dans les pays musulmans ou chrétiens, où l'on alla négocier par mer. L'empereur grec l'admit; et c'est ce qui a fait les établissements de Péra. On peut dire qu'il en subsiste encore une ombre, car les conventions de la terre sainte ont servi de tradition et de précédent aux capitulations des Français en Turquie; elles vivent encore en partie dans notre régime et dans nos privilèges des échelles du Levant. Enfin, ces principes, généralisés, modifiés par le temps et par la jalousie des puissances qui admettent des consuls étrangers, adoptés par tous les peuples chrétiens avec plus ou moins de leurs conséquences, ont été si purement conservés par les Génois, leurs premiers auteurs, qu'encore en 1797 la juridiction du consulat de France à Gênes entre Français, ou entre Français défendeur et Génois demandeur, était exactement celle que les traités dont nous parlons donnèrent, il y a sept cents ans, aux consuls de Gênes en Syrie. Le consul français était magistrat génois de première instance pour les affaires civiles où l'un de ses nationaux était intimé.
Les concessions du tiers des droits royaux et des revenus d'une ville sont des faveurs spéciales indépendantes de ces privilèges généraux constitutifs des établissements. Les Génois obtinrent ce don à Césarée, à Arsur, à Ptolémaïs, les Vénitiens à Tyr: dons immenses si les donataires prenaient une si grosse portion de la recette, sans participer aux charges publiques qu'elle avait été destinée à couvrir. Entre autres droits, il en était levé sur les navires qui portaient ou emportaient les pèlerins, et nous avons vu mentionner des chargements de cinq cents personnes. On nous parle d'arrivées et de retours par centaines de mille. Cet impôt devait être de haute importance; dans le traité fait avec les Vénitiens, en leur accordant à Ptolémaïs la franchise de tout péage, on en excepte le droit sur l'arrivée et le départ des navires chargés de passagers; ils n'en sont affranchis que pour les deux tiers. De même, à Tripoli, les Génois, libres de tout autre impôt, restent soumis à celui qui est perçu sur ce transport; ou plutôt le gouvernement se réserve de l'exiger des pèlerins eux-mêmes.
Les Génois obtinrent aussi comme récompense de leurs services, dans Antioche et dans les autres villes de cette principauté, rue et magasin, juridiction et franchise de commerce; enfin le tiers des revenus de Laodicée. Le comte Bertrand de Tripoli leur donne de même le tiers de sa capitale. Il leur reconnaît en outre la propriété de Gibel et du château du connétable Roger. Gibel est le Byblos des anciens, entre Tripoli et Béryte. C'est la ville que les Génois tenus avec Bertrand de Toulouse prirent pendant les préparatifs du siège de Tripoli, et cependant nous voyons que ce même Bertrand leur en fait don. Il est probable que, simples colons dans les villes voisines, n'ayant point par eux-mêmes de grande principauté, ils crurent rendre leur possession plus respectable à d'avides voisins, en la tenant du comte de Tripoli. D'ailleurs il avait servi d'auxiliaire à la conquête en attaquant la ville du côté de terre, et peut-être la propriété aurait-elle fait naître quelques prétentions opposées. Quoi qu'il en soit, cette donation de ce qui semblait leur appartenir déjà est confondue avec de simples libéralités; il est même remarquable que ce n'est pas à la commune de Gênes que ce présent est fait, c'est à l'église de Saint-Laurent de Gênes7.
Il existe une autre singularité. Quelques années auparavant, le vieux Raymond, père de Bertrand, avait donné la moitié de la même ville de Gibel à l'abbaye Saint-Victor de Marseille8; mais les historiens du Languedoc qui nous l'apprennent, remarquent que cette libéralité, quoique écrite de la manière la plus absolue, n'était qu'éventuelle, car à cette époque, et à sa mort, il n'était pas plus maître de Gibel que de Tripoli. Peut-être, cependant, que dans quelque expédition passagère dont la trace ne s'est pas même conservée, il avait momentanément occupé la première de ces villes, et s'en était cru maître assez paisible pour en faire don. Aussi cette première donation fut-elle sans effet.
(1109) Celle de Bertrand, faite aux Génois, leur accorde aussi des exemptions d'impôts dans sa terre, à eux, à tous les Liguriens de Nice à Porto-Venere, et à tout Lombard qu'ils se seraient associé9. Les historiens ont regardé ce titre comme le fondement des établissements génois et lombards dans tout le Languedoc: cette opinion peut être admise, à en juger sur les faits ultérieurs. On pourrait demander cependant, si plutôt ce n'est pas à sa terre du royaume de Jérusalem que se rapportait la concession de Bertrand.
Guillaume de Tyr, en racontant la prise de Byblos, dit qu'Hugues Embriaco, l'un des neveux de Guillaume, la garda un certain temps, sous une redevance qu'il payait au trésor de Gênes. Un autre Hugues, petit- fils de celui-ci, en était encore gouverneur au moment où l'archevêque écrivait. C'était probablement à l'église Saint-Laurent, et non au fisc, que profitait la redevance, distinction qui peut facilement avoir échappé à l'écrivain tyrien.
Plus tard, l'autre Gibel (le petit Gibel), première conquête des Génois, fut cédé par la commune de Gênes à un autre Embriaco, pour vingt-neuf ans, au prix de deux cent soixante besants par an, au profit du trésor, et de dix besants pour l'ornement de l'autel de Saint-Laurent10. Ce que la commune possédait dans les territoires d'Accon et d'Antioche est également affermé à un autre membre de la même famille, Nicolas Embriaco, au prix de cinquante besants pour la première propriété, et de quatre- vingts pour la seconde. Il s'agit, sans doute, des immeubles dont la république était propriétaire. On ne dit point que les droits à percevoir, ni surtout les revenus du port d'Accon, fussent compris dans ce marché. Au reste, toutes ces valeurs avaient déjà baissé de prix. La principauté d'Antioche avait été envahie plusieurs fois, et Noureddin, menaçant les villes maritimes, s'était montré jusque sur le rivage.
Les écrivains génois postérieurs, interprétant les mêmes textes du XIIe siècle que nous avons sous les yeux, disent que ces concessions pour 29 ans furent données aux Embriaco en fief. Ils ont appliqué ici des expressions qui, pour Gênes, n'ont commencé que dans un autre âge, et qui même n'y ont jamais eu la signification qu'elles ont ailleurs. Quoique, par ces conventions, on ait probablement voulu favoriser et récompenser une famille qui avait si heureusement guidé les entreprises génoises en Syrie, on ne trouve rien qui y donne une couleur féodale. On n'y voit qu'un bail à ferme; et il semble que le terme de vingt-neuf ans suffit pour écarter l'idée d'une constitution de fief telle que les peuples guerriers l'entendaient alors. On trouve seulement que les barons de la terre sainte, avant fait de la ville d'Accon une vicomté, les actes du royaume qualifiaient du titre de vicomtes d'Accon les consuls de Gênes en Syrie, représentants de leur commune dans cette copropriété. Une lettre apostolique de 1155 enjoignait au roi, aux princes et aux barons de Jérusalem de faire jouir les Génois des droits qui leur appartiennent; parmi ces droits, on compte la vicomté d'Accon.
Il est curieux de voir autour de Jérusalem la monarchie, l'aristocratie militaire et nobiliaire et trois républiques, créant de toute part, et chacune à son image, des institutions si opposées. Quelque flexible que fût le système féodal qui, en n'exigeant que l'hommage, laissait les membres de l'État à leur indépendance, un tel mélange de démocratie, de consulats indépendants, de châtellenies et de principautés; ces hommes étrangers les uns aux autres, ces émules différents de langue, d'habitudes, d'intérêts, admis au partage de droits communs, tous en usant aux dépens du gouvernement royal, tout cela ne pouvait se trouver ailleurs. Nulle autre part tant d'éléments discordants et tant de hasard n'avaient fondé et constitué un royaume. On s'aperçut plus d'une fois de ce défaut d'ensemble, quand il fallut réunir les efforts de tous les membres pour la défense commune. Tandis que les derrières et les extrémités étaient en proie aux attaques de l'ennemi, la partie baignée par la mer eut d'assez longues années de sécurité, depuis que la possession continue du rivage eut été assurée par la conquête de Tyr. Aussi l'histoire, qui compte sept flottes envoyées par les Génois à la première croisade, ne signale plus désormais de nouveaux efforts de leur part. On ne parle pas davantage de nouvelles expéditions tentées par leurs émules. Venise, Pise et Gênes ne voyaient plus d'acquisition à faire où la nature de leurs forces leur permît de faire acheter leur assistance. Par ce motif, ou sous ce prétexte, ils se bornaient à garder les rivages. Dans le mouvement de leur commerce, ces navigateurs armés arrivaient et partaient sans cesse; et leur présence en Syrie n'était plus un événement remarqué. Quand le royaume fut menacé sur les frontières de terre, il se peut que les consulats aient fourni leur contingent pour le salut commun; mais personne n'en fait mention; et le danger venant de loin, il est probable que les colonies maritimes prirent le moins de part qu'elles purent au fardeau de la défense publique. D'ailleurs la jalousie des trois peuples maritimes nuisait au concours des efforts qu'ils devaient à la cause générale. Le pieux Jacques de Vitry en exprime vivement le regret. Il reconnaît que ces colons, enfants dont les pères avaient acquis la couronne immortelle par leur courage et par leurs oeuvres pour le royaume du Christ, n'avaient pas dégénéré en Syrie comme les fils amollis de tant d'illustres croisés. Ils seraient, dit-il, encore redoutables aux Sarrasins, s'ils n'étaient bien plus livrés à leurs trafics, à leurs jalousies mercantiles, aux discordes que leur avidité sème entre eux, qu'occupés de la garde de la terre sainte. Ils effrayeraient l'ennemi autant que faisaient leurs ancêtres; ils le réjouissent par leurs dissensions et par les combats qu'ils se livrent. Ces dissensions en Syrie, se faisant sentir aux métropoles en Italie, y retenaient leurs forces divisées; attentives à envoyer, chaque année, des galères au-devant des flottes marchandes de leurs colonies, elles ne faisaient plus de grandes expéditions.
Cependant ces colonies étaient une source abondante de richesses qui refluaient sans cesse vers l'Occident. Elles n'étaient pas seulement importantes par les concessions obtenues; leurs avantages ne se bornaient pas aux profits industriels sur le transport des pèlerins, sur les consommations de tous les habitants latins de la terre sainte; les trêves, les alliances même faites à plusieurs reprises avec les gouverneurs de Damas ou de l'Égypte, avec d'autres princes musulmans; le besoin, qui, plus pressant que la voix du fanatisme et de la haine, poussait Orientaux et chrétiens, malgré la guerre, à échanger entre eux les jouissances et les marchandises de l'Asie et de l'Europe, donnaient une activité extrême à ces relations lucratives. Le bénéfice en restait aux plus habiles, aux plus actifs, aux plus économes; telle fut la source longtemps inépuisable de la fortune de Gênes.
CHAPITRE V.
Agrandissements en Ligurie.
(1115 à 1154) Tandis que les Génois formaient des établissements considérables en Syrie, que, pressé entre tant de résistances et de rivalités, ce peuple apprenait de la nécessité à donner à ses institutions une constitution forte et vraiment nationale, la métropole de ces colonies, sur laquelle refluaient les richesses du commerce lointain, la commune de Gênes, était restée dans sa simplicité primitive. Vingt ans (1112) après la prise de Césarée on eut pour la première fois des chanceliers, des archivistes, des greffiers ou notaires, enfin la forme d'un gouvernement régulier, substitué au simple lien d'une association maritime et mercantile.
Cependant les affaires publiques s'étaient déjà compliquées. On se sentait riche en force; on éprouvait le besoin de franchir les murs étroits de la cité; on s'indignait de ne pouvoir soumettre de faibles voisins à la domination d'une république qui possédait des villes en Asie, en commun avec les rois et les princes. On avait des trésors pour acheter ce qui était à vendre; on était résolu d'enlever le reste par la force.
(1115) Le butin de Césarée fournit la première monnaie qui fut battue à Gênes. Jusque-là celle de Pavie avait été seule connue. Les premiers essais que l'on fit furent sans doute exécutés grossièrement, car peu d'années après on fabriqua de nouvelles espèces, et ce ne fut qu'après un nouvel intervalle de vingt-cinq ans que le système monétaire fut fixé. Il conserva longtemps l'empreinte de l'empereur Conrad III, qui, survenu en Italie, autorisa par un diplôme la monnaie de Gênes, car la commune ne refusait pas d'être réputée ville impériale; mais c'était avec le soin de se soustraire, autant qu'il était possible, à toute dépendance réelle, et surtout à toute contribution.
Peu à peu s'établissait l'ordre public. Le consulat cessait de dépendre des compagnies formées pour l'armement des galères de la croisade. Mais, à mesure, on voit la jalousie de la liberté prendre ses précautions contre la longue habitude du pouvoir. Les consuls n'eurent plus quatre ans d'exercice. Dans la dernière élection, où il est encore question de ce terme, il fut réellement réduit à deux ans, et on stipula que les consuls nommés se partageraient par moitié les quatre années, en se succédant les uns aux autres. Immédiatement après, le consulat fut purement annuel, et ce fut alors que la commune acquit une chancellerie1.
Il existe un curieux monument de cette organisation municipale; c'est le modèle du serment que prêtaient les consuls, en prenant possession de leur charge, le jour de la Purification (2 février), et en jurant de la déposer à pareil jour de l'année suivante. La formule ajoute: La compagnie étant terminée, ce qui ferait croire que la compagnie, cette société, ce lien de la commune, était censée annuelle comme le consulat l'était devenu.
Les consuls stipulent des précautions assez étranges pour rendre la compagnie obligatoire. Quiconque, invité par le consulat ou par le peuple à y adhérer, ne se présentera pas dans le délai de onze jours, n'y sera plus à temps pendant les trois années suivantes; on ne le nommera à aucun emploi public; il ne sera pas admis en justice, si ce n'est quand il sera défendeur. Il sera interdit à tout membre de la compagnie de servir ce réfractaire sur ses navires, ou de le défendre devant les tribunaux. Quand un étranger aura été accepté dans la compagnie, les consuls l'obligeront, sous serment, à une habitation non interrompue, pareille à celle des autres citoyens. Seulement, il suffira pour les comtes ou marquis, et pour les personnes domiciliées entre Chiavari et Porto-Venere, d'habiter dans la cité trois mois par an.
Les consuls ne feront ni guerre, ni expédition, sans le consentement du parlement2. Le parlement réglera le salaire des ambassadeurs, et cette fixation précédera leur nomination. Le même consentement sera nécessaire à l'établissement des nouveaux impôts. On n'augmentera pas les droits sur la navigation à moins de nouvelles guerres. Le poids des charges publiques sera également réparti sur tous. Les consuls empêcheront l'importation des marchandises étrangères en concurrence avec celles du pays, les bois de construction et les munitions navales exceptés.
Avant même ces stipulations politiques ou économiques, le serment des consuls, comme autrefois à Rome l'album du préteur, fixe le mode et les conditions sous lesquelles ils exerceront les fonctions judiciaires au civil et au criminel. Ils jurent, enfin, qu'ils opéreront pour l'utilité de l'évêché et commune de Gênes, et à l'honneur de la sainte mère Église3.
On voit que les consuls étaient les juges des procès de leurs concitoyens; mais quand les affaires de l'État exigèrent plus de soin, la distribution de la justice, détachée de la direction de la république, fut déléguée à des magistrats électifs et temporaires qu'on appela consuls des plaids, pour les distinguer des consuls de la commune. Comme ceux-ci, ces juges étaient renouvelés tous les ans: leur nombre varia; mais, en général, il y en avait un pour chacune des compagnies entre lesquelles les citoyens étaient répartis et organisés par quartiers. Il est probable que ces compagnies nommaient les magistrats; mais on ne sait rien de certain sur la forme de l'élection. Quand, la population croissant, on eut beaucoup dépassé l'antique enceinte, il y eut quatre compagnies intérieures et quatre dans le bourg: ainsi fut appelée la partie nouvellement habitée, qui prolongea la ville le long de la mer vers le couchant. Dans chacune de ces deux grandes divisions, les juges des quatre compagnies qui les composaient, paraissent avoir formé un tribunal commun4.
Ainsi la république fondait ses institutions. Mais si déjà l'on voit quelques signes de réserve et de défiance contre les abus du pouvoir confié aux magistrats, on ne remarque rien qui trouble la pure démocratie, lien de cette société. Les élections annuelles (car nous possédons en entier les fastes du consulat) amènent toujours de nouveaux noms. Peu d'individus y sont rappelés plusieurs fois dans cette première époque; quelques noms seulement reparaissent parmi les consuls des plaids. Bientôt, sans doute, les notables ou les meilleurs, comme on les désigne, tentèrent de concentrer la magistrature entre leurs mains, d'en faire le patrimoine de leurs races; enfin, d'établir une aristocratie de caste entre les familles riches et puissantes. Mais il fallut du temps pour que cette entreprise fût formée et avouée, et pour qu'elle réussît. Il restait trop à faire au dehors, et autour des murs même de la ville, pour s'abandonner aux dissensions internes.
(1130) On a vu que dans un court intervalle, d'abord les Génois avaient intrigué auprès de leurs alliés de la terre sainte pour en faire exclure les vaisseaux de leur voisinage le plus immédiat de Savone; mais que bientôt ils avaient stipulé que tout ce qui habitait de Vintimille au couchant, jusqu'aux frontières de la Toscane au levant, serait reconnu pour Génois, et tenu de se ranger sous la jalouse protection de leurs consulats. Ce changement de disposition répond à celui qui s'était fait dans leurs relations avec leurs voisins. Ils avaient ménagé des acquisitions et entrepris des conquêtes des deux côtés du littoral; ils marquaient déjà le Var et la Magra pour les limites de leur domination, bornes qu'elle n'a point dépassées dans la suite du temps. Ils affectaient déjà d'en occuper l'espace. Mais entre ces deux frontières, leurs possessions étaient précaires et leurs prétentions mal reconnues.
Cent cinquante milles de côtes sont le territoire de cette Ligurie maritime dont ils ambitionnaient la souveraineté. Elles sont formées par une longue chaîne de montagnes, dont la partie occidentale joignant l'Apennin aux Alpes de Nice, borde immédiatement la mer, en courant au levant jusqu'à la ville de Gênes. Là la chaîne se plie, tourne au sud- est, et se prolonge vers la Toscane; elle est une portion de cette grande arête qui divise l'Italie entre les deux mers. Là où le flot n'a pas envahi le pied des monts, se trouvent d'étroites plages de tout temps peuplées de navigateurs. Une pénible culture tire quelque parti des vallées courtes et resserrées qui remontent le long du lit des torrents dont les montagnes sont sillonnées: l'olivier les enrichit et les pare. Là où les hauteurs donnent des abris favorables, s'unissent le citronnier et l'oranger; on y voit même le palmier apporté d'Afrique. Au delà des monts sont les fertiles plaines du Piémont et de la Lombardie. Mais cette terre promise n'a pas été réservée aux Génois. Au temps dont nous parlons, toute l'épaisseur de cette barrière de montagnes était loin de leur appartenir; l'ambition, non pas de descendre dans la plaine, mais de s'établir sur le revers qui la regarde par delà la crête des monts, n'était entrevue que dans le lointain.
Gênes, en voulant s'étendre, rencontrait un grand nombre d'obstacles dans toutes les directions. Des populations du littoral qu'elle a successivement agrégées à sa seigneurie, il n'en est aucune qui n'ait fréquemment secoué ce joug. Au couchant était Savone, Albenga, Vintimille, les principales des petites villes ou bourgades de Gênes au Var. Toutes trois étaient antiques; les deux dernières avaient été, sous les Romains, des cités qui servaient de chefs-lieux à toute cette portion de la Ligurie maritime. Savone et Albenga étaient, au douzième siècle, de petites républiques; et entre elles, Noli réclamait les mêmes droits. Gênes n'était pas beaucoup au-dessus de ses voisines. Nous ne connaissons pas les titres en vertu desquels elle prétendit les soumettre. Le plus apparent n'est que le droit de convenance, et celui du plus fort en a seul décidé à la longue.
Vintimille était tombée sous le pouvoir d'un comte héréditaire, car des débris des institutions de Charlemagne et de ses successeurs, il restait dans ces pays des marquis et des comtes. De nombreux seigneurs, se glorifiant d'être vassaux de l'empire, avaient planté leurs châtellenies féodales parmi les croupes et les pics de l'Apennin. De là ils enviaient le rivage de la mer, et les richesses qui commençaient à s'y répandre. Quelques-uns y avaient mis le pied, comme le comte de Vintimille: la famille des Caretto tenait le marquisat de Final. Dans les montagnes, il y avait des marquis de Ceva, de Clavesana, etc. Au nord était le marquis de Gavi. Au delà régnaient des seigneurs plus puissants: le comte de Piémont, le marquis de Montferrat. Des services réciproques à la terre sainte tenaient ordinairement ce dernier en bonne intelligence avec Gênes; mais plus d'une fois son ambition se heurta contre celle de la république. C'est ainsi que, pendant le cours des croisades, nous trouvons Gênes au milieu de petites communes mal soumises, et de nobles voisins plus guerriers que ses bourgeois: elle étend lentement son pouvoir contesté et envié dans la rivière du ponent. On sait que l'usage a conservé le nom de rivière (Riparia de la basse latinité) aux deux portions du rivage dont Gênes occupe le milieu.
La rivière du levant n'avait point alors de ville municipale; l'antique cité de Luni avait péri, mais les hauteurs étaient occupées par la puissante famille féodale de Malaspina, la même que nous avons vue associée avec les Génois dans une expédition de Sardaigne. Il y avait des comtes de Lavagna, dont les possessions tenaient de la montagne à la mer. Enfin, la frontière orientale confinait avec celle des Pisans, dont l'inimitié et les forces ne laissaient aucune sécurité.
Aussi les premiers efforts que nous voyons faire aux Génois, aussitôt que les biens recueillis à la croisade les ont fortifiés, sont dirigés de ce côté. Ce ne fut pas sans peine qu'ils établirent sur les populations maritimes une domination qui resta longtemps douteuse. Ils pensèrent bientôt à se donner un point d'appui plus solide. A l'extrémité de leur territoire est le beau golfe de la Spezia, enfoncé dans les terres avec une ouverture défendue par des îles. Les Pisans en tenaient le fond et la côte orientale. Les Génois bâtirent et fortifièrent Porto-Venere à l'occident et à l'entrée du golfe (1113). Cette position, en dominant les îles qui resserrent l'entrée de ce vaste bassin, y donne un passage assuré.
Une autre acquisition n'était pas moins importante pour s'assurer contre l'invasion. La vallée de l'un des deux torrents, de la Polcévera et du Bisagno, entre lesquels la ville de Gênes, au pied d'une haute montagne, est assise sur la mer, offre à ceux qui la remontent une voie pénible, mais alors la seule praticable pour communiquer aux plaines lombardes. Celui qui pouvait l'ouvrir à des ennemis était le maître d'exposer Gênes à des coups de main imprévus. Le marquis de Gavi possédait cet avantage; au moyen de son château et de celui de Voltaggio, il fermait les gorges de l'Apennin, et il n'avait pas manqué d'y établir un péage à son profit. C'était la moindre oppression qu'il fallait attendre de ce voisinage. Les Génois voulurent s'y soustraire à tout prix. Ils s'emparèrent d'abord de vive force de quelques positions qui dominaient ces défilés: mais ils s'estimèrent heureux que leurs succès servissent à faciliter une négociation, et ils ne craignirent pas d'acheter au prix de quatre cents livres d'or Voltaggio et les revenus qui en dépendaient (1121). Avertissons cependant que lorsqu'ils eurent donné l'exemple de livrer leurs trésors à leurs nobles voisins, ils furent bientôt réduits à payer plusieurs fois et à racheter sans cesse les territoires qu'on leur avait vendus le plus solennellement.
CHAPITRE VI.
Expéditions maritimes.
Tandis qu'on employait ainsi les richesses publiques rapportées de Syrie, on continuait à naviguer vers la terre sainte, mais le négoce, et non plus le zèle ou l'ardeur belliqueuse, y conduisait les vaisseaux génois. On se contentait de renforcer les colonies maritimes (1131). Cependant elles étaient déjà menacées (1144). Sous Foulque d'Anjou, gendre et successeur de Baudouin II, sous Baudouin III, fils de Foulque, tout commençait à présager la dissolution du royaume. L'empereur des Grecs, en attaquant la principauté d'Antioche, avait affaibli l'une des barrières de la terre sainte: un autre boulevard était tombé. Zenghi, émir de Mossoul, s'empara d'Édesse (1148). Noureddin, fils et successeur de Zenghi, pénétra jusqu'au port Saint-Siméon et affecta de se baigner dans cette mer dont il voulait enlever le rivage aux chrétiens. Damas tomba en son pouvoir, et devint le siège d'une grande puissance qui devait détruire celle des Latins (1152). Au milieu de ces désastres, Baudouin III eut le bonheur d'acquérir Ascalon, la dernière et la plus méridionale des villes de Syrie. Elle avait été tenue jusque-là par les Egyptiens, dont elle avoisinait la frontière. Cette ville servit, de ce côté, de rempart aux établissements chrétiens et retarda leur ruine. Ces événements occupèrent la scène jusqu'au milieu du douzième siècle.
Quand les intérêts des colonies génoises furent menacés de si près, on vit la république faire des efforts pour les secourir efficacement. Jusque-là elle ne paraît pas avoir montré un grand empressement pour la défense du royaume de Jérusalem. Il en eût été autrement s'il eût été permis aux Génois d'avoir pour leur évêque notre fameux abbé de Clairvaux. Les voyages de saint Bernard à Rome l'avaient fait connaître et révérer partout sur son passage, et l'épiscopat de Gênes lui fut offert. Cette nomination fut rendue inutile par la désapprobation du pape Gélase II. Il manda de laisser Bernard aux plus grandes choses auxquelles le ciel l'appelait. Le saint abbé, afin de marquer son affection envers le troupeau qui l'avait désiré pour pasteur, adressa à Gênes une lettre pleine d'exhortations pieuses. Il y recommanda de secourir la terre sainte, et de se défendre, au dedans, de l'hérésie. Il n'y a pas soixante ans que l'autorité de son épître fut citée au sénat contre un étranger devenu citoyen.
Sous ce grand promoteur de la croisade et de la paix de la chrétienté, Gênes, plus zélée pour l'oeuvre commune, n'eût point employé ses forces dans une guerre contre les Pisans excitée par la duplicité du pape Gélase. Elle fut ensanglantée par les souvenirs de l'ancienne rivalité comme par la jalousie nouvelle du commerce et de l'influence en Syrie.
Gélase avait été chassé de Rome. Il se sauva en Toscane. Il vint, en suppliant, à Pise, de là à Gênes, mendiant partout des secours. Les Génois lui prodiguèrent les soins et les respects; il consacra leur nouvelle cathédrale; ils le conduisirent en sûreté jusqu'en Provence. Or, en ce temps, la domination de la Corse était prétendue entre les deux républiques rivales. Chacune y avait quelques établissements, toutes deux s'appuyaient des concessions accordées par les papes; et Gênes, en preuve de la sienne, payait au saint-siège un tribut annuel d'une livre d'or. Le droit de consacrer les évêques de Corse dans l'église de Gênes ou dans celle de Pise était controversé depuis longtemps, et Rome ne se pressait pas de décider. L'archevêque de Pise, en vertu de son grade, réclamait les privilèges de métropolitain sur l'île entière. Les Génois n'avaient point d'archevêque chez eux, mais ils ne voulaient pas laisser dépendre d'un étranger les diocèses soumis à leur domination. Les deux partis sollicitèrent Gélase à son passage. Il avait entendu les Pisans les premiers, et ils assurent qu'il leur avait donné gain de cause. Mais, recueilli, aidé à Gênes, il lui resta sans doute assez de bonnes paroles à y prodiguer. C'est de ce moment que la guerre éclata avec une grande animosité; d'abord les Génois débarquèrent à l'improviste sur les côtes d'une des provinces de la Sardaigne; les établissements des Pisans furent ravagés: le butin fut considérable. L'année suivante on arma quatre-vingts galères pour attaquer les ennemis dans leur métropole. Vingt-deux mille combattants sortirent de Gênes: parmi eux cinq mille étaient couverts d'armes brillantes, disent les chroniques, et cette distinction des guerriers et de la foule qui les suivait peut faire considérer l'expédition entière comme une levée en masse. Elle donne aussi une idée des forces de la république en ce temps. L'annaliste Caffaro, alors un des consuls et l'un des chefs de l'entreprise, assure qu'on poussa jusque dans la ville ennemie, et que la terreur fit conclure une paix immédiate; aussi fut-elle passagère. Les Pisans reprirent les armes, mais la fortune continua à être favorable à Gênes. Le pape Calixte, successeur de Gélase, intervint; il évoqua à son siège la querelle des évêchés de Corse, et cita les parties au concile de Latran. On y fit tourner l'affaire en négociations inutiles; après un long délai, on la remit au jugement d'une junte d'archevêques et d'évêques; les anciens titres furent compulsés; et quelle fut enfin la décision tant attendue? On rejeta les prétentions des deux parties, et le droit de sacrer les Corses fut réservé au pape. Il suffit à l'animosité des Génois que Pise ne l'emportât pas sur eux. La sentence du pape fut rapportée à Gênes en triomphe; mais à Pise, on y résista, les hostilités reprirent leur cours, et Calixte ne s'en inquiéta guère.
Les flottes ennemies épiaient les convois marchands. On se mettait comme en embuscade entre la Corse et la Sardaigne, entre ces îles et le continent. On aimait mieux s'attacher à la poursuite lucrative des riches cargaisons ou des galères chargées de voyageurs que l'on pût rançonner, que de se chercher en force et de se combattre. Ainsi se prolongea la guerre de saison en saison. Cependant les Génois établissaient leur croisière à la bouche de l'Arno, défiaient leurs émules et se vantaient que ceux-ci ne venaient pas les braver si près de Gênes. En poursuivant une flotte pisane ils débarquèrent (1126) à Piombino, ravagèrent le pays et amenèrent les habitants en esclavage. Dans une autre rencontre, ils allèrent chercher l'ennemi jusqu'en Sicile et dans le port de Messine (1129). Les Messinois voulant s'opposer à la violation de leur territoire, les Génois débarquèrent et s'attaquèrent à tout ce qui se présenta devant eux. Dès ces temps, les droits de la neutralité n'étaient pas interprétés par les plus forts autrement que de nos jours. Le roi de Sicile fut obligé d'accourir pour s'opposer à ces audacieux étrangers, et, à en croire leur annaliste, ils ne s'arrêtèrent que devant le palais du prince, et n'abandonnèrent qu'à sa prière le butin qu'ils n'avaient pas manqué de faire sur le chemin qu'ils avaient parcouru.
Enfin le pape Innocent II entreprit d'éteindre une guerre qui troublait l'Italie, qui détournait des soins dus à la conservation de la terre sainte, mais surtout qui l'empêchait d'être secouru lui-même dans ses querelles. Le pontife éleva le siège de Gênes à la dignité d'archevêché, et, en vertu de l'égalité de titre et de juridiction, les deux métropoles se partagèrent pour suffragants les évêques de Corse. C'était faire gagner le procès aux Génois; mais ils avaient envoyé au pape huit de leurs galères pour l'aider à remettre sous son joug les Romains révoltés. La faveur des souverains pontifes s'arrêtait avec complaisance sur des enfants du saint-siège, si dociles et si respectueux. Lucius II, dans son court pontificat, se hâta de leur donner par une bulle la confirmation de leurs propriétés et de leurs privilèges à la terre sainte, et, par une autre largesse médiocrement coûteuse, il leur fit remise de la livre d'or qu'ils payaient en tribut pour leurs possessions de Corse. Leurs écrivains postérieurs ont beaucoup exalté ce don. Ils avaient besoin d'en tirer la preuve que la seigneurie que Gênes s'arrogeait sur l'île n'était pas imaginaire, qu'elle pouvait être réclamée en conscience et sans péché.
(1132) La guerre de Pise avait duré quatorze ans. Elle ne paraît pas avoir affaibli Gênes, ni retardé ses progrès. En obligeant à des armements continuels, en tenant la population maritime en haleine, elle tendait le principal ressort de la grandeur de la république; elle développait l'énergie. Au sortir de cette lutte, on voit les Génois étendre leur prépondérance et porter fort loin leurs entreprises maritimes, commerciales et guerrières.
Quoique le comte de Toulouse eût enseigné à ses sujets le chemin de l'Orient, il ne paraît pas qu'ils eussent été aussi diligents que les Italiens à en rapporter le commerce. Les Génois étaient en possession d'approvisionner de denrées et de marchandises étrangères la Provence, le Languedoc, la Catalogne, et toute la côte espagnole. Les seigneurs les rançonnaient quelquefois; mais parfois aussi, quand ces nobles châtelains avaient besoin d'assistance, ils briguaient celle de ces puissants navigateurs. Ceux-ci sentant leur force, habiles à ne pas l'employer sans s'en assurer le prix, ne répugnaient pas aux occasions d'accroître leur influence. Au nom du pape, leur secours fut sollicité par Guillaume VI, comte de Montpellier. Il avait été chassé de sa ville, favorisée dans sa révolte par le comte de Toulouse, Innocent II avait mis d'abord la cité rebelle en interdit. Il excommunia ceux qui, dit sa bulle, s'en faisaient appeler consuls; et avec eux le comte de Toulouse; mais il fallait d'autres armes. Guillaume obtint (1143) des troupes du comte de Barcelone et quatre galères des Génois. Ceux-ci, avaient eu à se plaindre des exactions que le comte leur avait fait souffrir. Il fut obligé, pour premier prix de l'assistance qu'il obtenait, de payer mille marcs d'argent en restitution de ce qu'il avait exigé; et lorsque, avec l'aide de ses auxiliaires et après un long siège, il fut enfin rentré dans sa ville, les Génois, fidèles à leur système d'établissement, se firent accorder des privilèges étendus pour leur commerce, l'exemption des droits, et une enceinte franche pour leurs magasins1.
(1144) La nièce du comte de Montpellier était dame de la petite ville de Melgueil (Magdelonne); elle avait épousé le comte de Provence frère du comte de Barcelone. Les Provençaux étaient alors en hostilité avec les Génois qui leur reprochaient de favoriser les fréquents soulèvements de Vintimille. Le comte de Provence eut peu d'égards pour les alliés de son oncle; il arma contre eux, et essaya de prendre leurs navires à leur approche du port de Melgueil; la tentative fut malheureuse, il fut tu par les Génois.
Cet événement ne rompit pas les alliances de sa famille avec la république. Peu après, les comtes de Barcelone et de Montpellier concouraient avec elle dans une très entreprise sur les côtes d'Espagne2.
Par delà la Catalogne, elles étaient habitées par les Mores. Les Génoisque le commerce et la course de leurs galères portaient par toute la Méditerranée, négociaient sans scrupule avec les mahométans d'Afrique et d'Espagne; mais quand la rencontre de quelque riche cargaison faisait juger que le profit du corsaire passerait ceux du marchand, on traitait les Sarrasins d'ennemis naturels des chrétiens, et on prenait leurs vaisseaux. Les Sarrasins croisaient à leur tour; et, pour mieux dominer sur les mers, ils avaient fait de Minorque le siège de leurs armements. Les Génois essayèrent, seuls d'abord, de les chasser de cette île (1146). Ils expédièrent vingt-deux galères et six grands vaisseaux, qui portaient des tours mobiles et des machines. On y embarqua des combattants et même cent cavaliers. Notre historien Caffaro, consul de cette année, fut le chef de l'expédition, avec Hubert della Torre, qu'il demanda pour adjoint. L'arrivée de cette flotte répandit la terreur dans l'île. Les Mores ne firent pas longue résistance: on pilla, on enleva tout ce qui fut rencontré. De là, profitant de ce qui restait de temps avant la mauvaise saison, on passa sur la côte d'Espagne. On se présenta devant Almérie. On s'empara d'abord de tous les vaisseaux qui étaient dans le port; ensuite les machines furent dressées pour attaquer la ville. Elle n'était pas préparée à la défense. Le roi de cette contrée demanda la paix et offrit de l'acheter. On ne voulut lui vendre qu'une trêve. Elle fut négociée au prix de cent trente mille marabotins3. Il en payait vingt-cinq mille comptant. Des otages devaient répondre que le reste serait acquitté dans huit jours. On apporta aux Génois les deniers du premier payement. Mais, tandis qu'on les comptait, et que les vainqueurs étaient attentifs à les partager à mesure, le roi more, profitant de la préoccupation commune, s'était enfui, enlevant sur deux galères tous les trésors qu'il avait pu réunir. Les assiégeants et les assiégés furent également troublés de cette disparition. Les Sarrasins se choisirent un autre chef, et protestèrent de leur bonne intention pour accomplir le traité. Mais il ne fut pas en leur pouvoir de le faire, et au terme convenu, leur impuissance ne laissa aux Génois que la triste ressource de multiplier les ravages autour d'Almérie. Ils les exercèrent vingt jours, sans que les portes de la ville s'ouvrissent. L'hiver approchait, il était temps de remonter sur les galères. Le siège fut levé et l'on revint à Gênes.
L'annaliste consul, qui se complaît dans les détails de l'entreprise qu'il avait commandée, passe si rapidement sur les conséquences qu'elle eut dans les deux années qui suivent, que nous pouvons soupçonner qu'à son retour on fut mécontent de lui, et qu'il le fut de la république. C'était le temps où la démocratie et une sorte d'aristocratie commençaient à lutter sourdement, et Caffaro paraît avoir été un des ardents fauteurs de la dernière. Le peu de succès de son consulat était une occasion favorable de le décrier. Être trompé par le More, avoir laissé fuir une riche proie, aura pu être un double sujet de reproche. L'expédition aura paru trop peu lucrative en proportion de la dépense. Il est certain du moins qu'on balançait à retourner à Almérie. Il fallut qu'Eugène III fît des efforts pour ranimer les courages contre les infidèles (1147); tout le crédit de l'archevêque de Gênes y fut employé. Il fallut aussi les sollicitations et les offres d'Alphonse VIII, roi de Castille et de Léon, vivement intéressé à enlever aux Mores les places maritimes de son voisinage. Des traités intervinrent, la guerre devait se faire par des efforts communs. Les Génois avaient soin de stipuler, suivant leur usage, que le tiers des conquêtes leur serait remis; Alphonse promettait des troupes, et, comme il disposait de peu de forces et qu'il comptait sur celles du comte de Barcelone, il se réservait de confier à celui-ci le commandement de son armée; mais si les Génois étaient mécontents de la coopération du comte, la faculté de se séparer leur était réservée.
Une fois l'impulsion donnée à Gênes, toutes les ressources furent prodiguées au nouvel armement. Il se composa de soixante-trois galères et de plus de cent soixante bâtiments de transport. On y monta en foule. On augmenta le nombre ordinaire des consuls de la république pour porter à la tête de l'expédition quatre d'entre eux, assistés de deux consuls des plaids. Entre les premiers était Hubert della Torre, le compagnon de Caffaro dans la campagne précédente. Guillaume, comte de Montpellier, prit part à l'expédition avec Raymond Bérenger, comte de Barcelone. Il paraîtrait que quelques Pisans s'y joignirent4. Quand la Catalogne et l'Aragon furent en mouvement, les historiens espagnols disent que cette guerre n'occupa pas moins de mille bâtiments, grands ou petits (1148). On attaqua Almérie par terre et par mer; mais la résistance fut longue. Alphonse était sans forces, l'argent manquait au comte de Barcelone, et les troupes commençaient à déserter. Les Mores tâchaient de détacher à prix d'argent les Castillans et les Catalans. Les alliés n'acceptèrent pas ces offres corruptrices; mais les consuls génois se méfièrent de l'effet de ces manoeuvres, et, pour le prévenir, ils brusquèrent l'assaut. La ville fut prise de vive force. La bannière de Gênes y fut arborée avec celles des deux comtes. Les Sarrasins, réfugiés dans un fort, se rachetèrent au prix de trente mille marabotins. Dix mille femmes ou enfants furent envoyés captifs à Gênes. Sur tout le butin on préleva cent cinquante mille marabotins, consacrés à l'extinction de la dette publique, estimée à dix-sept mille livres d'or. Le surplus fut réparti entre les galères et les vaisseaux.
Après la conquête, et dans Almérie même, les traités furent refaits; sans doute que les Génois avaient, su se prévaloir de l'infériorité des secours de leurs alliés pour faire mieux payer leur assistance. La possession d'Almérie et de ses dépendances fut remise à Othon Bonvillani au nom de la commune de Gênes, pour en jouir pendant trente ans.
La flotte se rendit ensuite à Barcelone. On y tint parlement. Le terme de l'autorité des consuls arrivait; on y fit un nouveau consulat pour l'année. Deux des magistrats sortant de charge, della Torre et Doria, retournèrent à Gênes sur deux galères chargées de l'argent réservé au trésor de la république. Le reste hiverna en Catalogne pour entreprendre le siège de Tortose à la nouvelle saison. Les machines des Génois, leurs approches à travers tous les obstacles, déterminèrent la capitulation; après une vaine attente de secours la place fut rendue. Le comte de Barcelone, qui en prit possession, en remit un tiers au comte de Montpellier et un tiers aux Génois. On trouve aussi qu'il fit don à l'église de Gênes d'une île sur l'Ebre, voisine de Tortose. Plus tard les Génois lui rétrocédèrent leurs droits sur la copropriété de la ville.
Ces brillantes expéditions rendirent le nom de Gênes imposant pour tous les peuples qui habitent les deux bords de la mer Méditerranée (1149). Les princes mores voisins étaient obligés de rechercher, d'acheter même l'amitié de ces nouvelles colonies. Sur la côte de Valence qu'infestaient les corsaires, il suffit à Hubert Spinola de montrer cinq galères, et les Mores, tirant à terre leurs bâtiments, demandèrent à traiter de la paix. Boabdil Mahomet, roi de Valence5, reconnaît pour ambassadeur Guillaume Lusio6, qu'il appelle un des principaux citoyens de Gênes. Il fait une paix de dix ans avec les consuls, les magistrats et tous les sages marchands de la république. Par amour pour elle, il donne aux Génois, dans Valence et à Denia, des quartiers pour leurs magasins, où nul autre qu'eux ne pourra habiter. Ils auront libre commerce et totale exemption d'impôt; mais les étrangers qui viendraient négocier avec eux payeront au roi ses droits ordinaires. Par une singulière concession, dans toutes les terres du royaume de Valence, les Génois jouirent gratuitement d'un bain par semaine. Enfin, pour prix de ces faveurs, ceux d'Almérie et de Tortose promettent de ne pas offenser les sujets du roi; celui-ci donne à la république dix mille marabotins; il prend un an de terme pour en payer la moitié. Du surplus, Lusio a reçu et emporte avec lui deux mille marabotins, tant en or qu'en étoffes de soie; les trois mille restants seront soldés dans deux mois.