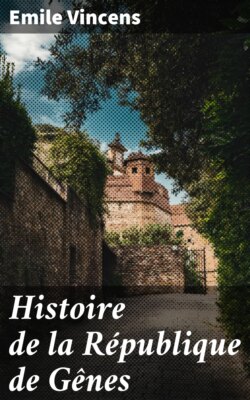Читать книгу Histoire de la République de Gênes - Emile Vincens - Страница 6
ОглавлениеLa terreur était grande devant ces navigateurs victorieux. Un de leurs navires marchands, qui revenait d'Alexandrie, rencontrant les galères d'un prince sarrasin, avait refusé de se faire reconnaître. De provocation en provocation, il s'ensuivit un combat que le marchand ne pouvait soutenir. Il fut conduit en Sardaigne. Mais à peine les Mores eurent reconnu que leur prise était génoise qu'ils s'alarmèrent des suites de leur victoire, et restituèrent le navire et la cargaison sans y toucher. Le juge ou seigneur de Cagliari, allié des Génois, médiateur dans cette circonstance, renvoya le bâtiment à ses propres frais. Si, malgré ces soins, la restitution ne compensa pas le dommage, c'est, dit le pieux annaliste, qu'ainsi peut-être Dieu châtie ses enfants pour les détourner de se livrer au commerce avec les infidèles.
CHAPITRE VII.
Progrès, tendance au gouvernement aristocratique. Noblesse.
La navigation des Génois au couchant n'arrêtait pas le cours de celle du levant. Ils faisaient un trafic considérable dans les ports de l'empire grec. Déjà leur assistance était briguée dans les fréquentes révolutions de ce pays. L'empereur Manuel Comnène ne dédaigna pas de leur envoyer son patriarche Démétrius, pour traiter d'une alliance avec la république. Manuel se méfiait de l'empereur d'Occident Frédéric Barberousse, et encore plus des entreprises des princes normands des Deux-Siciles. Les croisades mettaient son empire en contact avec ces conquérants, et leurs fréquents passages le menaçaient jusque dans Constantinople. Ses successeurs en éprouvèrent bientôt le danger. Pour lui, il cherchait des amis et des créatures en Italie1. A Gênes, il envoyait des présents; il prodiguait les faveurs, et surtout les promesses. La république se fit accorder par lui les privilèges dont les Vénitiens et les Pisans jouissaient dans l'empire. Elle obtint la liberté du commerce, et, avec une église, une enceinte de magasin, une cale de débarquement, le rabais au vingt-cinquième des droits de douane, qui étaient perçus au dixième. Prodigue d'engagements, l'empereur promit d'envoyer pendant dix ans cinq cents perperi à la république, et soixante à son église2, avec des ornements pour la commune et pour l'archevêque3.
On voit qu'en toute négociation importante le consulat faisait la part de l'église et de son pasteur. Choisis par leur troupeau et parmi leurs concitoyens, les archevêques obtenaient toujours considération et crédit; mais, confirmés et institués par les papes, il est naturel qu'ils aient usé de leur pouvoir pour retenir leurs fidèles dans une soumission habituelle envers la cour de Rome. Là aussi où leur dévouement était connu et leurs secours appréciés, les Génois trouvaient une protection paternelle. Quand ils croyaient avoir à se plaindre en Syrie, le pape écrivait des lettres menaçantes au roi de Jérusalem et à ses barons pour les obliger à respecter les droits de la république. Il écrivait aux évêques de Nîmes, de Béziers et d'Agde, pour leur ordonner d'excommunier leurs seigneurs s'ils ne rendaient à Gênes les sommes extorquées à ses navigateurs. L'archevêque fut décoré du titre honorifique de légat perpétuel dans la terre sainte, où il ne mit jamais le pied. A l'époque où notre histoire arrive, ces démonstrations redoublèrent, et en même temps le roi de Sicile, dont les navigateurs génois avaient fréquemment éprouvé de vexations, se rapprochait d'eux sensiblement. La venue du redoutable empereur Frédéric Barberousse, dont l'incursion soulevait l'Italie, était la cause de ces nouvelles dispositions. L'occasion fut saisie. Guillaume Vento et Ansaldo Doria furent expédiés en Sicile. Un traité favorable fut conclu. Le roi en jura l'accomplissement devant eux; ils s'engagèrent à le faire jurer dans Gênes à leur retour par trois cents notables. Les avantages étaient pour les Génois. Leur serment ne les obligeait qu'à ne conspirer ni la mort ni la détention du roi, et à indemniser la Sicile des déprédations que quelques-uns de leurs navigateurs pourraient commettre. Mais, dit l'historien, ce n'est là que ce que sans traité ni serment, la justice de la république accorde à tout le monde; et la négociation faisait acquérir sans rien céder (1157).
Ce traité fait avec Guillaume, roi de Sicile4, est tout commercial et nous donne une idée précise du négoce de ce temps. Un droit était perçu dans le port de Messine, probablement à l'entrée des bâtiments; les Génois en sont exemptés; à l'exportation ils doivent un tarin pour deux ballots de marchandises ou pour quatre sacs de blé, mais ils ne peuvent prendre du grain que pour le porter à Gênes et nullement pour en trafiquer. Arrivant en Sicile d'Alexandrie ou de Syrie, et soit des terres des chrétiens, soit de celles des mahométans, ils doivent trois pour cent de la valeur des cargaisons qu'ils vendent; ce qu'ils remportent invendu ne doit rien. A Palerme, ils doivent, à l'entrée, un tarin et demi par cent livres de cuir ou par cent livres de coton. La sortie est gratuite. Ils doivent un vingtième de la valeur des draps qu'ils apportent de chez eux; les autres articles, s'ils ressortent invendus, sont francs d'impôt.
Par la notice de ces traités et des expéditions lointaines que nous avons indiquées, il semble qu'on peut prendre l'idée d'une nation formée et consistante. L'importance génoise paraît l'emporter, du moins dans les parties occidentales de la Méditerranée, sur celle de Pise. Mais cet empire qui s'étend au loin est encore troublé et disputé dans la Ligurie. Cependant on commence à sentir une force capable de faire plier des voisins indociles.
Les comtes de Lavagna, vers la fin de la guerre pisane, avaient donné de l'inquiétude sur une frontière qui touchait à celle de l'ennemi. Des capitulations les liaient aux Génois, mais leur foi était devenue douteuse; ils étaient armés, on les soupçonna d'intelligence avec Pise qui pourrait leur donner la main. On marcha sur leur territoire, on le dévasta; le château de Rivarola fut bâti pour dominer leurs possessions. Eux-mêmes jurèrent obéissance perpétuelle au consulat. Cinquante ans après, nous trouvons, sous le nom de Fiesque, leur famille, divisée en plusieurs branches, établie à Lavagna, et dans Gênes au rang des citoyens; il est probable qu'à la paix et à la soumission dont nous venons de parler quelques-uns d'entre eux vinrent à la ville comme otages et furent forcés d'y accepter le domicile et la bourgeoisie.
Dans la province occidentale on avait également profité de ce que les forces et l'attention de la république étaient occupées au dehors. Vintimille, se débattant sous le joug, le secouait à chaque occasion favorable. Cette ville avait des seigneurs, et ils avaient été réduits à faire hommage de leur seigneurie à saint Cyr et à prêter serment à la commune de Gênes. Mais quand on fut libre de soins extérieurs, on revint sur ce traité qui avait cessé d'être exécuté fidèlement. Les comtes furent accusés d'y avoir forfait. Leur ville fut assiégée par terre et par mer; elle fut prise, dit l'annaliste, à la gloire de Dieu et de la commune de Gênes. Les habitants subirent le serment d'obéissance. Quelques années après, Guido Guerra, l'un des comtes, accepta le domicile à Gênes et donna ses terres à la république pour les reprendre d'elle en fief. Il en reçut l'investiture dans un parlement solennel où, après avoir exigé son serment, les consuls le revêtirent de pourpre. Ce singulier jeu de fief était usité. D'autres seigneurs féodaux en avaient donné l'exemple dans la même contrée. Ils avaient consenti à vendre leurs domaines à la république, à condition d'en devenir les détenteurs à titre de vassaux. Frédéric Barberousse, qui se regardait comme le seigneur dominant de l'Italie entière, et que ces translations privaient de l'hommage immédiat, fut obligé bientôt après de défendre à ses vassaux de tels marchés sous peine de la perte de la main droite.
Nous avons vu en quoi consistait le droit, ou plutôt l'obligation du domicile. Celui que jurait la compagnie était supposé devenir habitant de la ville de Gênes. Il n'en était censé absent que par permission; et les consuls pouvaient l'obliger à y paraître à la première sommation.
C'est ainsi que peu à peu sous la prépondérance d'une commune de marchands s'abaissait l'orgueil des nobles châtelains cantonnés autour d'elle. Ils s'en indignaient; alternativement ils prêtaient et faussaient le serment de fidélité. Mais ils retombaient dans la dépendance; et la soumission leur était d'autant plus onéreuse qu'elle était moins sincère.
Othon de Fresingue, témoin et narrateur des expéditions de son neveu l'empereur Frédéric, remarque, en le déplorant, que les cités d'Italie avaient étendu leur domination sur les territoires dont elles étaient entourées. Il restait à peine un seigneur assez puissant pour avoir sauvé son indépendance. Dans la haute Italie, dit-il, il n'y avait presque que le marquis de Montferrat qui eût évité le joug des villes. Elles obligeaient les autres nobles à prendre place dans leurs communautés organisées avec un reste des institutions romaines. Elles se régissaient par leurs consuls, magistrats que pour la plupart on ne laissait en place qu'un an, tant on était jaloux du pouvoir qu'on leur confiait. Par le même sentiment on ne réservait pas ces magistratures aux ordres supérieurs. On prenait les consuls indifféremment parmi les capitaines (les grands seigneurs), les vavasseurs et le peuple. Pour assujettir leurs voisins, ces municipalités ne craignaient pas d'admettre à la chevalerie et aux dignités la jeunesse des rangs inférieurs, jusqu'aux fils des artisans ignobles, gens que les autres nations repoussent comme une peste de toutes les occupations honorables ou libérales. C'est ainsi que s'exprime la hauteur tudesque du noble évêque. Dans l'orgueil méprisant de son antique noblesse, il voit chez ces républicains une véritable rouille de barbarie, et cependant, dit-il encore, c'est par ces moyens que ces villes surpassent celles du monde entier en richesses et en puissance.
Ce tableau répond très-bien à l'état où Gênes nous apparaît à la même époque et à ses rapports avec les seigneurs de son voisinage. Nous remarquons seulement que si les autres communes avaient obligé leurs nobles voisins à prendre une résidence réelle dans leurs villes, les Génois avaient fait peu d'usage de ce droit, et vraisemblablement ils auraient pris plus d'ombrage que de confiance du séjour habituel parmi eux de personnages trop élevés. Si ailleurs ces nobles participaient au consulat, on n'en voit aucun exemple à Gênes. Dans les fastes consulaires on ne trouve aucun de ces marquis ou de ces comtes dont nous avons eu occasion de parler, ni rien qui ressemble à des noms de seigneurs. Les Fiesque eux-mêmes ne paraissent mêlés à la conduite des affaires qu'à une époque postérieure, après qu'un des membres de la famille a été élevé à la papauté. À la venue de Barberousse tout était encore, dans Gênes, municipal et bourgeois.
Les occupations maritimes, qui avaient fait la force de toutes les principales familles, ne s'accordaient pas avec les établissements de châteaux et avec les devoirs ou les habitudes des possesseurs de fiefs. Sans doute les maisons les plus riches acquirent des terres autour de Gênes, et, à mesure que les chefs devinrent plus éminents, leurs fermiers et leurs paysans formèrent autour d'eux une clientèle dépendante; nous en verrons des effets. Mais il n'y a aucune trace de l'érection de leurs domaines en seigneuries proprement dites; tandis que Gênes est entourée de fiefs impériaux dans ses montagnes, il n'y a pas sur son territoire propre un seul lieu qui ait un titre et dont ses possesseurs aient affecté le nom.
Il ne paraît pas que l'ordre de chevalerie y fut conféré, comme l'évêque de Fresingue le reproche des autres villes. Le service de la mer laissait peu de place et moins de prix à la milice qui ailleurs ennoblissait le cavalier. Mais, dans la carrière civile, ceux qui donnaient à leurs nobles voisins des investitures, et des mains de qui des comtes recevaient la pourpre; ceux qui faisaient de leur ville une suzeraine respectée, une domination comptée entre les puissances, pouvaient bien s'attribuer les honneurs que les autres nations accordaient à l'épée et à la féodalité. Seulement on ne nous en dit rien à cette époque.
Quoi qu'il en soit, ces marchands, ces bourgeois avaient été, en Syrie, les compagnons des chevaliers et des nobles. Cette fréquentation, et l'effet naturel des richesses qui avaient rompu l'équilibre entre les citoyens, ne pouvaient manquer de donner carrière à l'ambition. Nous touchons au moment où, par une transition insensible, de l'égalité d'une commune sortit une noblesse, et d'une pure démocratie une aristocratie régulière. Ce passage est difficile à saisir, car on ne nous en a laissé aucun monument. L'événement se présente à nous, la date en paraît fixée à l'année 1157. Mais les moyens et les progrès de cette entreprise ont besoin d'être recherchés là où les annalistes n'ont pas même cru les avoir révélés.
L'origine de la noblesse à Gênes est incontestable. Les premières familles à qui l'opinion déféra ou laissa usurper cette distinction sont les mêmes dont le nom se recommande par le plus fréquent retour dans la liste des consuls depuis 1101. Ainsi, de la seule inspection de ces fastes, on peut conclure la justesse de la réflexion de Stella, historien de la fin du quatorzième siècle, mais instruit, et le moins servile des écrivains du pays, qui avait fait de grandes recherches sur les époques antérieures, et qui s'était aidé des traditions et des mémoires domestiques. «Alors, dit-il en parlant des temps anciens, on ne distinguait pas le peuple et la noblesse. Une seule dénomination confondait tous les citoyens. Mais avec le temps, les descendants des familles qui avaient exercé la magistrature se sont appelés nobles5.»
Dans ces anciens noms, il en est qui sont encore portés, de nos jours, avec un juste orgueil, après huit siècles complets d'illustration. Guido Spinola était un des consuls de la compagnie qui, en 1102, présidait à l'armement pour la terre sainte. Immédiatement après, on voit paraître des Defornari, des Mari, des Negri, Vento, Grillo, et bientôt Anselme Doria. Après les pères, on voit les fils arriver aux emplois ou au commandement des flottes. Avec les familles encore existantes, on trouve l'origine de celles qui se sont éteintes, mais dont on suit la trace honorable, comme des Embriaco, Usodimare, Malocelli. Enfin la scène va être occupée par les Avocati et les Volta dont les noms semblent perdus, parce que c'est sous d'autres titres que nous sont connus les descendants de ces familles. Stella nous avertit que les Avocati sont les mêmes que les Pevere (Piper) et que, mêlés avec les de Turca, autrement de Curia, ils sont devenus les Gentile. Les Volta et les Malone réunis sont devenus les Cattaneo. Si l'on ne voit, dans les temps anciens, ni Imperiali ni Centurioni, c'est que sous ces dénominations se sont confondues, dans des temps un peu moins reculés, des familles non moins antiques que celles qu'on vient de nommer.
L'annaliste Caffaro fut aussi l'un de ceux qui ouvrirent la porte des honneurs à leurs descendants: il laissa sa famille au rang des nobles. Peu de personnages, en son temps, prirent aux affaires une part aussi active. Il vécut quatre-vingt-six ans. A trente ans nous l'avons vu à Jérusalem et à Césarée; à cinquante il fut porté au consulat dès la première année où cette magistrature prit une assiette régulière. On trouve son nom six fois sur la liste des consuls de la république, et deux fois parmi les consuls des plaids. Il devait avoir soixante et treize ans quand, dans son dernier consulat, il alla régir l'expédition lointaine de Minorque et d'Almérie. Il fut chargé depuis des missions les plus importantes et les plus délicates. La mort le surprit dans toute l'activité du patriotisme ou de l'ambition, et sans que ses facultés eussent paru baisser. Ce témoin si essentiel des faits, cet acteur des scènes les plus intéressantes pendant près de soixante ans, a écrit ce qu'il a vu, et Gênes ne nous fournit pas d'autres mémoires contemporains. Ceux-ci ont encore un caractère remarquable, l'authenticité officielle.
Ce sont ces annales qui renferment d'abord la liste complète des consuls année par année; mais si elles sont précieuses, elles laissent beaucoup à désirer à notre curiosité, et elles ont des réticences évidentes.
Depuis le commencement de l'ouvrage, jusqu'au siège d'Almérie, le récit propre à chaque année est plus ou moins étendu. A partir de cette époque, l'auteur semble s'être imposé silence. La chronique des sept années suivantes ne contient plus que le nom des consuls. A la première, il ajoute seulement que les Génois ont pris Almérie, qu'il ne saurait tout raconter et qu'il s'en remet aux histoires qu'en écriront les sages témoins de l'événement. L'année suivante, Tortose a été prise (1145); il n'en dit pas davantage, et il passe outre6. Pour les quatre ans qui suivent (1153), il n'y a pas un mot de plus que la liste des magistrats, quand tout à coup l'écrivain se réveille, et certes le tableau qu'il nous trace de la république au commencement de l'année 1154 nous fait bien voir que la matière n'aurait pas manqué à l'annaliste pour les années précédentes, si son silence n'eût été affecté. La république ne possédait plus de galères; l'administration était sans ressources. Tous les revenus étaient aliénés, les terres, les péages, les douanes, les droits du port, les revenus du pesage, du mesurage, de la monnaie. Les citoyens étaient riches sans doute, puisqu'ils avaient prêté sur ces gages, mais eux-mêmes paraissaient tombés en léthargie, tandis que l'État ressemblait à un navire sans pilote abandonné parmi les flots. Telle était la situation où les derniers temps (ces temps sur lesquels Caffaro avait gardé le silence) avaient réduit la chose publique, que les consuls qu'on venait de nommer refusaient de prêter serment et s'excusaient d'accepter leur office. Un Doria, un Spinola étaient parmi eux; leur découragement était- il sincère? L'approche du redoutable Barberousse l'avait-il accru? Ou seulement ces magistrats ambitieux voulaient-ils être sollicités et marchander un plus grand pouvoir? Voulaient-ils mettre le gouvernement hors des mains du peuple, ou affranchir leur dignité de sa tutelle? Leur refus devint un grand événement. Le public s'en émut. L'archevêque vint sur la place réprimander leur égoïsme et leur imposer le consulat en punition de leurs péchés: le peuple les força de prêter serment. Ils le firent par honneur pour la ville. Mais à peine ils furent entrés en charge, c'est eux qui se firent obéir, qui contraignirent les citoyens à vivre en paix: obligation qui, en ce temps, semble leur avoir été nouvelle. Des galères furent construites. Dès le commencement de leur consulat quinze mille livres de dettes furent payées. Avant la fin de l'année, les revenus engagés furent tous retirés des mains des créanciers. Tout prend une vie nouvelle, et alors l'annaliste, après sept ans de réticence, donne carrière à sa plume. Il annonce, comme s'il commençait un ouvrage nouveau, qu'il va écrire les choses dont il est témoin, et il les croit dignes d'être connues du présent et de l'avenir.
Or quelles étaient ces grandes choses? On les aperçoit en y regardant de près. La démocratie perd du terrain; les affaires ne sont plus du peuple, mais du gouvernement. Les ambassadeurs envoyés à l'empereur, au pape, rendent aux seuls consuls le compte mystérieux de leur mission. Les consuls en transmettent les secrets à leurs successeurs. Ces magistrats qui avaient reculé devant leurs fonctions pour les saisir avec une autorité nouvelle, auteurs de vastes plans que le cours d'une année ne leur avait pas suffi à réaliser, y associent ceux qui les remplacent, et leur confient des instructions secrètes pour continuer leur système. La gradation des termes doit même être re-marquée surtout dans un écrivain fauteur évident de la révolution aristocratique. Dans les chroniques de plus de cinquante ans, depuis le commencement du douzième siècle, Caffaro n'a jamais trouvé un mot pour désigner deux classes de citoyens; quand on marchait contre les Pisans, il n'y avait encore de distingués que ceux qui portaient des cuirasses blanches comme la neige. Si une seule fois il est écrit que les consuls s'embarquèrent avec une très-noble escorte, ce n'est là qu'une épithète et non une qualification. Mais maintenant nous entendons à chaque pas parler des meilleurs de la ville, et bientôt ce n'est plus une dénomination vague, c'est le nom d'une classe. On a pris parmi ces meilleurs des ambassadeurs; et Caffaro, qui est du nombre, se donne cette qualité à lui-même, comme un titre convenu qui vient à son rang dans l'État et que la modestie ne peut empêcher de prendre. D'année en année, on voit les magistrats, travaillant tous dans le même sens, s'attacher à circonscrire le choix de leurs successeurs dans cette classe de notables qui tend à devenir une caste privilégiée. Enfin, ceux de 1157 ayant réussi, comme Caffaro s'en vante expressément, à diriger l'élection du consulat, et à le faire tomber aux mains des meilleurs, un seul mot des annales nous fait voir qu'alors un changement fut opéré. Les consuls firent jurer une compagnie nouvelle. On se souvient que la constitution de la commune de Gênes avait été une sorte de société dont les armements pour les croisades furent le principal intérêt. Nous ne savons si ce pacte social était écrit, ou simplement consacré par la tradition. Mais le voici renouvelé, la charte municipale est refaite sous l'influence des meilleurs, qui ont tiré à eux le consulat; cette charte est jurée. C'est là une circonstance remarquable, et, puisqu'elle coïncide avec le temps où le gouvernement a repris une nouvelle vigueur, où il s'est resserré, où les maisons en crédit s'attribuent des distinctions ostensibles, nous pouvons conclure que ce nouveau pacte, s'il ne consacra pas l'usurpation, renferma plus ou moins implicitement le germe du pouvoir et du privilège aristocratique. Telle fut la solennité de la compagnie nouvelle, que Caffaro se glorifie d'avoir prononcé en un même jour trois harangues, pour les consuls sortant de charge, pour ceux qui entraient en fonction, et pour le peuple génois, en invoquant sur la cité les premiers dons du ciel, la paix et la concorde.
Dès ce moment, la dénomination de noble commence à paraître et à remplacer celle sous laquelle elle avait été cachée. Dix ans après, un annaliste, successeur de Caffaro, consacre expressément son oeuvre à un double but, l'utilité de la république et l'émulation parmi les nobles7.
LIVRE DEUXIÈME.
FRÉDÉRIC BARBEROUSSE. - GUERREPISANE. - BARISONE. - AFFAIRES DE SYRIE. -
COMMERCE ET TRAITÉS. - FINANCES.
1157 - 1190.
CHAPITRE PREMIER.
Frédéric Barberousse.
L'an 1154, l'empereur Frédéric Barberousse était descendu en Lombardie: à son approche l'Italie entière fut en confusion. C'est l'année même où Gênes ne trouvait plus de consuls qui osassent la gouverner. Mais on a vu qu'il se rencontra des magistrats fermes en même temps qu'ambitieux, qui se firent de leur résistance affectée un titre à de plus amples pouvoirs. Cette autorité qui fonda l'aristocratie était tombée dans des mains habiles, si nous en jugeons par la conduite tenue dans les rapports avec Frédéric, et par l'impulsion donnée aux citoyens.
Depuis longtemps les empereurs et les papes s'étaient fait la guerre, et leur discorde avait bouleversé l'Italie. Les premiers se croyaient toujours successeurs des Césars et surtout rois de Rome. L'évêque de cette métropole de l'Occident n'était pour eux qu'un sujet qui ne pouvait être ni élu ni installé sans leur congé. A son tour, le successeur de saint Pierre se croyait supérieur au souverain temporel; et le titre d'empereur ne se prenant qu'après le couronnement dans Rome, les papes en possession d'en accomplir la cérémonie regardaient le monarque qui venait se prosterner à leurs pieds comme un candidat qui n'allait tenir la couronne que de leur acquiescement à son élévation. La querelle longue et sanglante des investitures avait été enfin étouffée après des malheurs et des affronts réciproques. A son issue, les papes se trouvaient en jouissance d'une souveraineté territoriale considérable; mais ils n'étaient pas les maîtres de Rome où était leur siège épiscopal, et ils s'en indignaient. Là, les empereurs, quoique absents, faisaient sentir le poids de leurs prétentions souveraines toujours vivantes. Sous leur influence les grandes familles romaines réprimaient l'ambition des pontifes, et le peuple lui-même y opposait des souvenirs de république de temps en temps réveillés. Ces agitations et l'impuissance où les empereurs allemands avaient été de rendre effective, par une administration suivie, leur souveraineté sur les Italiens, avaient habitué chaque ville à un régime municipal tout à fait libre. On ne proclamait pas une indépendance absolue de tout devoir envers le chef de l'empire, mais l'obéissance, rarement réclamée, avait cessé d'être connue.
Cependant la venue d'un nouvel empereur, se rendant à Rome pour son couronnement, était une époque de crise. Suivant l'usage, ses envoyés, le précédant, se répandaient dans toutes les cités pour rappeler aux peuples leurs devoirs, surtout pour exiger des tributs que d'Allemagne en eût vainement réclamés, et dont l'approche du prince et de ses forces rendait seule la levée possible. L'empereur convoquait tous ses vassaux pour grossir son cortège, et pour venir renouveler les serments d'obéissance et de fidélité. Il les appelait aussi pour leur rendre la justice dans sa cour.
Frédéric Barberousse était jeune, vaillant, avide de gloire et de biens; il venait en force, et il amenait avec lui des docteurs disposés à l'assurer qu'il était le maître absolu de toutes choses dans l'empire. Son langage était conforme à ces maximes: souvent ses actions y répondaient. Les Italiens le regardaient d'avance comme le chef impitoyable d'une horde de nouveaux barbares.
Il trouvait pourtant des partisans. Ces villes si multipliées dans la haute Italie, en se gouvernant en républiques indépendantes, étaient ennemies l'une de l'autre. Elles se faisaient la guerre; les plus fortes opprimaient les faibles, et les opprimés ne manquèrent pas de recourir à l'empereur, dont la politique s'en fit autant d'appuis.
Gênes, protégée par son éloignement, n'avait pris aucune part aux rivalités lombardes, ni aux querelles de l'investiture. Ses pieux habitants penchaient évidemment pour les papes, mais ils avaient évité d'offenser les empereurs.
Leurs premiers rapports avec Frédéric n'eurent rien que de bienveillant. Comme les autres, ils députèrent vers lui. Caffaro et un archidiacre lui furent envoyés avec des présents. Les dépouilles des Sarrasins d'Espagne, les riches tissus de soie d'Almérie, les lions, les autruches et les perroquets d'Afrique firent l'admiration de la cour impériale. L'empereur reçut les députés avec bonté. Loin de leur faire aucune injonction, il évita d'entrer en discussion sur ses droits, il leur témoigna son estime pour leur ville; enfin, dit l'ambassadeur historien, il leur confia ses projets les plus secrets.
La suite nous fait connaître et la nature de ces projets et les motifs de tant de ménagements. Frédéric convoitait les Deux-Siciles. Il n'avait point de flotte; il fallait s'aider des Génois ou des Pisans, et de tous deux s'il était possible. Les ouvertures qu'il fit aux envoyés de Gênes sont ces secrets mystérieusement rapportés aux consuls, et que ces magistrats transmirent à leurs successeurs en les dérobant au peuple. Le véritable usage qui en fut fait à Gênes paraît avoir été de les dévoiler au roi normand de Sicile, pour tirer parti de ses craintes afin d'obtenir de lui le traité avantageux dont nous avons déjà parlé. La négociation en fut probablement ouverte dès lors; elle fut terminée quand, peu après, Gênes, se voyant plus menacée par Frédéric, s'engagea plus avant dans la cause des papes.
(1155) Milan fut la première ville qui brava la colère de Frédéric. Ensuite Tortone, qui avait embrassé la cause des Milanais, fut la victime de cette alliance. L'empereur l'assiégea, et, après de longs combats, il s'en rendit maître, la ruina de fond en comble et en chassa les habitants. Dans cette expédition il avait appelé tous ceux qui lui devaient obéissance. Les Génois ne se pressèrent pas de marcher, malgré les menaces portées contre les réfractaires. Des voisins, qui avaient fait leur soumission, et qui devenaient jaloux de les voir s'en dispenser, les pressaient avec une amitié affectée de ne pas exciter la colère de l'empereur qui avait déjà manifesté son déplaisir. Mais les moyens dilatoires n'étaient pas encore épuisés, et ceux-là ont été de tout temps agréables, souvent utiles, à un peuple accoutumé à marchander en toute chose. Ses consuls furent mandés: l'un d'eux, accompagné d'autres envoyés, se rendit aux ordres de Frédéric; mais cette entrevue fut encore pacifique. La discussion des droits et des devoirs s'ajourna d'elle-même: en renvoyant les députés, il les assura de l'intention où il était d'honorer Gênes au-dessus de toutes les villes d'Italie. Tout le pays se divisait en deux alliances, pour ou contre lui; ou voit qu'il voulait attirer les Génois dans la sienne. D'ailleurs le temps lui eût manqué pour les réduire par la voie de la rigueur. Il n'ignorait pas que les consuls avaient fait des préparatifs de défense. On commençait à élever des murailles. Tous les hommes de la ville et de son district, en état de servir, étaient requis, en vertu de leur serment de citoyens, de se tenir prêts à s'armer. On avait déjà envoyé quelques forces dans les châteaux placés entre Gênes et Tortone.
Frédéric, reçu par le pape, fut couronné à Rome avec cette circonstance singulière, que les Romains ne voulurent pas lui ouvrir leurs portes. Il fallut en occuper une par surprise dans un quartier éloigné, barricader les issues qui communiquaient avec le reste de la ville, brusquer la cérémonie d'un couronnement furtif, et se hâter de regagner la campagne, tandis que le peuple furieux forçait les barrières: étrange solennité par laquelle était conféré le titre fastueux d'empereur des Romains. Poursuivi en se retirant, Frédéric s'éloigna; les combats, les maladies, la lassitude et la désertion des vassaux qui l'avaient accompagné, l'obligèrent à prendre le chemin du retour; il le marqua par des ravages. Mais, parvenu devant Ancône, il cessa d'avoir une armée. Ce ne fut pas sans danger qu'avec une simple escorte il put sortir de l'Italie et regagner l'Allemagne.
(1156) Ce départ, après un an de séjour et de domination violente, était un événement considérable pour tout le monde. Les faibles respirèrent, les opprimés levèrent la tête; les Milanais rebâtirent Tortone et attaquèrent ceux de leurs voisins qui s'étaient donnés à Frédéric. Ce fut le premier signal du nouveau caractère que prirent les rivalités italiennes, et l'époque de la séparation de ce pays en deux partis permanents et irréconciliables, les fauteurs et les adversaires de l'autorité impériale, animosité qui, après avoir opposé ville à ville, porta bientôt la division de famille à famille dans une même cité.
Les Génois n'étaient entrés dans aucune alliance, ni contre l'empereur ni pour lui. Ils se tenaient encore séparés de la politique lombarde: leur indépendance était leur unique pensée; et s'ils s'étaient vus assurés de la sauver, ils auraient accordé peu d'intérêt à la cause de la liberté du reste de l'Italie. Echappant d'abord à la nécessité d'aider Frédéric dans ses projets contre la Sicile et la Pouille, ils gagnaient à l'événement de ne pas se commettre avec Guillaume, roi de ces pays. Le commerce considérable qu'ils y exerçaient avait été récemment assuré par le traité qu'ils venaient d'obtenir de lui. Mais aussi Frédéric, n'ayant plus besoin d'eux, allait avoir ce motif de moins pour les ménager, et cet empereur redoutable menaçait de repasser les Alpes. La république ne regarda la paix où elle se voyait que comme une trêve dont elle devait profiter pour se mettre en état de défense. (1158) En effet, l'empereur revint dans cette Italie qu'il avait appris à regarder comme un digne objet de son ambition. Sa querelle avec Milan recommença aussitôt. Après des succès divers et de grands efforts des deux côtés, les Milanais affaiblis furent obligés de se rendre. Enflé de ses succès qui intimidaient toutes les cités, Frédéric alla tenir son parlement solennel à Roncaglia. Tous ses vassaux et dépendants y comparurent: il y dicta ses lois: les jurisconsultes impériaux les rédigèrent dans le plus impudent système de despotisme absolu, et l'assemblée y donna un consentement servile. Là, il fut décidé qu'en présence de l'empereur cesse toute dignité, toute magistrature; que tout pouvoir indépendant, toute liberté publique sont nécessairement des usurpations sur l'autorité du souverain; qu'à lui seul appartenaient les duchés, les comtés, les magistratures; à lui seul le droit d'imposer des tributs, tous les droits des monnaies, des ports, des douanes, des péages, des moutures; tout profit dérivant des rivières; enfin, non-seulement le cens sur le revenu des terres des particuliers, mais encore sur leurs têtes. Dans les campagnes, excepté les boeufs du labourage et la semence des terres, il n'est rien que les armées de l'empereur ne puissent prendre à leur bienséance, à concurrence de leurs besoins. C'est la ce que les évêques, les grands, les députés des villes s'empressèrent de reconnaître d'une seule voix, en résignant leurs titres et leurs privilèges. Mais le droit une fois constaté, et tous ces biens recensés sur les registres du fisc, l'empereur fut si généreux qu'à tous ceux qui eurent des titres bien réguliers, il daigna rendre leurs propriétés; celles qui ne furent pas remises gratuitement assurèrent à l'épargne impériale un gros revenu annuel, dont le latin classique des chroniques fait une somme de plus de trente mille talents.
L'empereur se réserva de nommer, à l'avenir, les consuls et les podestats des villes, toutefois avec l'assentiment des citoyens. Il défendit les guerres privées entre les cités, et dans leur intérieur entre les habitants. Citant tout le monde à sa cour, il rendit ou fit rendre la justice aux particuliers. C'est à cette occasion qu'il donna un exemple qui servit bientôt, et pour longtemps, de règle générale; le juge assigné à une ville fut nécessairement pris dans une ville différente. Surtout Frédéric se fit justice à lui-même; il infligea arbitrairement des peines et des amendes aux réfractaires, à la contumace et à la négligence.
Les Génois se virent appelés à ce tribunal menaçant, et le temps se trouva venu de défendre ou de perdre cette liberté si chère au peuple. On leur reprochait de n'avoir fourni aucun contingent aux forces impériales pendant le siège de Milan. On les accusait, ainsi que les Pisans, d'avoir contrarié par leurs intrigues le succès des envoyés de l'empereur dans la Sardaigne et dans la Corse, que Frédéric regardait comme des dépendances de l'empire. Gênes et Pise, qui s'en disputaient la domination, n'avaient eu garde de contribuer à y faire régner un autre maître. Les Génois continuèrent à plaider leur cause de loin, sans comparaître à Roncaglia. On les pressait d'envoyer des otages et des tributs, ils n'envoyèrent que des représentations. Ils rappelaient les services rendus à l'empire pendant plusieurs siècles; la garde des côtes depuis Rome jusqu'à Barcelone leur avait été confiée; ils en avaient repoussé les barbares, et ils en écartaient encore les Sarrasins. A eux était due la sûreté de l'Italie, et cette garde leur coûtait plus de dix mille marcs: n'était-ce pas un tribut suffisant? Et quelle autre contribution pourraient-ils devoir? Ils n'ont de l'empire qu'un territoire sans produit, incapable de les nourrir. Leurs subsistances, leurs ressources ne sont que dans ce commerce qu'ils font au loin et que les étrangers soumettent à d'énormes impôts; et n'est-ce pas une loi des empereurs romains que, si eux seuls lèvent des tributs dans leur empire, ils n'ont rien à prétendre sur ce qui contribue ailleurs? Gênes doit hommage et fidélité à l'empire, et rien de plus.
On voit que dès ces temps-là les Génois ne manquaient ni d'adresse, ni même d'arguties. Ces raisons, que les consuls tâchaient de faire valoir, le peuple les répétait avec un patriotique enthousiasme. Frédéric entreprit de vaincre la résistance d'une cité indocile. Elle lui semblait incapable de tenir contre la moindre attaque. De riches quartiers qui s'étaient établis en dehors de ses anciens murs, et que rien ne couvrait, en faisaient une place sans défense. Il crut n'avoir qu'à s'en approcher avec ses forces. Ce mouvement eut l'effet le plus contraire à son attente. Un soulèvement universel éclata contre ses menaces; tout se mit sérieusement en défense. Une enceinte projetée autour des nouveaux quartiers avait été déjà tracée; tout à coup le mur s'élève et la population entière accourt à l'ouvrage. Le jour, la nuit, hommes et femmes traînent les pierres et le sable. On fit, en une semaine, dit l'annaliste, ce qu'une autre ville n'eût pas fait en un an. Là où le temps manque pour exhausser le rempart, on construit des palissades et des redoutes avec les bois et les mâtures des navires. En quelques jours la ville a des défenses à l'abri d'un coup de main. Les consuls, qui savent par où pourrait faiblir la résistance du peuple s'il se voyait aux prises avec des troupes exercées, soldent des archers et des arbalétriers, les placent au dedans, au dehors, et sur tous les points de la montagne.
A cette démonstration courageuse, l'empereur s'arrête et se modère enfin. Parvenu au château du Bosco, il ne passe pas au delà, il demande une ambassade des Génois, promettant de leur prêter une oreille indulgente. L'un des consuls et quelques sages, au nombre desquels est encore le vieux Caffaro, se présentent sur cet appel et sont favorablement reçus. La crise se termine par un accord, ou, si l'on veut, par une trêve, car un terme jusqu'à la fête de saint Jean y est exprimé. La construction tumultuaire des murs de Gênes doit cesser. Un serment de fidélité sera prêté par quarante notables entre les mains des délégués impériaux, qui viendront le recevoir dans le palais de la république: mais les devoirs de cette fidélité ne comprendront ni l'obligation d'aucun service militaire, ni le payement d'aucune contribution. Les Génois s'engagent seulement à payer les anciens droits régaliens, sur la fixation desquels ils s'en remettent à la propre conscience de l'empereur. Les droits nouveaux que la diète avait reconnus, il en laisse la jouissance à la république. L'empereur leur promet de ne point admettre de réclamation au sujet de leurs possessions justement ou injustement tenues. Il ne se réserve contre eux que de faire justice s'ils dépouillaient les voyageurs. En terminant cet accord, les Génois payèrent au fisc impérial mille marcs à titre de don gratuit, disent-ils, à titre d'amende selon leurs ennemis. Un présent si médiocre fait conjecturer qu'au milieu de ses magnificences l'empereur n'était pas riche en argent comptant. Pour Gênes ce sacrifice était peu considérable, s'il est vrai que dans le même temps la seule nourriture des hommes armés qu'on employait à la défense coûtait à la république cent marcs d'argent tous les jours.
L'historien de Frédéric attribue à une inspiration céleste cette terreur salutaire qui disposa le coeur des Génois à la soumission et qui permit une paix également désirable pour les deux parties, qui surtout arrêta le mauvais exemple donné à l'insubordination des autres villes. Car la difficulté des abords à travers ces montagnes, la force de la position, et la grandeur des préparatifs de défense rendaient, dit-il, l'entreprise de forcer Gênes aussi périlleuse que pénible, quoique la magnanimité de César ne calculât pas ces obstacles et s'assurât de les vaincre. On peut estimer sur ces réflexions l'importance de la république dans l'opinion, la crainte même qu'elle inspirait au plus puissant souverain du temps.
Quelques tribulations nouvelles n'en suivirent pas moins cette paix. Les délégués impériaux allèrent exiger le serment à Savone, et dans tout le Comté: c'est ainsi qu'on nommait le pays jusqu'au Var. Les Génois le réputaient compris dans ces possessions justes ou injustes que Frédéric avait naguère confirmées. Ils regardaient comme leurs vassaux les châtelains établis sur ce territoire. Nous avons vu le seigneur de Vintimille prendre l'investiture à Gênes: sa ville même était liée aux Génois par un engagement plus ancien. Quand ils l'avaient conquise, ils y avaient élevé un château, et dans le serment de fidélité prêté par tous les habitants de la ville au-dessus de quatorze ans, avait été stipulée la promesse de maintenir cette citadelle sans l'attaquer et sans en souffrir aucune attaque, ou du moins en présence et avec la connivence des délégués de Frédéric. Les Génois, touchés de cet affront, en portèrent plainte. Ce château, disaient-ils, ils l'avaient élevé sur l'invitation de l'empereur Conrad, quand, recevant de toute part des réclamations contre Vintimille, il avait ordonné aux Génois de purger ce repaire de pirates et de brigands.
Aucune satisfaction ne fut donnée. La république n'ignorait pas que si Frédéric s'était contenté de quelques soumissions sous l'apparence desquelles il avait laissé indécis la question de l'indépendance, il était loin d'être favorablement disposé. Il poursuivait le cours de ses prétentions despotiques et de ses vengeances sur les cités qui ne portaient pas son joug. Il brûlait Crème: sur l'autorité de ses décrets de Roncaglia (1159), il regardait comme annulée les concessions qu'il avait faites aux Milanais, et rallumait la guerre contre Milan; il rompait avec le pape Adrien; à la mort de ce pontife, il suscitait le schisme en opposant un compétiteur à Alexandre III. Ce pape, dès les premiers jours de la querelle, avait intéressé à sa cause, par les lettres les plus suppliantes, les Génois enfants si dévots de l'Eglise. Tout enfin les avertissait de ne pas compter sur l'amitié de Frédéric.
C'est alors qu'ils reprirent le travail de leurs fortifications1 et qu'ils le poursuivirent sans relâche avec une unanimité et une constance toute patriotique. Nous ne craindrons pas de nous arrêter sur ce détail; il est honorable pour un peuple amant de sa liberté, et il porte avec lui la mesure des progrès et des ressources d'une ville intéressante.
En soixante ans de prospérité les habitations, franchissant l'ancienne enceinte, s'étaient étendues au nord et au couchant sur les collines et le long du rivage de la mer2.
La nouvelle muraille embrassa ces augmentations. On y mit un tel zèle, que, suivant les annales, en cinquante-trois jours on en construisit près des quatre cinquièmes. Toute la population se fit honneur d'y travailler avec le même zèle qu'au temps des menaces instantes de Frédéric. Les villages voisins y concoururent. Les maçons de profession et les indigents étaient seuls payés. Les habitants des divers quartiers de la ville se relevaient chaque jour, et les sections d'un même quartier se partageaient le travail. Le consulat qui éleva les tours y dépensa trois cents livres d'argent et paya neuf cents livres pour les dettes que ses prédécesseurs avaient contractées, outre cent livres pour retirer le château de Voltaggio des mains des capitalistes de qui l'on avait emprunté sur ce gage. J'aime à noter ces résultats du budget d'une république du douzième siècle. L'année suivante on construisit les murailles de Porto-Venere, de Voltaggio et de plusieurs autres positions au nord et à l'est. Ainsi se suivait le système de mettre les approches de Gênes et le territoire en état respectable de défense.
(1162) La guerre rallumée par l'empereur contre les Milanais, et le siège de leur ville, durèrent trois ans. Enfin ils se rendirent. Frédéric battit leurs murailles et jusqu'à leurs habitations. Il voulut que la cité rebelle perdit son existence et son nom (1162): vengeances farouches d'un despote, que nous avons vues imitées par un gouvernement de terreur, soi-disant républicain. Les populations ennemies du voisinage furent chargées de l'exécution de cet odieux décret.
Les Génois avaient suivi leur système; ils s'étaient tenus à l'écart, se gardant d'attirer le courroux de l'empereur, mais se dispensant de lui envoyer des soldats. Quoiqu'un long siège, si voisin de leurs frontières, ne pût manquer de les préoccuper, leurs annales gardent un silence prudent sur cette grande lutte et ne le rompent qu'au dénoûment. L'illustre historien des républiques italiennes fait justement remarquer comme une preuve de la terreur que l'événement inspirait, qu'alors le style et les expressions changent. Barberousse est le magnanime, l'invincible César, qui fait courber toutes les têtes sous le joug de son glorieux triomphe. On peut ajouter que l'adulation ne manque ni pour les courtisans ni pour les ministres de ce maître redoutable. Ceux avec qui les Génois sont forcés de traiter sont doués des qualités les plus hautes. L'archevêque de Cologne, archichancelier du royaume d'Italie, laisse partout après lui la trace de la renommée d'un autre Cicéron. Il n'est pas jusqu'au chapelain de cet archevêque, délégué subalterne, qui, dans le langage barbare de l'écrivain, ne soit orné de toute virtuosité. Mais au milieu de ces éloges paraissent contre ces vertueux personnages les reproches de corruption et de partialité vénale. Malgré les protestations les plus soumises, Gênes haïssait et craignait l'empereur: on y reconnaissait le pape qu'il rejetait (1161), Alexandre, persécuté à Rome, trouvait chez les Génois la réception la plus solennelle et l'hospitalité la plus filiale. On prodigua avec joie et avec amour, pour lui des subsides magnifiques, pour ses cardinaux et ses prélats des secours considérables. Pour faire éclater sa gratitude, le pape prodigua les bienfaits spirituels à l'église de Gênes; on peut être certain que ce n'était pas à des sujets sincèrement dévoués à Barberousse que le pape accordait ses largesses apostoliques.
(1162) Le conquérant jouit à Pavie de son triomphe sur les Milanais, et parmi ceux qui vinrent humblement le féliciter d'un événement qui leur était fâcheux, étaient les envoyés de Gênes. Il les mandait, et, cette fois, ils se gardèrent de se faire attendre. Cette ambassade fut confiée aux hommes les plus accrédités de la république. Deux des consuls la présidaient; et, sur neuf personnages, on y voit un Spinola, un Grimaldi, un Doria, un Vento, un Volta. Cette députation fut reçue avec assez de faveur. Frédéric se voyant maître absolu en Lombardie, reprenait le dessein de conquérir le royaume de Sicile. Il demanda aux Génois de le servir: ceux-ci protestèrent qu'ils étaient toujours prêts à l'obéissance; mais ils représentaient avec humilité, que, contribuant plus qu'aucune autre ville d'Italie, par leur soin, à la défense des côtes de l'empire, il serait juste de leur assigner une indemnité pour un service extraordinaire. Cette insinuation ne déplut pas. Frédéric renvoya les députés en les chargeant de lettres adressées en son nom aux consuls et à tout le peuple. Il y exprimait ses dispositions favorables pour Gênes. Il voulait qu'une réponse positive sur ses demandes lui fût apportée dans huit jours, pour tout délai, par de nouveaux envoyés. Cette seconde députation fut renforcée du chancelier de la commune, jurisconsulte expert que l'on supposait propre à discuter le droit avec les commissaires impériaux. Après une négociation assez longue, le traité fut conclu. Les Génois s'obligèrent à mettre aux ordres de l'empereur, dans le délai d'un an, une flotte qui agirait contre la Sicile. Au moyen de cet engagement il les dispensait de le suivre à la guerre contre tout autre ennemi que les Siciliens ou les Provençaux. Pour indemnité de leur armement, il leur donnait d'avance sur les conquêtes qu'ils aideraient à faire, la ville de Syracuse et deux cent cinquante fiefs de chevaliers dans le Val di nota: il leur concédait des privilèges de commerce, même exclusifs au préjudice des Vénitiens alors réfractaires. Il ne devait faire avec le roi de Sicile aucun traité sans leur concours. Toutes les possessions de Gênes étaient confirmées. A la guerre, c'est sous la bannière de leur commune que devaient marcher toutes les milices de Porto-Venere à Vintimille, sans préjudice toutefois de la juridiction des comtes et des marquis, et de la fidélité des feudataires impériaux. Enfin Barberousse laissait à Gênes le libre choix de ses consuls. Une bulle d'or, remise aux ambassadeurs, convertit ce traité en concession solennelle.
CHAPITRE II.
Guerre pisane. - Barisone.
(1162) Au moment où la république se voyait délivrée de ce que sa situation avait de menaçant, un incident malheureux la fit rentrer en guerre avec Pise. L'état de paix entre les deux républiques était fondé sur une convention qui excluait toute hostilité non-seulement sur leur territoire, mais sur la mer et en tout lieu, excepté en Sardaigne. Là même, le négoce, les relations et les propriétés respectives étaient exploités sans user du droit d'y vivre en ennemis. Mais quand les bienfaits du commerce, au lieu d'être accessibles à tous, sont une sorte de secret et de monopole, il est impossible que la jalousie ne règne pas entre les commerçants qui y prennent part. Les nations qui vivaient en paix sont ainsi entraînées à des guerres funestes par leurs colonies, ou par leurs facteurs dans les pays étrangers.
Gênes et Pise avaient des établissements rivaux à Constantinople. Une rixe y devint une guerre nationale. Les Pisans s'y trouvant fortuitement en plus grand nombre, assaillirent leurs ennemis. Trois cents Génois, dît-on, se défendirent un jour entier contre mille adversaires. A la nuit ceux-ci proposèrent de cesser le combat; mais les Génois, endormis par cet accord, furent surpris au point du jour suivant. Ils ne purent résister davantage; ils se sauvèrent sur leurs bâtiments, abandonnant leurs magasins et leurs effets dont les Pisans firent leur proie. Quelques victimes périrent dans le combat, et parmi elles, le fils d'Othon Rossi, personnage considérable à Gênes. La ville apprit ces tristes nouvelles par l'arrivée des vaisseaux qui rapportaient les fugitifs. Aussitôt on se soulève. Douze galères de particuliers sont à l'instant armées et vont mettre à la voile pour courir à la vengeance sur les Pisans, sans vouloir même attendre que le consulat en donne l'ordre; mais les magistrats arrêtèrent ce transport. Les usages de la guerre et du droit des gens devaient être accomplis. Un messager, solennellement expédié à Pise, y porta des lettres de défiance. La teneur de cet acte diplomatique nous a été conservée: je la rapporterai.
«Vous nous provoquez dès longtemps; vous avez troublé notre paix sur tous les rivages du monde. Nous n'avons eu de sécurité nulle part où vous vous êtes sentis en force, et c'est trop peu pour vous si vous n'y ajoutez d'horribles massacres, l'assassinat non d'obscures victimes, mais de nos nobles, un pillage odieux, et encore ces imprécations furibondes par lesquelles vous nous insultez en ennemis perfides. Nous ne supporterons pas plus longtemps l'usurpation de cette Sardaigne que Gênes seule a délivrée du joug des Sarrasins, ni l'enlèvement de nos titres que vous retenez par une violence inouïe. Nous abrogeons les traités d'une paix si mal observée. Libres des liens d'une trêve rompue, nous vous portons, dans notre bon droit, un défi solennel.»
On voit ici dans un acte politique la qualification de noble attribuée aux victimes comme une circonstance qui aggrave le meurtre. On y voit aussi réveillée la querelle sur la Sardaigne. On ignore si le reproche des titres enlevés et injustement retenus se rapporte à autre chose qu'à la spoliation des magasins de Constantinople.
Le messager revenu sans réponse, les galères sortirent, et les hostilités prirent cours. On entra d'abord dans l'Arno, pour insulter le port de Pise. D'autres galères allèrent chercher les ennemis dans les eaux de la Sardaigne et de la Corse. Othon Rossi, le père du jeune homme tué à Constantinople, était de cette expédition; il vengea cruellement son fils sur les prisonniers qui tombèrent entre ses mains.
Dans une rencontre, douze galères génoises se trouvèrent en présence de trente-six galères de Pise. La difficulté n'était pas d'échapper au péril, mais il en coûtait de reculer devant des rivaux. Les Génois s'avisèrent de proposer à leurs adversaires de combattre douze contre douze, et s'irritèrent d'être moqués par un ennemi peu disposé à se départir de son avantage. Il fallut donc se retirer avant de se voir enveloppés. Sur ce récit, les consuls assemblent les citoyens en parlement public; ils proposent l'armement général, et le peuple entier répond: Fiat. Cependant, sur le bruit de ce renouvellement des voies de fait, l'archichancelier accourt pour les interdire. Il ordonne que huit députés de chaque ville comparaissent promptement à Turin devant l'empereur. On s'y rendit: les parties se préparaient à traiter leur cause; mais Frédéric, toujours prêt à mander, ne l'était pas à entendre: il imposa silence en déclarant qu'il était pressé de retourner en Allemagne; il ordonna que les parties jurassent d'observer la trêve jusqu'à son retour.
(1164) L'empereur revint en Italie quelque temps après, et le procès qu'il devait juger se compliqua d'un incident assez curieux. On vint lui demander, au nom de Barisone, juge d'Arborea, le titre de roi et l'investiture de la Sardaigne entière, moyennant un prix raisonnable, argent comptant. Les quatre provinces de cette île étaient tenues par autant de gouverneurs qui, en conservant leur titre antique de juges, en étaient devenus princes héréditaires. Les Pisans, qui les avaient constitués dès le temps où avec les Génois ils avaient chassé les Mores, affectaient chez eux de regarder ces juges comme leurs vassaux: en Sardaigne, ils se contentaient de cultiver leur alliance. Les Génois la briguaient afin de regagner par leur appui la prépondérance dans l'île où il leur restait quelques possessions.
Barisone était loin d'être le plus puissant des quatre juges, et l'événement prouva que ses forces ne répondaient pas à son ambition et à son orgueil. Mais Frédéric, flatté d'être reconnu pour suzerain, et charmé de tirer quelque argent d'une domination qu'il n'aurait pas été capable de rendre plus lucrative, ne fit aucune difficulté d'accorder la demande: le traité s'accomplit. Barisone s'engagea à payer à Frédéric quatre mille marcs d'argent1. Des délégués impériaux le conduisirent d'abord d'Arborea à Gênes où son entreprise était favorisée. L'empereur l'appela à Pavie: il manda à sa suite les consuls génois, qui obéirent, non sans quelque anxiété; mais la réception fut favorable. Le juge fut roi. Frédéric lui mit sur la tête une couronne que les consuls avaient apportée avec eux.
La cérémonie à peine achevée, le consul de Pise comparut et protesta contre tout ce qui s'était fait. L'empereur avait donné ce qui ne lui appartenait pas, ce qui appartenait aux Pisans: il avait fait roi un ignoble paysan, vassal de Pise. Le consul de Gênes, élevant la voix, repoussa ces assertions. Ce serait à Gênes et non à Pise de revendiquer la Sardaigne par droit de conquête. César en donne la couronne, non à un homme vulgaire, mais à un seigneur très-noble, riche de possessions immenses, et qui a pour vassaux les nombreux Pisans établis dans l'île, loin qu'il soit le vassal de leur république. Frédéric prononça que ce qu'il avait fait était bien fait, qu'il avait usé de sa pleine puissance et donné ce qui lui appartenait. Les Pisans se retirèrent irrités.
L'empereur demanda ensuite s'il lui restait à accomplir quelque promesse qu'eussent faite ses ambassadeurs. Barisone témoigna sa satisfaction et sa reconnaissance. Maintenant c'était donc à lui de remplir son engagement. Les quatre mille marcs convenus lui furent demandés. Il avoua avec embarras que ce n'était pas à Pavie qu'il avait compté les payer; mais, à peine rendu dans son royaume, il les ferait tenir ponctuellement à son auguste bienfaiteur. Le bouillant Barberousse s'enflammant à cette réponse, s'écria: «Je pars, j'ai le pied à l'étrier, et ne puis attendre. A me remettre ainsi, autant vaut me déclarer que tu ne me payeras jamais. Quand et comment, de l'on île, tes deniers pourraient-ils me parvenir au fond de l'Allemagne? Apprends que ce n'est pas ainsi qu'un roi tient sa parole. Que sont d'ailleurs quatre mille marcs au prix d'une couronne acquise et de ses profits? Tu dois avoir reçu au delà de cette somme de ceux à qui tu as destiné les nouvelles dignités de ta cour. Ni paroles ni délais, il faut payer sa dette.»
Barisone désolé n'obtint que le temps de recourir à ses amis. Il n'avait de ressource que dans l'assistance de Gênes, il l'employa; la somme était forte, le recouvrement peu certain, à en juger par l'impuissance dans laquelle le roi se trouvait dès les premiers pas, et déjà ses préparatifs et les équipages assortis à son nouveau rang avaient constitué la république en avances qu'elle répugnait à grossir. Mais si la royauté de Barisone était caduque, Gênes perdait avec ses premiers frais tout le fruit de sa politique. On avait connivé à la vanité de ce petit prince dans la vue de se faire de lui une puissante créature en Sardaigne; la dérision et le mépris allaient tomber du protégé sur les protecteurs. L'intérêt et l'amour-propre étaient blessés; l'amour-propre national dicta la réponse.
On retourna donc à Barberousse, et, marchandant d'abord, on essaya de faire accorder de longs délais sous la caution des Génois. L'impatient empereur jura que s'il n'était payé à l'instant, il enlèverait Barisone et le conduirait en Allemagne. Les consuls génois furent forcés de prendre des arrangements plus effectifs. L'empereur fut payé; Barisone, libéré envers un créancier, resta entre les mains d'un autre, moins violent que le premier, mais non moins attentif à ses sûretés. Le roi dut promettre de fournir des garanties en arrivant à Gênes.
Mais là, il n'avait pas plus qu'à Pavie les moyens de s'acquitter. Toutes ses ressources étaient en Sardaigne. Les consuls s'en convainquirent avec d'autant plus de regret que pour le secourir il avait fallu mettre les propriétés de la république en gage entre les mains des citoyens les plus riches. On sentit douloureusement surtout la nécessité d'ajouter de nouveaux deniers à ceux qu'on avait fournis. Barisone, en présence des Pisans, ne pouvait passer dans son royaume sans forces et sans appareil. Il demandait un nouveau prêt pour armer sept galères et trois grands vaisseaux, pour solder des troupes, des archers. Pendant ces préparatifs il vivait à Gênes avec un faste royal. Il montrait gratitude et magnificence. Il souscrivait un acte authentique qui accordait aux Génois les privilèges les plus étendus, les plus exclusifs, dans toute la Sardaigne. Il prodiguait les investitures de ses terres aux citoyens les plus distingués, et probablement à ceux qui lui prêtaient de l'argent, car, en tout, il se trouva devoir jusqu'à vingt-quatre mille livres, tant à la commune qu'aux particuliers. Ainsi un petit prince riche se vit tout à coup devenu un roi pauvre et nécessiteux, destiné à vivre prisonnier pour dettes, soit sur le territoire des étrangers, soit sur leurs vaisseaux.
Picamilia, l'un des consuls, assisté de prudents et vigilants personnages, monta sur la flotte préparée afin d'amener le nouveau roi dans sa capitale d'Arborea avec l'honneur dû à sa couronne; mais les instructions portèrent de ne pas souffrir son débarquement que le payement de sa dette ne fût effectué et l'argent mis en sûreté à bord des galères.
On arriva devant Arborea. Le roi assura que le payement allait être fait, et il fit passer à terre ses ordres portés par des envoyés génois. Ils revinrent annoncer qu'il ne leur avait pas même été permis de débarquer. Les officiers du roi, sa femme même, avaient signifié qu'on ne payerait rien avant que Barisone leur eût été librement rendu. Il offrit de faire cesser ce malentendu sur-le-champ; il lui suffisait d'aller à terre. Mais les Génois n'étaient pas disposés à le laisser sur sa bonne foi; pendant cette négociation ils demandaient au roi de faire du moins apporter des vivres sur les vaisseaux, puisque le retard qu'on mettait à remplir ses engagements prolongeait le séjour à la mer. Le roi promettait chaque jour; mais les approvisionnements n'arrivaient pas. La saison devenait mauvaise. Picamilia craignit qu'on ne lui dérobât la personne qui lui était confiée en gage, et, se défiant de Barisone, des Sardes, des Pisans et d'une surprise, il remit à la voile pour Gênes, et y ramena le royal débiteur. Là il fut consigné à quelques nobles qui en répondirent. La république leur assigna une pension pour son entretien et pour les frais de garde.
(1165) Les Génois et les Pisans étaient intéressés de trop près et trop en contact dans cette affaire pour qu'entre eux la trêve pût subsister, La cargaison d'un vaisseau naufragé retenue par les Pisans avait ému une querelle, et donné occasion de tenir pour la débattre un congrès à Porto- Venere. Les Pisans ne pouvaient se refuser à la restitution: mais ils opposaient qu'il fallait d'abord régler d'autres comptes. Les Génois en bons marchands, qui déjà ne manquaient pas de légistes exercés pour consulteurs, soutenaient qu'il fallait avant tout solder le compte liquide et la dette reconnue. Enfin le consul de Pise éleva la vraie prétention. Gênes, disait-il, a commis la première violence et rompu la trêve en retenant prisonnier Barisone vassal des Pisans. Le consul génois, sans s'arrêter à discuter les qualités, répondit que s'il en était ainsi, et s'ils voulaient que leur vassal fût libre, ils payassent sa dette. Le Pisan sembla prêt à consentir à ce marché. Mais quand, dans le cours des explications, il entendit porter la somme à vingt-huit mille livres, il reprocha à l'avare créancier d'avoir fait recevoir pour argent, des poivres et du coton à des prix doubles et triples de leur valeur véritable, et déclara que sa ville n'était pas assez riche pour se charger d'un tel fardeau. Il offrait seulement d'obliger les sujets de Barisone à reconnaître la dette et à jurer de l'acquitter. Puis il offrait six mille marcs; les Sardes auraient fait le reste. Un incident vint troubler cette singulière négociation marchande.
Un Pisan, exilé de son pays et réfugié à Gênes, s'y était fait corsaire. Sa galère parut tout à coup à Porto-Venere. Le consul génois craignit qu'on ne lui imputât les violences que l'armateur irait commettre au milieu des conférences d'une paix. Il l'astreignit à jurer de s'abstenir de toute voie de fait jusqu'à nouvel ordre, et lui-même il cautionna cette promesse au consul de Pise. Mais celui-ci ne se crut tenu d'aucun ménagement pour châtier un transfuge rebelle. Il fit venir secrètement une galère de sa république, et le corsaire se vit attaqué. Le consul génois accourut dans un canot et fut témoin d'un furieux combat (1166): la galère pisane était abordée par le corsaire. Le consul de Pise qui s'y était rendu se jeta à la mer pour sauver sa vie à la nage. Recueilli par le consul de Gênes, il supplia celui-ci de monter sur le bord, pour arrêter le carnage. Le Génois le crut, et une blessure presque mortelle fut le prix de son dévouement. Cependant, après avoir reproché au magistrat pisan son imprudence et sa perfidie, il le renvoya libre et les autres prisonniers avec lui. Il se contenta d'emmener à Gênes la galère prise.
Peu après les Pisans tentèrent une autre voie. Ils dépêchèrent secrètement des négociateurs en Allemagne, et traitèrent avec l'archevêque de Mayence. Quand Frédéric revint en Italie, ils parurent devant sa cour. Là ils représentaient qu'ils avaient payé au fisc impérial, entre les mains de l'archevêque, treize mille livres, et qu'à ce prix celui-ci leur ayant donné de sa part l'investiture de la Sardaigne, leur avait fait serment qu'il serait ordonné aux Génois de s'abstenir de tout rapport avec cette île. Le Mayençais attesta que telle était la vérité et qu'il avait ainsi juré par ordre de l'empereur. Frédéric reconnut le fait, et, s'adressant aux consuls génois, il leur intima d'abandonner la Sardaigne aux Pisans. Les consuls de Gênes présents étaient Hubert Spinola et Simon Doria, hommes de coeur et habiles. Sans s'intimider, ils répondirent à l'archevêque qu'il avait mal et injustement conseillé l'empereur; à l'empereur qu'il était trop juste pour avoir voulu donner ce qui ne lui appartenait pas; qu'il oubliait sans doute que l'investiture royale avait été solennellement conférée à Barisone; que Gênes avait d'ailleurs des droits supérieurs et incontestables, qu'elle ne saurait en être dépouillée sans jugement, et que si avant qu'il en eût été régulièrement décidé, les parties entendues, les Pisans se prévalaient d'une concession de pure faveur, aucun respect n'empêcherait de les chasser comme usurpateurs du bien d'autrui.
L'empereur, indifférent au fond de la querelle, pourvu qu'il n'eût à rendre ni les treize mille livres ni les quatre mille marcs, convint qu'il avait couronné Barisone, qu'il l'avait fait sans préjudice du droit des Génois, le nouveau roi ayant consenti à cette réserve. En voulant gratifier Pise, il n'avait pas entendu dépouiller les Génois de ce qui serait à eux, et la chose devait être examinée. Alors les parties essayèrent de produire ce qu'elles regardaient comme leurs titres; mais, à ce qu'avançait une partie, l'autre opposait d'abord des dénégations, enfin des démentis: un défi en fut la suite. Frédéric fit apporter l'Evangile et ordonna que deux Pisans et deux Génois jurassent de vider la querelle en un combat singulier, tel qu'il se réservait de l'ordonner. Comme il s'agissait d'en marquer le terme. «Les Pisans et nous, dit Spinola, nous devons marcher ensemble à l'expédition que l'empereur projette; son service ne doit pas souffrir de nos débats. Nous sommes prêts à jurer de ne faire dommage à nos adversaires ni dans leurs personnes ni dans leurs biens pendant la durée de la campagne et un mois après le retour. Qu'ils s'engagent ici envers vous par le même serment; nous leur ferons volontiers présent de mille marcs d'argent, s'ils veulent nous donner cette garantie. Puis, à l'expiration de cette trêve, nous promettons de n'aller importuner personne pour nous plaindre du mal que nous nous laisserions faire par eux.»
Frédéric expédia bientôt à Pise l'archevêque de Mayence, à Gênes celui de Cologne, pour faire cesser les hostilités. Mais les Génois prétendent que l'arbitre qu'on leur envoyait était déjà corrompu par les dons des Pisans, et ils accusent la partialité de l'un et l'autre délégué. Aussi la guerre fut-elle continuée sans égard pour les défenses de l'empereur occupé d'autres soins.
Avant d'en raconter les principaux événements, nous épuiserons ce qui concerne la Sardaigne. Le malheureux Barisone languissait à Gênes, tandis que les juges ses voisins, plus blessés de ce que leur égal avait voulu s'appeler roi, que touchés de sa disgrâce, profitant de son absence, ravageaient ses terres et menaçaient de le dépouiller tout à fait. Après quatre ans (1168) d'une pénible attente dans Gênes, il se présenta aux consuls et au conseil; il les entretint de la nécessité de le laisser reparaître en Sardaigne, si on ne voulait lui faire tout perdre. C'était la seule manière de le mettre en état de payer sa dette, et les Génois devaient sentir que si sa mort leur enlevait leur gage, tout espoir de rien récupérer leur échapperait. Il avait préparé les voies pour parvenir à une extinction certaine de leur créance. A son arrivée en Sardaigne quatre mille livres leur seraient comptées. Une imposition serait mise pour solder la dette, ils la lèveraient par leurs mains. Pour garantie, il leur livrerait ses places, il donnerait en otage, outre un nombre de ses vassaux, sa femme, ses enfants, et lui-même encore, après une courte apparition dans son pays.
Ces raisons étaient palpables. On se décida à tenter cette voie de recouvrement. La commune ne voulut dépenser que l'armement d'une seule galère. Les citoyens qui avaient reçu des investitures de terres en Sardaigne en équipèrent trois autres à leurs frais. Les choses convenues s'exécutèrent de bonne foi; les Génois furent mis en possession de la principale forteresse. La contribution fut établie, ils la perçurent. Le roi, sa famille, les otages qu'il avait promis se rembarquèrent sur la flotte et revinrent habiter Gênes. Après trois années (1171), la dette éteinte, Barisone, escorté par un des consuls, rentra dans sa province, heureux de la retrouver et conservant le vain titre de roi, chèrement payé, sans plus rien prétendre sur le reste de la Sardaigne.
CHAPITRE III.
Suite de la guerre pisane.
La guerre avec les Pisans, que la jalousie irréconciliable des deux républiques commerçantes était propre à perpétuer, convenait peut-être aux intérêts des principaux citoyens (1165). Elle les faisait écouter dans les conseils, les rendait nécessaires aux négociations, leur donnait de l'autorité sur les flottes ou à l'armée. Si elle épuisait le trésor, c'est encore à eux qu'on recourait, et leurs secours intéressés se changeaient en spéculations lucratives, en fructueux emplois de leurs richesses privées. Ils prenaient en nantissement les revenus et jusqu'aux propriétés de l'État; un vif enthousiasme de vanité nationale soutenait les dispositions du peuple, qui d'ailleurs tout dévoué à la navigation, trouvait sa subsistance dans les expéditions où il était appelé. Le commerce n'éprouvait pas un dérangement extrême, parce que quelques flottes ennemies ne suffisaient pas pour interrompre son cours parmi tant d'échelles et de ports de refuge qu'offraient toutes les côtes de la Méditerranée. Chaque bâtiment naviguait armé; on spéculait autant sur la chance de prendre que sur celle d'être pris; on craignait beaucoup moins qu'aujourd'hui la rencontre d'une force supérieure. Il était bien plus facile d'y échapper. Les coups n'atteignaient pas de loin avant l'usage de l'artillerie, et il suffisait d'éviter l'abordage. Enfin les Génois avaient un avantage; s'ils croisaient à l'embouchure de l'Arno, il fallait les combattre pour sortir de Pise ou pour y entrer. L'ennemi ne pouvait de même leur fermer l'entrée de leur port, ni occuper les avenues de leur golfe immense.
Tous les printemps, les Génois envoyaient quelques galères en station à Porto-Venere. De là s'ils n'empêchaient pas la sortie des grandes flottes, ils donnaient la chasse aux bâtiments isolés qui fréquentaient le port de Pise. Une autre partie des galères allait croiser autour de la Corse et de la Sardaigne. On courait jusque sur les côtes d'Afrique pour enlever les vaisseaux qui allaient y trafiquer. Mais la région les plus fréquentées par le commerce des deux peuples, c'étaient les rivages de la Provence et du Languedoc. Sur ce point se dirigeaient souvent les forces des parties belligérantes pour y protéger leur négoce ou pour y détruire leur ennemi. Les galères convoyaient les marchands aux foires de Fréjus et de Saint-Raphaël, et tâchaient d'en intercepter à leurs concurrents les abords ou le retour. De tous côtés on se faisait des créatures dans ces pays pour obtenir des informations sur la marche des adversaires ou pour faire parvenir à propos de faux avis qui donnaient le change aux croiseurs quand il y avait de riches proies à leur dérober.
Les armements qui se rendaient tous les ans aux bouches du Rhône ne cherchaient pas seulement des marchands à dépouiller. C'était une vraie guerre navale, il s'agissait pour les flottes de se détruire; et, comme elles se poursuivaient en remontant le fleuve, les riverains ne pouvaient rester spectateurs désintéressés de la lutte. Ceux de Saint-Gilles étaient alors favorables aux Pisans: ceux-ci avaient huit galères dans ces parages; Gênes en expédia quatorze sous la conduite d'Améric Grillo, un de ses consuls. Informé que les ennemis étaient à Saint-Gilles, il conduisit sa flotte dans le Rhône pour essayer de les joindre. Les magistrats d'Arles, incertains de ses intentions, vinrent lui demander s'il était ami ou ennemi: il les rassura et passa outre. Mais, vers Saint-Gilles, les habitants lui affirmèrent que les galères pisanes n'étaient pas de leur côté, et, grâce à ce mensonge, tandis qu'il rétrogradait, on ménageait leur sortie furtive par une autre issue du fleuve. Désespérant de trouver l'ennemi, Grillo revint à Gênes. Comme il y arrivait, on apprit qu'une nouvelle flotte pisane s'était présentée sur la côte de Ligurie, avait pris, saccagé et incendié la ville d'Albenga. De là elle avait continué sa route vers la Provence. Gênes ressentit cet événement comme un sanglant outrage. En quatre jours trente-cinq galères furent à la voile. Grillo y remonta et courut au Rhône. Les Pisans étaient à Saint-Gilles. Les Génois entrèrent dans le fleuve, appelant leurs ennemis à grands cris, et suivant leur route sans consulter ni écouter personne. Telle était leur furie qu'arrivée de nuit entre Fourques et Saint-Gilles, la flotte s'embarrassa dans le petit bras du Rhône, où l'eau manqua sous les galères; elles se poussaient et s'échouaient l'une sur l'autre; elles brisèrent leurs rames, leurs apparaux, et ne purent se remettre à flot sans perte de temps et sans dommage.
Au jour, les consuls et les notables de Saint-Gilles se présentèrent: ils demandèrent à Grillo de s'abstenir de toute hostilité. Ils se chargeaient d'obliger les Pisans à n'en commettre aucune. Ils répondaient de la sûreté des Génois comme il avait répondu de celle des adversaires. Grillo leur reprocha le traitement peu amical qu'il avait reçu d'eux au précédent voyage; mais puisqu'ils étaient neutres, ils ne devaient pas refuser de lui vendre les vivres dont ils avaient besoin. Ils s'en excusèrent; les Pisans étaient arrivés chez eux les premiers; ils leurs devaient pleine hospitalité et ne pouvaient justement donner aucune aide à ceux qui venaient contre eux. Ils écoutèrent encore moins la demande de Grillo qui les sollicitait de congédier les Pisans. Ils lui déclarèrent qu'ils les assisteraient envers et contre tous; et en ce moment une grande foire réunissant à Saint-Gilles beaucoup d'habitants des contrées voisines qui, tous, paraissaient disposés à prêter la main contre les Génois, ceux-ci n'eurent qu'un parti à tenter; ils députèrent quelques- uns d'entre eux à Beaucaire, auprès de Raymond, comte de Toulouse et de Saint-Gilles, pour lui porter plainte contre la partialité de ses gens. Ils rappelèrent au comte l'amitié que son père, à la terre sainte, et lui-même, avaient toujours témoignée à Gênes; des propositions d'alliance et des offres d'argent appuyèrent ces souvenirs. Un traité fut promptement conclu; moyennant une promesse de mille trois cents marcs d'argent, le comte devait, à son choix, ou joindre ses armes à celles des Génois, ou les laisser attaquer les Pisans en toute liberté, ou enfin accorder le champ libre pour que la querelle fût régulièrement vidée entre les deux parties. Il avait à peine donné sa parole que l'abbé de Saint-Gilles vint interrompre la conférence et tenir avec le comte un colloque secret. Cependant, à l'heure convenue pour recevoir le serment des Génois choisis pour lui être garants de la somme promise» il fît procéder à leur appel. Soixante et dix avaient déjà répondu et juré, quand de nouveaux messagers arrivèrent. Après les avoir entendus, Raymond déclara que le traité ne serait pas maintenu. On apprit que l'abbé et ses religieux avaient consenti à prendre sur leur conscience, à la décharge de celle du comte, le péché du parjure. Raymond s'était mis à la solde des Pisans pour un salaire supérieur à celui qu'il avait accepté de Grillo. Il fallut donc que les Génois renonçassent à l'espérance de brûler la flotte pisane ou de la combattre. Ils se contentèrent de séjourner deux jours pour braver tous les ennemis. Personne ne vint les assaillir. Ils payèrent largement les secours que les habitants d'un lieu voisin (les Baux) leur avaient prêtés. Ensuite ils redescendirent le Rhône. A leur grande surprise, il était barricadé devant Arles. Ils se préparaient à s'ouvrir la voie par force, mais le comte de Provence accourut pour leur donner les explications les plus amicales; l'obstacle avait été élevé en son absence et sans son aveu; il en ordonnait la destruction, et la ville d'Arles prêterait toute assistance au consul. Les galères séjournèrent quelques semaines autour de cette ville. Grillo tenta d'y conclure une alliance offensive contre les Pisans; mais le comte de Provence était engagé en trop de rapports avec le comte de Toulouse pour porter la guerre sur le territoire de ce voisin. Il promit seulement de n'admettre aucun vaisseau pisan dans ses ports pendant un espace de temps déterminé. Il reçut quatre mille livres de sa monnaie de Melgueil pour cette promesse et pour les services qu'il avait rendus.