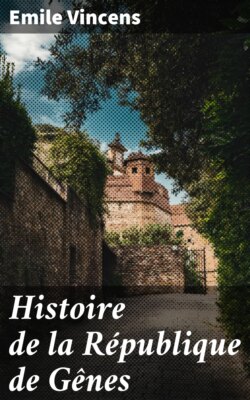Читать книгу Histoire de la République de Gênes - Emile Vincens - Страница 8
ОглавлениеLes populations du territoire que Gênes considérait comme son État ne donnaient pas moins d'inquiétude que les troubles internes. Nous ne savons si c'est aussi la querelle générale des deux grands partis de l'Italie qui les agitait; mais à cette époque oh vit de moment en moment et tour à tour les bourgs de la Ligurie soulevés (1198), en état de résistance et de guerre (1199). Chaque podestat pendant son exercice se trouve obligé de marcher contre ces réfractaires (1204). La manière de procéder, en ce cas, est de dévaster le pays, de couper les arbres, de ruiner les habitations autour des lieux qu'on ne peut entièrement soumettre. Là où l'on pénètre on lève des contributions, on prend des otages, et l'on impose des amendes. En un mot, Gênes est la plus forte, mais elle s'entoure de voisins de plus en plus ennemis, et si elle les compte pour des sujets, elle ne peut ignorer combien leur foi est douteuse. Ceux que les poursuites ou les menaces font sortir de leurs foyers se font pirates sur la côte et troublent le commerce. Il faut prendre soin de les détruire, et la république n'y réussit pas toujours. Bientôt les émigrés de la ville même firent en grand cette guerre de corsaires.
Dans les expéditions du podestat, outre les gardes, serviteurs ou clients qu'il s'était attachés, il faisait marcher comme fantassins les hommes en état de porter les armes tant de la ville que de la banlieue. Mais surtout les chevaliers de Gênes se rangeaient à sa suite. C'est ici qu'on en parle pour la première fois. Jadis on requérait ou l'on invitait à grands frais les seigneurs châtelains, vassaux ou amis de la république. Mais l'économie et la méfiance tout à la fois avaient conseillé d'avoir dans Gênes même le moyen de suppléer ce secours étranger. On avait formé un corps de plus de cent chevaliers parmi les jeunes gens le plus en état de s'adonner à l'exercice militaire et les moins engagés dans d'autres carrières, afin qu'ils fussent prêts à marcher à toute heure. A cette époque où combattre à cheval était, chez les autres nations, le privilège et la marque de la noblesse, nous pensons que l'institution des chevaliers de Gênes fut ce qu'elle était ailleurs. L'annaliste, pour en relever l'éclat, la représente comme un retour aux nobles usages de leurs aïeux, et si ce n'est là qu'une supposition, c'est la preuve de l'importance attachée alors à cette chevalerie. Elle fut certainement composée des nobles en état d'y prendre part, et il se peut qu'elle ait servi à faire quelques nobles nouveaux. Précisément à cette époque nous savons que la ville de Narbonne, alliée de Gênes, se maintenait dans la possession de donner à ses bourgeois la ceinture militaire, c'est-à-dire l'ordre de chevalerie, en un mot, la noblesse. Il n'y aura pas eu plus de scrupule à Gênes, qui déjà avait fait des nobles de ses magistrats. Quelques années plus tard la commune de Gênes arma chevalier le fils du noble Hubert de Montobbio, probablement un Fiesque. Quoi qu'il en soit, les chevaliers de Gênes et la part qu'ils prennent aux excursions de la force publique sont souvent mentionnés pendant quelques années, après quoi l'on cesse d'en parler. La guerre maritime répandit toujours plus d'éclat dans ce pays que la guerre de terre. Cependant il ne tarda pas à fournir des stipendiaires aux étrangers; et probablement les capitaines génois de ces compagnies d'archers qui servirent en Angleterre et en France ne négligèrent pas de se décorer du grade de chevalerie.
(1202) La plus importante des soumissions extérieures obtenues à cette époque de notre histoire est celle des marquis de Gavi. Les seigneurs de ce nom, deux frères et leurs neveux fils d'un troisième, abandonnèrent à la république leur château, leurs domaines et tout ce qu'ils possédaient à Gavi, y compris les droits attachés à leur seigneurie, sous la réserve seulement de la moitié du péage qui se levait au défilé de la Bochetta que Gavi domine. Ils reçurent de la commune de Gênes pour cette cession 3,200 livres en argent; et, pour en porter le prix à 4,000 livres, il fut établi, avec le consentement des villes de Lombardie intéressées à l'usage de ce chemin, un droit extraordinaire et temporaire sur les passants qui durerait jusqu'à ce qu'il eût rendu les 800 liv. dues encore aux marquis. De leur personne, non-seulement ils jurèrent à Gênes la compagnie et le domicile, mais ils se soumirent à ne pas se remontrer plus de trois fois par an dans les environs de leur ancienne seigneurie. On ne voit pas que ces nouveaux hôtes aient pris de l'ascendant à Gênes. Leur nom ne paraît pas, soit dans la liste des consuls, soit parmi les conseillers. Seulement on trouve, cinquante ans plus tard, un des marquis de Gavi au nombre des nobles commissaires chargés de la rédaction des annales; et c'est tout ce qu'on en sait.
CHAPITRE III.
Guerre en Sicile. - Le comte de Malte. - Finances.
L'empereur Henri était mort. En Allemagne deux compétiteurs se disputaient la couronne impériale. Celle de Sicile fut dévolue à Frédéric, enfant que Henri laissait au berceau. Constance, veuve de l'empereur, ne survécut pas longtemps à son époux, et en mourant elle légua la tutelle de son fils au pape Innocent III; mais le sénéchal Marcuard occupait le royaume et le gouvernait à son gré.
La querelle des Génois avec le gouvernement sicilien n'était pas finie. Il y eut cependant quelques rapprochements d'après lesquels les rapports commerciaux reprirent leur cours, et la république cessa de prohiber à ses citoyens la fréquentation de la Sicile. Mais les Génois n'avaient pas oublié que Henri leur avait promis Syracuse et ils cherchaient l'occasion de se faire justice sur cette promesse; la guerre pisane en fournit le moyen.
Cette guerre se poursuivait sur la mer; à chaque saison on entreprenait de nouvelles croisières. Une flotte partie de Gênes se donna rendez-vous avec les galères que l'automne ramenait de Syrie et d'Égypte. La réunion se fit sur l'île de Candie. Un aventurier, Henri le pêcheur, comte de Malte, se réunit aux Génois. Tous ensemble allèrent assiéger Syracuse sous prétexte d'en chasser une garnison pisane qui y dominait, et d'y rétablir l'évêque qu'elle en avait expulsé. L'on occupa la ville. La possession en fut prise au nom de la commune de Gênes, et, sous son autorité, les chefs de l'expédition en nommèrent comte Allaman della Costa que l'annaliste qualifie de brave et excellent ami des Génois1, mais qui, par le reste du récit, semblerait Génois lui-même. Une étroite alliance s'établit entre ce nouveau seigneur et le comte de Malte. Leurs courses maritimes se firent en commun. Syracuse fut le point d'appui de celles des Génois. En partant de ce port on allait au-devant des galères qui retournaient du Levant. On rassemblait ainsi des flottes formidables. Le comte Henri en fut nommé commandant, et, après plusieurs exploits, il se servit de ces forces pour s'emparer de Candie2 et pour s'en faire souverain. Mais cette propriété fut disputée par les Vénitiens3, et les suites de cette entreprise donneront bientôt un aliment tout nouveau à notre histoire. Les Génois ne furent d'abord mêlés à la querelle que comme simples auxiliaires. Le comte leur demanda des secours; ils lui accordèrent des galères, des hommes, beaucoup de vivres et de l'argent. Cependant, après quelques pertes réciproques, Gênes désira 1a suspension d'hostilités qui retombaient sur le commerce. Leur trêve avec les Vénitiens fut jurée pour trois ans. La république obligea le comte de Malte à y souscrire: on ne l'obtint pas sans difficulté.
Ainsi s'était compliquée la querelle avec les Pisans. Il fallait la soutenir non-seulement sur les côtes de la Ligurie et de la Toscane, mais en Sicile, vers le Levant, dans les eaux de la Sardaigne, de la Corse, de la Provence, de l'Espagne. Soit que ces croisières fussent l'occasion d'actes peu agréables aux neutres, soit que d'autres causes les aliénassent, les Génois paraissent avoir été partout traités, à cette époque, avec peu de faveur.
(1212) Le roi d'Aragon se comportait généralement en ennemi; et comme son pouvoir et celui de son frère, comte de Provence, s'étendaient alors jusqu'à Nice, c'était pour Gênes un mauvais voisinage. Cependant les Marseillais avaient déjà fini ou ajourné leurs anciennes querelles avec les Génois par un procédé singulier. Hugues de Baux, suivi de dix gentilshommes de son pays, se présente dans le port de Gênes et vient proposer de faire la paix. Cette démarche noble, la considération due à de tels ambassadeurs font accepter leur offre sans autre délibération, et la paix est conclue pour vingt et un ans.
(1215) Nice secoue en ce moment le joug des Aragonais et recherche une étroite alliance avec Gênes. Ses députés viennent jurer la compagnie de la commune génoise, et s'y associent pour la guerre et pour la paix, se soumettant à leur part de contribution dans les levées d'hommes et d'impositions maritimes. Le château enlevé aux Aragonais fut livré à Hubert Spinola, consul de Gênes; mais cette occupation ne fut pas de longue durée.
Avec les Pisans les hostilités étaient mêlées de trêves. Tour à tour les empereurs d'autorité, les papes dans l'intérêt de leur influence, réclamaient le droit de juger ou de concilier les deux républiques4. Les abbés de quelques monastères situés à la frontière des deux territoires, gens révérés des deux côtés, provoquaient des rapprochements. Ils obtenaient que l'on compromît entre leurs mains; ils portaient des sentences arbitrales, ils faisaient donner des baisers de paix, et au même moment les parties réconciliées s'accusaient de mauvaise foi; enfin on se retrouvait toujours en état de guerre.
(1211) On n'était pas ainsi avec Pise sans avoir à craindre les fluctuations et les perfidies de la politique des seigneurs feudataires voisins des deux États. Les puissants marquis de Malaspina étaient surtout redoutés. Le propriétaire du château de la Corvara l'avait vendu à Gênes. Cette transaction déplut aux Malaspina. Après quelques mois d'hostilité ils acceptèrent une somme pour se désister de leur opposition et souscrivirent la cession la plus authentique et la plus ample de tous leurs droits sur la Corvara. Mais, à leur instigation, le fils du premier vendeur y rentre par surprise (1216), et leur livre immédiatement le château. Les Malaspina n'hésitent pas à se mettre en possession de ce qu'ils avaient solennellement abandonné. Nouvel armement pour les chasser de cette place usurpée. Ils en sont quittes pour faire une fois de plus ce qu'ils ont fait si souvent, ils jurent obéissance à la république et soumission à ses jugements (1218).
De l'autre côté du territoire, la république reçut (1214) d'Othon, marquis de Caretto, l'abandon de certaines terres et les lui rendit en fief sous serment de fidélité. Foulques de Castello prit ensuite (1215) un parti vigoureux pour mettre une barrière entre Nice et Vintimille. Pendant un de ses consulats, il conduisit trois galères où montèrent un grand nombre de nobles avec lui. Elles étaient accompagnées de bâtiments de transport, chargés d'ouvriers et de matériaux de toute espèce. Le convoi débarqua sur le rivage de Monaco, pays que la république prétendait compris dans les concessions de l'empereur Henri IV. Sur ce promontoire élevé au-dessus de la mer, on traça une forteresse défendue par quatre tours entourées d'un rempart. On se mit incessamment à l'ouvrage. Foulques ne rembarqua qu'après avoir vu les murailles à trente-cinq pieds au-dessus du sol.
(1219) Malgré ces mesures, Vintimille donnait sans cesse de l'inquiétude. Un soulèvement nouveau suivait promptement une vaine soumission. Une révolte déclarée avait éclaté. Pour la réprimer, on ravagea le territoire, mais c'est tout ce qu'on put faire dans une première campagne. La seconde année (1220) on eut à la solde de Gênes Manuel, l'un des comtes de Vintimille. Il avait, ainsi que son frère, cédé ses droits sur la ville, mais on ne devait pas s'attendre à les voir les oppresseurs de leurs anciens vassaux. Manuel, qui stipulait aussi pour son frère Guillaume, s'engagea à leur faire une guerre sincère et sanglante de sa personne et avec quinze chevaliers et dix arbalétriers. Il promit de plus, sous bonne caution, de céder aux Génois les prisonniers qu'il ferait, pour le même prix qu'il aurait pu tirer d'eux par rançon, et cette odieuse partie du traité fut accomplie (1221). La guerre continua. Il fallut cinq ans pour lasser les Provençaux et les seigneurs qui étaient venus défendre la ville. Ce comte qui avait déserté ses vassaux pour les assiéger avec les Génois, était retourné au milieu d'eux: enfin, quand la constance des habitants fut épuisée et qu'ils furent réduits à se rendre, l'on s'estima heureux de recevoir leur soumission.
Les guerres, les troubles intérieurs, les mesures répressives sans cesse rendues urgentes devaient rendre très-difficile le maniement des finances d'un État sans territoire. Il nous en reste des détails assez curieux pour les indiquer.
(1208) L'armement de la flotte pour la guerre pisane coûte 10,000 liv. On dépense 20,000 liv. par le second secours accordé au comte de Malte quand il devait lutter contre les Vénitiens. Afin de le fournir, on eut recours à une contribution extraordinaire et temporaire pendant six ans, de deux deniers par livre sur les marchandises exportées et importées. La recette de cette imposition fut vendue à l'encan et produisit une somme de 12,452 liv. A la nouvelle qui se trouva fausse d'un armement des Pisans d'une force supérieure (1210), on en décréta un dont les préparatifs ne furent pas achevés, mais qui donna lieu à une autre contribution. Tous les citoyens furent obligés (1216) de déclarer le montant de leur fortune pour en payer trois deniers par livre, et, en outre, sur chaque 1,000 liv. ils devaient fournir les vivres de guerre pour deux hommes. La seconde campagne de la guerre de Vintimille se fit au moyen d'une réquisition d'hommes sur tous les habitants au-dessus de quatorze ans, de Cogoleto à Porto-Venere. Cinq hommes devaient en faire marcher un ou payer trente sous en s'unissant riches et pauvres, de sorte que la taxe pour ceux-ci fût de cinq sous, et de neuf pour ceux-là. L'année suivante, on fit un emprunt forcé de 20 sous par 100 livres.
Enfin une opération de l'un des consulats de l'époque qui nous occupe nous fait connaître les ressources de l'État et la difficulté de les conserver disponibles et égales au besoin.
(1214) On aliéna pour six ans la recette de l'imposition ordinaire de quatre deniers pour livre sur le commerce maritime d'entrée et de sortie. Cette ferme fut adjugée pour la somme de 38,050 liv.; elle fut consacrée à racheter des droits ou gabelles qui se trouvaient engagés5, non compris toutefois la gabelle du sel; car ce monopole existait déjà: la moitié de cette ressource était aliénée alors pour vingt-quatre ans. Une imposition extraordinaire fut mise sur les immeubles, à raison de 6 deniers par livre. La moitié du produit fut réservée pour le rachat de la portion engagée de la gabelle; l'autre moitié, consacrée aux travaux du port, qui, de la droite du vieux môle, s'étendait maintenant jusqu'à la nouvelle darse. L'année suivante, l'imposition fut répétée, à moins que les annales qui en parlent deux fois, ne se rapportent à une seule mesure, d'abord pour la promulgation, ensuite pour l'exécution6.
En rentrant dans la jouissance du revenu des droits sur le sel, une loi expresse fut portée, pour défendre à l'avenir d'aliéner les impositions et gabelles, excepté celle du sel, les droits du palais que la république possédait à Messine, les revenus de Tyr (1214), et les chancelleries de Ceuta et de Buzea (Bougie). Nous avons vu (1222) qu'en vertu d'un arrangement singulier dans une de ces villes d'Afrique, et probablement dans toutes deux, sur les impôts que le gouvernement des Mores exigeait du commerce génois qui fréquentait leurs ports, une partie du droit revenait au fisc de la république par les mains des officiers qu'elle y entretenait. Ces revenus, par exception, pouvaient être légitimement affermés, mais pour deux ans seulement. Au delà ou pour tout autre, l'aliénation était déclarée nulle de plein droit, et les prêteurs étaient avertis que la république reprendrait ce qu'on leur aurait irrégulièrement engagé en son nom. Tous les citoyens de quinze ans jusqu'à soixante et dix furent tenus de prêter un vain serment pour le maintien de ce nouvel article ajouté aux statuts. En même temps des nobles furent institués commissaires pour la gestion des finances.
CHAPITRE IV.
Frédéric II. - Guelfes et gibelins. - Guerres avec les voisins.
La domination germanique était, en Italie, comme en suspens depuis la mort de Henri VI. Son frère Philippe de Souabe et Othon d'Aquitaine, descendant du duc Guelfe de Bavière, se disputaient la couronne impériale. De leur opposition naquirent en Allemagne ces fameux noms de partis de gibelins et de guelfes, qui, passés en Italie, s'y appliquèrent, non pas au choix entre deux empereurs, mais d'abord à la lutte des amis de l'indépendance et des fauteurs de l'autorité impériale, et bientôt à des intérêts purement italiens; ainsi ils survécurent longtemps aux causes qui leur avaient donné naissance.
Le pape devait être opposé au parti de la maison de Souabe, bien qu'il se portât pour protecteur du jeune rejeton qu'elle avait laissé (1198) dans le royaume de Naples. Cependant Philippe l'ayant emporté sur son compétiteur, Innocent III ne dédaigna pas de négocier pour se rapprocher de l'empereur gibelin. Il avait déjà levé (1208) l'interdit dont il l'avait frappé, quand ce prince mourut assassiné. Othon IV lui succéda paisiblement: il épousa (1209) la fille du mort, et se présenta comme devant recueillir les affections des deux partis. Il vint (1214) en Italie, et, chef des guelfes, il y caressa les gibelins (1222).
Othon se rendant à Rome, manda les Génois pour lui prêter serment et pour soumettre à son jugement leurs querelles avec Pise. Il ordonna une trêve; pour en assurer le maintien, il exigea que de part et d'autre des otages lui fussent remis.
L'empereur fut couronné dans Rome. Mais Innocent III, auquel il faut rapporter l'établissement solide de la monarchie temporelle des papes, avait mis le temps à profit pendant l'éloignement et les discordes des compétiteurs à l'empire. Il avait soulevé la Toscane, entraînant toutes ses villes dans une ligue dont il s'était fait le chef. Les Pisans seuls avaient refusé d'y adhérer et persistaient dans leur attachement aux empereurs. En même temps, le pape réclamait la tutelle du jeune Frédéric, fils de Henri, dans l'espérance d'étendre sa propre autorité sur Naples et sur la Sicile. C'est dans ces conjonctures qu'Othon se présentait. S'il était le chef des guelfes d'Allemagne, ce n'est pas pour lui qu'Innocent avait suscité ceux d'Italie. Ces deux hommes ne se virent qu'en rivaux. Othon, résolu à l'invasion du royaume de Naples, est excommunié pour cette entreprise. Il y appelait à la fois les Génois et les Pisans. Les derniers s'y prêtent avec zèle; les Génois se disent retenus par l'excommunication qu'ils ne sauraient braver. Frédéric, grâce aux intrigues du pape, devenu gendre du roi d'Aragon, favorisé par le roi de France, ennemi d'Othon, va tenter la fortune en Allemagne. C'est à Gênes que le pontife lui ménage les premiers secours. Accueilli à son passage (1212), aidé d'un don de 1,500 liv., il part de là et exécute heureusement son voyage périlleux. En ce moment, tout à Gênes était réuni pour lui. Le gouvernement était encore guelfe et le pape en disposait en faveur de Frédéric; le parti gibelin, qui se renforçait de jour en jour, était favorable à sa personne.
(1214) La bataille célèbre de Bouvines, perdue par Othon contre Philippe Auguste, ébranla le trône de cet empereur; Frédéric s'en prévalut. Il fut reconnu roi des Romains à Aix-la-Chapelle. Deux ans après il eut le champ libre dans l'empire par la mort d'Othon.
Mais à mesure que le pupille se fortifiait, le tuteur lui retirait son appui. L'ambitieux Innocent n'avait voulu faire de Frédéric que sa créature, et le jeune roi était né pour un autre rôle. Ce prince, que le pape avait opposé à Othon comme le vrai César, ne put jamais obtenir de ce même pontife la reconnaissance formelle de son titre impérial. Toutes ses démarches furent croisées, son royaume de Naples fut une source de prétentions et de chicanes. Innocent mourut; Honorius III et Grégoire IX qui lui succédèrent (1217) agirent dans le même esprit. Honorius avait été longtemps ministre de Frédéric dans Palerme. A peine élevé au pontificat, il fit sentir à son maître que leur position avait changé. Avant de renoncer aux apparences de l'amitié il en employa les séductions pour éloigner Frédéric sous un prétexte honorable. Ceci nous ramène un moment aux affaires de la Syrie1.
Tandis que Guy de Lusignan était allé régner en Chypre, son frère Amaury était devenu roi de Jérusalem, du chef de sa femme Isabelle, soeur et héritière de la reine Sibylle. A proprement parler, son autorité n'était reconnue que dans les murs de Ptolémaïs. Il s'y maintint avec des succès divers, attendant le secours d'une nouvelle croisade. Mais, promise à la terre sainte, elle alla éclater (1203) d'abord sur la ville chrétienne de Zara, ensuite sur l'empire chrétien de Constantinople. Les Génois n'avaient point eu de part à cette expédition. Loin de là, elle blessait leurs intérêts en les privant des fruits de leurs alliances avec les empereurs grecs dépouillés. Elle excitait leur plus vive jalousie par l'accroissement de pouvoir et de commerce échu aux Vénitiens. L'annaliste de Gênes parle avec mépris de ces seigneurs qui feignirent de se croiser et qui allèrent à Venise conspirer des usurpations.
Une nièce de Sibylle, fille d'Isabelle et du marquis de Montferrat, l'un de ses maris, succéda au titre royal d'Amaury (1210). L'on appelle du fond de la France Jean de Brienne pour épouser cette princesse et pour partager une couronne si difficile à soutenir. Le nouveau roi reçut quelques secours; mais plusieurs fois les chevaliers venus à la défense du pays se découragèrent et se rembarquèrent sans persévérer. Cependant ce roi conduisit (1219) une armée en Égypte et conquit Damiette. Les Génois l'avaient assisté dans cette entreprise. L'un d'eux, Pierre de Castello, fut dépêché pour en donner la nouvelle, qui retentit dans toute la chrétienté. Ce succès pouvait porter des fruits immenses. Le soudan d'Égypte offrait de rendre en échange de Damiette, Jérusalem et tout ce qu'il avait possédé dans la terre sainte. Le roi croyait assurer la paix et sa couronne par cette glorieuse négociation. Le cardinal Pélage, le plus hautain des légats, s'y oppose d'autorité. Les mesures furent mal prises; Damiette échappa aux chrétiens: dix galères promptement envoyées de Gênes, sous le commandement d'un Doria et d'un Volta, arrivèrent trop tard pour sauver la ville. Ce secours remonta du moins les courages abattus et contint les attaques des Sarrasins. L'armée put rentrer en sûreté dans les murs d'Acre. Jean de Brienne passa bientôt la mer pour aller solliciter à Rome une assistance sans laquelle il ne pouvait plus se maintenir. Sur cette circonstance le pape fonda son projet pour se débarrasser de Frédéric. Ce prince était veuf de Constance d'Aragon. Honorius mit en usage jusqu'à son autorité pontificale pour l'obliger à épouser (1225) la fille de Jean de Brienne qui lai apportait pour dot la succession au titre de roi de Jérusalem; le pape l'excite à réaliser le nom que ce mariage lui assure, à relever le trône de la sainte cité; il lui déclare enfin qu'il ne le couronnera point empereur avant d'avoir reçu son serment de passer promptement la mer pour la défense du saint sépulcre. Frédéric opposa la ruse aux exigences du pontife. Il feignit de partir, envoya une flotte avec quelques secours en Palestine et resta en Italie. Excommunié par Grégoire IX (1227), successeur d'Honorius, comme désobéissant et parjure, il partit enfin; il arriva en Syrie, il combattit, il négocia, il obtint que Jérusalem et le saint sépulcre fussent restitués aux chrétiens. Mais pour les services signalés qu'il rendait à la cause sacrée, il ne trouva qu'ingratitude et persécution. Les malédictions pontificales le suivirent partout. En Syrie, les chevaliers de l'Hôpital et du Temple ne voulurent prendre part ni à ses conquêtes ni à ses traités inespérés. Le clergé rejeta (1229) toute communication avec lui. Les concessions qu'il avait obtenues lui furent reprochées comme autant de sacrilèges et de pactes avec l'enfer. En Europe les anathèmes redoublèrent. On fit déclarer contre lui jusqu'à Jean de Brienne, son beau-père. A ces nouvelles, et son voeu accompli au saint sépulcre, il se hâta de repasser en Italie pour y défendre ses droits attaqués, et, quoiqu'il obtînt du pape intimidé la suppression des censures qui l'avaient frappé, c'est en ennemi qu'il revint et qu'il fut reçu.
Dans la première période de la querelle avant le pèlerinage de Frédéric, le gouvernement génois, toujours guelfe, avait suivi sa politique ordinaire. Ce prince si bien accueilli au temps où, hôte de la république, elle le voyait protégé par le pape et adversaire d'un empereur régnant, ne trouva plus qu'éloignement et défiance quand il fut devenu le chef effectif de l'empire. De son côté, il ne montra pas plus de bienveillance. Lorsqu'il se rendit d'Allemagne en Italie pour venir prendre la couronne, il manda les Génois, les appela au serment qu'ils lui devaient, et les somma de soumettre à son jugement leur différend avec Pise. On obéit: une députation et le podestat en personne allèrent au-devant de lui à Modène. Le serment lui fut prêté; il confirma en faveur de Gênes les concessions qu'elle tenait de l'empire (1220). Mais, quand on lui demanda la confirmation de celles du royaume de Sicile, il remit à la faire jusqu'à ce qu'il fût rendu dans cet État. Frédéric requit les députés de le suivre à Rome pour assister à son couronnement. Ils s'en excusèrent sur ce que la mission qu'ils tenaient du conseil de la république ne s'étendait pas jusque-là. L'empereur s'offensa de cette réponse évasive. Cependant son chancelier, l'évêque de Metz, ne cessa pas de caresser les ambassadeurs. L'annaliste se complaît à nous apprendre qu'il les admit trois fois à sa table; il est vrai, ajoute-t-il naïvement, qu'ils lui apportèrent de riches présents.
Quand Frédéric eut passé de Rome à Naples et en Sicile, une nouvelle députation vint le sommer de s'expliquer sur les privilèges des Génois dans son royaume (1221); mais, loin de les confirmer, il les révoqua durement. Le palais qui leur avait été donné dans Messine leur fut repris. Allaman fut expulsé de son comté de Syracuse. Les procédés sévères étaient pour Gênes et la faveur pour Pise. Telles étaient les dispositions de l'empereur avant sa croisade. Au retour, en guerre ouverte avec le pape, disposant des forces pisanes, c'était pour Gênes décidément un ennemi. Deux nouvelles ambassades n'obtinrent point de dispositions plus amicales, quoique Foulques de Castello, ce grand personnage évidemment attaché au parti impérial, eût été chargé de la dernière.
Gênes, en disgrâce auprès de l'empereur, n'en éprouvait pas plus de bienveillance de ses voisins de Lombardie. Alors cette loi d'un peuple antique, qui punissait quiconque prétendait rester neutre dans les guerres civiles, avait de ville à ville une application immanquable et rigoureuse. Gênes, où les opinions étaient déjà mi-parties, se donnait encore comme attachée à la confédération lombarde; elle y prenait ses podestats; mais elle ne s'en déclarait pas membre actif: elle tergiversait avec tout le monde, elle faisait trop ou trop peu pour chacun.
On avait annoncé que Frédéric venait tenir une diète à Crémone. C'était encore pendant ses préparatifs apparents pour le voyage d'outre-mer (1226). Les voisins ennemis ou envieux de la république spéculèrent sur la partialité de l'empereur contre elle. Savone avait un podestat de Crémone, par conséquent gibelin. Appelé à Gênes pour prêter le serment accoutumé, il comparut, mais il refusa de jurer. Les députés qui l'accompagnaient feignirent de désavouer son refus et de vouloir le contraindre: il persista. La république assigna un bref délai pour la réception du serment sous la commination d'une forte amende. Alors Savone affecta de destituer le podestat réfractaire et d'en nommer un autre à sa place. Celui-ci vint à Gênes et jura sans difficulté avant le terme fatal; mais le prédécesseur reprit ses fonctions, et les habitants de Savone se vantèrent d'avoir échappé à l'amende et éludé le serment en le laissant prêter par un intrus sans qualité. Bientôt après, ils comparurent à Crémone et y portèrent plainte contre l'oppression que les Génois faisaient peser sur eux. Ils n'obtinrent rien de l'empereur directement; mais Thomas de Savoie, celui que les Génois soudoyaient naguère, était devenu vicaire impérial. Par l'entremise de Henri de Caretto, ils acquirent toute sa protection. Ils lui faisaient espérer de le rendre seigneur de toute la rivière. Leur premier soin avait été de s'affranchir de la gabelle du sel dont Gênes imposait le monopole à tout le pays. Ils en établirent un dont ils promettaient le profit au comte Thomas. Il vint résider au milieu d'eux: Albenga le reconnut. Noli seule refusa de se détacher de Gênes. La république fut obligée d'armer pour soumettre les populations soulevées. Le peuple en armes fut appelé sur la place publique et de là entraîné à la guerre sous la conduite du podestat. En marchant contre Savone l'armée fut renforcée par les comtes de Massa, par ceux de Lavagna, par Othon de Caretto et son fils, opposés à Henri leur parent. Les chevaliers de Parme accoururent; il en vint de plusieurs villes de Lombardie (1227). Gênes défrayait cinq cents hommes d'armes étrangers, sans compter plus de trois cents placés en observation sur la frontière lombarde. On prit Savone, et, sur un décret rigoureux du conseil de Gênes, le podestat fit combler les fossés, raser les murailles, subvertir le port par la destruction du môle. Une forteresse fut bâtie sur une hauteur pour dominer la ville. Cent cinquante otages furent pris parmi les principaux citoyens et conduits à Gênes. Deux podestats, nobles génois, furent mis en possession du gouvernement de la ville. Ils arrivèrent suivis de leurs juges et de tout le cortège de leurs officiers de justice. Henri de Caretto vint à son tour faire sa soumission. On la reçut sans y croire. Les victoires obtenues furent pompeusement célébrées. Le podestat, homme magnifique, qui devant Savone n'avait pas manqué de créer des chevaliers sur le champ de bataille, de retour à la ville, fêta son triomphe avec un faste royal. Il tint cour plénière au palais archiépiscopal. Les princes, les seigneurs de la Lombardie et de la Toscane furent invités. Les troubadours italiens et provençaux accoururent aux festins. Des dons, de riches vêtements leur furent prodigués par le podestat et par les principaux nobles génois.
CHAPITRE V.
Entreprise de Guillaume Mari.
(1227) On touchait en ce moment même à une crise extraordinaire qui menaçait de changer la face du gouvernement. Le consulat, quand on préférait des consuls à un podestat, les places des conseillers ou sénateurs, véritables arbitres des affaires, les autres offices de la république étaient des objets naturels d'ambition. Si les familles considérables non encore réputées nobles étaient absolument privées de toute part aux magistratures, ce que nous ne savons pas, du moins elles concouraient à l'élection médiate ou immédiate, et elles n'étaient pas disposées à renoncer à toute influence sur les choix de leurs gouverneurs. Enfin les grandes factions toujours en présence, intéressées à faire prévaloir leurs candidats, mêlaient les intrigues de parti aux brigues personnelles.
Il paraît que chacun des huit quartiers fournissait son contingent dans chaque magistrature, ou du moins nommait séparément des électeurs qui, réunis, choisissaient les magistrats. Il semble aussi qu'il y avait plusieurs degrés, et peut-être le sort y avait part. Enfin parmi les candidats désignés un petit nombre d'électeurs devaient terminer la nomination. Quelques exemples feraient croire que ces derniers suffrages devaient être unanimes. Quoi qu'il en soit, l'ordre patent était modifié, comme il arrive toujours, par des associations de parti. Il s'était formé des compagnies particulières, insidieusement organisées pour s'assurer la majorité dans les élections. L'uniformité des votes de leurs membres était garantie par la foi du serment, profané et respecté tout ensemble. Par là on imposait à la république des magistrats désignés par des coteries, secrètement, si même ceux qui étaient les plus forts prenaient la peine de s'en cacher. Des podestats exclusivement pris dans les villes guelfes indiquent assez quel était le parti auquel ces compagnies étaient vouées; mais rien ne dit que leur majorité représentât fidèlement celle des citoyens. Au moment dont nous parlons, depuis dix ans le consulat était en oubli. Il avait été abandonné depuis qu'un légat du pape avait séjourné à Gênes; et c'est peut-être aux compagnies particulières qu'était due cette période assez longue de podestats se succédant sans interruption.
Quelques nobles se plaignaient de se voir éloignés des emplois par cela seul qu'ils n'étaient pas membres de ces compagnies privées. Un d'entre eux, déjà fort distingué dans la république, Guillaume Mari, se rendit l'organe de tous. Il forma une compagnie de son côté pour réunir ceux que les autres sociétaires avaient laissés à l'écart. Non-seulement les nobles mécontents y accédèrent, mais beaucoup de familles populaires y prirent part, et hors de la ville presque toutes les communes y adhérèrent. Il fallait pour ce concours, ou que le gouvernement fut devenu bien intolérable pour les particuliers, ou que la faction gibeline se fut bien renforcée contre la direction guelfe, ou enfin qu'une nouvelle aristocratie populaire se sentît en force pour se mesurer avec l'oligarchie régnante. Probablement tous ces motifs agissaient. Cette grande et puissante ligue donna bientôt l'alarme au parti opposé.
Des rixes commencèrent à éclater entre les adhérents et les opposants. Le podestat Lazare Glandoni passait pour avoir donné une sorte d'autorisation aux nouveaux associés. Cette condescendance rendait sa position difficile, il prétexta des affaires de famille et il obtint du conseil un congé pour passer à Lucques sa patrie. En son absence la nouvelle compagnie gagna rapidement du terrain. On lit courir le bruit que le podestat ne devait plus revenir à ses fonctions. Aussitôt, le peuple se leva et demanda Guillaume Mari pour chef de la république. On l'enleva de chez lui, malgré ses refus affectés, et il fut installé dans le palais fortifié des Volta près de l'église de Saint-Laurent, loué à cette occasion pour servir de siège à ce nouveau gouvernement. Mari notifia partout sa prise de possession. Il nomma des juges, des greffiers, des officiers pour administrer chaque commune et pour y recevoir le serment.
Au bruit de cette nouveauté, le podestat revint démentir la fausse nouvelle de son abdication. Les nobles l'entourèrent, mais ce fut pour lui reprocher d'avoir avoué Mari, et pour le rendre responsable des suites de sa connivence. Il niait en vain, Mari menaçait de produire des écrits. Glandoni prit alors le parti de se justifier aux dépens d'autrui en opprimant ceux qu'il avait aidés. Il avertit les hommes sur qui il pouvait le mieux compter, de se tenir armés et prêts à agir au premier son du tocsin. Mari, de son côté, était entouré de ses partisans qui chaque nuit venaient en troupe grossir sa garde. Cependant il parut hésiter. Mandé au conseil par le podestat, il s'y fit attendre, mais il s'y rendit avec quelques-uns de ses principaux adhérents; un Volta était du nombre. On leur intima d'évacuer le palais qu'ils tenaient; au lieu d'obéir ils y rentrèrent pour s'y fortifier; et la terreur fut au comble quand on les vit appeler à la garde de leurs postes les ouvriers en laine et, en un mot, la populace. Les nobles s'assemblèrent dans l'église des Vignes. Pierre Grimaldi harangua avec violence. On requit le podestat de réduire les insurgés. On lui offrit toute assistance. Dix commissaires furent nommés cependant pour essayer, avant l'attaque, de retirer Mari et les autres nobles d'une coalition populaire pour laquelle ils ne devaient pas être faits. D'autres envoyés se répandirent dans la ville pour aller de porte en porte exiger des serments d'obéissance et le désaveu de l'association factieuse. Dès ce moment la compagnie commença à décroître et tendit à se dissoudre. Mari avait été évidemment gagné. Il remit le palais et ses tours aux mains de treize nobles choisis avec assez d'impartialité entre les divers partis, si nous en jugeons sur la liste de leurs noms; on contremanda les changements qui avaient été faits dans l'administration. Quand la sécurité fut rétablie, le podestat dans un parlement solennel prononça une pleine amnistie: il cassa et interdit à jamais la compagnie de Mari et en même temps toutes les autres qui existaient ou qu'on avait prétendu exister. Ces décrets furent sanctionnés par le serment de tous les citoyens présents. Mari prêta le sien à son tour, et, sur la réquisition du podestat, il y ajouta avec une contenance très-dégagée, la déclaration qu'il remettait à tous ses adhérents les obligations qu'ils avaient contractées entre ses mains. Ainsi s'évanouit ce premier symptôme constaté des dispositions peu favorables des plébéiens, tentative où c'est la voix d'un noble qui avait appelé les populaires, probablement dans les intérêts de son ambition particulière, ou dans ceux d'une faction, beaucoup plus qu'au profit de la liberté. On retrouve immédiatement Mari dans les plus hauts emplois de la république; il est vrai que bientôt après on voit sa famille émigrer et servir l'empereur Frédéric contre la patrie.
Les Génois, à cette époque, recherchaient des alliances qui leur garantissent la sécurité des relations commerciales avec les villes de la Provence. Ils faisaient des traités avec les communes de Toulon, de Marseille, d'Arles, qui stipulaient comme autant de républiques. Il est bon de recueillir de siècle en siècle les détails que ces documents fournissent sur la matière et les usages du commerce de ce temps. Le traité d'Arles, outre les sauvegardes les plus complètes pour les personnes et pour les biens (le cas de naufrage expressément prévu), contient, en faveur des habitants d'Arles, l'autorisation d'établir à Gênes un consulat, pour décider de leurs contestations civiles. On leur accorde la franchise des droits de douane sur les produits du sol provençal importés à Gênes, mais ils ne pourront les envoyer au delà: le transit gratuit n'en est pas compris dans la concession. Pour les marchandises qui ne sont pas de leur cru, ils sont soumis aux droits, non comme les autres étrangers, mais comme les Génois les payent eux-mêmes. Ils pourront exporter de Gênes des bois de charpente pour la construction de leurs maisons, des douves et des cercles pour leurs tonneaux, mais à condition d'en faire usage pour eux-mêmes, sans pouvoir les vendre ni à Marseille ni ailleurs. Il leur est défendu de prendre à Gênes les toiles d'Allemagne, de Reims ou de Champagne, les draps de France (la Provence n'était pas française encore). Ils ne peuvent exporter des blés, mais seulement des châtaignes, quand le prix marchand n'en excède pas une certaine limite, et, chose bizarre, quoiqu'à l'exemple des Athéniens d'autrefois, le commerce des figues de Gênes leur est interdit.
En accordant aux navigateurs d'Arles, sur l'apport de leurs denrées, la franchise des droits qui appartiennent à la république, on réserve le payement de la gabelle du sel et des droits que d'autres sont en possession de lever sur le territoire génois; ceux de l'empereur sont particulièrement énumérés, et nous apprenons par là qu'à cette époque ou percevait pour l'empereur, dans le port de Gênes, certaines redevances sur les blés, les huiles et quelques autres denrées.
Ce traité nous est connu par les archives des deux villes intéressées1, et, dans cette double authenticité, il confirme que, dans les usages de l'époque, pour une telle alliance on ne faisait pas un seul instrument en deux originaux semblables. On rédigeait séparément les promesses de chaque partie, par des actes relatifs et correspondants, mais distincts. Celui qui était souscrit le premier portait la réserve de la réciprocité des conditions. Des ambassadeurs de chaque part allaient recevoir et accepter les engagements de l'autre cité. A Gênes, le contrat se passait tant au nom du podestat, de la volonté et du consentement du conseil, qu'au nom des conseillers stipulant pour la commune. Le traité d'Arles dont nous venons de parler est qualifié de paix pour dix ans. Cinquante- quatre nobles génois y sont dénommés comme ayant prêté le serment en présence de l'ambassadeur d'Arles. On remarque, en passant, que parmi tous ces nobles pas un Spinola n'est nommé. D'autre part, le podestat d'Arles était alors un Génois, Guillaume Embriaco.
La conservation des traités de Gênes est due à un des podestats de cette ville, Jacques Baldini, Bolognais. Il institua, sous le titre de Liber jurium, un registre où il fit transcrire tout ce qu'on possédait avant lui de diplômes, de privilèges obtenus, de conventions faites avec les rois, les princes, les communes. On continua à enregistrer à la suite les actes semblables qui survinrent, et ce recueil, incomplet sans doute, n'en est pas moins précieux. On trouve en tête du livre le décret du podestat, qui le consacre non-seulement à l'utilité, mais à l'émulation des Génois, afin, dit-il, qu'ils voient comment les progrès et la grandeur de la république ont été le prix des vertus ou des travaux de leurs pères.
(1229) Baldini était actif et ambitieux; il s'adonna aux affaires publiques avec un zèle sans exemple. Il y consumait tout le jour, souvent une partie de la nuit, différant ses repas tant qu'il lui restait quelque chose à faire, et, dit naïvement le chancelier annaliste, tenant souvent ses subordonnés à jeun jusqu'à une heure très-avancée. Il conclut des conventions favorables avec plusieurs2 voisins et avec le roi de Castille. Il poursuivit les pirates, il fit partir avec une grande vigilance des flottes pour toutes les stations où le commerce avait besoin d'être protégé. Mais son ambition alla bien plus loin, et là elle se mit trop à découvert: il voulut se faire législateur et se perpétuer dans sa place. Les statuts de la république avaient prévu que les lois pourraient avoir besoin de corrections, et ils attribuaient au conseil le droit de nommer les correcteurs. Baldini se fit élire correcteur unique. S'adonnant à la refonte des statuts, il les divisa et les classa en livres par ordre de matières. Le travail était utile, mais cette attribution insolite, cette entreprise d'être seul arbitre de la constitution, excita déjà une vive clameur. La rumeur fut bien plus grande, quand, au temps ordinaire de l'élection du podestat futur, on apprit que Baldini manoeuvrait pour rester en charge. Il avait fait venir de Rome Godefroy, chapelain du pape, chargé par le pontife d'absoudre de tout serment tant le podestat qui, à son installation, avait juré de ne pas garder le pouvoir au delà de son année, que les électeurs, le conseil, la commune entière qui juraient tous les ans de ne souffrir ni la prorogation ni la réélection de ce souverain magistrat. Déjà les électeurs étaient renfermés, le scrutin leur avait été remis et leur séance se prolongeait aux yeux du public soupçonneux. Ils avaient expédié un message à l'archevêque, au chapelain et aux frères mineurs dont le crédit était fort grand, pour qu'on leur dît si en effet ils pouvaient sans péché renommer le podestat actuel contre la teneur de leur serment. L'impatience publique trancha la question. Il y eut un soulèvement universel; on protesta que ce parjure et cet opprobre ne seraient pas soufferts, et comme il plut à Dieu, l'archevêque et les frères mineurs répondirent aux électeurs de ne pas songer à la réélection: Spino de Sorexino, Milanais, fut nommé.
(1230) La magistrature de Sorexino fut troublée et terminée par un incident qui fait connaître le peuple et le siècle. On avait fait capture de quelques pirates de Porto-Venere. On condamna les complices à la mutilation de la main droite, et les chefs au dernier supplice. Mais dans ce pays où le sang se répandait avec si peu de scrupule et souvent pour des intérêts si indignes, il régnait une horreur invincible pour les exécutions de la justice. Ce sentiment favorable à l'impunité, perpétué jusqu'à nos jours, y était entretenu par les soins des prêtres, et surtout des religieux qui avaient ordinairement les honneurs de toute grâce obtenue pour les malfaiteurs convertis. Dans cette occasion les dominicains et les frères minimes sollicitèrent pour les condamnés. Le podestat, peu disposé à céder, pour couper court à tout délai, ordonna d'exécuter la sentence sans remise au lendemain; c'était un dimanche et le jour de la fête de Nazaire et Celse, saints martyrs de Gênes. Cette circonstance souleva d'indignation les femmes de tous les rangs et avec elles l'archevêque et le reste du clergé. Le podestat voulait être obéi; il convoqua un parlement à Saint-Laurent. Les femmes se précipitèrent dans l'église et rendirent la convocation inutile. Dans le tumulte un cheval effrayé emporta le malheureux Sorexino et le précipita sur le perron de Saint-Laurent. Il eut une jambe cassée. A peine transporté chez lui et le premier appareil mis, les officiers qu'il avait chargés de veiller à l'exécution des condamnés vinrent lui annoncer un miracle inouï. Sur quatre coupables, deux qui en marchant à la mort s'étaient recommandés à Dieu et à saint Jean-Baptiste, pendus avec leurs compagnons n'étaient pas morts comme eux. Ils respiraient encore. On venait demander de nouveaux ordres sur un incident si peu croyable. Le podestat, dont l'accident passait déjà pour un jugement de Dieu, se hâta d'ordonner que les deux malheureux fussent ramenés. Le conseil, appelé, consentit que leur grâce et leur liberté fussent prononcées. Enfin, comme pour imprimer plus avant les terreurs superstitieuses, le podestat ne se rétablit des suites de sa chute que pour être frappé de mort subite au milieu des réjouissances de sa guérison.
CHAPITRE VI.
Frédéric II. - Expédition de Ceuta.
(1231) L'état de l'Italie était toujours précaire. L'empereur Frédéric indiqua une diète à Ravenne, où il voulait, d'accord, disait-il, avec le saint-père, pourvoir aux discordes et aux guerres intestines dont les villes étaient agitées. C'est en ces termes qu'il manda les représentants de la commune de Gênes. Dans cette assemblée il promulgua un décret général pour défendre à toute cité de prendre ses podestats ou ses gouverneurs parmi les citoyens des villes lombardes en rébellion contre la souveraine puissance impériale. Les députés de Gênes eurent peine à obtenir la parole pour lui représenter humblement que le podestat de l'année prochaine était déjà nommé, que l'élection, toujours faite à l'avance et au temps déterminé par les lois du pays, était tombée sur un Milanais1; qu'à cette époque l'intention de l'empereur n'était ni annoncée ni prévue; Gênes à l'avenir se garderait bien de tout choix qui pourrait déplaire, mais on réclamait son indulgence pour ce qui était déjà fait. On ne pouvait faire affront au podestat désigné; on ne pouvait, sans manquer à toutes les lois de la commune et aux serments les plus sacrés, rétracter une nomination régulière et solennelle qui n'avait pas même été faite par acclamation, mais qui était sortie de l'urne d'un scrutin2. Frédéric ne donna point de réponse. Les députés de retour ayant rendu compte de leur mission, les partisans impériaux élevèrent la voix et demandèrent que le podestat élu fût contremandé. Ils prirent les armes pour appuyer leur voeu. Cependant le parti opposé l'emporta dans le conseil, et l'installation du nouveau magistrat fut délibérée. Frédéric, irrité, fit emprisonner les Génois qui se trouvaient dans son royaume de Sicile, et saisit leurs biens (1232). Gênes tint un grand parlement sur cette fâcheuse nouvelle. Les opinions divergentes s'y donnèrent pleine carrière. On proposa d'entrer franchement dans la ligue lombarde. La majorité du conseil fit du moins résoudre une ambassade à cette ligue. La minorité, qui voulait députer à l'empereur, parut assez imposante pour ne pas refuser d'expédier à Frédéric un chanoine de Saint-Laurent, comme négociateur secret; mais il fut promptement éconduit. Les amiraux de l'empereur donnèrent la chasse aux bâtiments génois. Frédéric, occupé d'autres combinaisons, affecta la miséricorde (1233). Il écrivit à Gênes des lettres pacifiques. Les messagers se succédèrent; enfin la négociation tourna heureusement. Les Génois détenus à Naples et en Sicile furent remis en liberté, ils reprirent leurs propriétés séquestrées. L'effet de ce raccommodement dura quelques années, pendant lesquelles les Génois continuèrent à recevoir leur podestat de Florence, de Bologne, de Milan. La république, dans cet intervalle, adhéra de plus en plus au pape, envoya des ambassadeurs traiter avec Venise, et mit le plus grand soin à rétablir la concorde troublée dans les villes guelfes de son voisinage.
Le commerce maritime était toujours l'intérêt principal. On expédiait fréquemment des galères pour protéger la navigation, particulièrement pour tenir en respect les Mores d'Espagne et de Barbarie, tantôt amis, tantôt ennemis, et toujours prêts à prendre leurs avantages quand ils voyaient de riches proies et peu de forces pour leur imposer. Dix galères et quelques bâtiments légers devant Ceuta avaient ramené (1231) à l'alliance de Gênes l'émir qui y commandait et le soudan de Maroc, suzerain de ce pays. Malocello et un Spinola en avaient rapporté au trésor de Gênes huit mille besants et avaient montré au peuple, comme un don de l'émir à la république, un cheval couvert de drap d'or et ferré d'argent. Ceuta était alors un des points les plus importants du commerce des Génois; ils y avaient beaucoup de marchands et de capitaux, quand tout à coup on apprit qu'une croisade avait été prêchée en Espagne contre cette ville, et qu'elle était menacée d'un siège par les chrétiens. Les croisés avaient déjà pris les bâtiments génois qu'ils avaient rencontrés dans ces parages. Il y avait tout à craindre pour les propriétés et pour les personnes, si l'on ne s'opposait à cette entreprise. Le risque et le scrupule de combattre contre des chrétiens pour les païens affligeaient vivement, mais un intérêt humain si puissant devait passer avant tout. On se hâta d'expédier une flotte. On espéra qu'en déployant ces forces devant les Espagnols et en employant les voies de la conciliation, les hostilités pourraient être évitées. On obtint en effet quelques promesses, mais si vaines que les croisés tentèrent ouvertement d'incendier la flotte génoise. En même temps le soudan invoquait le secours des Génois et s'engageait à payer la moitié des frais des armements qu'ils enverraient pour la défense des intérêts communs. Cet appel détermina un effort; on fit partir vingt-huit galères et quatre grands vaisseaux (1234). Il paraît que ce puissant secours détourna l'orage et rendit la sécurité à Ceuta. Mais quand on en vint à réclamer du soudan le remboursement des dépenses suivant sa promesse, il fut peu disposé à la tenir. Les Génois qui étaient en force la revendiquèrent avec une hauteur menaçante; le soudan traînant la négociation en longueur, fit venir de l'intérieur des troupes nombreuses de ses barbares. Une rixe entre cette soldatesque et les équipages des galères ne tarda pas à s'élever; ce fut le signal d'un massacre et surtout du pillage et de l'incendie des magasins et des maisons des Génois. Rien ne put induire le soudan à la réparation de ce dommage et à l'exécution de ses engagements. On n'eut pas d'autre ressource que de déclarer formellement la guerre à ce prince barbare, tandis que les galères croisaient devant ses ports. La république, informée de cette fâcheuse conjoncture, envoya de nouveaux renforts de provisions et d'armes; mais ses amiraux lui demandaient des hommes, et personne à Gênes ne s'embarqua. Cependant les ennemis se lassèrent d'être renfermés sans communication avec la mer; une paix fut faite: sans nous en faire connaître les conditions, on nous dit qu'elle fut honorable pour Gênes et que la flotte revint triomphante.
La dépense subite du secours envoyé à Ceuta, si mal remboursée par le More, avait exigé des ressources extraordinaires. Douze deniers du produit de la gabelle du sel, probablement le vingtième du total, furent aliénés pour dix ans et produisirent vingt-huit mille livres. On avait eu recours également à des emprunts et sur de singuliers gages. A la fin de l'année (1235) où se fit la paix de Ceuta et où l'ordre put être remis dans les finances, Ingon Grimaldi rendit la vraie croix que le podestat lui avait remise, du consentement de l'archevêque et du chapitre de Gênes. Il fut dressé acte authentique de cette restitution. Je ne pense pas que ce fait puisse être entendu autrement que d'un prêt sur nantissement et de sa libération. Nous savons que les croix produisaient un revenu, soit qu'elles eussent un casuel attaché à leur emploi dans les cérémonies du culte, soit plutôt que, traitées en reliques, elles attirassent des aumônes: ce revenu avait été sans doute, comme ceux de la gabelle, ou aliéné temporairement aux prêteurs, ou assigné pour le nantissement de leur créance.
La vraie croix, et en général les croix de la ville, jouaient à Gênes un grand rôle. Les annales ne manquent jamais de signaler leur apparition efficace toutes les fois que l'archevêque et ses prêtres viennent entremettre leur ministère de paix au milieu des partis et imposer des réconciliations au nom du Dieu de miséricorde. Les croix contribuent avec les cendres de saint Jean-Baptiste à calmer les tempêtes de la mer comme celles de la place publique. Aussi quelques années avant l'époque dont nous nous occupons, un malheureux reçu dans l'église de Saint-Laurent sous prétexte d'y chercher un asile, ayant une nuit forcé le coffre qui renfermait les croix et les ayant enlevées, le trouble dans la ville fut tel que peu d'événements sinistres en eussent produit un semblable. On courut de toutes parts après le larron; il fut saisi à Alexandrie, mais son butin n'était plus entre ses mains, il en avait été dépouillé lui- même. On découvrit enfin le détenteur. La ville racheta son palladium sacré, il lui en coûta plus de quatre cents livres. On replaça ces précieuses croix, mais elles furent mieux gardées; le coffre fut couvert de lames de fer. L'archevêque institua un anniversaire solennel pour célébrer leur réintégration dans l'église, et il fut ordonné que leur revenu dans cette journée serait employé à la rédemption des captifs. Ce prélèvement spécial excepté, le revenu des croix fut assignée la commune, en indemnité de ce qu'elle avait payé pour leur rachat; elle en affecta le produit aux constructions du môle et du port.
Chez ce peuple dévot, la superstition qui attachait légalement le jugement de Dieu à l'événement d'un duel n'avait pas encore perdu son autorité. Mais des exemples que nous en rencontrons précisément à cette époque, prêtent à une autre observation de moeurs. Les parties ne combattaient point en personne; elles abandonnaient le sort de leur tête à des champions mercenaires. Parmi ces hommes si hardis à la mer, qui sur terre s'étaient faits chevaliers pour marcher à la guerre, qui n'avaient nulle horreur du sang et qui ne craignaient pas de payer de leur personne dans les affaires de partis, il paraît que l'usage de descendre en champ clos répugnait à toutes les idées admises. Dans les temps modernes l'on observait à Gênes plus de rencontres fortuites ou plus de vengeances par le poignard et par le guet-apens que de duels tels qu'on les connaît ailleurs. Cette disposition parait avoir été très-ancienne. Nous avons vu quel effroi causa la menace de dix combats singuliers ordonnés par l'autorité: maintenant on en cite d'ordonnés, soutenus par procureur. Jacques Grillo, accusé d'un crime, ne peut être ni convaincu ni justifié. Le podestat ordonne le combat, et il a lieu. Le champion de l'accusé était de Cumes; celui de l'adversaire, de Florence; le Florentin tua son antagoniste, Grillo eut la tête tranchée.
La guerre de l'empereur avec les Lombards avait recommencé. Le prince les rencontra près de Brescia, et remporta sur eux une victoire signalée. Ces succès donnaient de l'audace aux gibelins répandus dans les villes guelfes: ils réveillèrent ceux de Gênes, et soulevèrent de nouveau les populations gibelines, de Vintimille à Savone. On conçut à Gênes qu'il fallait plier devant le vainqueur, ou du moins essayer de fléchir sa colère. On lui expédia, comme des messagers qui ne pouvaient lui être désagréables, des Volta et des Castello. Mais, dans l'intervalle de ces négociations, on s'était un peu rassuré; l'insurrection des voisins était moins pressante, et les principaux guelfes craignaient moins de se faire entendre. Dans ces circonstances des délégués de l'empereur se présentèrent au conseil pour exiger le serment qui lui était dû. Foulques Guercio, l'un des conseillers, se leva et déclara qu'une telle matière méritait une délibération plus solennelle et devait être mise à la connaissance de toute la commune. Le lendemain un grand parlement s'assembla dans l'église Saint-Laurent. On y donna lecture des lettres de Frédéric. Il paraissait imposer à Gênes le serment de fidélité et d'obéissance à sa domination. Le podestat fit ressortir cette exigence: il rappela au peuple comment celui qui voulait être leur maître les avait traités en Sicile. A cette harangue, à ce mot de domination des clameurs s'élevèrent; le serment fut refusé, le parlement se rompit; le podestat prit des mesures pour que le gouvernement restât le plus fort dans l'intérieur. Les écrivains allemands assurent que le podestat fit ici une erreur, c'est-à-dire un mensonge: la lettre impériale ne requérait que le serment de fidélité et de vasselage (fidelitatis et hominii): on affecta de lire: fidélité et souveraineté (fidelitatis et dominii)3. Quoi qu'il en soit de cette équivoque, elle fit son effet sur l'esprit public. On expédia des ambassades à Rome, afin d'y contracter, sous les auspices du pape, une étroite alliance avec les Vénitiens alors en guerre avec Frédéric. Le pontife, à cette occasion, déclara publiquement que la république de Gênes était placée sous la protection immédiate des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
La force était donc restée aux guelfes dans Gênes (1239). Un nouveau podestat fut demandé à Milan (1240), et l'on prêcha, au nom du pape, contre les ennemis du saint-siège une croisade avec les mêmes indulgences attachées à celles d'outre-mer; mais en ce moment, Alexandrie passait au parti impérial et contribuait à soutenir l'insurrection de Savone et d'Albenga. Le marquis Caretto la dirigeait: de l'autre côté du territoire, Hubert Pallavicini, vicaire impérial, menaçait la ville. Gênes avait des ennemis de tous les côtés.
CHAPITRE VII.
Concile convoqué à Rome.
Cependant le pape Grégoire, se sentant appuyé par une partie des villes de la Toscane et de la Lombardie, décidé à pousser aux termes extrêmes sa querelle avec l'empereur, convoqua un concile à Rome dans l'église de Saint-Jean de Latran. Empêcher la tenue de cette assemblée devint la principale affaire de Frédéric. Déjà un grand nombre de prélats de diverses nations s'étaient réunis à Nice, recrutés et conduits par le cardinal de Préneste. Il s'agissait de les faire arriver jusqu'à Rome. Les flottes de Frédéric furent destinées à leur fermer le passage; un Spinola avait été son amiral; il venait de le perdre. Pour le remplacer, Ansaldo Mari fut appelé; il s'échappa mystérieusement de Gênes et fut bientôt sur la flotte impériale occupé à donner la chasse aux Pères du futur concile.
Les Pisans n'étaient plus en guerre avec Gênes. Ils y envoyèrent une ambassade solennelle pour notifier que les ordres de l'empereur les obligeaient à s'opposer à force ouverte au passage des évêques que le pape mandait à son concile. Ils priaient donc les Génois de s'abstenir de prêter leurs galères pour ce voyage, car il serait trop pénible d'avoir à combattre des voisins avec qui l'on désirait conserver la concorde rétablie (1241). Le podestat répondit avec hauteur que les Génois avaient toujours été les fidèles de la sainte Eglise, toujours prêts à la défense de la foi; qu'on avait promis de conduire à Rome les prélats, et qu'aucune menace n'empêcherait de tenir parole. Jacques Malocello, amiral de la république, fut immédiatement expédié à Nice avec tous les bâtiments que l'on put mettre à la mer. Là il prit à bord les cardinaux légats, les évêques et leur suite et les conduisit à Gênes. Quelques-uns cependant, alléguant que ces bâtiments ne suffisaient pas à tous les passagers, saisirent ce prétexte pour se dispenser d'un voyage périlleux et d'un concile non moins fâcheux; ils s'en retournèrent de Nice à leurs demeures.
Ceux qu'on avait conduits à Gênes y séjournèrent plusieurs semaines, d'abord afin d'attendre l'arrivée des prélats et des ambassadeurs des villes lombardes. Il s'éleva d'ailleurs des obstacles avant-coureurs d'un dénoûment fatal. Tandis que les forces maritimes de Frédéric et des Pisans se préparaient à disputer le passage sur la mer, la voie de terre était interceptée par les excursions de Pallavicini et d'autres vicaires impériaux. Dans la ville même il s'ourdissait des trames pour s'opposer au départ de la flotte.
Un émigré florentin avait été arrêté comme espion. Rosso della Volta l'enleva aux sbires: le podestat fit sonner le tocsin et prendre les armes; il dénonça en plein parlement non-seulement cette dernière violence, mais les manoeuvres des factieux contre la tenue du concile, la conjuration découverte contre la vie des meilleurs citoyens, enfin les préparatifs hostiles qui remplissaient les maisons des Doria, des Volta, des Thomas Spinola d'Avocato1, de leurs adhérents, maisons dont on avait fait autant de citadelles menaçantes. «Génois, dit le podestat en terminant ce tableau, Génois serviteurs de Dieu, armés pour sa défense et pour votre liberté, que faut-il faire? - Meurent les traîtres!» ce fut la réponse. Le podestat chargea aussitôt les officiers d'aller punir exemplairement les coupables. On commença par envahir la demeure d'un des nobles accusés. Elle fut ravagée et livrée au pillage, ce qui intéressa sur-le-champ la populace à concourir à de semblables exécutions. On marcha à l'attaque des maisons des Doria et des Volta; et, pour cet effet, on fit descendre à l'improviste tous les équipages de la flotte. Après un combat long et sanglant, les gibelins se jugèrent hors d'état de se défendre, ils abandonnèrent sans bruit les maisons qui allaient être assiégées: la plupart prirent la fuite; le podestat s'empara des postes qu'ils avaient quittés et les fortifia pour son parti. Maître alors de la ville, il put ordonner le prompt départ de la flotte. Les Pères du concile y montèrent. On gagna Porto-Venere. A Gênes on armait encore d'autres galères pour rejoindre la flotte, et pour éclairer la marche d'un si précieux convoi. Mais sans attendre ce renfort Malocello et ses conseillers crurent que le parti le plus sûr était de brusquer le voyage. On remit en mer; ce fut pour essuyer le plus grand désastre. Les galères de Frédéric, commandées par Hensius son bâtard et par Andriolo Mari, fils de l'amiral Ansaldo, renforcées par tout ce que Pise avait pu armer de bâtiments, enveloppèrent, entre le rivage pisan et l'île Meloria, la flotte génoise encombrée de ses vénérables passagers et gênée dans ses mouvements par leur terreur. La défaite fut complète; sur vingt-deux galères dix-sept furent prises; cinq seulement échappèrent. Trois légats, desquels deux étaient cardinaux, une foule de prélats, évêques, archevêques, abbés, clercs, députés des villes guelfes, furent prisonniers avec un bagage immense. Ces illustres captifs furent renfermés dans les prisons de Pise. Quant aux Génois qui étaient sur les galères capturées, la plupart trouvèrent le moyen d'échapper à leurs conducteurs pendant qu'on débarquait tant de prisonniers notables.
A cette fatale nouvelle, la terreur fut grande dans la ville. Cependant le podestat et le conseil écrivirent au pape une lettre pleine de noble fermeté, et même de consolations et d'encouragements pour le pontife. Mais ce fut en vain. Ses espérances étaient détruites, son concile ajourné. Sa haine contre Frédéric trompée au moment où il croyait le satisfaire, il ne put soutenir ce coup inattendu; l'inflexible vieillard n'y survécut pas longtemps.
(1242) Autour de Gênes, Pallavicini redoubla ses efforts et occupa plusieurs châteaux sur les sommités de l'Apennin. La république implora des secours pour se garantir des entreprises de l'ennemi dans un moment si critique. Il lui vint de Milan des fantassins et quelques cavaliers. Mais la plus grande crainte du public était pour le convoi des bâtiments du commerce de la Syrie, d'Alexandrie et de Chypre, dont le retour était attendu à tout moment et dont Mari et les Pisans ne manqueraient pas de tenter la capture. Tout ce qu'on put armer de bâtiments fut envoyé au- devant; et quand le convoi parut, il se trouva assez de forces devant ceux qui le poursuivaient pour les arrêter et pour lui donner le temps d'entrer en sûreté dans le port de Gênes: c'étaient des richesses immenses mises à couvert. Cet événement remonta les courages. Par un nouvel effort de Gênes on eut cinquante et une galères armées sous le drapeau de Saint-George. Les flottes opposées firent alors une longue guerre d'évolutions et de chicane. Quand les galères génoises allaient à la recherche de leurs adversaires, Mari venait braver la ville et se montrer jusque dans le port. Repoussé, il s'écartait devant la flotte ramenée au secours de Gênes par les signaux du phare.
CHAPITRE VIII.
Innocent IV. - Les Fieschi.
(1243) Le cardinal Sinibalde Fiesco, frère du comte de Lavagna, citoyen de Gênes, fut nommé souverain pontife sous le nom d'Innocent IV. Un successeur donné à Grégoire, peu après sa mort, n'avait vécu que peu de jours. Les cardinaux étaient tellement dispersés que six ou sept seulement se réunirent pour une nouvelle élection. Parmi eux quelques-uns passaient pour dévoués à l'empereur, disposition qui rendait difficile l'accord d'où la nomination devait sortir. Ils étaient d'ailleurs peut- être autant de candidats que d'électeurs, et le petit nombre excluait ces combinaisons où la foule entraîne les volontés et emporte les espérances. Chacun pouvait s'opiniâtrer longtemps dans ses prétentions personnelles. La vacance fut de plus d'un an. Frédéric affectait de s'en plaindre. Il appelait enfants de Bélial les cardinaux qui tardaient à donner à l'Église un pasteur, et par lui la paix au monde. Enfin le cardinal Fieschi fut nommé. Jusque-là il avait paru favorable à l'empereur et même attaché à sa personne. Néanmoins celui-ci ne s'y trompa pas; il prévit qu'il avait perdu un ami dans le collège des cardinaux et acquis un ennemi nouveau dans la chaire de Saint-Pierre. Il essaya cependant de se prévaloir de l'ancienne familiarité. Il proposa de marier Conrad son fils et son héritier à une nièce d'Innocent. Il offrit de grandes concessions à l'Église. On l'amusa de promesses et on lui demanda incessamment de nouveaux sacrifices. Il sollicitait une entrevue du pape; il n'aurait pu ni être reçu ni s'aventurer dans Rome, mais on pouvait se rencontrer au dehors, et à cet effet le pape vint à Sutri; mais il ne tarda pas à croire que l'empereur lui tendait un piège et voulait attenter à sa liberté.
(1244) Gênes avait été dans la joie à la nouvelle de l'exaltation d'Innocent. On avait alors Philippe Visdomini pour podestat; c'était un noble de Plaisance qui, ayant déjà rempli les mêmes fonctions, il y avait quelques années, savait bien ce qui convenait aux Génois et par quels moyens on pouvait influer sur eux. Il avait entrepris de concilier au gouvernement ceux des gibelins qui étaient encore dans la ville; le rapprochement qui se traitait entre Frédéric et le pape avait secondé cette louable intention. Mais un frère mineur lui fut secrètement dépêché par Innocent. Immédiatement après on répandit que Frédéric, toujours irrité contre les Génois, envoyait une flotte à Tunis pour y intercepter le commerce de la république; qu'il était indispensable d'armer, et d'expédier dans ces parages pour la protection des convois. Quand, sous ce prétexte, une flotte de vingt-deux galères fut prête, une nuit le podestat y monta avec Albert, Jacques et Hugues Fieschi, neveux du pape, et avec quelques autres nobles à qui fut révélé le mystère de l'expédition. On mit à la voile et l'on gagna la haute mer, afin qu'au jour on ne fût vu d'aucune des côtes de l'Italie. On reconnut le cap Corse, et de là, tournant rapidement vers le rivage romain, on parvint heureusement à Civita-Vecchia. Innocent, qui en attendait impatiemment l'avis, sortit de Sutri aussitôt, il se rendit sur la flotte; ses cardinaux, ses prélats le suivirent. On repartit, on pressa la navigation, on n'eut de repos qu'en se voyant dans le port de Gênes. La réception y fut magnifique; la joie d'avoir pour hôte un pape concitoyen était au comble. Les galères qui avaient porté ce précieux fardeau et son cortège sacré se couvrirent de drap d'or et de soie. L'archevêque et son clergé, les nobles, les chevaliers et les matrones, toute la population enfin vinrent au-devant du successeur de saint Pierre; et à travers les rues, toutes tendues de riches étoffes jusqu'aux plus misérables passages, on le conduisit en triomphe au palais archiépiscopal.
Frédéric était à Pise. La nouvelle de la fuite du pape et de son arrivée à Gênes le frappa d'un coup inattendu. Il essaya de renouer la négociation. Innocent, dans ce qu'on lui offrait prétendit ne voir que des paroles sans garanties, il n'entendit à rien et se décida à se mettre en sûreté à Lyon. Gênes avait pourvu à sa garde par une escorte convenable, et tous les secours nécessaires lui furent libéralement prodigués. Parvenu à Lyon il convoqua aussitôt un concile; l'un des Fieschi fut au nombre des ambassadeurs que Gênes y envoya. Frédéric y fut cité et montra quelque intention de s'y rendre. Il passa à Pavie et de là à Alexandrie, dont les habitants lui livrèrent les clefs de leur ville. Il parut à Tortone, et ce voisinage inquiéta beaucoup Gênes. Cependant la nouvelle de son excommunication et de sa déposition prononcée au concile l'offensa vivement. Il alla raffermir ses partisans de Crémone et de Parme.
(1245) L'assistance donnée au pape redoublait l'animosité contre Gênes. La guerre maritime ne s'arrêtait point. Les succès en étaient variés, le commerce payait toujours les pertes.
Frédéric était fatigué à l'excès de cette contention longue et cruelle qui l'empêchait de jouir de son pouvoir et du repos, qui avait troublé la paix jusque dans ses foyers domestiques et dans ses affections privées. Il haïssait, dit-on, les partis et leurs noms, quoiqu'il fût obligé de se servir d'une faction pour se défendre. Il eût volontiers transigé avec le pontife. Innocent s'était hâté de consolider l'anathème qu'il lui avait lancé de Lyon, en reconnaissant un nouveau César. C'était le landgrave de Thuringe. Ce prince, qu'on appela l'empereur des prêtres, avait notifié (1246) son avènement aux Génois par des lettres flatteuses, où les assurances de sa dérisoire protection impériale n'étaient probablement pas séparées de quelques demandes de subsides. Mais la mort débarrassa bientôt la scène politique de ce personnage importun (1247). C'était un obstacle de moins à la réconciliation de Frédéric. Il trouvait aussi un médiateur puissant; il recourait à saint Louis pour obtenir l'indulgence du pape; Louis s'adressait à lui à son tour pour un grand intérêt. C'était le temps où ce roi se préparait à partir pour la croisade. Les guelfes n'avaient pas manqué de répandre que Frédéric, en digne excommunié, avait résolu de fermer les passages au saint roi. Louis avait à s'assurer qu'un tel obstacle ne lui serait pas opposé. Il obtint aisément le démenti des projets hostiles attribués à Frédéric contre son pieux dessein (1248). La négociation, pour réconcilier le pape et l'empereur, fut moins facile. Frédéric parut déterminé se rendre à Lyon pour y faire une pleine soumission. Mais, au moment du départ, il apprit que Parme avait enfin secoué son joug et renoncé à son parti. Sa colère se réveilla et l'emporta sur toute autre résolution. Il rétrograda aussitôt, appelant ses fidèles Crémonais et toutes ses forces devant la ville révoltée. En arrivant sous les murs, il jura solennellement de ne pas les abandonner qu'il n'en fût devenu maître; prévoyant un long siège, pour gage de sa résolution sur la place où il campait, il jeta les fondements d'une ville nouvelle destinée à remplacer celle qu'il allait détruire, et il l'appela Vittoria par anticipation de sa prochaine victoire. Ses ennemis ne laissèrent pas les Parmesans sans secours. A la sollicitation des Plaisantins accourus à leur défense, Gênes envoya quatre cent cinquante arbalétriers pour son contingent. Mais les assiégés ne perdirent pas courage. Dans une sortie heureuse ils surprirent l'empereur, ils dispersèrent et détruisirent son armée. Frédéric se sauva presque seul, son trésor Tut pillé, l'enceinte de Vittoria fut forcée, les Parmesans détruisirent les fondements de cette cité nouvelle qui s'élevait pour leur honte. Le malheureux Frédéric, après avoir vainement tenté de nouveau de se réconcilier avec le pape, abandonna la haute Italie à elle-même et se retira dans la Pouille; mais deux ans après il y termina tristement sa vie toujours agitée et à la fin si malheureuse.
Sa disgrâce et surtout sa mort mirent en Italie une vive agitation dans les esprits. Les guelfes étaient triomphants et les gibelins abattus (1250). Déjà une partie de la Ligurie orientale, qui s'était donnée à l'empereur, avait embrassé le parti contraire et emprisonné son vicaire impérial. Plusieurs lieux détachés de l'obéissance des Génois s'y étaient volontairement remis. A la nouvelle de la mort de Frédéric, des députés de Savone et d'Albenga et avec eux Jacques de Caretto qui avait dirigé l'insurrection, vinrent demander à être reçus en grâce. Des conditions furent dictées; Savone consentit de nouveau à la démolition de ses murailles; enfin la rivière occidentale rentra paisiblement sous la juridiction de la république. Pise même envoya un religieux pour témoigner le désir de rétablir la concorde, afin, disait-elle, que le Pisan pût librement aller à Gênes et le Génois à Pise. Gênes mettait pour seule condition à la paix que Lerici, au fond du golfe de la Spezia, lui serait abandonné. Mais les Pisans répondirent qu'ils céderaient plutôt un quartier de leur propre ville. Les Vénitiens, à cette époque, renouvelèrent avec Gênes le traité existant dont le terme était près d'expirer.