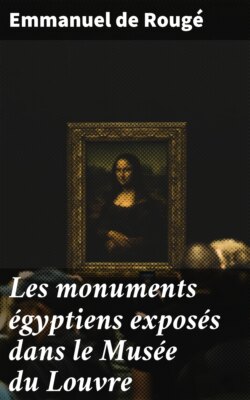Читать книгу Les monuments égyptiens exposés dans le Musée du Louvre - Emmanuel de Rougé - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
AVANT-PROPOS.
ОглавлениеTable des matières
Un musée égyptien n’était, au commencement de notre siècle, qu’une collection d’objets antiques dont la signification, l’âge et souvent la véritable origine restaient également inconnus. S’il n’en est plus de même aujourd’hui; si nous pouvons expliquer la destination de chaque monument et définir son âge historique; si nous savons nommer les souverains qui ont construit ou réparé les temples d’Égypte, et reconnaître leurs figures dans les statues de nos musées; si la religion de Thèbes et de Memphis a laissé pénétrer ses principaux mystères, c’est à Champollion que revient la gloire d’avoir créé ces lumières inespérées. Les travaux de notre illustre compatriote ont fondé toute une science nouvelle. Avant qu’on eût déchiffré les textes égyptiens, on ne connaissait, de l’histoire des Pharaons, que quelques traditions recueillies par les auteurs grecs et reproduites dans des récits incomplets et souvent contradictoires. Des listes de rois, peu concordantes entre elles et d’une authenticité douteuse, donnaient seules quelques idées sur la succession des temps et sur les grandes révolutions qu’avait subies la vallée du Nil. Aussi les premiers chronologistes chrétiens n’avaient-ils pas pu établir une concordance satisfaisante entre l’histoire hébraïque et l’histoire égyptienne pour les événements rapportés dans la Bible, même jusqu’à l’époque de Salomon. Au delà, tout était incertitude. Si les voyageurs continuaient d’âge en âge à venir admirer les ruines de Thèbes, ils n’y trouvaient plus, comme au temps des Romains, le prêtre qui pouvait leur expliquer les scènes sculptées sur les vieux pylônes; l’époque historique des monuments, le nom des rois vainqueurs et celui des nations vaincues, tout était retombé dans un oubli qu’on pouvait croire éternel.
Même après la grande publication de la commission d’Égypte, on n’avait pas remarqué, sur les monuments des époques les plus distantes, des différences assez sensibles pour qu’on pût songer à tracer une histoire de l’art égyptien, et l’on avait cru trouver des indices de la plus extrême antiquité sur les temples que nous reconnaissons aujourd’hui pour les œuvres des Ptolémées et des Césars.
La confusion était à peu près aussi complète en ce qui concerne la mythologie des Égyptiens: défigurée, chez les auteurs grecs, par des assimilations arbitraires avec les divinités helléniques; étouffée, chez les gnostiques, sous les uperstitions empruntées à divers peuples d’Asie; interprétée d’une manière suspecte tant par les premiers apologistes chrétiens que par les philosophes néoplatoniciens, la religion de la vallée du Nil restait aussi peu connue dans ses détails que dans ses croyances fondamentales.
Nous sommes heureusement sortis de cette complète ignorance à la suite de Champollion; mais, pour jouir des résultats que nous devons au déchiffrement des hiéroglyphes, avec une entière sécurité d’esprit et avec une conviction éclairée sur la certitude de nos méthodes de déchiffrement, il faudrait se livrer à des études longues et difficiles que peu d’hommes instruits ont le temps ou la volonté d’entreprendre. Un esprit raisonnable sera néanmoins entraîné à nous accorder quelque croyance en remarquant que tous les pays civilisés comptent aujourd’hui, parmi l’élite de leurs savants, des hommes qui consacrent leurs veilles à cette étude si féconde.
Il sera peut-être utile, pour augmenter la confiance que nous demandons aux lecteurs, d’exposer brièvement à l’aide de quels moyens le déchiffrement des textes égyptiens a été entrepris et se poursuit aujourd’hui avec tant de succès dans tous les centres scientifiques de l’Europe.
Le premier espoir du déchiffrement des hiéroglyphes fut donné par une inscription trouvée à Rosette et conçue en trois sortes d’écritures. La partie grecque faisait savoir que le même texte devait être reproduit sur ce monument, d’une part en langue grecque, et, de l’autre, dans l’écriture sacrée et dans l’écriture vulgaire de l’Égypte. Young, le premier, entreprit de décomposer en lettres le nom du roi Ptolémée Le groupe où l’on croyait le reconnaître était désigné à l’attention par une sorte de nœud ou d’enroulement elliptique que nous nommons cartouche, et dans lequel se trouvaient renfermés les signes servant à écrire le nom royal. Mais, quoique Young eût rencontré juste, quant au nom lui-même et quant à la valeur de certaines lettres, cet essai resta stérile entre ses mains, parce qu’il ne sut pas, dans son déchiffrement, démêler les vrais principes de l’écriture égyptienne. Champollion, reprenant cette idée, et comparant le nom de Ptolémée à celui de Cléopâtre, trouvé sur un autre monument bilingue, réussit à assurer la valeur d’un certain nombre de lettres. A l’aide de cette première decouverte, il eut bientôt déchiffré beaucoup d’autres noms grecs et romains, écrits en hiéroglyphes sur les monuments. Un second pas lui livra quelques mots égyptiens écrits avec ces mêmes lettres, et il put, du même coup, constater plusieurs principes très-féconds: 1° il y avait, au milieu des autre-signes, un certain nombre de lettres simples ou un alphabet hiéroglyphique; 2° ces lettres ne servaient pas seulement à écrire des noms propres étrangers, mais aussi des mots égyptiens; 3° ces mots dont le sens était connu par le texte grec, s’expliquaient très-bien par la langue copte, langue usuelle des premiers chrétiens d’Égypte.
Ces premières conquêtes portaient exclusivement sur les caractères égyptiens alphabétiques, mais les anciens attestaient unanimement que les Égyptiens avaient possédé des caractères symboliques, c’est-à-dire des signes qui valaient à eux seuls un mot, une idée entière. On connaissait même, par divers auteurs, l’explication de plusieurs de ces signes. Champollion retrouva et expliqua, par le texte grec de Rosette, un grand nombre de ces caractères symboliques. Il entrait dès lors dans l’intelligence des lois savantes et harmonieuses qui enchaînaient, chez les Égyptiens, l’usage simultané de ces deux sortes de caractères qui se fondaient en un seul système d’écriture. Ses idées, exposées de plus en plus clairement dans ses publications successives, furent enfin réduites en un code régulier dans sa grammaire hiéroglyphique. Il ne put mettre la dernière main à cet ouvrage, qui ne parut qu’après sa mort. La tâche de ses successeurs fut encore immense: il fallait donner aux diverses formules de l’écriture hiéroglyphique plus de précision, aux valeurs proposées une démonstration plus rigoureuse; il fallait poursuivre l’œuvre à peine commencée du dictionnaire et compléter la grammaire, dont la syntaxe n’était pas même ébauchée; il était nécessaire de comparer l’ancienne forme de la langue, constatée par le déchiffrement, avec les divers dialectes du copte, et de reconnaître les lois qui avaient présidé à la dégénérescence du langage antique. L’écriture vulgaire n’avait encore laissé pénétrer qu’empiriquement la valeur de quelques-uns de ses groupes; sauf une partie de l’alphabet, tout le système restait à découvrir. Il fallait enfin, à l’aide de la nouvelle méthode, étudier l’ensemble des monuments égyptiens, bibliothèque de pierres et de papyrus aux myriades de volumes; car Champollion n’avait pu qu’esquisser les premières notions de l’histoire et de la mythologie que ses lectures hardies venaient de lui révéler.
Chaque partie de cette immense étude a été l’objet de grands travaux, et l’école de Champollion voit chaque année paraître quelque savant mémoire ou quelque belle publication de planches, où les inscriptions sont sauvées à jamais de la destruction qui les menace sur le sol égyptien. Après les recueils de la commission d’Égypte, de Champollion et de Rosellini, la magnifique collection publiée par M. Lepsius, offre à la science une telle quantité de monuments inédits, qu’il semble, en les étudiant, que la vallée du Nil n’ait encore été parcourue par aucun dessinateur .
Tous ces efforts ont porté leurs fruits: on peut aujourd’hui traduire les trois quarts des plus longues inscriptions, quelquefois plus, quelquefois moins, suivant la difficulté du sujet.
Il est nécessaire d’expliquer ici les différences qui existent entre les trois systèmes d’écriture qui furent usités en Égypte. La première espèce était composée de figures d’animaux ou d’autres objets dessinés ou gravés.C’était spécialement l’écriture monumentale; on l’appelle l’écriture hiéroglyphique. Lorsqu’on s’en servait pour écrire les volumes de papyrus, on la disposait généralement en colonnes, et les formes des objets, devenues très-cursives, s’altéraient sensiblement.
Une plus grande abréviation des même signes, appropriée à l’usage rapide du calame, se nomme l’écriture hiératique; elle est disposée ordinairement en lignes horizontales et se lit de droite à gauche, comme les écritures dites sémitiques. Son intelligence présente donc une première difficulté de plus, à savoir de reconnaître chacun des signes hiéroglyphiques ainsi abrégés. On s’est servi de cette écriture, depuis des temps extrêmement reculés, pour écrire les livres sur le papier indestructible que donnait l’écorce du papyrus.
La troisième écriture, celle que les Grecs ont appelée démotique ou vulgaire, est une dernière simplification et une altération de l’écriture hiératique. On la trouve usitée pour les usages civils depuis le septième siècle avant notre ère; elle servait à écrire les textes rédigés dans la langue vulgaire, laquelle s’éloignait dès lors considérablement de la langue antique, dont les prêtres conservaient l’usage pour les textes sacrés. L’écriture démotique est aussi devenue accessible dans son ensemble, surtout depuis les travaux du docteur Brugsch, de Berlin, qui a rédigé la grammaire de la langue et de l’écriture vulgaire des égyptiens.
J’ai dit que l’on comprenait plus ou moins complètement les textes égyptiens, suivant la difficulté du sujet; il est facile de se rendre compte des obscurités toutes particulières qu’offrira, par exemple, un texte mythologique, souvent mystérieux à dessein. Les métaphores hardies des hymnes ou des récits poétiques seront moins facilement saisies qu’une généalogie ou un simple récit. Il y a, en effet, dans les textes égyptiens qui nous sont parvenus, des matières de toute espèce, outre les légendes et les grandes inscriptions, dont nous donnerons une idée dans cette notice en expliquant les monuments.
La plupart des manuscrits égyptiens que l’on a retrouvés ne contiennent que des textes funéraires. Ce sont des extraits plus ou moins longs du livre des morts dont nous exposerons le sujet à la salle funéraire; mais on a aussi rencontré quelques manuscrits d’un autre ordre. Une sorte de petite bibliothèque, trouvée à Thèbes, nous a donné des fragments de toute espèce écrits vers l’époque de Moïse. Plusieurs de ces fragments sont datés, ce qui nous permet d’affirmer qu’ils appartiennent à la littérature qu’a dû étudier dans sa jeunesse le grand législateur des Hébreux. Livres de morale et de médecine, textes mythologiques et calendriers, récits et poëmes historiques, ou simples exercices littéraires, on y a reconnu des fragments de toute espèce. J’ai même eu le bonheur d’y rencontrer une sorte de légende merveilleuse, analogue à certains récits orientaux, mais empreinte d’une couleur tout égyptienne, et qui n’est pas sans analogie avec l’histoire du patriarche Joseph .