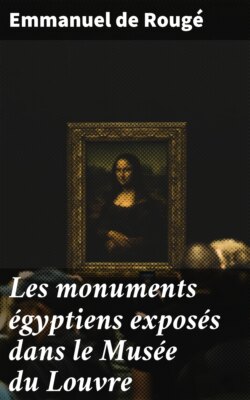Читать книгу Les monuments égyptiens exposés dans le Musée du Louvre - Emmanuel de Rougé - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE D’ÉGYPTE.
ОглавлениеTable des matières
Les annales égyptiennes commençaient, comme celles des autres peuples, par des légendes se rapportant à des dieux, des demi-dieux et des héros fabuleux. Menés était indiqué comme le premier des rois humains qui eût réuni sous un même sceptre toute la monarchie égyptienne. Les monuments confirment cette tradition. On trouve le cartouche de Ménès à la tête de ceux des rois historiques, et nous connaissons quelques traces d’un culte commémoratif qui lui fut rendu à Memphis. L’histoire lui attribuait la construction de la grande digue qui détourna le cours du Nil pour obtenir l’emplacement de cette capitale de la basse Égypte. Nous ne voyons pas de raison sérieuse pour douter de la réalité de ce fait, quoique nous ne connaissions aucun monument contemporain de ce roi. Manéthon, l’historien national, a divisé la série des rois successeurs de Ménès en dynasties, et nous nous servirons de ce terme pour classer les faits dans la série des âges; le vague même que laisse dans l’esprit l’expression de dynastie convient à merveille à l’incertitude absolue dans laquelle nous laissent les divers systèmes quant à la chronologie de ces premières époques. Nous ne savons rien de précis sur les deux premières dynasties; le premier monument auquel nous puissions assigner un rang certain se place vers la fin de la troisième: c’est un bas-relief sculpté à Ouadi-Magara; il représente le roi Snéwrou faisant la conquête de la presqu’île du Sinaï. Ce roi, souvent cité depuis, fonda, le premier, un établissement égyptien pour exploiter les mines de cuivre de cette localité .
Ses successeurs furent célèbres dans le monde antique; Hérodote a conservé leur mémoire: ce sont les auteurs des pyramides de Gizeh. C’est au groupe de la quatrième dynastie qu’appartiennent les rois Khouwou (Chéops), Khawra (Chephren) et Menkérès (Mycérinus). Ainsi, dès la quatrième dynastie, les rois d’Égypte avaient la puissance et la richesse nécessaires pour se livrer à ces colossales entreprises dont la grandeur n’a jamais été surpassée Ces rois possédaient probablement la Thébaïde en même temps que la basse Égypte. Ce qui est certain, c’est qu’ils sont cités sur les monuments de Thèbes parmi les ancêtres royaux des souverains thébains. Les bas-reliefs sculptés à Ouadi-Magara sont les seuls de cette époque qui nous rappellent des expéditions militaires; mais les temples et les palais sont écroulés, les tombeaux seuls ont survécu.
Ces mêmes tombeaux nous conduisent, à travers une période où l’empire paraît avoir été divisé, jusqu’à une famille qui a laissé plus de trace dans les monuments. Le personnage le plus remarquable des successeurs de Menkérès semble avoir été le roi Pépi-meri-ra. Il régnait sur la haute Égypte et sur l’Égypte moyenne; il était également maître des établissements égyptiens du Sinaï. Peut-être même réunissait-il tout l’empire sous son sceptre; les monuments de son règne sont assez nombreux, et l’on conjecture, avec vraisemblence, qu’il est le même que le roi Phiops, placé par Manéthon dans la sixième dynastie, avec un règne de près de cent ans.
La première dynastie thébaine est la onzième dans l’ordre de Manéthon; il paraît certain qu’elle se composa de souverains partiels: le nom dominant dans cette famille se lit Antew. On a trouvé à Thèbes le tombeau de ces princes et notre musée possède deux cercueils qui en proviennent.
La seconde époque de grandeur pour la monarchie égyptienne, réunie alors sous un seul sceptre, commença avec la douzième dynastie.
Manéthon nomme le premier roi Aménèmès ( Amenemha, des monuments). Ici les inscriptions, plus nombreuses, permettent déjà d’apprécier plus complètement l’état de l’Égypte sous cette puissante famille. Au nord, ses rois possédaient la presqu’île du Sinaï, et ils se vantent de leurs continuelles victoires sur les peuples voisins. Au midi, la douzième dynastie étendit au loin sa domination. Ousourtasen Ier avait reculé ses frontières jusqu’à Ibsamboul; ses successeurs les portèrent jusqu’à Semneh et assurèrent à l’Égypte la possession de toute la Nubie. La vallée du Nil se couvrit de temples; la province du Fayoum vit s’élever le Labyrinthe, autre merveille du monde antique, et de nouvelles pyramides continuèrent la rangée majestueuse des tombes royales sur la limite du désert.
Les peintures des tombeaux conservés à Beni-Hassan font voir que les Égyptiens connaissaient dès lors les diverses variétés de la race humaine, et que le commerce ou la guerre les avait déjà mis en rapport avec les nations asiatiques.
La fin de cette dynastie, où nous trouvons une reine nommée Sebeknowréou, semble avoir amené des divisions. Quelques savants pensent que, dès le commencement de la treizième dynastie, arrivèrent les invasions des peuples nomades de l’Asie, que l’histoire nous désigne sous le nom de pasteurs. Il faut néanmoins remarquer que les rois nommés Sebekhotep et Nowrehotep, qui appartiennent à cette dynastie, étaient encore de puissants princes. Nous avons une grande statue de granit rose représentant Sebekhotep III, qui fut trouvée, dit-on, dans la basse Égypte. Un de ses successeurs faisait élever d’immenses colosses dans l’île d’Argo, au fond de l’Éthiopie. Tous ces travaux semblent indiquer encore une souveraineté paisible. On possède une très-longue liste des rois qui suivirent les Sebekhotep; ils constituent les quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième dynasties, sous lesquelles Manéthon place l’invasion des pasteurs.
Ce grand désastre et la longue oppression qui en fut la suite sont attestés par tous les souvenirs historiques. L’interruption violente de la série monumentale en est aussi la preuve la plus directe. On peut croire que tous les temples furent renversés; car il y eut une guerre religieuse, indépendamment de la soif du pillage qui préside à toutes les incursions des peuples nomades. L’emplacement des temples antiques se reconnaît par les arasements et les anciennes fondations, sur lesquels on reconstruisit les nouveaux sanctuaires, après la restauration de l’empire égyptien par la dix-huitième dynastie .
Rien n’est concordant dans les récits divers que les auteurs nous ont transmis de cette époque de servitude, et naturellement les monuments y font défaut. Nous ne pouvons donc pas savoir au juste s’il faut placer l’invasion, comme semble l’indiquer Manéthon, à la quinzième dynastie; mais il est certain qu’elle finit sous Amosis, avec la dix-septième. Un récit égyptien, conservé dans un papyrus , nous montre quel était l’état du pays vers la fin de cette période. Un roi ennemi, nommé Apapi, régnait dans Avaris, place forte du Delta. Il exigeait le tribut de toute l’Égypte; il était ennemi de la religion du pays. Ses exactions ayant amené une guerre qui fut longue et sanglante, le prince de la Thébaïde, nommé Raskenen-Taaaken, finit par réunir les autres princes d’Égypte et obtint des succès contre les pasteurs; mais la gloire d’expulser ces étrangers fut réservée à l’un de ses successeurs, Amosis.
Ici les textes égyptiens viennent encore au secours des historiens, peu d’accord entre eux sur l’époque du fait. Une inscription contemporaine montre qu’Amosis, après plusieurs batailles, s’empara d’Avaris et se débarrassa définitivement des pasteurs vers la sixième année de son règne . Il put aussitôt tourner ses armes contre les Nubiens révoltés. A la fin de son règne, nous le voyons occupé à rouvrir paisiblement les carrières de Tourah pour en extraire les blocs destinés à relever partout les temples des dieux.
A partir de ce moment, décisif pour la puissance de l’Égypte, commence la série des triomphes qui rendirent ce pays l’arbitre du monde pendant plusieurs siècles. Aménophis Ier affermit les conquêtes faites sur les frontières au nord et au midi. Toutmès Ier conduit ses armées en Asie, et porte le premier le cimeterre royal jusqu’en Mésopotamie. Sa fille, pendant une longue régence, semble s’être spécialement préoccupée d’embellir les temples; ToutmèsII, son frère, fit des campagnes heureuses en Éthiopie et en Palestine. La régente paraît avoir ressaisi l’autorité après sa mort; mais à peine Toutmès III, son second frère, fut-il en possession du pouvoir souverain, qu’il entreprit une série d’expéditions dont le récit couvre les murailles de Karnak. Il fit passer sous son joug les peuples de l’Asie centrale, et nous voyons figurer parmi ses vassaux Babel, Ninive et Sennaar, au milieu de peuples plus importants alors, mais dont les noms se sont obscurcis dans la suite des temps.
L’Égypte soutient toute sa grandeur jusqu’au régne d’Aménophis III, qui fut aussi un prince guerrier; c’est celui que les Grecs nommèrent Memnon et dont le colosse brisé résonnait, dans la plaine de Thèbes, au lever du soleil; main la fin de la dix-huitième dynastie fut troublée par des usurpations et par une révolution religieuse. Aménophis IV ne voulut pas souffrir d’autre culte que celui du Soleil, représenté sous la forme d’un disque rayonnant. Des mains sortant de chaque rayon apportaient aux dévots mortels le signe de la vie. Ce roi fit effacer le nom du dieu Ammon sur les monuments, et nous devons à son fanatisme une quantité de mutilations les plus regrettables.
Ces révolutions intérieures avaient porté leurs fruits ordinaires. L’empire de l’Asie parait avoir échappé à des mains débiles et à un peuple divisé, lorsque la dix-neuvième dynastie amena sur le trône deux grands hommes qui restaurèrent le pouvoir et étendirent encore les conquêtes de l’Égypte. Séti Ier (que Manéthon nomme Séthos) trouva la révolte arrivée jusqu’aux portes de l’Égypte; il soumit de nouveau l’Asie centrale, qu’avaient dominée les Toutmès et les Aménophis. Les grands travaux qu’il fit exécuter à Thèbes prouvent que ses expéditions lui avaient assuré pour quelque temps une domination tranquille.
Le fils et successeur de Séti Ier est le plus grand conquérant des temps antiques, celui que les prêtres nommaient Ramsès, au témoignage de Tacite, lorsqu’ils montraient ses exploits sculptés sur les murs de Thèbes. Hérodote le nomme Sésostris, et Diodore Sésoosis, d’après un nom populaire . Son nom propre, sur les monuments, se lit Ramsès-Meïamoun; c’est exactement la forme conservée par Josèphe. Quelque exagération que l’on puisse supposer dans les récits officiels de ses exploits, Ramsès-Meïamoun, qui parvint à la couronne dès son enfance, paraît avoir été réellement un grand homme de guerre. Sa première campagne le conduisit en Éthiopie; dans les inscriptions qui la mentionnent, on donne déjà les éloges les plus outrés à la bravoure du jeune monarque. Les peuples de l’Asie centrale s’étant révoltés, Ramsès courut, dans la cinquième année de son règne, au-devant de la confédération des rebelles. Le prince des Khétas, qui en avait le commandement, ayant trompé par de faux rapports les généraux de Ramsès, le roi se trouva un instant séparé de son armée, et ne dut son salut qu’à des prodiges de valeur. Cet exploit fut le sujet d’un poëme qui devait jouir d’une grande vogue, puisqu’il eut l’honneur d’être gravé en entier sur une des murailles du temple de Karnak; un des papyrus de la collection Sallier nous a conservé une partie de ce poëme: la composition en est souvent remarquable, comme pensée et comme expression poétique. Ramsès triompha de la révolte, et d’autres expéditions étendirent encore ses conquêtes. On manque malheureusement de points de comparaison pour identifier d’une manière précise la plupart des places conquises par les Égyptiens dans ces temps si reculés. Déconcertés par leurs défaites successives, les chefs des Khétas vinrent enfin demander la paix. Dans la vingt et unième année de son règne, Ramsès leur accorda des conditions honorables dont l’exécution fut mise sous la garantie des divinités des deux nations. L’acte en fut gravé sur une muraille de Thèbes qui nous en a conservé des fragments importants. Il est à croire qu’une tranquillité durable suivit ces longues guerres, car Ramsès-Meïamoun put, pendant un règne de soixante-sept ans, couvrir l’Égypte de ses monuments. Il employa pour les construire les nombreux esclaves qu’il avait ramenés de ses conquêtes, et ce fait nous conduit naturellement à dire quelques mots de Moïse et du séjour des Hébreux en Égypte.
La chronologie présente trop d’incertitudes, tant dans l’histoire égyptienne que dans la Bible, et spécialement quand il s’agit de mesurer la période des Juges, pour que l’on puisse, a priori, et par un simple rapprochement de dates, définir sous quel roi eut lieu la sortie d’Égypte. La difficulté est encore plus grande quand il s’agit du patriarche Joseph, puisque la longueur du temps de la servitude en Égypte est elle-même l’objet de nombreuses controverses. Moïse ne se sert jamais que du mot générique Pharaon, qui veut dire le roi. Mais en recueillant soigneusement les particularités éparses dans le récit biblique, on y trouve d’abord un roi qui forçait ses esclaves à bâtir la ville de Ramsès dans la basse Égypte. Ensuite, lorsqu’on veut calculer le temps que Moïse dut passer chez Jéthro pour fuir la colère du roi, si l’on réfléchit que Moïse tua l’Égyptien dès qu’il fut parvenu à la virilité et que le livre saint lui donne quatre-vingts ans à l’époque de la sortie d’Égypte, on voit que le règne indiqué fut excessivement long. La Bible dit, en effet: «Après un long temps le roi mourut.» Un seul Ramsès convient à toutes ces circonstances, c’est Ramsès II, qui régna soixante-sept ans, et qui fit en effet construire dans la basse Egypte une ville à laquelle il donna son nom . Moïse revint d’Arabie aussitôt qu’il apprit la mort du souverain qu’il avait irrité. Le récit des plaies de l’Égypte et de la terrible catastrophe qui accompagna la sortie des Israélites, ne paraît compatible qu’avec un petit nombre d’années. Ménéphthah, fils de Ramsès II, est sans doute le Pharaon de la mer Rouge; mais le récit de Moïse autorise à penser que le roi ne fut pas personnellement victime de ce désastre. Il paraît, en effet, avoir régné dix-neuf ans, et peut-être ne s’est-il pas écoulé un temps aussi long entre le retour de Moïse et le passage de la mer Rouge. On n’a pas retrouvé, sur les monuments, la trace de ces premières relations des Israélites avec l’Égypte, et il serait bien extraordinaire qu’ils eussent enregistré ce désastre ailleurs que dans les annale; les sculptures des temples ne rappellent jamais que des victoires.
La puissance des Égyptiens et leur domination en Asie se soutinrent, malgré une succession de révoltes , pendant toute la dix-neuvième dynastie et pendant une partie de la vingtième, qui se compose exclusivement de rois nommés Ramsès comme leur aïeul. Ramsès III parait aussi avoir fait de grandes conquêtes en Asie, et ses monuments présentent la circonstance remarquable d’une bataille navale. Les expéditions, pacifiques ou belliqueuses, qui s’étaient multipliées, avaient amené des rapports intimes entre les Égyptiens et les nations asiatiques. Les uns faisaient des voyages en Mésopotamie; c’étaient des officiers envoyés par le prince pour gouverner les provinces, surveiller les stations établies et commander les garnisons mises dans les places fortes. Les autres venaient jusqu’en Égypte, soit pour faire le commerce, soit pour consulter les médecins égyptiens, dont le savoir était déjà renommé, probablement les magiciens qui luttèrent avec Moïse. Un monument trouvé à Thèbes nous montre un prince de la Mésopotamie qui envoie solennellement chercher un dieu thébain pour venir au secours de sa fille, possédée d’un esprit malin. Le roi d’Égypte avait épousé la sœur de cette princesse. Ramsès-Meïamoun, le grand conquérant, avait lui-même épousé la fille du prince des Khétas, son plus vaillant ennemi.
A la suite de ces alliances, quelques divinités asiatiques avaient été admises dans le Panthéon, et la Vénus des bord de l’Euphrate eut à Thèbes un temple et des prêtres qui l’invoquaient sous les noms de Qadesch et d’Anata. Baal et Astarté avaient aussi des autels officiels dans la ville de Ramsès. Cette domination de plus de cinq siècles que l’Égypte exerça sur l’Asie centrale est un fait historique des plus importants; c’est de là que dérivent une foule de rapports entre les populations de l’Égypte, de l’Assyrie et de la Phénicie.
Vers la fin de la vingtième dynastie, les grands prêtres d’Ammon s’emparèrent petit à petit de l’autorité et finirent par succéder à la famille des Ramsès. Moins belliqueux peut-être, ils ne surent pas conserver la suprématie de leur nation. Les grands empires d’Asie prenaient plus de force et de développement; l’Égypte fut réduite à ses limites naturelles. La vingt-deuxième dynastie amena pourtant sur le trône un conquérant: le roi Scheschonk (le Schischak de la Bible) recouvra une partie de la Syrie. Les trésors rassemblés par David et Salomon lui apprirent le chemin de Jérusalem, et l’on voit figurer parmi ses captifs le malheureux Roboam, les mains liées derrière le dos, avec cette inscription: Juda roi . Néanmoins, l’empire des Assyriens devint alors trop puissant pour que les Égyptiens pussent désormais régner d’une manière durable en Asie, et leurs expéditions les plus heureuses se terminèrent par de stériles victoires ou par l’asservissement de quelques parties de la Palestine et de la Syrie.
«L’établissement des rois de race éthiopienne sur le
«trône des Pharaons résulta de leurs victoires, rendues
«plus faciles par les divisions des divers partis
«égyptiens: mais la faveur marquée qui salua leur intronisation
«dans la Haute-Égypte fut la conséquence d’anciennes
«alliances qui liaient cette famille avec les grands-
«prêtres d’Amon, autrefois souverains de la Thébaïde. En
«effet, la dynastie de Sabacon nous apparaît maintenant,
«dans ses origines, comme la descendance d’un rameau
«thébain, détaché du tronc à la suite de quelque révolution
«que nous ne pouvons pas encore préciser et qui avait implanté
«au fond de la Nubie la langue, les mœurs et la religion
«de la mère-patrie. Tel est le résultat évident des
«monuments découverts en Ethiopie. Peu de temps avant
«Sabacon, suivant nos calculs, un roi puissant, nommé
«Piankhi-Meriamoun, et résidant à Napata, apparaît déjà
«comme possédant la Thébaïde en toute tranquillité et
«comme réduisant par la force, à l’état de vassaux, une
«vingtaine de personnages qui se partageaient la souveraineté
«dans tout le reste de l’Égypte.
«Sabacon doit avoir trouvé le pays à peu près dans le
«même état; rien n’indique qu’il ait eu quelque combat à
«soutenir contre les Thébains pour monter sur le trône,
«mais l’histoire nous apprend qu’il emporta de haute
«lutte la souveraineté de Memphis et qu’il fit mourir
«Bokkoris, après l’avoir vaincu. Il ne faudrait pas cependant
«conclure de cette vengeance que les Éthiopiens eussent
«des mœurs féroces ou fussent alors moins civilisés que
«leurs nouveaux sujets. Tous les détails de leurs monuments
«prouvent, au contraire, qu’ils voulurent justifier,
«aux yeux des peuples, leur prétention hautement proclamée
«de représenter le sacerdoce d’Amon. On vante partout,
«dans leurs inscriptions, la sagesse et la douceur de
«leur gouvernement, ainsi que le respect des rites sacrés
«et des droits des temples, auxquels ils consacrent de nouvelles
«offrandes. Piankhi-Meriamoun consigne ces faits à
«chacun des pas de sa marche victorieuse jusqu’aux extrémités
«de l’Égypte.» (DE ROUGÉ, De quelques monuments du règne de Tahraka.)
Sabacon a laissé à son tour de nombreuses preuves de son zèle pour la religion . On sait peu de choses de son successeur Schabatak, mais il eut aussi le soin de laisser à Karnak des preuves de sa fidélité au culte d’Amon.
Le règne de Tahraka, qui occupe le troisième rang dans cette dynastie, débuta par des victoires sur les Libyens et les Assyriens, qui prirent sur lui, l’an 23 de son règne, une terrible revanche, sous le commandement d’Assarhaddon. Ce roi d’Assyrie conquit le pays entier et le partagea entre vingt gouverneurs, mais Tahraka réorganisa ses forces en Éthiopie et parvint à se rétablir deux fois à Memphis. A sa mort une seconde invasion assyrienne, dirigée par Assurbanipal, eut pour résultat un pillage complet de l’Égypte.
Psammétik Ier, fils de l’un de ces gouverneurs imposés à l’Égypte par les Assyriens, inaugura la vingt-sixième dynastie par un règne long et glorieux. A partir de cette époque les Grecs commencent à nous tenir au courant de l’histoire égyptienne. Les relations établies par les soldats auxiliaires que les rois saïtes prirent à leur service, ne s’interrompirent plus, et les événements de la vallée du Nil sont désormais enregistrés dans l’histoire ancienne avec les récits des autres nations. Nous insisterons ici seulement sur quelques points que les monuments nous ont fait mieux connaître.
La civilisation égyptienne s’imposa constamment à ses vainqueurs successifs. Cambyse, avant les fureurs qui s’emparèrent de lui à son retour d’Éthiopie, s’était fait reconnaître régulièrement comme roi légitime de l’Égypte; il avait accompli tous les rites religieux et subi l’initiation dans le temple de Sais. De nombreux monuments attestent que Darius suivit ces errements avec persévérance; aussi son autorité fut-elle acceptée facilement par les Égyptiens. Mais Ochus, par une conduite opposée, souleva tous les esprits contre lui.
Alexandre, en grand politique qu’il était, comprit que le plus sûr moyen d’établir sa domination dans l’esprit de ces peuples, était d’employer à son usage des préjugés qui avaient pour eux la force des siècles. C’est dans ce but qu’il fit son voyage à l’oasis d’Ammon. L’oracle le proclama fils du Soleil. en sorte qu’il représenta désormais, aux yeux des peuples d’Égypte, l’incarnation de la race du Soleil, à laquelle était due l’obéissance des humains. Il faut bien connaître les idées des Égyptiens sur la royauté pour pénétrer toute la portée politique de cet acte d’Alexandre. Les Ptolémées, ses successeurs, suivirent constamment son exemple. Les serviteurs de Jupiter continuèrent à être pour l’Égypte les dieux, fils du soleil, car en aucune région l’adoration de l’homme couronné ne prit un caractère d’idolâtrie plus complet et plus persistant que dans ce pays. Toutes les coutumes y avaient le même caractère de persistance; aussi l’archéologie doit-elle suivre l’Égypte tant que ses monuments restent réellement égyptiens, et ils conservent ce caractère pendant de longues années encore sous la domination des empereurs romains.