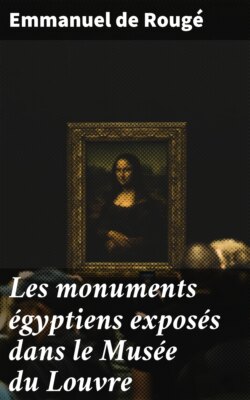Читать книгу Les monuments égyptiens exposés dans le Musée du Louvre - Emmanuel de Rougé - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
HISTOIRE DE L’ART EN ÉGYPTE.
ОглавлениеTable des matières
Ces longues générations, dont nous ne pouvons pas préciser les dates, ont vu s’accomplir diverses phases de l’art égyptien. Nos musées contiennent des échantillons suffisants pour en suivre les principales transformations. Nous ne connaissons pas les commencements de cet art; nous le trouvons dès les monuments de la quatrième dynastie, les premiers auxquels nous puissions assigner un rang certain, extrêmement avancé sous divers rapports. L’architecture montre déjà une perfection inconcevable quant à la taille des pierres dures et quant à la pose des blocs de grande dimension; les couloirs de la grande pyramide restent un modèle d’appareillage qui n’a jamais été surpassé. Nous sommes obligés de deviner le style extérieur des temples de cette première époque et de le restaurer d’après les bas-reliefs des tombeaux ou la décoration des sarcophages. Ce style était simple et noble au plus haut degré ; la ligne droite et le jeu des divers plans faisaient tous les frais de la décoration; un seul motif d’ornement varie ces dispositions, il se composait de deux feuilles de lotus affrontées .
Le caractère propre des figures, tant dans les statues que dans les bas-reliefs des premiers temps, consiste dans l’imitation d’un type plus fort et plus trapu. Il semble que, dans la suite des siècles, la race se soit amaigrie et élancée sous l’action du climat. Dans les monuments primitifs, on a cherché l’imitation de la nature avec plus de simplicité, et, en gardant toute proportion quant au mérite relatif des divers morceaux, les muscles y sont toujours mieux placés et plus fortement indiques.
Les figures conservent ce caractère jusque vers le milieu de la douzième dynastie; c’est à cette époque qu’elles prennent des formes plus grêles et plus allongées. L’architecture avait fait alors de grands pas quant à l’ornementation: on trouve, à la douzième dynastie, les premières colonnes conservées jusqu’à nos jours en Égypte: épaisses, cannelées et recouvertes d’un simple dé, elles ressemblent d’une manière frappante aux premières colonnes doriques.
Les bas-reliefs, dénués de toute perspective, sont souvent, dans le premier empire, d’une extrême finesse; ils étaient toujours coloriés avec soin. On en connaît où la liberté des attitudes et la vérité des mouvements semblent promettre à l’art égyptien des destinées bien différentes de celles qui lui furent réservées dans les siècles suivants. Les statues de pierre calcaire étaient souvent peintes en entier, les figures de granit étaient coloriées dans quelques-unes de leurs parties, comme les yeux, les cheveux et les vêtements.
Le chef-d’oeuvre de l’art du premier empire est une jambe colossale en granit noir, provenant d’une statue du roi Ousourtasen Ier; elle appartient au musée de Berlin. Ce fragment suffit pour prouver que la première école égyptienne était dans une meilleure voie que celle du second empire.
La gravure des inscriptions ne laisse rien à désirer dans ces premiers monuments égyptiens. Elle est en général exécutée en relief jusqu’à la cinquième dynastie. Les gravures en creux de la douzième dynastie n’ont été surpassées à aucune époque. Les obélisques d’Héliopolis et du Fayoum autorisent à supposer aussi des temples d’une grandeur et d’une magnificence en rapport avec ces beaux débris de la douzième dynastie. L’on sait, en effet, qu’une des merveilles du monde, le labyrinthe du Fayoum, avait été construit par un de ses rois.
L’invasion des peuples nomades parait avoir détruit les temples et les palais; nous ne jugeons plus actuellement l’art primitif d’Égypte que par les tombeaux. L’abaissement des Égyptiens, pendant cette époque, dut amener nécessairement une décadence, quoique les artistes réfugiés dans la Thébaïde et la Nubie eussent conservé scrupuleusement les traditions . Amosis, le restaurateur de l’empire, n’eut pas le loisir de faire des constructions, et l’on remarque sur quelques monuments d’Aménophis Ier, son successeur, une hésitation et une médiocrité qui s’expliquent facilement. Mais la victoire et la prospérité eurent bientôt donné à l’art égyptien un essor nouveau, et le plus beau style de la dix-huitième dynastie se marque dès Toutmès Ier. L’architecture développe toute sa grandeur, l’ornementation s’enrichit, et Syène fournit les obélisques de granit que le ciseau couvre des plus belles gravures. La sculpture se distingue alors particulièrement dans l’imitation de la figure humaine; l’étude de la nature est bien moins parfaite dans le modelé des membres, et les statues royales du musée de Turin, les plus belles que l’on connaisse, n’atteignent pas, sous ce rapport, certaines figures de l’époque primitive.
L’art se soutint à peu près à la même hauteur sous le règne de Séti Ier, qui commença la dix-neuvième dynastie. Il suffit de citer, à l’honneur de ce roi, la salle hypostyle de Karnak; mais on commence à trouver bien du mélange dans les œuvres très-nombreuses exécutées sous Ramsès II. Cette décadence se marque d’une manière beaucoup plus sensible dans les monuments des particuliers, et elle devient générale sous Ménephtah, son successeur. Le style égyptien conserve bien alors un certain caractère de grandeur, mais il est empreint trop souvent d’une rudesse et d’une laideur inouïe sous les derniers rois de cette famille. Entre cette époque et celle de Psammétik on trouve çà et là quelques ouvrages très-finement exécutés, et néanmoins on peut dire que l’art ne se releva réellement que sous la dynastie saïte. Si l’on examine, par exemple, la statuette du roi éthiopien Schabak, que renferme la villa Albani, on sera frappé de la beauté de ce bloc de prime d’émeraude, mais la sculpture est mauvaise. Les bons artistes manquaient sans doute, dans un temps où l’on confiait une aussi admirable matière à des mains aussi malhabiles. Les bas-reliefs et les inscriptions du temps du roi Scheschonk sont d’ailleurs, comme exécution, déjà bien inférieurs à ceux de Ramsès II.
La domination des Saïtes donna une physionomie toute spéciale à l’art égyptien. La gravure des hiéroglyphes prend, à cette époque, une finesse admirable, les belles statues se multiplient; on emploie avec préférence le basalte noir ou vert, cette roche d’un grain si fin et dont le sculpteur tire un merveilleux parti lorsque le ciseau triomphe complètement de sa dureté. Sans sortir du type égyptien, les membres des statues acquièrent plus de souplesse et de vérité. Maintenant que nous connaissons quelques-uns des modèles que les Égyptiens purent étudier à Babylone et à Ninive, dans les relations multipliées qui s’établirent à cette époque entre eux et les Assyriens, il nous est peut-être permis de supposer que ces relations eurent quelque part aux nouveaux progrès de l’art des Saïtes; mais, par compensation, nous reconnaissons bien plus visiblement l’influence égyptienne dans les productions des Phéniciens.
Les monuments égyptiens, sous la domination persane, ne montrent aucune décadence, et le style saïte se continue jusqu’aux Ptolémées; mais, à cette époque, le type grec fut, par sa beauté même, funeste à l’art égyptien: loin de l’améliorer, il ne fit qu’introduire dans les forme une rondeur mal assortie qui ne fut ordinairement que de la mollesse. On reprit l’usage général de la gravure en relief, mais les formes des caractères devinrent de plus en plus négligées et les matériaux moins bien choisis. Ces défauts allérent en empirant sous la domination romaine; une seule partie de l’art égyptien conserve son caractère au milieu de cette décadence. Les architectes d’Esné, d’Ombos et de Dendérah ne se laissèrent pas séduire par les lignes merveilleuses des édifices de Corinthe ou d’Athènes, et ils continuèrent à élever des temples dans un ordre purement pharaonique, aussi longtemps qu’ils travaillèrent en l’honneur de leurs dieux nationaux.
L’histoire de ces dieux, ou la mythologie égyptienne, est une des parties les moins avancées de la science: nous nous bornerons à en donner un aperçu en parlant de la salle des dieux, située au premier étage du Louvre.
Nous supposerons maintenant que le visiteur, entrant par la salle Henri IV, parcourt successivement les salles du musée égyptien, et nous appellerons son attention sur les morceaux qui sont de nature à exciter un intérêt plus général.