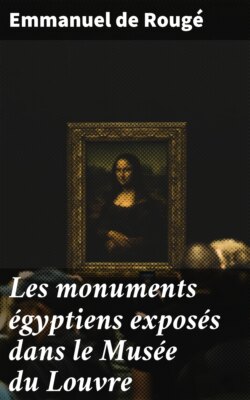Читать книгу Les monuments égyptiens exposés dans le Musée du Louvre - Emmanuel de Rougé - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHRONOLOGIE
ОглавлениеTable des matières
Nous avons évité, dans cette esquisse historique, d’assiner aucune date aux événements, et nous avons déjà indiqué quelle incertitude s’attachait aux calculs qu’on peut établir sur la chronologie des anciennes dynasties égyptiennes. Peut-être est-il nécessaire de faire connaître ici quelles sont les limites de nos connaissances à cet égard. Il serait inutile d’enregistrer dans un aussi bref résumé des chiffres qui ne ressortent pas de bases certaines. Là où il peut y avoir une foule de systèmes divers, il n’y a pas encore de véritable chronologie. Les Égyptiens n’ont employé aucun de leurs cycles astronomiques pour numéroter les années; on ne leur connaît pas non plus d’ère historique ; ils ne dataient leurs monuments que par l’année du souverain régnant: la moindre interruption dans les dates de ce genre vicie toute la série. Les listes de Manéthon, contenant la suite des dynasties égyptiennes, accompagnées de chiffres chronologiques, étaient la seule ressource qu’on pût employer pour tenter de rédiger une chronologie de l’histoire égyptienne, et l’on était, il y a quelques années, beaucoup trop disposé à les considérer comme un critérium infaillible. Cependant, aussitôt qu’on a pu confronter ces listes avec les monuments, on a dû revenir de cette idée. Si les listes de Manéthon ont acquis de l’importance en ce sens qu’on les a reconnues comme des documents historiques réellement émanés des sources égyptiennes, les chiffres qui y sont aujourd’hui annexés n’ont pu soutenir l’examen de la critique, éclairée par les monuments. Aussitôt que le canon de Ptolémée n’a plus guidé les faiseurs d’extraits, dès la vingt-sixième dynastie, la dernière avant l’invasion de Cambyse, les inscriptions ont décelé, dans ces chiffres, une erreur de dix ans. Une seconde erreur plus considérable ressert avec évidence des inscriptions nouvelles de la tombe d’Apis, pour les temps qui précèdent immédiatement Psammétik; de sorte que nous sommes plus que jamais obligés de nous défier des chiures chronologiques conservés dans les listes de Manéthon. Si ces chiffres sont inexacts pour des époques où les Grecs auraient pu venir presque directement au secours des chronologistes qui nous les ont conservés, quelle confiance pouvons nous avoir en eux quand il faut remonter à des époques plus reculées?
Voici maintenant ce que nous ont fait connaître les monuments étudiés jusqu’ici. On paraît d’accord sur ce point que Cambyse conquit l’Égypte dans la troisième année de son règne , qui est la deux cent vingt et unième année de l’ère de Nabonassar. Le canon chronologique, dressé par Ptol mée, nous escorte avec son invincible autorité jusqu’à cette époque, qui correspond à l’an 527 avant Jésus-Christ. La dynastie égyptienne qui précède les rois de Perse, la vingt-sixième, a retrouvé sa chronologie complète dans les monuments de la tombe d’Apis. Elle s’écarte assez sensiblement de celle que l’on avait pu dresser avec les listes de Manéthon. La première année du règne de Psammétik 1er répond à l’an 94 de l’ère de Nabonassar ou à l’année julienne 654 avant notre ère.
Les mêmes monuments montrent ici de nouveau une différence sensible avec les chiffres des listes; ils ne donnent qu’un très-petit intervalle entre Psammétik Ier et Tahraka, le dernier roi de la dynastie éthiopienne. Une inscription de la tombe d’Apis permet de calculer que le règne de Tahraka, commença vers l’an 685 avant Jésus-Christ, mais il y a déjà une incertitude de quelques années sur cette date. Ici s’arrête la région des chiffres exacts. En remontant encore, nous manquons de moyens pour vérifier les règnes des deux prédécesseurs de Tahraka. Les chiffres des listes paraissent rop courts; nous entrons dans le régime des corrections hasardées, dont les monuments ne nous dictent pas l’exacte quotité. Contentons-nous de dire que Bokkoris (vingt-quatrième dynastie) doit se placer vers 715; que le commencement de la vingt-troisième ou l’avènement de Pétubastes, remonte tout au commencement du huitième siècle. Ici l’erreur possible a déjà pris de grandes proportions.
La vingt-deuxième dynastie nous fournirait un point de comparaison et un moyen de rectification bien précieux dans le fait de la prise de Jérusalem par Schéschonk Ier, si la chronologie du livre des Rois était mieux définie; mais elle présente, dans les séries des rois d’Israël et de Juda, de nombreuses difficultés qui n’ont pas été résolues d’une manière satisfaisante.
M. de Bunsen place la prise de Jérusalem en 962: tout ce qu’une sage réserve nous permet d’affirmer, c’est que la vingt-deuxième dynastie parait, sur les monuments, beaucoup plus longue que les listes de Manéthon ne le donneraient à entendre, et que le règne de Schéschonk commença avant le milieu du dixième siècle.
Pour la vingt et unième et la vingt-deuxième dynastie, les inscriptions ne donnent que des dates partielles; nous sommes réduits à ces mêmes chiffres des listes, que nous trouvons toujours si défectueux à chaque fois que nous avons des monuments pour les contrôler. Il paraît certain que le chiffre de la vingtième est particulièrement tronqué. Les limites de l’erreur pourraient donc, à cette antiquité, dépasser facilement un siècle.
D’après un calcul de M. Biot, un lever de l’étoile Sothis indiqué à Thèbes sous Ramsès III, vers le début de la vingtième dynastie, se placerait au commencement du treizième siècle avant Jésus-Christ. Cette date nous paraît s’accorder à merveille avec la dernière époque que nous avons pu calculer et avec la durée probable des vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième dynasties.
Comme nous l’avons déjà dit, le synchronisme de Moïse avec Ramsès II (dix-neuvième dynastie), si précieux au point de vue historique, ne nous donne qu’une lumière insuffisante pour la chronologie, parce que la durée du temps des juger d’Israël n’est pas connue d’une manière bien certaine. On restera dans la limite du probable en plaçant Séti Ier vers 1450, et le commencement de la dix-huitième dynastie vers le dix-huitième siècle. Mais il n’y aurait nullement à s’étonner si l’on s’était trompé de deux cents ans dans cette estimation, tant les documents sont viciés dans l’histoire ou incomplets sur les monuments.
Nous voici remontés jusqu’au moment de l’expulsion des pasteurs. Ici nous n’entreprendrons plus même aucun calcul. Les textes ne sont pas d’accord sur le temps que dura l’occupation de l’Égypte par ces terribles hôtes, et les monuments sont muets à cet égard. Ce temps fut long; plusieurs dynasties se succédèrent avant la délivrance, c’est tout ce que nous en savons. Nous ne sommes pas mieux édifiés sur la durée du premier empire, et nous n’avons aucun moyen raisonnable de mesurer l’âge des pyramides, témoins de la grandeur des premiers Égyptiens. Si néanmoins nous venons à nous rappeler que les générations qui les construisirent sont séparées de notre ère vulgaire, d’abord par les dix-huit siècles du second empire égyptien, ensuite par le temps de l’invasion asiatique, et enfin par plusieurs dynasties nombreuses et puissantes qui nous ont laissé des monuments de leur passage, la vieillesse des pyramides, pour ne pouvoir pas être calculée exactement, ne perdra rien de sa majesté aux yeux de l’historien.