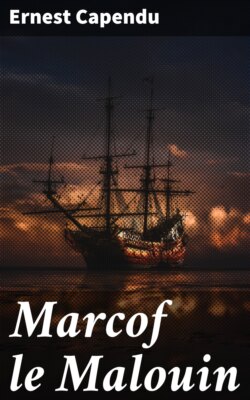Читать книгу Marcof le Malouin - Ernest Capendu - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIÉGO ET RAPHAEL.
ОглавлениеTable des matières
Le chevalier de Tessy et le comte son frère s'étaient éloignés assez vivement du château, se retournant de temps à autre comme s'ils eussent craint d'entendre siffler à leurs oreilles quelques balles de mousquet ou de carabine. Arrivés au bas de la côte, ils frappèrent à la porte d'une humble cabane, laquelle ne tarda pas à s'ouvrir. Un domestique parut sur le seuil. En apercevant les deux gentilshommes, il salua respectueusement, courut à l'écurie, brida deux beaux chevaux normands auxquels on n'avait point enlevé la selle, et, les attirant à sa suite, il les conduisit vers l'endroit où les deux gentilshommes attendaient. Le chevalier se mit en selle avec la grâce et l'aisance d'un écuyer de premier ordre. Le comte, gêné par un embonpoint prononcé, enfourcha néanmoins sa monture avec plus de légèreté qu'on n'aurait pu en attendre de lui.
—Picard, dit-il au valet qui lui tenait l'étrier, vous allez retourner à Quimper.—Vous direz à madame la baronne, que nous serons de retour demain matin seulement.
Le valet s'inclina et les deux cavaliers, rendant la bride à leurs montures, partirent au trot dans la direction de Penmarckh.
—Sang de Dieu! caro mio! fit le comte en ralentissant quelque peu l'allure de son cheval et en frappant légèrement sur l'épaule du chevalier, sang de Dieu! carissimo! nos affaires sont en bonne voie! Que t'en semble?
—Il me semble, Diégo, répondit le chevalier en souriant, que nous tenons déjà les écus du bélître!
—Corps du Christ! nous les aurons entre les mains avant qu'il soit huit jours.
—Il adoptera Henrique, n'est-ce pas?
—Certes!
—Hermosa va nager dans la joie!...
—Ma foi! je lui devais bien de lui faire ce plaisir, n'est-ce pas, Raphaël, à cette chère belle?
—D'autant plus que cela nous rapportera beaucoup.
—Oui, carissimo! et notre avenir m'apparaît émaillé de fêtes et d'amours.
—Nous quitterons Paris, j'imagine?
—Sans doute.
—Et où irons-nous, Diégo?
—Partout, excepté à Naples!
—Corpo di Bacco! je le crois aisément. Quittons Paris, d'accord, on ne saurait trop prendre de précautions; mais pourquoi fuir la France?
—Parce que, après ce qui nous reste encore à faire dans ce pays, mon très-cher, nous ne serions pas plus en sûreté à Marseille, à Bordeaux ou à Lille qu'au centre même de Paris. Mon bon chevalier, nous irons à Séville, la cité par excellence des petits pieds et des beaux grands yeux, la ville des sérénades et des fandangos! Grâce à notre fortune, nous y vivrons en grands seigneurs. Cela te va-t-il?
—Touche-là, Diégo!... C'est convenu.
—Convenu et parfaitement arrêté.
—Et Hermosa?
—Son fils aura un nom, elle touchera sa part de l'argent, ma foi, elle fera ce qu'elle voudra... Si elle souhaite venir avec nous, je n'y mettrai nul obstacle...
—Palsambleu! la belle vie que nous mènerons à nous trois...
—En attendant, songeons au présent et veillons à ce qui se passe autour de nous; car, tu le sais, chevalier, ce brave Marat est un ami précieux, mais il entend peu la plaisanterie en matière politique, et ma foi, à la façon dont tournent les choses, je pense toujours avec un secret frisson à cette ingénieuse machine de M. Guillotin, que l'on a essayée devant nous à Bicêtre, le 15 avril dernier, avec de si charmants résultats...
—Eh bien!... quel rapport établis-tu entre cette ingénieuse machine, comme tu l'appelles, et notre excellent ami Marat?
—Eh! c'est pardieu bien lui qui l'établit, ce rapport, puisqu'il répète à satiété dans ses conversations intimes qu'il faut faire tomber deux cent mille têtes. Or, l'invention de M. Guillotin arrivant tout à souhait pour réaliser son désir, je trouve la circonstance de fâcheux augure...
—Bah! que nous importe qu'on fauche deux ou trois cent mille têtes, pourvu que les nôtres soient toujours solides sur nos épaules? Allons, Diégo, depuis quand as-tu donc une telle horreur du sang répandu?...
—Depuis que je n'ai plus besoin d'en verser pour avoir de l'or! répondit à voix basse le comte de Fougueray en se penchant vers son compagnon.
—Oui, je comprends ce raisonnement, et j'avoue qu'il ne manque pas de justesse; mais, crois-moi, laissons Marat agir à sa guise, et servons-le bien. S'il ne nous paie pas en argent, il nous laissera nous payer nous-mêmes comme nous l'entendrons, et nous n'aurons pas à nous plaindre, je te le promets.
—Je l'espère aussi.
—En ce cas, hâtons le pas et pressons un peu nos chevaux.
—C'est difficile par ce chemin d'enfer tout pavé de rochers glissants, répondit le comte en relevant vertement sa monture qui venait de faire une faute.
Les deux hommes avaient, tout en causant, atteint les hauteurs de Penmarckh, et suivaient la crête des falaises dans la baie des Trépassés, qui avait failli devenir si funeste, la veille au soir, au lougre de Marcof. Le soleil s'élevant rapidement derrière eux, donnait aux roches aiguës des teintes roses, violettes et orangées, des reflets aux splendides couleurs, des tons d'une chaleur et d'une magnificence capables de désespérer le pinceau vigoureux de Salvator Rosa lui-même. La brise de mer apportait jusqu'à eux les âcres parfums de ses émanations salines. Les mouettes, les goëlands, les frégates décrivaient mille cercles rapides au-dessus de la vague poussée par la marée montante, et venaient se poser, en poussant un cri aigu, sur les pics les plus élevés des falaises. Le ciel pur et limpide reflétait dans l'Océan calme et paresseux l'azur de sa coupole. Aux pieds des voyageurs, au fond d'un abîme profond à donner le vertige, s'élevaient les cabanes des habitants de Penmarckh. En dépit de leur nature matérialiste, les deux cavaliers arrêtèrent instinctivement leurs montures pour contempler le spectacle grandiose qui s'offrait à leurs regards.
—Corbleu! chevalier, fit le comte en rompant le silence, l'aspect de ce pays a quelque chose de vraiment original! Ces falaises, ces rochers sont splendidement sauvages, et j'aime assez, comme dernier plan, cette mer azurée qui n'offre pas de limites au tableau...
—Cher comte, répondit le chevalier, l'Océan ne vaut pas la Méditerranée; ces falaises et ces blocs de rochers ne peuvent lutter contre nos forêts des Abruzzes, et j'avoue que la vue de la baie de Naples me réjouirait autrement le coeur que celle de cette crique étroite et déchirée.
—A propos, cher ami, c'était dans cette crique que Marcof avait jeté l'ancre hier soir, et le diable m'emporte si je vois l'ombre d'un lougre!
—En effet, la crique est vide.
—Il a donc mis à la voile ce matin, ce Marcof enragé?
—Probablement.
—Diable!
—Cela te contrarie?
—Mais, en y réfléchissant, je pense, au contraire, que ce départ est pour le mieux.
—Sans doute. Marcof est difficile à intimider, et si le marquis de Loc-Ronan avait eu la fantaisie de lui demander conseil...
—Ne crains pas cela, Raphaël, interrompit le comte. Le marquis ne révélera jamais un tel secret à son frère. Non, ce qui me fait dire que le départ de Marcof nous sert, c'est que, tu le sais comme moi, jadis cet homme, lui aussi, a été à Naples, et qu'il pourrait peut-être nous reconnaître, s'il nous rencontrait jamais.
—Impossible, Diégo! Il ne nous a parlé qu'une seule fois.
—Il a bonne mémoire.
—Alors tu crains donc?
—Rien, puisqu'il est absent. Seulement je désirerais fort savoir combien de jours durera cette absence. Eh! justement, voici venir à nous des braves Bretons et une jolie fille qui seront peut-être en mesure de nous renseigner.
Trois personnages en effet gravissant un sentier taillé dans les flancs de la falaise, se dirigeaient vers les cavaliers. Ces trois personnages étaient le vieil Yvon, sa fille et Jahoua. Les promis et le père avaient voulu aller remercier Marcof, et n'avaient quitté Penmarckh que lorsque le lougre avait repris la mer. Puis, après être demeurés quelque temps à le suivre au milieu de sa course périlleuse à travers les brisants, ils reprenaient le chemin de Fouesnan. En apercevant les deux seigneurs, dont les riches costumes attirèrent leurs regards, ils s'arrêtèrent d'un commun accord.
—Dites-moi, mes braves gens, fit le comte en s'avançant de quelques pas.
—Monseigneur, répondit le vieillard en se découvrant avec respect.
—Nous venons du château de Loc-Ronan, et nous craignons de nous être égarés. Où conduit la route sur laquelle nous sommes?
—En descendant à gauche, elle mène à Audierne en passant par la route des Trépassés.
—Et, à droite, en remontant?
—Elle va à Fouesnan.
—Merci, mon ami...
—A votre service, monseigneur.
Pendant ce dialogue, le chevalier de Tessy contemplait avec une vive admiration la beauté virginale de la charmante Yvonne.
—Vive Dieu! s'écria-t-il en se mêlant à la conversation, si toutes les filles de ce pays ressemblent à cette belle enfant, Mahomet, je le jure, y établira quelque jour son paradis, et, quitte à damner mon âme, je me ferai mahométan!
—Silence! Vous scandalisez ces honnêtes chrétiens! fit observer le comte.
Puis, se retournant vers Yvon:
—N'y avait-il pas un lougre dans la crique hier au soir? demanda-t-il.
—Si fait, monseigneur.
—Qu'est-il devenu?
—Il a mis à la voile, ce matin même.
—Savez-vous où il allait?
—A Paimboeuf, je crois.
—Comment s'appelle le patron?
—Marcof le Malouin, monseigneur.
—C'est bien cela. Et quand revient-il, ce lougre?
—Dans douze jours si la mer est bonne.
—Merci de nouveau, mon brave. Comment vous nommez-vous?
—Yvon pour vous servir.
—Et cette belle fille que mon frère trouve si charmante est votre fille, sans doute?
—Oui, monseigneur.
—Et ce jeune gars est-il votre fils?
—Il le sera bientôt. Dans six jours, à compter d'aujourd'hui, Jahoua épouse Yvonne.
—Ah! ah! interrompit le chevalier; et s'adressant à Yvonne: Puisque vous allez vous marier, ma jolie Bretonne, et que ce mariage tombe le premier juillet, jour que notre ami le marquis de Loc-Ronan nous a priés de lui consacrer tout entier, je prétends aller avec lui jusqu'à Fouesnan pour assister à votre union et pour vous porter mon cadeau de noces.
—Monseigneur est bien bon, balbutia Yvonne en ébauchant une révérence.
—Monseigneur nous comble! ajouta Jahoua en saluant profondément.
—Maintenant, bonnes gens, allez à vos affaires et que le ciel vous conduise! reprit le comte avec un geste tout à fait aristocratique, et qui sentait d'une lieue son grand seigneur.
Yvonne et les deux Bretons saluèrent une dernière fois, et continuèrent leur route non pas sans se retourner pour admirer encore les riches costumes des voyageurs et la beauté de leurs chevaux.
—Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie d'aller à la noce? demanda le comte en souriant, et en dirigeant sa monture vers l'embranchement de la route qui conduisait à Audierne.
—Est-ce que tu ne trouves pas cette petite fille ravissante?
—Si, elle est gentille.
—Mieux que gentille!... Adorable! divine!...
—Te voilà amoureux?
—Fi donc! La Bretonne me plaît; c'est une fantaisie que je veux contenter, mais rien de plus.
—Puisqu'elle se marie...
—Bah! d'ici à six jours nous avons dix fois le temps d'empêcher le mariage.
—Soit! agis à ta guise; mais en attendant hâtons-nous un peu, sinon nous n'arriverons jamais assez tôt!...
—Connais-tu le chemin?
—Parfaitement.
—Il nous faut descendre jusqu'à la baie, n'est-ce pas?
—Oui; il nous attendra sur la grève même, et, grâce à la superstition qui fait de cet endroit le séjour des spectres et des âmes en peine, il est impossible que nous puissions être dérangés dans notre conversation...
—Allons, essayons de trotter, si toutefois nos chevaux peuvent avoir pied sur ces miroirs.
Et les deux cavaliers pressant leurs montures, les soutenant des jambes et de la main pour éviter un accident, allongèrent leur allure autant que faire se pouvait. Ils parcoururent ainsi une demi-lieue environ, toujours sur la crête des falaises. Enfin, arrivés à un endroit où un sentier presque à pic descendait vers la grève, ils mirent pied à terre, et, reconnaissant l'impossibilité où se trouvaient leurs chevaux d'effectuer cette descente périlleuse, ils les attachèrent à de gros troncs d'arbres dont les cimes mutilées avaient attiré plus d'une fois le feu du ciel.
—Nous sommes donc arrivés? demanda le chevalier.
—Il ne nous reste plus qu'à descendre.
—Mais c'est une opération de lézards que nous allons tenter là, mon cher!...
—Rappelle-toi nos escalades dans les Abruzzes, Raphaël, et tu n'hésiteras plus.
—Oh! je n'hésite pas, Diégo. Tu sais bien que je n'ai jamais eu peur.
—C'est vrai, tu es brave...
—Et défiant, ajouta le chevalier. C'est pourquoi je te prie de passer le premier.
—Tu te défies donc de moi, Raphaël?
—Dame! cher Diégo, nous nous connaissons si bien!...
Le comte ne répondit point; et, passant devant le chevalier, il se disposa à entreprendre sa descente. L'opération était réellement difficile et périlleuse. Il fallait avoir la main prête à s'accrocher à toutes les aspérités, le pied sûr, l'oeil ferme, et un cerveau à l'abri des fascinations du vertige pour l'accomplir sans catastrophe. Aussi les deux hommes, employant tout ce que la nature leur avait donné d'agilité, de force et de sang-froid, ne négligèrent-ils aucune précaution pour éviter un accident fatal. Enfin ils touchèrent la grève.
Ils étaient alors au centre d'une petite baie semi-circulaire, cachée à tous les regards par d'énormes blocs de rochers qui surplombaient sur elle, et qui, depuis la haute mer, semblaient une simple crevasse dans la falaise. Les vagues, même en temps calme, se brisaient furieuses sur cette plage encombrée de sinistres débris.
—C'est la baie des Trépassés? demanda le chevalier en regardant autour de lui.
—Oui, répondit le comte; et élevant le doigt dans la direction opposée, c'est-à-dire vers l'extrême limite de l'un des promontoires, il ajouta:—Voici l'homme auquel nous avons affaire.
En effet, debout et immobile sur un quartier de roc contre lequel déferlaient les lames, on apercevait un personnage de haute taille, la tête couverte d'un vaste chapeau breton, le corps entouré d'un vêtement indescriptible, assemblage étrange de haillons, la main droite appuyée sur un long bâton ferré.