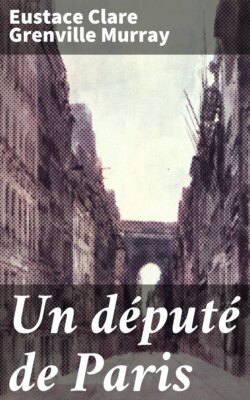Читать книгу Un député de Paris - Eustace Clare Grenville Murray - Страница 7
GÉRARD, L’HONNÊTE HOMME
ОглавлениеOn leur donna les meilleures chambres de l’hôtel; le choix n’en était que trop facile à faire, car la maison était vide.
Marianne les fit entrer dans le salon jaune du premier étage, qui prenait vue sur la place du Marché, et, leur montrant à gauche deux tableaux qui décoraient la muraille, se hâta de leur apprendre qu’ils se trouvaient en face des portraits de feu Monseigneur le duc d’Auvillars et de son père, propriétaires de cet immeuble; à droite, au-dessus de la cheminée, cet autre portrait avec perruque était celui de M. le marquis, guillotiné par Robespierre; une quatrième toile, avec jabot en toile de Hollande, représentait Monseigneur Longepierre, évèque d’Autun, un saint homme qui avait fait beaucoup de bien en brûlant des protestants.
Marianne récitait son affaire tout d’une haleine; elle gagnait aussi quelques sous en montrant aux voyageurs le lit authentique dans lequel avait reposé Monseigneur le premier duc d’Auvillars, la première nuit de son retour en France, après l’émigration, l’an 1814, alors qu’on n’avait pas eu le temps de préparer sa chambre au château.
Et il n’était pas un démocrate dans le pays qui ne se fût payé le luxe de coucher dans le lit de Monseigneur.
Le plus âgé des trois étrangers écouta Marianne avec beaucoup de bienveillance, les deux plus jeunes semblèrent s’en amuser.
Tous trois avaient de belles figures, le vieillard surtout. Il se tenait droit et ferme, et tout dans son allure rappelait un ancien militaire. Cependant, il portait la barbe et les cheveux longs; ses cheveux étaient d’une blancheur éblouissante. Mais ce que ce vieillard avait de plus remarquable, c’était l’expression vivante et fière de ses yeux.
On devinait que ce regard n’avait jamais dû s’abaisser devant personne au monde. Sa voix était d’une douceur singulière. Il devait croire à l’humanité, à la liberté, au bien.
Les deux jeunes gens se ressemblaient assez pour qu’on pût découvrir à première vue qu’ils étaient frères.
L’aîné paraissait vingt-trois ou vingt-quatre ans; l’autre était à peine son cadet.
Tous deux avaient les mêmes yeux, qui brillaient comme ceux du vieillard, et leurs physionomies étaient aussi ouvertes et intelligentes que la sienne.
Le plus jeune était le plus vigoureux: il paraissait le plus sérieux aussi; l’aîné était plus délicat, plus fin, plus enclin à la bonne humeur; à chaque instant, son visage s’éclairait d’un sourire.
Tous deux étaient mis avec soin; mais ici le moindre trait de caractère a son importance: le plus jeune portait une simple cravate en soie noire attachée par un nœud; l’aîné avait une cravate longue en satin noir retenue par une épingle de prix.
Il régnait entre ces trois hommes une familiarité confiante, née d’un profond amour dans le cœur du père, et dans celui des fils de la déférence la plus tendre.
Marianne se dit que c’étaient les trois plus beaux messieurs qu’elle eût vus depuis bien longtemps, et, dans son admiration, se mit à épousseter les chaises — opération qu’elle négligeait lorsqu’elle avait affaire à des clients vulgaires.
Elle ouvrit ensuite les fenêtres pour montrer à ces messieurs la place du Marché, et le héros de Poitiers qui se pavanait au milieu de la place.
Enfin, elle annonça que M. Duval allait monter pour offrir ses respects à ses hôtes.
Elle avait à peine achevé quand Duval parut.
Il portait sa serviette sous le bras, il était aussi obséquieux, aussi affairé que si la maison eût été pleine et que s’il n’eût fait que de servir à table toute la journée. Il exprima l’espoir que ces messieurs étaient logés suivant leur goût.
— C’est parfait, monsieur Duval, je vous remercie, —dit poliment le vieillard. — Mais nous n’aurons guère occasion d’en profiter, car mes fils et moi nous serons dehors du matin au soir. Il est maintenant une heure; je pense que nous ne serons pas de retour avant sept; pouvons-nous compter sur vous pour nous préparer à dîner?
— Monsieur peut avoir toute confiance en moi, —répliqua Duval en saluant.
Les voyageurs confièrent leurs sacs à Marianne et suivirent Duval, qui leur montrait le chemin pour sortir de la maison.
Le digne aubergiste n’était point curieux; mais il se souvint de certain règlement de police.
— Je vous demande pardon, messieurs, — dit-il, —vous déplairait-il d’écrire vos noms sur le registre?
Le vieillard fut un peu contrarié, mais il ne témoigna de rien qui pût le faire voir, et suivit Duval dans le salon où l’aubergiste mit tout en l’air pour trouver une plume neuve; puis il étala sur la table l’imposant registre qui devait être visé par M. le Commissaire.
Les feuillets étaient divisés en colonnes, et le voyageur était requis, par des questions imprimées en haut de ces colonnes de fournir les renseignements suivants: Nom et prénoms, âge, lieu de naissance, profession ou commerce, motif du voyage actuel, nom de la ville qu’on venait de quitter, nom de celle où l’on se rendait, nature des certificats d’identité en possession du voyageur.
Et, pour le cas où le voyageur n’aurait pas trouvé qu’il en avait dit encore assez, il y avait une neuvième colonne, intitulée: Observations.
L’étranger à cheveux blancs prit la plume, et d’une écriture assurée remplit silencieusement les places vides pour lui et ses deux fils.
L’hôtelier pendant ce temps se tenait à une distance respectueuse, mais, dès que les voyageurs eurent quitté la maison, il courut au registre.
A peine y avait-il jeté les yeux, qu’il fit un saut en arrière, et s’écria:
— Mon Dieu! ce n’est pas possible... et, pourtant, cela est.
Et, d’un autre bond, il se retrouva sur le seuil de la porte extérieure, le visage en feu, cherchant à voir encore les voyageurs.
Mais déjà ils avaient tourné le coin de la place du Marché et descendaient vers la grande route qui menait à Pourlans.
Duval rentra dans la maison: ce n’était pas pour s’y enfermer.
En moins d’une heure, toute la ville d’Auvillars était sens dessus dessous.
C’était un joli chemin que celui de Pourlans. Il avait été jadis très-animé sous le règne des deux premiers ducs.
Un certain entrepreneur avait pourtant fait de son mieux pour le gâter par une spéculation d’ailleurs bien fâcheuse pour lui-même, en le bordant de petites constructions de lattes, de mauvaises briques, et de méchants plâtras qu’il avait décorées du nom de chalets. Cela ressemblait autant à des chalets qu’un joujou de Suisse représentant. un donjon du Rhin ressemble au château de Versailles.
Connaissez-vous rien de plus laid que des ruines neuves? Or ces chalets étaient déjà ruinés, non par leur antiquité sûrement.
Figurez-vous une troupe de pensionnaires fraîchement habillées de rose et de blanc pour un jour de fête et surprises par une forte averse qui les fouaille et les mouille jusqu’aux os. Ahuries, effarées, elles se tiennent piteusement au soleil pour se sécher.
Telle était l’image qui venait à l’esprit quand on considérait ces plâtres blancs et ces briques décolorées, ces volets où ne restait plus vestige de peinture.
Ces maisonnettes n’avaient jamais été habitées: le constructeur avait fait faillite.
Les trois hommes continuaient leur route tout en causant, ou plutôt c’étaient les deux jeunes gens qui causaient; le vieillard écoutait.
Il semblait un peu plus soucieux, et quelques nuages s’amoncelaient sur son front; cependant, il souriait à l’humeur joyeuse de l’aîné de ses fils, à qui chaque objet animé ou inanimé, qui se trouvait sur le chemin, suggérait une saillie nouvelle, et il donnait son assentiment par un signe de tête toutes les fois que le cadet, moins brillant, mais plus réfléchi, atténuait les vivacités de son frère par quelque observation sensée.
— Où nous conduis-tu, père? — demanda l’aîné en riant. — Je commence à croire que ce pèlerinage mystérieux doit se terminer nécessairement à quelque ruine; tout ce que nous avons vu sur la route est dans un tel état de délabrement... Regarde donc ce cabaret!
— Notre pèlerinage touche à sa fin, Horace, — répondit le vieillard; puis il ajouta, non sans un certain trouble dans la voix: — Est-ce que tu trouves réellement que ce pays a l’air délabré ? Nous n’avons pas encore rencontré de mendiants.
Horace jeta les yeux autour de lui, il cherchait un mendiant.
— Je crois décidément qu’on ne voit de mendiants que dans les pays libres, — dit-il. — J’en ai rencontré beaucoup en Belgique, et quand nous sommes allés en Angleterre l’année dernière, je les ai vus par milliers; mais ici.....
— Ici, à la place des mendiants, il y a des gendarmes —interrompit le jeune frère.
Ils avaient fait à peu près deux kilomètres, lorsqu’ils arrivèrent à un carrefour où aboutissaient quatre chemins.
Une jeune fille venait au devant d’eux, portant un panier plein d’œufs frais.
Le vieillard, qui semblait mal connaître la route, lui dit: —
— Voulez-vous avoir l’obligeance, mademoiselle, de nous indiquer le chemin de Pourlans?
— A gauche, — répondit-elle; — il n’y en a pas pour dix minutes. Voyez le poteau.
Ils n’avaient point remarqué ce poteau qui disait:
POURLANS, à un demi-kilomètre.
LONGEPIERRE, à deux kilomètres.
SAINT-LOUP, à trois kilomètres et demi.
SERMESSE, à cinq kilomètres.
— Mon père, — dit le fils aîné, — tu as l’air d’Abraham conduisant au sacrifice son fils Isaac.
Le vieillard mit une main sur son épaule.
— Tu répondras toi-même à cette question, mon cher fils, quand nous reviendrons ce soir, — reprit-il avec une gravité extraordinaire.
Et il continua:
— Il se peut que nous allions à un sacrifice.
Pendant les quelques minutes qui suivirent, ils marchèrent silencieusement, le père toujours grave, le fils un peu troublé, jusqu’à ce qu’un nouveau tournant de la route les amenât subitement en vue de la cabane du garde de Pourlans, avec son avenue princière.
Le château à tourelles dominait le point de vue.
Le visage du vieillard semblait s’animer d’une émotion trés-vive, et les deux jeunes gens firent entendre un murmure d’admiration.
C’était en effet un spectacle splendide que ce château de Pourlans, dans sa majesté solitaire, baigné par les rayons empourprés du soleil d’automne, et entouré de son cortège d’arbres géants.
— La belle chose que la fortune! — soupira Horace. —Et dire que le propriétaire de ce paradis, ce Crésus, trouve peut-être le pays ennuyeux, dépense les trois quarts de son temps à Paris, parqué dans un appartement à peine aussi grand que cette maison de garde.
— Tu auras le loisir d’inspecter ce paradis à ton aise, — lui répondit son père, — car c’est ici le terme de notre voyage.
Et, comme on était arrivé à la grille, il tira la chaîne de la cloche qui pendait à son côté.
C’était la vieille femme dont nous avons déjà fait connaissance qui vint en trottinant. Elle était habituée aux demandes de visiteurs qui désiraient voir les jardins; plus il en survenait, plus elle était contente, car chaque visiteur représentait en moyenne une pièce de vingt sous.
Elle découvrit pourtant bientôt que ceux-ci n’étaient point des curieux ordinaires.
Lorsque les trois voyageurs eurent franchi les grilles en fer forgé, décorées d’écussons et de couronnes ducales, le vieillard tira une lettre de sa poche et la présenta à la vieille.
— Cette lettre est de M. Claude, le régisseur, — dit-il.
La vieille femme fouilla dans son tablier pour en tirer une paire de lunettes en corne, les mit sur son nez d’une main tremblante, brisa le cachet, et lut les lignes suivantes:
«Madame Léger,
«Vous aurez l’obligeance de conduire le porteur du
» présent billet dans tout le château, les appartements,
» les écuries, la galerie de tableaux. S’il préférait visiter
» seul la maison, vous lui donneriez les clefs.
» J. CLAUDE.»
— Monsieur est sans doute la personne dont M. Claude me parlait l’autre jour, — s’écria madame Léger, en jetant un regard scrutateur, mais respectueux sur les étrangers. — Il m’a dit qu’un monsieur devait venir qui aurait besoin de voir le château... un ami de Monseigneur le nouveau duc, je crois...
Le vieillard fit un signe de tête affirmatif; ses fils ouvraient de grands yeux: ils ne semblaient se douter en aucune façon des motifs que leur père avait de les amener en ce lieu.
Madame Léger, plus maussade encore qu’à son ordinaire lorsqu’elle se trouvait en présence des grands de la terre, formula l’espoir que Monseigneur était en bonne santé, et demanda si ces messieurs voulaient monter seuls au château ou si elle devait les y accompagner.
Il y eut un moment de délibération sur ce point; l’étranger désirait évidemment éviter à la brave femme de faire un kilomètre à pied, car l’avenue n’avait pas moins, mais madame Léger assura qu’elle avait de bonnes jambes et que ces messieurs se perdraient dans les appartements si elle n’était pas là pour les guider.
— Mais peut-être — ajouta-t-elle — ces messieurs sont déjà venus ici?
— Je suis venu ici autrefois, — répondit très-vite le vieillard, — mais il y a longtemps de cela; les choses ont changé depuis, et à présent je pourrais bien ne plus retrouver mon chemin.
Et, pour récompenser l’honnête vieille femme de la peine qu’elle allait prendre, il lui glissa un napoléon dans la main.
— Monsieur est bien généreux, — répondit madame Léger, qui tombait de son haut.
Et aussitôt les quatre personnages se mirent en marche. Madame Léger était en tête; les autres la suivaient doucement réglant leurs pas sur le sien.
Comme rien ne ressemble plus à une vieille maison qu’une autre vieille maison, et que la description de salons, de chambres désertes, de bibliothèques, de galeries de tableaux silencieuses, et de vieux meubles recouverts de leurs housses n’est intéressante pour personne, nous ne suivrons pas les étrangers dans leur inspection du manoir de Pourlans; nous les laisserons aux soins de madame Léger, et nous les attendrons sur la terrasse qui donne sur le jardin.
On avait mis à peu près trois quarts d’heure pour faire le chemin de l’avenue, grâce à madame Léger, qui à chaque instant s’arrêtait pour montrer le paysage.
Ici, c’était un banc sur lequel M. le feu duc s’était souvent assis pour lire son journal.
Ici, un belvédère construit par M. le marquis, qui regardait très-souvent les étoiles avec son télescope.
Dans ce sentier, si ces messieurs voulaient faire un petit détour, ils verraient la tombe en marbre blanc du chien chéri de madame la marquise, femme de Monseigneur qui fut mis à la Bastille par Louis XIV. Elle était jolie comme un amour, messieurs, et cependant très-respectée par le roi. Ah! dame, c’était sage!... Mais de toutes ces choses, celle qui avait pour madame Léger le plus d’attrait était un hêtre auquel avait été pendu un jacobin.
Ce jacobin était l’homme qui, en 1793, avait dirigé le sac de Pourlans, et qui, après le coup, s’était retiré et avait tranquillement vécu comme un bon bourgeois pendant les vingt années suivantes. Mais en 1814, au retour des Bourbons, une nuit, les paysans eurent l’idée d’aller le réveiller pour le pendre, juste en face les fenêtres du nouveau duc... attention délicate qui avait grandement touché Monseigneur et qui semblait également touchante à madame Léger.
Les visiteurs restèrent plus de deux heures dans le château.
Le vieillard désirait que ses fils vissent tous les coins et recoins de la maison.
Madame Léger fit comme il voulait; elle les conduisit d’étage en étage, de l’antichambre à la chambre, de la chambre à la salle à manger, de la salle à manger à la chapelle, faisant grincer les serrures et entrant dans des explications interminables, comme si elle eût parlé d’une ville morte.
Chaque pouce de tapis du château de Pourlans était quelque chose de sacré pour madame Léger.
Elle avait coutume de parler sur un ton pleurard et respectueux à la fois de ses maîtres disparus. Mais quand elle prononçait le nom du nouveau duc, qu’elle n’avait jamais vu, elle avouait que son absence était pour elle la chose la plus mystérieuse du monde et qu’elle n’en revenait pas.
Les jeunes gens l’écoutaient avec cette attention silencieuse et bienveillante que l’on témoigne à un vieux bedeau qui vous fait visiter une cathédrale.
Leur père ne parla que fort peu pendant ces deux heures. Une fois seulement lorsqu’ils furent dans une chambre du second, qui jadis avait été une chambre d’enfants, il sourit, mais son sourire avait quelque chose de profondément triste; désignant un portrait d’un très-jeune enfant qui était accroché au mur, il demanda:
— Quel est ce portrait?
— Ça, monsieur, c’est le duc actuel d’Auvillars, — répondit madame Léger; — il y a près de soixante-dix ans que c’est fait.
Quand cette visite du château fut enfin terminée, et du haut en bas, nos étrangers s’arrêtèrent sur la terrasse.
— Eh bien! Emile, — demanda le vieillard au plus jeune de ses fils, — que penses-tu de tout ce que nous venons de voir?
Et il interrogeait avec une expression de curiosité particulière le regard du jeune homme.
— Il doit y avoir un cadavre dans cette maison, mon père, — répliqua le jeune homme d’un air pensif.
— Comment, un cadavre, cher enfant?
— Oui! un cadavre qui empêche le nouveau seigneur de Pourlans de l’habiter. Ne crois-tu pas, père, — ajouta-t-il, — qu’il faut qu’il y ait quelque douloureux souvenir qui éloigne le nouveau duc d’Auvillars de cette demeure?
Le père ne répondit pas; et se tournant vers madame Léger:
— Nous ne voulons pas, — lui dit-il avec douceur, —vous ennuyer et vous obliger à rester plus longtemps avec nous, madame Léger; mes fils et moi nous allons nous asseoir pendant un moment sous ce chêne là-bas, et aussi probablement nous promener dans le parc.
Madame Léger fit une révérence.
— Très-bien, monsieur, — répondit-elle; — quand vous aurez envie de vous en aller, vous n’aurez qu’à suivre tout droit l’avenue; vous me trouverez à la maison du garde pour vous ouvrir les grilles.
Elle fit une seconde révérence, et s’en alla en clopinant.
Les trois hommes se dirigèrent vers le chêne, qui avait été planté au milieu d’une grande pelouse, d’où l’on dominait presque tout le parc.
Avaient-ils le pressentiment qu’ils allaient entendre des choses extraordinaires ou était-ce simplement par hasard qu’ils se taisaient?
Toujours est-il que les jeunes gens marchaient l’un à côté de l’autre sans prononcer une parole.
Le bruit de leurs pas dans ces hautes herbes, les chansons des oiseaux dans les arbres, troublaient seuls le profond silence qui enveloppait les choses.
Il y avait un banc de bois qui faisait le tour du chêne. Tous trois s’y assirent, le père entre les deux jeunes gens.
— Pouvez-vous deviner pourquoi je vous ai amenés ici? — dit-il.
— Pourquoi, père?
— Je veux vous raconter une histoire, — dit-il, prenant affectueusement une de leurs mains dans les siennes. —Désirerais-tu par hasard que je t’apprisse ce que c’est que le cadavre de Pourlans, Émile? Et toi, Horace, es-tu curieux de savoir comment certaines gens peuveut se trouver plus heureux dans un petit appartement de Paris, que dans un château comme celui-ci?
Emile sourit légèrement.
— C’est bien cela, — répliqua-t-il. — Il y a un cadavre.
Et Horace ajouta d’un ton mi-badin, mi-tragique: —
— Je me plaignais de ce qu’on ne rencontrait que des mendiants dans les pays libres. Il faut également remarquer que les maisons riches semblent avoir la spécialité des souvenirs sinistres: pas de château où quelque mortel n’ait été empoisonné, jeté dans un puits ou par la fenêtre.
— Oui; mais il n’y a rien de pareil dans mon histoire, — interrompit doucement le vieillard. — Ce n’est pas une histoire de meurtre, ni un mystère. C’est... je ne puis pourtant pas dire que ce soit une histoire comme il en arrive tous les jours. Du reste, vous allez en juger.
Voyant les deux jeunes gens attentifs, il commença son récit d’un ton très-simple, comme s’il eût dit un conte de fées.
— Il y avait autrefois un très-riche gentilhomme qui vivait dans une maison comme celle-ci. C’était un homme bon; mais il eut le malheur de vivre dans des temps troublés. Alors le peuple, exaspéré par le souvenir de longs siècles d’oppression, se souleva contre ses maîtres, et il paya, ainsi que cela arrive souvent, pour les fautes de ses ancêtres. Il mourut noblement. En mourant, il laissa deux fils: leur mère était morte quelques années auparavant. L’aîné avait dix-sept ans, le plus jeune en avait neuf. En temps ordinaire, l’aîné aurait succédé à son père et serait devenu le tuteur de son frère. A cette époque, il y avait dans tout le pays un tel sentiment de colère et de haine contre la noblesse, que les jeunes gens ne purent rester en France, où ils n’eussent pas été en sûreté. L’aîné, qui avait pris le titre de marquis, fut officier dans l’armée de Condé, à Coblentz; le plus jeune, qui était vicomte, devint page d’honneur d’une Princesse Royale, la comtesse de Provence. Je n’ai pas besoin de vous rappeler ce qu’il advint de l’armée de Condé. Les officiers et les soldats qui la composaient étaient des braves; mais ils avaient porté les armes contre leur pays; or, la victoire ne reste pas longtemps du côté de ceux qui bravent le droit et la justice. Quelques-uns acceptèrent du service dans les armées étrangères; d’autres, et probablement les plus sages, partirent pour l’Amérique pour tenter d’y refaire leur fortune; il y en eut encore qui émigrèrent en Angleterre, où ils formèrent une grande colonie qui ne fut ni très-unie, ni très-raisonnable, et qui s’intitulait: les Réfugiés. Parmi ceux-là se trouvaient le jeune marquis et son frère. Ils avaient été complètement ruinés par la Révolution; la Convention avait décrété que les émigrés perdraient leurs biens, et il ne leur resta plus pour vivre que l’argent qu’ils retirèrent de la vente des bijoux et de l’argenterie de famille, qu’un vieux serviteur avait pu sauver et leur avait fait parvenir en Angleterre. C’était une dure époque pour des jeunes gens élevés dans le luxe; mais les deux frères ne se plaignirent pas, car il y en avait de bien plus malheureux encore. Bon nombre de ducs et de comtes avaient dû se faire professeurs de musique, d’escrime, de langues, ou de dessin. Il y en eut qui s’établirent dans de petits commerces. On en cite un, depuis pair de France, qui se fit bravement charpentier et réussit à merveille dans cette carrière. Malheureusement cette adversité, qui eût dû servir de leçon à ceux dont l’imprévoyance avait provoqué la Révolution, ne semblait pas leur avoir beaucoup profité ; la colonie des réfugiés ne s’occupait guère que d’intrigues; elle ne songeait qu’aux moyens d’envahir la France et de restaurer l’ancien régime; on n’y entendait que des anathèmes contre l’esprit nouveau de la Révolution. Cette attitude affligea d’abord le plus jeune des deux frères, et, petit à petit, l’éloigna de la cause royaliste. A mesure qu’il avançait en âge, il comprenait que la Révolution n’avait pas fait autant de mal que ceux de sa caste auraient voulu le lui faire croire. Certes, les excès de la Révolution, les orgies sanglantes de 93, furent des crimes... de grands crimes, qui ont été d’ailleurs chèrement expiés par les républicains; mais pour juger cette grande et sombre époque, il faut séparer le bien du mal; distinguer entre les révolutionnaires qui ne voulaient que le règne de la liberté et de la loi et tombèrent victimes de leur modération, et les tristes misérables qui... Mais ne les jugeons point non plus trop sévèrement, — fit avec tristesse le vieillard, — la mort les a pris comme les autres!
Il s’arrêta pendant un moment.
— Le jeune homme, je veux dire le jeune vicomte, avait lutté longtemps avant d’oser s’avouer à lui-même, qu’il n’était plus du même sentiment que ceux qui l’entouraient. La mort de son père avait été une injustice et une cruauté, et il s’écoula quelque temps avant qu’il comprit qu’il ne serait pas plus équitable de considérer le parti républicain comme responsable de ce crime qu’il l’eût été de rendre son père responsable des crimes et des folies de la noblesse française. Peut-être si le langage des émigrés, au milieu desquels il vivait, avait été plus sensé, plus tolérant, plus digne, plus patriotique, peut-être, n’aurait-il jamais été amené à faire ces réflexions, et serait-il resté royaliste jusqu’au bout comme son frère aîné. Mais, sauf quelques très-rares exceptions, il en allait tout autrement; si les réfugiés gardaient au fond du cœur quelque reste de leur amour pour la France, ils n’en laissaient certainement rien paraître. Aux yeux d’un jeune homme de dix-sept ans, ils apparaissaient comme des êtres entêtés et frivoles, sans générosité, sans largeur de vue auquel le malheur n’avait rien appris, et tels que, si jamais le pouvoir tombait entre leurs mains, ils semblaient marqués d’avance pour conduire leur pays aux abîmes. Vous le savez, les jeunes gens sont ainsi faits, qu’ils vont dans tout ce qui est extrême, sans transition. Lorsqu’ils perdent leur foi dans certains principes, ils en concluent soudain que les principes contraires sont les seuls vrais, les seuls bons. C’est ce qui arriva au vicomte; il sentit sa confiance et son admiration pour la cause royaliste diminuer insensiblement, et un beau jour il se trouva qu’il avait nettement pris parti pour les républicains. Ceci se passait à l’époque où Bonaparte étonnait l’Europe entière par sa campagne d’Italie, et quand la gloire militaire de la France brillait d’un éclat qu’elle n’avait pas encore connu. Il était difficile de ne point sentir son cœur tressaillir d’orgueil tout au moins, au récit de ces batailles où les jeunes armées de la République française, luttant contre un ennemi partout plus nombreux, mieux armé, plus exercé, étaient partout victorieuses.
Les réfugiés et avec eux la presse anglaise avaient beau rire de ces guenillards, affirmer qu’ils n’étaient point vainqueurs, ces manifestations évidentes du dépit et de la jalousie ne faisaient qu’ajouter au plaisir qu’éprouvaient tous les cœurs français restés patriotes, Un jour... c’était en l’année 1801, le jeune vicomte prit une résolution grave. Fatigué de cette vie d’exil et ne voyant rien qui l’attirât dans la pensée d’être retenu indéfiniment à la cour pour rire de ce prince, qui s’intitulait lui-même Louis XVIII, il fit un grand effort — effort nécessaire, je vous le jure, et qui demanda du courage, — puis il fit part à son frère de l’intention où il était de retourner en France et de s’engager dans l’armée du général Bonaparte. Le marquis, lui, était toujours resté royaliste, et la pensée que quelqu’un des siens pouvait devenir républicain, n’avait jamais traversé son esprit, même en rêve. Il bondit en entendant son frère, comme s’il avait reçu un grand coup de fouet; ce qu’il lui disait lui paraissait ressembler singulièrement à un blasphème. Quoi! son frère, son propre frère, devenant renégat, servant dans les rangs des assassins de son père! C’était à ses yeux comme une sorte de complicité dans le parricide même. Il pâlit, saisit la main de son frère, et le supplia de lui dire que tout cela n’était qu’un jeu, une folie, ce qu’il voudrait enfin, hormis la vérité. Mais le jeune homme tint bon. Il avait prévu l’accueil qu’il recevrait, mais il sentait ses raisons si élévées, si décisives, il savait si bien que la haine contre les meurtriers de son père était toujours en lui, intacte et forte, que l’indignation et la surprise de son frère ne le touchèrent point. Il alla même jusqu’à concevoir l’espoir de le convertir. Il plaida sa cause avec chaleur. Il ne pouvait offenser la mémoire de son père, en servant son pays. Ce n’était ni pour Robespierre, ni pour Marat qu’il allait combattre, ils étaient morts; il allait tout simplement se faire soldat français, et combattre pour la France. Bref, il dit tout, tout ce qu’il sut, tout ce qu’il put trouver pour convaincre son frère; mais celui-ci demeura inébranlable. Chevaleresque et inflexible, il n’admettait point qu’on pût abandonner son parti, sans trahison, sans crime. Il s’indigna des propositions de son frère, finit par lui dire durement: «Cesse, je t’en prie!» et de ce jour jusqu’à celui de sa mort, il ne voulut jamais le revoir...
Le vieillard s’interrompit un instant; il était un peu pâle; mais il continua d’une voix assurée:
— L’esprit de parti était poussé très-loin à cette époque; je crois vraiment que les hommes avaient une capacité de haine plus grande qu’aujourd’hui. Oui! les mots de royaliste ou de républicain séparaient alors les hommes si profondément qu’aucun lien de famille, si fort qu’il fût, ne pouvait les rapprocher; et une fois qu’on avait abandonné un camp pour un autre, c’en était fait des anciens amis; ils vous devenaient absolument odieux, comme on le leur devenait à eux-mêmes. Celui dont je parle ne haïssait pas son aîné, Dieu le sait! mais l’aîné conserva un ressentiment éternel contre son cadet... Mais laissons là ce triste passé, et que ceux qui ne sont plus oublient comme leur frère a oublié. Je ne désire pas faire mon histoire trop longue, — continua le vieillard, — je dirai seulement que la fortune se montra bienveillante pour le jeune volontaire de l’armée républicaine; très-vite il obtint l’épaulette de lieutenant, fut capitaine après trois ans de service, et aurait pu arriver bien plus haut s’il eût voulu rester dans l’armée. Mais en devenant soldat sous Bonaparte, il avait juré fidélité à la République et n’avait pas prévu l’Empire. Lorsque le Premier Consul se changea en Empereur, le jeune vicomte donna sa démission. Elle ne fut pas immédiatement acceptée... car on avait justement besoin alors d’hommes pour la campagne d’Autriche qui venait de s’ouvrir. Après le traité de Presbourg, lorsqu’on vit qu’il ne voulait accepter ni avancement, ni la croix, on le laissa partir. C’est dans ces circonstances qu’il vint s’établir à Paris. Il quitta l’épée pour la plume. Et la nouvelle carrière qu’il choisit, si elle dépassa peut-être ses mérites, dépassa certainement ses espérances. Le frère aîné réussissait, pendant ce temps, dans un genre tout différent. Durant son exil, il épousa une femme très-riche, — la fille d’un Anglais qui faisait la traite des nègres, —et à la rentrée des Bourbons il revint en France, fut fait duc, racheta avec l’argent de sa femme les biens de sa famille, qui avaient été vendus comme propriété nationale, et mourut comblé d’honneurs, immuable jusqu’à la fin dans sa fidélité à une dynastie dont il avait partagé la bonne et la mauvaise fortune. Maintenant, que diriez-vous? — demanda le vieilllard, regardant ses deux fils alternativement, avec une émotion visible, — que diriez-vous si, le hasard ayant voulu que le fils unique du frère aîné mourût sans enfants, le plus jeune... le républicain... était devenu un beau jour, sans s’y attendre, héritier du titre de duc et des biens rachetés?... Voyez et réfléchissez...
Il continua, d’une voix suppliante et grave à la fois:
— Voyez, et réfléchissez à la situation de cet homme. Il ne s’était jamais occupé de cet héritage, ne l’avait jamais désiré ; c’est un malheur — malheur sorti d’un crime politique odieux, — qui le lui apporta. Ceci aurait suffi à une âme honnête pour refuser cette fortune; car, profiter du crime, c’est en être complice. Mais il y avait d’autres raisons. A partir du moment où il s’était séparé de son frère, le républicain avait arrêté, avec une netteté et une rigueur parfaite, les principes qui devaient diriger sa vie. A tort ou à raison, ces principes lui interdisaient de porter un titre, et il avait abandonné celui de vicomte, pour prendre simplement son nom de famille. C’était sous ce nom qu’il était généralement connu et qu’il s’était fait sa petite réputation; et c’était sous ce nom que les électeurs républicains l’avaient envoyé à la Chambre quatre fois de suite comme membre de l’opposition libérale, c’est-à-dire non-seulement pour y défendre la liberté à l’intérieur, mais encore,si l’occasion s’en présentait, pour réclamer l’abolition de l’esclavage dans les colonies. Rappelez-vous que nous parlons d’un temps où l’abolition de l’esclavage était un mot d’ordre favori de l’opposition avant 48. A présent, — fit- il doucement, en manière de conclusion, — qu’en pensez vous?... Cet homme, qui refusait de porter le titre de vicomte, pouvait-il changer d’avis pour porter celui de duc; cet adversaire implacable de l’esclavage pouvait-il accepter une fortune gagnée en vendant des esclaves? Voyons, mes enfants, répondez.
Il y eut un instant de silence; un seul instant.
Les deux fils se levèrent ensemble, la tête découverte, les yeux pleins d’éclairs.
— Mon père!.., — fit le plus jeune avec orgueil; mais il était trop profondément ému pour en dire davantage.
L’aîné ajouta, d’une voix toute frémissante de joie, d’admiration:
— Mais tu n’as pas eu besoin de duché ou de richesses, père, pour faire ton nom illustre.
Les trois hommes se serrèrent la main. Et dans cette silencieuse étreinte, il sembla que les fils, jugeant la vie du père, qui leur apparaissait alors avec toute l’austère grandeur de l’abnégation et de la dignité humaine, étaient fiers de sentir dans leur cœur assez de noblesse native pour avoir le droit de la ratifier solennellement, de dire: C’est ainsi, père, qu’il fallait faire.
Ce fut, d’ailleurs, la première fois que les deux jeunes gens entendaient parler de leur famille. Ils n’avaient connu leur père que comme un des chefs les plus estimés du parti républicain, auquel son intégrité et sa droiture naturelles avaient fait donner, par ses amis comme par ses adversaires, le surnom enviable de Gérard l’honnête homme.
Il y a certains Français qui ont l’art de rendre la cause républicaine particulièrement désagréable; mais Manuel Gérard n’était point de ceux-la.
La République, comme il la rêvait, eût été une chose magnifique. Malheureusement, avant de l’établir, il eût fallu faire disparaître les mauvais instincts du cœur humain, il eût fallu transformer radicalement l’homme.
Dans sa République, il n’y avait ni prisons, ni geôliers, ni bourreaux, ni gendarmes.
A l’entendre, le crime n’était que le résultat de l’ignorance, et le jour où chacun saurait lire, écrire, et compter, il ne serait plus besoin d’établissements pénitentiaires.
On eût été mal venu à lui faire remarquer que le plus grand nombre profitait de la connaissance des trois règles pour voler ses voisins et s’enrichir à leur dépens.
Cependant, malgré sa croyance naïve dans les vertus innées de l’homme, Manuel Gérard n’était pas un pur rêveur. Il savait être habile quand il le fallait, mais il méprisait d’instinct tout ce qui est mesquin ou faux; plus d’une fois il avait étonné ses adversaires par l’énergie et même la crudité avec lesquelles il avait dénoncé leurs manœuvres ou leurs mauvais desseins.
Il y avait en lui du soldat et du prêtre.
Très-doux par nature, indulgent, d’une amabilité courtoise, il lui arrivait de s’enflammer comme un enfant au récit d’une mauvaise action, et de laisser cours, alors, à la véhémence, à la libre fougue impétueuse de son imagination.
N’ayant rien à attendre, comme il le croyait, de sa famille, il avait élevé ses deux fils très-modestement.
Il leur disait toujours qu’un homme en restant simplement honnête devait finir par réussir. C’était chez lui une croyance profondément enracinée.
S’il avait bien possédé la Bible, ce qui n’était pas son cas, je dois l’avouer avec douleur, il n’aurait pas manqué de citer à tout bout de champ ce beau passage: J’étais jeune, et maintenant je suis vieux, pourtant je n’ai point vu le juste abandonné ni sa progéniture mendiant son pain.
Mais étant républicain et se donnant comme libre-penseur, il invoquait simplement sa propre expérience et disait qu’il avait connu un grand nombre de braves gens et aussi beaucoup d’autres; mais qu’il n’avait jamais rencontré un honnête homme qui ait eu à se repentir de so honnêteté.
Élevés dans ces principes, les jeunes gens avaient grandi et étaient devenus de véritables hommes; ils partageaient le dégoût de leur père pour tout ce qui n’est pas loyal et droit, et ils se promettaient bien de défendre, dans la mesure de leur force, la cause républicaine.
La France n’est pas un de ces pays où chaque personne a un nobiliaire sur sa table; il est donc assez facile de cacher son origine et sa famille.
Bon nombre d’amis de Manuel Gérard, ne soupçonnaient même pas qu’il eût quelques liens de parenté avec une maison ducale; le défaut des Français n’est point de se déprécier, et quand un homme se donne comme le premier venu, il est toujours cru sur parole.
Les jeunes gens n’avaient point été émerveillés par les révélations que leur avait faites leur père sur leur origine aristocratique.
Quelques jours auparavant, Manuel Gérard, qui avait toujours vécu avec eux à Bruxelles depuis le Coup d’État, leur avait tranquillement fait part de son intention de les conduire en France pour régler quelques affaires, et, une fois à Pourlans, il leur avait dit son secret de la façon que nous venons de dire.
Ce récit leur avait causé une très-grande surprise et quelque émotion.
Pour des jeunes gens de vingt-quatre ans et de vingt-et-un ans, l’argent et les honneurs n’ont pas la même importance dans la vie que plus tard.
D’une façon ou d’une autre, ils trouvaient tout naturel que leur père fût duc; ils trouvaient tout aussi naturel qu’il refusât de porter son titre, et qu’ayant hérité d’un domaine acquis avec un argent mal gagné, il s’en dessaisit sans hésitation.
Mais cela ne les empêchait pas d’admirer ce désintéressement et d’en être fiers; les belles actions ont la vertu de nous émouvoir, même lorsque nous en sommes nous-mêmes le plus capables.
Il y eut un long silence, après lequel le père, qui avait regardé ses fils avec une grande joie et une grande tendresse, dit:
— Et que fera-t-on d’un domaine que tout le monde refuse?
Émile répondit le premier.
— Il a été acheté avec l’argent provenant d’un trafic ignoble, — dit il gravement, — qu’il soit vendu et que le prix de la vente soit employé à racheter des esclaves ou à travailler à l’abolition de l’esclavage en Amérique.
— Oui!...oui! — fit son frère en donnant vivement son assentiment.
Manuel Gérard avait apporté un parchemin plié en quatre, jaune, et qui avait l’air le plus authentique du monde.
— Pendant ces trois dernières années, — observa-t-il, — la propriété a été sans maître, c’est-à-dire qu’un régisseur a encaissé les revenus et les a dépensés en charités; mais voici un acte que j’ai fait préparer et qui vous transfère la pleine propriété du domaine et vous donne le droit d’en disposer.
Horace prit le parchemin et fit le geste de le déchirer immédiatement.
— Ceci doit être le sacrifice dont nous parlions ce matin, — ajouta-t-il en riant.
Son frère l’approuva, en ajoutant:
— Oui!... déchirons-le; il ne peut rien nous apporter de bon.
— Arrêtez un moment, — fit Manuel Gérard.
Et il cita ces deux vers:
Un sacrifice fier charme une âme hautaine,
La gloire en est présente el la douleur lointaine.
Ils étaient tirés d’une pièce de Ponsard très en vogue alors.
— Laissez-moi vous conseiller d’attendre et de ne pas agir sous le coup d’une première impression, chers enfants, — continua-t il. — Le mérite de votre sacrifice sera d’autant plus grand qu’il sera accompli après réflexion. Je ne voulais point vous parler de cela avant que vous fussiez en âge de vous rendre compte à cet égard de la valeur et de la portée de vos résolutions; mais je ne voudrais pas que vous vous décidassiez trop vite. Réfléchissez sérieusement, froidement, de façon que vous ne puissiez jamais rien regretter de ce que vous aurez fait.
— Mais que pourrions-nous faire? — demanda le frère aîné d’un ton surpris, en regardant son père presque d’un air de reproche. — Est-ce que nous aurons jamais, Émile ou moi, un sentiment différent de celui qui nous anime aujourd’hui?
— Fasse le ciel que non, mon cher enfant, — répliqua le vieillard, avec un affectueux sourire pour le rassurer; — mais quand je songe à la satisfaction intime que vous éprouverez plus tard, au souvenir de votre belle action, il me semble que cette satisfaction sera plus vive, si vous pouvez vous dire que vous avez agi, non dans l’impétuosité d’un mouvement généreux, mais avec le sang-froid d’hommes réfléchis et libres. Voici donc ce je veux vous proposer. Gardons les titres de propriété entre nos mains pendant une période déterminée... Disons quatre ou cinq ans... Pendant ce temps, les revenus de Pourlans seront consacrés à des œuvres de bienfaisance; et si à la fin du terme vous êtes restés fermes dans votre résolution, alors la proposition d’Émile sera adoptée et l’héritage entier retournera à ses vrais possesseurs, aux malheureux esclaves dont la liberté en a été le prix.
Il s’écoula quelques instants avant que l’aîné pût comprendre les avantages de ce projet; il est même probable qu’il ne les aurait jamais compris; mais le plus jeune pour plaire à son père, dont il devinait les véritables pensées, se prétendit converti.
Émile devina que le désir intime de Manuel Gérard était que ses fils ne fussent pas influencés par sa présence; il voulait qu’ils pussent délibérer en pleine liberté pour que le sacrifice qu’ils allaient accepter fût bien leur œuvre propre.
— Très-bien, père, — dit le jeune homme avec tranquillité ; — attendons si tu veux, cela reviendra au même.
L’aîné, cependant, ne se rendit pas aussi vite. Il avait ouvert le parchemin et il avait machinalement jeté les yeux dessus.
L’acte était aussi formel, aussi régulier que possible; il avait été préparé et signé en présence de témoins. Il était inattaquable.
Il partageait la propriété en deux parts égales: le château de Pourlans avec le domaine du même nom, et toutes les terres situées dans la ville d’Auvillars formaient la part d’Horace; et les biens fonds de Longepierre, de Saint-Loup, de Sermesse, aussi bien que l’hôtel de la famille dans le faubourg Saint-Germain, à Paris, formaient celle d’Émile.
Pour satisfaire aux exigences de la loi, le républicain avait été obligé, pour la première fois de sa vie, de signer de ses titres et de ses noms et prénoms: Manuel-Armand-Gérard de Pourlans, duc d’Auvillars, marquis de Longepierre et de Sermesse, comte de Saint-Loup, et baron Gérard d’Auvillars.
Horace, après avoir parcouru tout cela, replia l’acte et dit d’un ton de gravité qui ne lui était pas habituel;
— Je crois que nous ferions mieux de ne pas attendre. Notre devoir en cette occasion est si simple, qu’un délai semble presque un tort. D’ailleurs, cinq ans!... qui sait ce qui peut arriver en cinq ans?
— Mais il n’y a point de nécessité absolue de fixer le terme à cinq ans, — répliqua gaiement Manuel Gérard; — faites ce que vous voudrez; dites deux ou trois ans, si bon vous semble. Tout ce que je désire, c’est que vous vous soumettiez à une épreuve suffisante pour bien montrer que vous êtes à l’abri de la tentation; car, croyez-moi, si vous restez inébranlables dans ces conditions, ce sera pour vous un encouragement dans bien des épreuves à venir; cela vous convaincra que les sacrifices en apparence les plus durs peuvent, avec de la volonté,sembler faciles aux âmes bien situées.
Ces dernières paroles décidèrent les deux frères.
Du moment où il s’agissait de prouver qu’ils n’étaient point hommes à changer de sentiment, Horace aurait consenti à attendre vingt ans s’il l’avait fallu.
Il jeta un regard autour de lui dans le parc, sur les vastes pelouses, les sentiers abandonnés, et les grands arbres sauvages; il regarda le vieux château, qui se dressait devant lui, désert et sombre, tout ce paysage plein de cette majestueuse tranquillité qui l’avait charmé une heure auparavant. Toutes ces choses lui parurent alors tristes et froides, et il sentait, avec une netteté parfaite, qu’il aurait pu refuser, sans regret, mille châteaux pareils, et, mettant le parchemin dans sa poche, il dit:
— Eh bien! que ce soit dans cinq ans, père. Nous sommes au 20 septembre 1854; le 20 septembre 1859 nous brûlerons cet acte et nous en ferons un autre. Je me rappellerai cette date.
— Amen! — répondit Manuel Gérard.
La grande résolution étant prise, il était à peu près cinq heures. Le père et les deux fils se dirigèrent d’un pas insouciant vers la maison du garde où madame Léger avait promis de les attendre.
Ils s’entretenaient naturellement du sujet dont les jeunes gens étaient tout pleins: l’histoire des d’Auvillars passés et disparus.
Manuel Gérard parla du temps où il avait vu le parc pour la dernière fois, il y avait soixante ans.
C’avait été dans la nuit où son père fut arrêté comme royaliste. Son frère et lui durent se sauver par une porte dérobée, tandis que cinq ou six cents paysans, conduits par un chenapan du pays, attaquaient le château et le mettaient à sac.
Il se rappelait la triste voiture qui était venue pour enlever le marquis, les sabres des gendarmes qui brillaient à la lueur des torches, les vociférations furieuses de la foule en voyant ce noble garrotté comme un voleur; aussi et surtout, il se souvenait avec émotion des tentatives héroïques et désespérées faites par quelques braves gens pour le délivrer.
C’était grâce à ceux-ci que les deux fils du marquis ne furent pas arrêtés. Il fallut employer la force, car les jeunes gens voulaient suivre leur père, et Manuel Gérard se souvenait même d’un fermier dévoué mais brutal, qui l’avait bâillonné pour l’empêcher de crier.
Puis on parla des sanglantes assises qui s’étaient tenues dans le vieil Hôtel-de-ville d’Auvillars, sous la présidence d’un des hommes de Robespierre; de la destruction des monuments, de tous les emblèmes de la grande famille de Pourlans; du pillage de l’église, de sa conversion en grenier; et de la vente du château par le gouvernement révolutionnaire à un huissier sans-culotte, pour quelques milliers d’écus.
Lorsque, à la Restauration, les d’Auvillars revinrent, cet huissier, qui avait fait une fortune colossale, demanda un million pour rendre la propriété, et il eût certainement insisté pour en avoir le double s’il n’avait eu de bonnes raisons de craindre que le duc l’en fit sortir par la fenètre.
— Voyez ceci, — continua Manuel Gérard en touchant du bout de sa canne une grotte recouverte de mousse, —aucun parc n’était complet, il y a un siècle, sans une grotte comme celle-ci; je me souviens, comme si c’était hier, de mon pauvre père assis là, en perruque poudrée, avec des manchettes, et m’apprenant à épeler des mots dans la Gazette de France étendue sur son genou; la Gazette était le grand journal de l’époque: elle nous apportait habituellement deux fois par semaine les nouvelles de Paris. Elle était à peu près de la grandeur d’un mouchoir de poche.
C’est ainsi qu’en devisant du passé, ils arrivèrent au bout de l’avenue où madame Léger, debout, tenait la grille toute grande ouverte pour les laisser passer.
— Bien le bonjour, messieurs — dit-elle d’une voix chevrotante — et si vous voyez monseigneur, dites-lui que nous serons tous bien contents de le voir, car, sans lui, Pourlans, est un vrai cimetière.
Manuel Gérard lui répondit quelques mots gracieux et banals, et sortit.
Quand il eut franchi la grille, il se retourna pour voir une dernière fois le château et le parc.
Il semblait parfaitement calme, mais il dit à voix basse et en faisant de la main un geste affectueux et triste:
— Adieu! Pourlans. Il y a huit siècles que tu es tombé honorablement entre les mains de nos ancêtres, ils ne nous reprocheront pas de ne pas te quitter aujourd’hui honorablement!
Sur ces mots, le père et les fils s’éloignèrent, reprenant la même route que celle par où ils étaient venus pour se rendre à Auvillars.
Durant le trajet, Horace et Émile se gardèrent de parler plus longtemps de Pourlans ou du passé, et, cette fois, leur entretien roula exclusivement sur leurs projets d’avenir.
Les deux frères étaient licenciés en droit: l’aîné avait passé sa thèse à Paris en 1851, le plus jeune à Liège en 1854, et il avait été décidé qu’ils iraient à Paris au commencement d’octobre pour y faire leur stage au barreau.
Leur visite à Pourlans, et les choses qu’ils y avaient entendues ne modifièrent en rien leurs dispositions; mais les jeunes gens étaient très-désireux d’amener leur père à les accompagner; jusque-là il avait refusé, alléguant son intention de retourner à Bruxelles où il avait beaucoup d’amis parmi les exilés républicains.
Ils essayèrent encore d’ébranler sa résolution, mais sans plus de succès.
— Non, laissez-moi retourner dans mon exil volontaire, — dit-il avec douceur; — mon temps est fini maintenant; si je pouvais faire quelque bien à Paris, j’irais, sans doute; mais l’opposition a besoin de soldats plus jeunes et plus solides que moi.
Émile et Horace protestèrent tous deux contre cette façon de voir, et la discussion se poursuivit jusqu’à ce qu’ils arrivassent à ces fameuses villas de plâtre et de lattes dont nous avons déjà parlé.
Ils remarquèrent alors que depuis quelques centaines de mètres environ les gens qu’ils avaient rencontrés les avaient regardés avec curiosité et avaient été particulièrement empressés à leur ôter leur chapeau.
Lesdites villas s’étendaient environ à trois quarts de kilomètre de la ville, et plus ils se rapprochaient d’Auvillars, plus le nombre des passants augmentait. Chacun d’eux, sans exception, les regardait, se rangeait de côté, et se découvrait.
— Il est évident que nous ne sommes plus ici incognito, — observa Horace, — voilà ce que c’est que de mettre son nom sur les registres d’un hôtel.
Un gendarme venait au devant d’eux à ce moment; il les regarda aussi, et... fit un salut militaire.
— Ah! — dit le républicain, — voici qui est décisif: ce n’est point Manuel Gérard que ce gendarme salue, c’est le duc d’Auvillars.
Il s’arrêta un moment.
— Je n’avais pas compté là-dessus, — murmura-t-il, —j’avais espéré qu’on ignorait ici que Gérard et le duc ne faisaient qu’un, Il ne serait pas à propos d’avoir une entrée triomphale dans Auvillars Si nous retournions sur nos pas, et si nous marchions jusqu’à la nuit.
Mais il était trop tard.
En se retournant, on apercevait un groupe de vingt ou trente personnes qui, formant arrière-garde, suivaient à une distance respectueuse: sans être trop expansifs, ils avaient l’air de gens extraordinairement attentifs.
Presque immédiatement, un autre groupe trois fois plus considérable se dessina à l’horizon.
Le fait est que Duval, le maître de l’hôtel de Pourlans, ayant perdu toute discrétion et tout sang-froid en découvrant qu’il donnait l’hospitalité au duc en personne, avait employé son après-midi à aller de porte en porte annoncer la grande, la merveilleuse, la stupéfiante nouvelle...
C’était vrai, bien vrai, le duc était enfin venu, il a dîné à l’hôtel!
Ce mot «il est venu», se répandit dans la ville avec la promptitude de l’éclair.
Puis peu à peu, et tout en voyageant, il grossissait à vue d’œil. On dit d’abord: «il est venu avec sa maison!» puis, «avec toute sa famille», puis, avec «tous ses chevaux, tous ses chiens.»
On fit la description des valets de pied, des piqueurs, des sommeliers, des officiers de bouche. On avait vu la calèche: elle était découverte, elle avait quatre chevaux.
Le receveur de l’enregistrement poussa même l’aplomb jusqu’à affirmer que le duc lui avait dit qu’il venait définitivement s’installer à Pourlans.
Je n’ai pas besoin de vous dire, n’est ce pas, que ce fut une véritable révolution dans Auvillars?
Les robes de soie noire qui, depuis trois ans, n’avaient point vu le jour, sortirent des commodes et des armoires comme par enchantement.
On ouvrit les fenêtres, on accrocha des drapeaux tricolores en calicot, on débarbouilla les enfants.
Le curé qui faisait son somme apparut tout à coup sur la place du Marché avec sa soutane la moins crasseuse.
Le Conseil municipal aussi fit toilette, et, le maire en tête, alla se ranger le long de l’Hôtel de Pourlans.
Bellanger, le grainetier, Coste, le bottier, et M. Leboucey, le percepteur, se faisaient remarquer par leur agitation.
Madame Coste était magnifique avec ses boucles d’oreilles grosses comme des amandes et son crêpe de Chine blanc. Elle s’était fourré un demi-flacon d’eau de Cologne dans les cheveux, ce qui fait qu’elle sentait extraordmairement bon.
D’autres dames de l’endroit avaient fait comme elle, et, depuis une heure, allaient, venaient, au travers de la ville.
Tout à coup ce mot retentit, fut répété par cent voix:
— Il vient!... il vient!...
Tous se précipitèrent, empressés, mais respectueux.
Il venait, en effet, et il avait, ma foi, fort grand air.
Quand ils parurent tous les trois, les acclamations éclatèrent; Bellanger criait comme un sourd:
— Vive le duc d’Auvillars!
Le bedeau avait la larme à l’œil; le capitaine des pompiers, en grand uniforme, avec son pantalon blanc, son sabre, faisait aussi le meilleur effet.
Ses hommes, quand ils aperçurent le duc et ses deux fils qui s’avançaient, tête nue, d’un pas tranquille, mais délibéré, n’y tinrent plus et, quoiqu’ils fussent sous les armes, poussèrent une longue acclamation.
Le brigadier de gendarmerie et ses quatre gendarmes avaient bien envie d’en faire autant, mais ils surent se contenir.
Hélas! que serait devenu l’enthousiasme de tous ces braves gens s’ils avaient su que ce grand monsieur qui faisait ainsi son entrée dans sa bonne ville d’Auvillars, accompagné de ses deux héritiers, était le démocrate, le républicain terrible, le révolutionnaire Manuel Gérard!