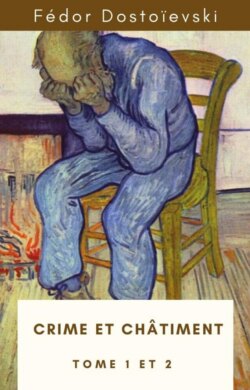Читать книгу Crime et châtiment (Tome 1 et 2) - Fedor Dostoievski - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII
ОглавлениеComme à sa précédente visite, il vit la porte s’entrebâiller et par l’étroite ouverture deux yeux perçants, apparus dans l’ombre, le fixer avec méfiance.
À ce moment le sang-froid l’abandonna et il commit une faute qui faillit tout gâter.
Craignant que la vieille ne fût prise de peur à l’idée de se trouver seule avec un visiteur dont l’aspect n’était pas pour la rassurer, il saisit la porte et la tira à lui pour que la vieille ne s’avisât pas de la refermer. L’usurière voyant cela ne fit pas un geste, mais elle ne lâcha pas non plus le bouton de la serrure, si bien qu’elle faillit être projetée sur le palier. Comme elle s’obstinait à rester debout sur le seuil et ne voulait point lui livrer passage, il marcha droit sur elle ; effrayée elle fit un saut en arrière et voulut parler, mais elle ne put prononcer un seul mot et continua à regarder le jeune homme avec de grands yeux.
« Bonjour, Alena Ivanovna », commença-t-il, du ton le plus dégagé qu’il put prendre. Mais ses efforts étaient vains, sa voix était entrecoupée, ses mains tremblaient. « Je vous... ai apporté... un objet... entrons plutôt pour en juger... il faut l’examiner à la lumière... »
Sans attendre qu’on l’invitât à entrer, il pénétra dans la pièce. La vieille courut derrière lui, sa langue s’était déliée.
« Seigneur, mais que voulez-vous ?... Qui êtes-vous ? Que vous faut-il ?
– Voyons, Alena Ivanovna... vous me connaissez bien... Raskolnikov... Tenez, je vous apporte le gage dont je vous ai parlé l’autre jour. » Il lui tendait l’objet.
La vieille jeta un coup d’œil sur le paquet puis parut se raviser ; elle releva les yeux et fixa l’intrus. Elle le considérait d’un regard perçant, irrité, soupçonneux. Une minute passa. Raskolnikov crut même remarquer une lueur de moquerie dans ses yeux, comme si elle avait tout deviné.
Il sentait qu’il perdait la tête, qu’il avait presque peur, si peur même que si cette inquisition muette se prolongeait une demi-minute de plus, il prendrait la fuite.
« Mais qu’avez-vous à me regarder comme si vous ne me reconnaissiez pas ? s’écria-t-il tout à coup, en se fâchant à son tour. Si vous voulez cet objet, prenez-le, s’il ne vous convient pas, c’est bien, je m’adresserai ailleurs, je n’ai pas de temps à perdre. »
Ces paroles lui échappaient malgré lui, mais ce langage résolu sembla tirer la vieille de son inquiétude.
« Mais aussi, mon ami, tu viens à l’improviste... Qu’est-ce que tu as là ? demanda-t-elle en regardant le gage.
– Un porte-cigarettes en argent, je vous en ai parlé la dernière fois. » Elle tendit la main.
« Mais pourquoi êtes-vous si pâle ? Vos mains tremblent, vous êtes malade, mon petit ?
– C’est la fièvre, fit-il, la voix entrecoupée ; comment ne pas être pâle quand on n’a rien à manger ? » ajouta-t-il, non sans peine.
Ses forces l’abandonnaient de nouveau ; mais sa réponse parut vraisemblable, la vieille lui prit le gage des mains.
« Qu’est-ce que c’est ? » demanda-t-elle en soupesant l’objet ; elle le fixait encore d’un long regard perçant.
« Un objet... un porte-cigarettes... en argent... regardez.
– Tiens, mais on dirait que ce n’est pas de l’argent... Oh ! comme il l’a ficelé ! »
Elle s’approchait de la lumière (toutes ses fenêtres étaient closes malgré la chaleur étouffante) et pendant qu’elle s’efforçait de défaire le paquet, elle lui tourna le dos, et cessa un instant de s’occuper de lui.
Il déboutonna alors son pardessus, dégagea la hache du nœud coulant, mais sans la retirer entièrement ; il se borna à la retenir de sa main droite, sous son vêtement. Une faiblesse terrible envahissait ses mains ; il les sentait d’instant en instant s’engourdir davantage. Il craignait de laisser échapper la hache... Soudain, la tête commença à lui tourner.
« Mais comment a-t-il ficelé cela ? – c’est tout emmêlé », fit la vieille agacée, en faisant un mouvement dans la direction de Raskolnikov.
Il n’y avait plus une seconde à perdre ; il retira la hache de dessous son pardessus, l’éleva à deux mains et d’un geste mou, presque machinal, la laissa retomber sur la tête de la vieille.
Il lui semblait n’avoir plus de forces ; elles lui revinrent dès qu’il eut frappé une fois.
La vieille était tête nue, selon son habitude ; ses cheveux clairs, grisonnants et rares, abondamment frottés d’huile, étaient tressés en une petite queue de rat, retenue sur la nuque par un fragment de peigne en corne ; comme elle était de petite taille, le coup l’atteignit à la tempe. Elle poussa un faible cri et soudain s’affaissa par terre après avoir cependant eu le temps de porter les mains à sa tête. L’une tenait encore le gage. Alors Raskolnikov la frappa de toutes ses forces deux fois, l’une après l’autre, à la tempe. Le sang jaillit à flot comme d’un verre renversé ; le corps s’abattit. Il recula pour le laisser tomber, puis se pencha sur son visage. Elle était déjà morte. Les yeux grands ouverts semblaient prêts à sortir de leurs orbites, le front et toute la figure étaient ridés et défigurés par les dernières convulsions.
Il déposa la hache sur le plancher près du cadavre et se mit immédiatement à fouiller, en prenant bien soin d’éviter les taches de sang, cette même poche droite d’où il lui avait vu tirer ses clefs la dernière fois. Il avait toute sa présence d’esprit, et n’éprouvait plus ni étourdissements, ni vertiges. Seules ses mains continuaient à trembler. Plus tard il se souvint d’avoir été très attentif, très prudent et même capable d’appliquer tous ses soins à ne pas se tacher... Il trouva très rapidement les clefs. Elles formaient comme la dernière fois un seul trousseau, fixé à un anneau d’acier.
Il courut ensuite, ces clefs à la main, vers la chambre à coucher. C’était une pièce de grandeur médiocre ; on voyait d’un côté une immense vitrine pleine d’images pieuses, de l’autre, un grand lit fort propre, couvert d’une courtepointe ouatinée, cousue de petits morceaux de soie dépareillés. Le troisième mur était occupé par une commode ; chose étrange, à peine eut-il entrepris d’ouvrir ce meuble et commencé à essayer les clefs, qu’une sorte de frisson le parcourut tout entier.
Un désir le reprit soudain de lâcher tout et de s’en aller, mais cette velléité ne dura qu’une seconde. Il était trop tard pour renoncer ; il sourit même d’avoir pu y songer quand une autre pensée, une pensée inquiétante, s’empara de lui.
Il lui sembla brusquement que la vieille n’était peut-être pas morte, qu’elle pouvait revenir à elle. Laissant là la commode et les clefs, il courut vivement auprès du corps, saisit la hache et la brandit encore, mais l’arme ne retomba point. Il ne pouvait y avoir de doute, la vieille était morte. En se penchant sur elle pour l’examiner de plus près, il constata que le crâne était fracassé.
Il se préparait à le toucher du doigt, mais il se ravisa ; il n’avait pas besoin de cette preuve. Une mare de sang s’était formée sur le parquet. Tout à coup, il remarqua un cordon au cou de la vieille et le tira, mais il était solide et ne se rompit pas ; au surplus, le sang l’engluait. Alors il essaya de l’enlever en le remontant, mais il rencontra un obstacle ; dans son impatience, il allait avoir encore recours à la hache pour trancher le lacet et en frapper le cadavre, mais il n’osa pas se résoudre à cette brutalité ! Enfin, après deux minutes d’efforts, il parvint à couper le cordon, en se rougissant les mains, mais sans toucher le corps ; puis il l’enleva.
Ainsi qu’il l’avait supposé, c’était une bourse que la vieille portait au cou ; il y avait encore, suspendues au cordon, une petite médaille émaillée et deux croix, l’une en bois de cyprès, l’autre en cuivre. La bourse crasseuse, en peau de chamois, était bourrée d’argent ; Raskolnikov la fourra dans sa poche sans l’ouvrir ; il jeta les croix sur la poitrine de la vieille et prenant cette fois la hache avec lui, il rentra précipitamment dans la chambre à coucher.
Il procéda avec une hâte fébrile, saisit les clefs et se remit à la besogne. Mais ses tentatives pour ouvrir les tiroirs demeuraient infructueuses. Non point tant à cause du tremblement de ses mains, que de ses méprises continuelles ; il vit par exemple que telle clef n’allait pas à une serrure et s’obstina cependant à vouloir l’y introduire. Soudain, il se dit que cette grosse clef dentelée qui faisait partie du trousseau avec les autres plus petites, ne devait pas appartenir à la commode (il se souvint qu’il l’avait déjà pensé la dernière fois), mais à quelque cassette où la vieille serrait peut-être toutes ses richesses.
Il abandonna donc la commode et se jeta sous le lit, sachant que les vieilles femmes ont l’habitude d’y cacher leurs coffres. Il y trouva en effet une assez grande caisse, longue de plus d’un mètre, couverte de maroquin rouge et cloutée d’acier ; la clef dentelée s’adaptait parfaitement à la serrure. Quand il l’eut ouverte, Raskolnikov aperçut sous le drap blanc qui la recouvrait, une pelisse de lièvre blanc garnie de rouge ; sous la fourrure, il y avait une robe de soie, puis un châle ; le fond ne semblait contenir que des chiffons. Il commença par essuyer ses mains ensanglantées à la garniture rouge. « C’est rouge, le sang doit se voir moins sur le rouge », pensa-t-il et soudain il se ravisa ; « Seigneur ! est-ce que je deviendrais fou ? » pensa-t-il tout effrayé.
Mais à peine avait-il remué ces hardes que de dessous la fourrure glissait une montre en or. Il se mit alors à retourner de fond en comble le contenu du coffre. Parmi les chiffons se trouvaient en effet des bijoux, des gages probablement qui n’avaient pas encore été retirés : des bracelets, des chaînes, des boucles d’oreilles, des épingles de cravate, etc. Les uns étaient enfermés dans des écrins, les autres simplement mais fort soigneusement enveloppés dans des journaux plies en deux et noués de faveurs. Il n’hésita pas un instant, fit main basse sur le tout et se mit à en bourrer les poches de son pantalon et de son pardessus, au hasard, sans ouvrir les paquets ni les écrins.
Mais il fut bientôt interrompu dans sa besogne. Il lui sembla entendre un bruit de pas dans la chambre de la vieille. Il s’arrêta, glacé de terreur. Non, tout était calme, il devait s’être trompé. Soudain, il perçut distinctement un léger cri, ou plutôt un faible gémissement entrecoupé qui se tut aussitôt, et de nouveau un silence de mort régna une ou deux minutes ; Raskolnikov accroupi sur les talons, devant le coffre, attendait, respirant à peine. Tout à coup, il bondit, saisit la hache et s’élança hors de la chambre à coucher.
Au milieu de cette pièce, Lisbeth, un grand paquet dans les mains, contemplait d’un air hébété le cadavre de sa sœur. Elle était pâle comme un linge et semblait n’avoir pas la force de crier. En le voyant apparaître, elle se mit à trembler comme une feuille, son visage se convulsa. Elle essaya de lever le bras, d’ouvrir la bouche, mais elle ne put proférer un son et se mit à reculer lentement vers le coin opposé, en le fixant toujours en silence, comme si le souffle lui manquait pour crier. Il se jeta sur elle, sa hache à la main ; les lèvres de la malheureuse se tordirent en une de ces grimaces qu’on remarque chez les tout petits enfants quand un objet les effraie et que, les yeux fixés sur lui, ils s’apprêtent à crier.
Elle était si naïve, cette malheureuse Lisbeth, si hébétée et si terrorisée qu’elle n’esquissa même pas le geste machinal de lever le bras pour protéger son visage ; elle souleva seulement son bras gauche et le tendit vers l’assassin, comme pour l’écarter. La hache pénétra droit dans le crâne, fendit la partie supérieure de l’os frontal et atteignit presque l’occiput. Elle tomba tout d’une pièce ; Raskolnikov perdit complètement la tête, s’empara de son paquet, puis l’abandonna et se précipita dans le vestibule.
Il était de plus en plus terrifié, surtout depuis le second meurtre qu’il n’avait point prémédité et il se pressait de fuir. S’il avait été à cet instant capable de mieux réfléchir, de comprendre les difficultés de sa situation sans issue, son horreur, toute son absurdité, d’autre part d’imaginer combien d’obstacles il lui restait à surmonter et de crimes à commettre pour s’arracher de cette maison et rentrer chez lui, peut-être aurait-il abandonné la lutte et serait-il allé se livrer, non par pusillanimité sans doute, mais par horreur de ce qu’il avait fait. C’était le dégoût surtout qui augmentait en lui de minute en minute. Il n’aurait pour rien au monde consenti désormais à s’approcher de la caisse ni même à rentrer dans l’appartement.
Cependant son esprit se laissait peu à peu distraire par d’autres pensées ; il tomba même dans une sorte de rêverie ; par moments il semblait s’oublier ou plutôt oublier les choses essentielles pour s’attacher à des vétilles. Cependant, ayant jeté un regard dans la cuisine et découvert, sur un banc, un seau à moitié plein d’eau, il eut l’idée de nettoyer ses mains et sa hache. Ses mains étaient ensanglantées, gluantes ; il plongea d’abord le tranchant de la hache dans le seau, puis prit un morceau de savon qui se trouvait dans une assiette fêlée sur l’appui de la fenêtre et il se lava.
Ensuite, il tira la hache du seau, nettoya le fer de son arme puis passa au moins trois minutes à en frotter le bois qui avait également reçu des éclaboussures de sang. Enfin il essuya le tout à un linge qui séchait sur une corde tendue à travers la cuisine et il se mit à examiner attentivement la hache devant la fenêtre. Les traces accusatrices avaient disparu, mais le bois était encore humide. Il la remit soigneusement dans le nœud coulant, sous son pardessus. Après quoi, il inspecta son pantalon, son paletot, ses chaussures, aussi minutieusement que le lui permettait la pénombre où était plongée la cuisine.
À première vue, ses vêtements n’offraient rien de suspect ; les bottes seulement étaient souillées de sang ; il trempa un chiffon dans l’eau et les essuya. Il savait du reste qu’il y voyait mal et qu’il pouvait ne pas remarquer des taches fort visibles. Il restait indécis au milieu de la pièce, en proie à une pensée angoissante ; il se disait qu’il était peut-être devenu fou, hors d’état de réfléchir et de se défendre, occupé à des choses qui le menaient à sa perte...
« Seigneur, mon Dieu ! Il faut fuir, fuir », marmotta t-il et il se précipita dans le vestibule ; il devait y éprouver une terreur telle qu’il n’en avait jamais connue jusqu’ici. Un moment, il demeura immobile, n’osant en croire ses yeux ; la porte de l’appartement, la porte extérieure du vestibule qui donnait sur le palier, celle-là même à laquelle il sonnait tout à l’heure et par où il était entré, cette porte était entrouverte ; pas un tour de clef, pas de verrou, ouverte tout le temps ; pendant tout ce temps, ouverte ! La vieille avait négligé de la fermer derrière lui, peut-être par précaution, mais, Seigneur ! il avait pourtant bien vu Lisbeth, et comment avait-il pu ne pas deviner qu’elle était entrée par la porte ? Elle ne pouvait pas avoir traversé la muraille, tout de même !
Il se précipita sur la porte et la verrouilla.
« Mais non, encore une sottise, il faut fuir, fuir. »
Il tira le verrou, ouvrit la porte et se mit aux écoutes. Longtemps il prêta l’oreille. On entendait des cris lointains, ils devaient venir d’en bas, de la porte cochère ; deux voix fortes échangeaient des injures.
« Qu’est-ce que ces gens font là ? » Il attendit patiemment ; enfin le bruit cessa, coupé net, eût-on dit ; les hommes étaient partis. Il se préparait à sortir, quand, à l’étage au-dessous, la porte de l’appartement s’ouvrit avec fracas et quelqu’un se mit à descendre en fredonnant. « Mais qu’est-ce qu’ils ont donc tous à faire tant de bruit ? » pensa-t-il ; il referma de nouveau la porte sur lui et attendit.
Finalement le silence régna ; pas une âme. Mais au moment où il s’apprêtait à descendre, son oreille perçut un nouveau bruit de pas. Ils étaient fort éloignés et semblaient résonner sur les premières marches de l’escalier ; Raskolnikov se souvint parfaitement plus tard avoir pressenti, dès qu’il les entendit, qu’ils se dirigeaient vers le quatrième. À coup sûr, l’homme allait chez la vieille ; d’où lui venait ce pressentiment ? Le bruit de ces pas était-il particulièrement significatif ? Ils étaient lourds, réguliers et lents.
L’homme parvenait au palier du premier étage ; le voilà qui montait encore, les pas devenaient de plus en plus distincts ! on entendait maintenant le souffle asthmatique de l’homme. Il atteignait le troisième étage... « Ici ! Il vient ici ! » Raskolnikov se sentit soudain paralysé, il croyait vivre un de ces cauchemars où l’on se voit poursuivi par des ennemis, sur le point d’être atteint et assassiné, sans pouvoir remuer un membre pour se défendre, comme si l’on était cloué au sol.
L’autre commençait à monter l’escalier qui menait au quatrième étage, quand Raskolnikov put enfin secouer la torpeur qui l’avait envahi, se glisser d’un mouvement vif et adroit dans l’appartement, puis en refermer la porte ; ensuite il tira le verrou en ayant soin de ne pas faire de bruit. Son instinct le guidait ; quand il eut pris ces précautions, il se blottit contre la porte en retenant son souffle. Le visiteur inconnu était déjà sur le palier. Il se trouvait maintenant vis-à-vis de Raskolnikov, à l’endroit d’où celui-ci avait épié les bruits de l’appartement tout à l’heure, quand seule la porte le séparait de la vieille.
L’homme souffla profondément à plusieurs reprises. « Il doit être grand et gros », pensa Raskolnikov en serrant sa hache dans ses mains. Tout cela ressemblait à un rêve, en effet. L’autre tira violemment le cordon de la sonnette.
Quand retentit le son métallique, il lui sembla entendre remuer dans l’appartement et pendant quelques secondes il écouta attentivement ; puis l’homme sonna encore, attendit un peu et, soudain pris d’impatience, se mit à secouer de toutes ses forces le bouton de la porte. Raskolnikov regardait, horrifié, le verrou trembler dans son ferrement et il s’attendait à le voir sauter d’un moment à l’autre ; une morne épouvante s’était emparée de lui.
La chose était possible, en effet, sous la violence des secousses imprimées à la porte. Un moment, il eut l’idée de maintenir le verrou d’une main, mais l’autre pouvait deviner le manège. Il perdait tout sang-froid ; la tête recommençait à lui tourner. « Je vais tomber », pensa-t-il ; à cet instant l’inconnu se mit à parler et Raskolnikov retrouva sa présence d’esprit.
« Mais est-ce qu’elles roupillent par hasard ou les a-t-on étranglées, créatures trois fois maudites ! rugit-il d’une voix de basse ; hé ! Alena Ivanovna ! vieille sorcière ! Lisbeth Ivanovna ! ma beauté ! – Ouvrez ! hou ! filles trois fois maudites. Dorment-elles ? »
Exaspéré, il sonna encore au moins dix fois le plus fort qu’il put. On voyait bien que c’était un homme impérieux et qu’il avait ses habitudes dans la maison.
Au même instant, des pas légers, rapides et assez proches retentirent dans l’escalier ; c’était encore quelqu’un qui montait au quatrième. Raskolnikov n’avait pas entendu arriver ce nouveau visiteur.
« Il est impossible qu’il n’y ait personne ! fit le nouvel arrivé d’une voix joyeuse et sonore en s’adressant au premier visiteur qui continuait à tirer la sonnette. – Bonsoir, Koch. »
« Un tout jeune homme, à en juger par sa voix », pensa tout à coup Raskolnikov.
« Le diable le sait ; un peu plus je brisais la serrure, répondit Koch. Et vous, comment me connaissez-vous ?
– En voilà une question ! Je vous ai gagné trois parties l’une après l’autre au billard avant-hier, chez Gambrinus.
– Ah !...
– Alors elles ne sont pas chez elles ! Étrange ! Je dirai même que c’est idiot ; où a-t-elle pu aller, la vieille ? J’ai à lui parler.
– Moi aussi, mon vieux, j’ai à lui parler.
– Que faire ? Il n’y a plus qu’à s’en retourner. Et moi qui pensais me procurer de l’argent ! s’écria le jeune homme.
– Naturellement qu’il faut s’en retourner ; mais aussi pourquoi fixer un rendez-vous ? C’est la vieille elle-même qui m’a indiqué l’heure. Il y a un bout de chemin d’ici chez moi. Où diable peut-elle traîner ? Je n’y comprends rien ; cette vieille sorcière ne bouge pas de toute l’année ; elle moisit sur place, ses jambes sont malades et voilà que tout d’un coup elle s’en va se balader !
– Si l’on interrogeait le concierge ?
– Pourquoi ?
– Mais pour savoir où elle est et quand elle reviendra.
– Hum, peste !... interroger... Mais elle ne sort jamais. » Il secoua encore une fois le bouton de la porte. « Ah ! diable, rien à faire, il faut s’en aller.
– Attendez ! s’écria tout à coup le jeune homme, regardez : voyez-vous comme la porte cède quand on tire ?
– Et alors ?
– Cela signifie qu’elle n’est pas fermée à clef, mais au crochet ; entendez-vous hocher le verrou ?
– Et alors ?
– Comment, vous ne comprenez pas ? C’est la preuve que l’une d’elles est à la maison. Si elles étaient sorties toutes les deux elles auraient fermé la porte à clef de l’extérieur et n’auraient pas mis le crochet à l’intérieur. Écoutez, entendez-vous le verrou qui hoche ? Or, pour mettre le verrou, il faut être chez soi, comprenez-vous ? C’est donc qu’elles sont chez elles et ne veulent pas ouvrir.
– Bah ! mais oui, au fait ! s’écria Koch tout stupéfait. Mais alors, qu’est-ce qu’elles font ? » Il se mit à secouer furieusement la porte.
« Arrêtez, reprit le jeune homme, ne tirez pas comme cela, il y a quelque chose de louche là-dessous... Vous avez sonné, tiré sur la porte et elles n’ouvrent pas, cela veut dire qu’elles sont toutes les deux évanouies, ou alors...
– Quoi ?
– Oui ! Allons chercher le concierge pour qu’il les réveille lui-même.
– C’est une idée. »
Tous deux se mirent en devoir de descendre.
– Attendez. Restez ici, moi j’irai chercher le concierge.
– Et pourquoi resterais-je ?
– Qui sait ce qui peut arriver ?
– Soit...
– Voyez-vous, je fais mes études pour être juge d’instruction. Il y a quelque chose qui n’est pas clair ici, c’est évident, é-vi-dent », fit le jeune homme avec chaleur ; et il se mit à descendre l’escalier quatre à quatre.
Koch, resté seul, sonna encore une fois tout doucement, puis il se mit à tourmenter d’un air songeur le bouton de la porte, le tirant à lui, puis le laissant aller, pour mieux se convaincre qu’elle n’était fermée qu’au verrou. Ensuite il se baissa en soufflant et voulut regarder par le trou de la serrure, mais on avait laissé la clef dedans, de sorte qu’il était impossible de rien voir.
Debout, devant la porte, Raskolnikov serrait la hache dans ses mains. Il semblait en proie au délire. Il était même prêt à se battre avec ces hommes quand ils pénétreraient dans l’appartement. En les entendant cogner et se concerter entre eux il avait été plus d’une fois prêt à en finir d’un coup et à les interpeller à travers la porte. Parfois il éprouvait l’envie de les injurier et de les narguer, jusqu’à ce qu’ils ouvrent. Il songea même : « Ah ! qu’ils en finissent au plus vite ! »
« Qu’est-ce qu’il fait donc, diable ?... »
Le temps passait, une minute, une autre et personne ne venait. Koch commençait à s’énerver.
« Mais, qu’est-ce qu’il fait, diable ?... » gronda-t-il soudain ; à bout de patience, il abandonna la faction et se mit à descendre d’un pas pesant en faisant sonner lourdement ses bottes sur l’escalier.
« Seigneur ! que faire ? »
Raskolnikov tira le verrou, entrebâilla la porte ; on n’entendait pas un bruit, il sortit sans plus réfléchir, ferma la porte du mieux qu’il put et s’engagea dans l’escalier.
Il avait déjà descendu trois marches quand il entendit un grand vacarme à l’étage en dessous. Où se fourrer ? Nulle part où se cacher ; il remonta rapidement.
« Hé, maudit, que le diable... Arrêtez-le. »
Celui qui poussait ces cris venait de surgir d’un appartement du dessous et s’engageait dans l’escalier non pas au galop, mais comme une trombe en criant à tue-tête :
« Mitka, Mitka, Mitka, Mitka, Mitka, le diable l’emporte, le fou ! »
Les cris s’étouffaient ; les derniers venaient déjà de la cour ; puis tout retomba dans le silence. Mais au même instant plusieurs individus qui s’entretenaient bruyamment entre eux se mirent à monter tumultueusement l’escalier ; ils étaient trois ou quatre. Raskolnikov distingua la voix sourde du jeune homme de tout à l’heure. « C’est eux ! » pensa-t-il.
N’espérant plus leur échapper, il alla carrément à leur rencontre.
« Arrive que pourra ! S’ils m’arrêtent tout est perdu ; mais s’ils me laissent passer aussi, car ils se souviendront de moi. » La rencontre paraissait inévitable ; un étage à peine les séparait, quand soudain ! – le salut : à quelques marches de lui, sur sa droite, un appartement vide avait sa porte grande ouverte. Ce même logement du deuxième étage où travaillaient les peintres tout à l’heure – et qu’ils venaient de quitter comme par un fait exprès. C’étaient eux probablement qui étaient sortis en poussant les cris. Les planchers étaient fraîchement repeints ; au milieu de la chambre traînaient encore un cuveau, une boîte de peinture et un pinceau. Raskolnikov se glissa dans le logement et se dissimula contre la muraille ; il était temps ; les hommes étaient déjà sur le palier mais ils ne s’y arrêtèrent pas et continuèrent à monter vers le quatrième, en causant toujours bruyamment. Il attendit un instant, puis sortit sur la pointe des pieds et descendit précipitamment.
Personne dans l’escalier ; personne sous la porte cochère ; il en franchit rapidement le seuil et tourna à gauche.
Il savait fort bien, il savait parfaitement que les hommes étaient en ce moment dans le logis de la vieille, qu’ils étaient fort surpris de trouver ouverte la porte tout à l’heure close, qu’ils examinaient les cadavres et qu’il ne leur faudrait pas plus d’une minute pour deviner que le meurtrier était à l’instant encore dans l’appartement et qu’il venait à peine de fuir ; peut-être devineraient-ils aussi qu’il s’était caché dans l’appartement vide pendant qu’ils montaient.
Pourtant, il n’osait pas hâter le pas, bien qu’il lui restât cent pas à faire jusqu’au premier coin de rue.
« Si je me glissais sous une porte cochère, pensa-t-il, et si j’attendais un moment dans l’escalier d’une autre maison ? Non, c’est mauvais. Jeter ma hache ? prendre une voiture ? Ah, malheur ! malheur ! »
Ses pensées s’embrouillaient ; enfin une ruelle s’offrit à lui, il s’y engagea plus mort que vif ; il était à moitié sauvé – il le comprenait –, il risquait déjà moins d’être soupçonné et, d’autre part, la ruelle était pleine de passants, il s’y perdait comme un grain de sable.
Mais toutes ces angoisses l’avaient tellement affaibli qu’il avait peine à marcher. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son visage ; son cou était tout trempé.
« Encore un qui a son compte ! » lui cria quelqu’un comme il débouchait devant le canal.
Il n’avait plus sa tête à lui ; plus il allait, plus son esprit se troublait. Toutefois, en arrivant sur le quai, il s’effraya de le voir presque vide ; de crainte d’être remarqué, il regagna la ruelle. Quoique prêt à tomber d’épuisement, il fit un détour pour rentrer chez lui.
Quand il franchit la porte de sa maison, il n’avait pas encore retrouvé ses esprits. Il était dans l’escalier lorsqu’il se souvint de la hache.
Il lui restait à mener à bien une opération des plus importantes : la remettre à sa place sans attirer l’attention. Naturellement il n’était plus en état de comprendre qu’il valait mieux ne pas rapporter la hache à l’endroit où il l’avait prise, mais s’en débarrasser en la jetant, par exemple, dans la cour d’une autre maison.
Pourtant, tout se passa le mieux du monde. La porte de la loge était fermée, mais pas à clef : le concierge, probablement, était chez lui. Mais Raskolnikov avait si bien perdu toute faculté de raisonner, qu’il s’approcha de la loge et ouvrit la porte.
Si l’autre avait surgi à cet instant pour lui demander : « Que voulez-vous ? » peut-être lui aurait-il tout bonnement tendu la hache. Mais cette fois encore la loge se trouvait vide et cette circonstance permit au jeune homme de replacer la hache sous le banc, à l’endroit où il l’avait trouvée ; il la recouvrit même d’une bûche, comme elle était tantôt.
Ensuite il monta jusqu’à sa chambre, sans rencontrer personne ; la porte de l’appartement de la logeuse était close.
Rentré chez lui, il se jeta sur son divan tout habillé et tomba dans une sorte d’inconscience qui n’était pas le sommeil. Si quelqu’un était entré dans sa chambre pendant ce temps, il aurait sans doute bondi et poussé un cri. Sa tête fourmillait de bribes d’idées, mais il avait beau faire, il n’en pouvait suivre, ni même saisir aucune...