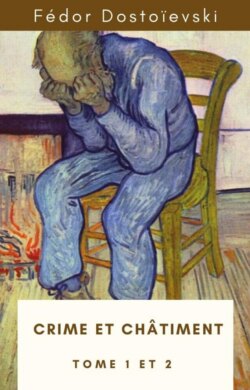Читать книгу Crime et châtiment (Tome 1 et 2) - Fedor Dostoievski - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
Оглавление« Et si la perquisition avait déjà eu lieu ? Je peux aussi bien les rencontrer chez moi... »
Mais voici sa chambre, tout y est en ordre, on n’y voit personne ; Nastassia elle-même n’a touché à rien.
Seigneur, comment avait-il pu laisser toutes ces affaires dans ce trou ?
Il se précipita vers le coin et, introduisant sa main sous la tapisserie, il les retira et en remplit ses poches. Il y avait huit pièces en tout : deux petites boîtes contenant des boucles d’oreilles ou quelque chose d’approchant. Il ne s’arrêta pas à les examiner. Puis, quatre petits écrins en maroquin. Une chaîne de montre était simplement enveloppée dans un journal, un autre objet qui semblait devoir être une décoration également. Raskolnikov mit le tout dans ses poches, dans celles de son pantalon et dans la seule qui restât à son pardessus, la droite, en faisant tout son possible pour qu’elles ne parussent pas trop gonflées. Il prit la bourse aussi et sortit de la pièce en laissant la porte grande ouverte, cette fois.
Il marchait d’un pas rapide et ferme ; il se sentait lucide quoique brisé. Il redoutait les poursuites et craignait que, dans une demi-heure, un quart d’heure peut-être, on n’eût déjà décidé de le faire suivre. Il fallait par conséquent se hâter de faire disparaître les pièces à conviction. Il devait s’acquitter de cette tâche tant qu’il lui restait un semblant de forces et quelque sang-froid... Mais où aller ?... Cette question était résolue depuis longtemps. « Je jetterai les objets dans le canal et toute l’affaire en tombera à l’eau, ni vu ni connu. » Voilà ce qu’il avait décidé dès la nuit précédente, dans son délire, et il avait alors, à plusieurs reprises, tenté de se lever pour aller tout jeter au plus vite. Pourtant, l’exécution de ce plan présentait de graves difficultés.
Pendant plus d’une demi-heure, il se contenta d’errer sur le quai du canal Catherine, en examinant au fur et à mesure tous les escaliers qui conduisaient au bord de l’eau. Mais il ne pouvait pas songer à réaliser son dessein. Ici, c’était un lavoir où des blanchisseuses travaillaient ; plus loin des barques amarrées à la berge et le quai fourmillait de passants ; il risquait d’être vu, remarqué de toutes parts : on trouverait étrange de voir un homme descendre exprès, s’arrêter et jeter quelque chose ; et si les écrins surnageaient au lieu de disparaître ? Ce qui ne manquerait pas d’arriver... Chacun pourrait les voir. Surtout que déjà les gens le regardaient d’un air singulier en le croisant, comme s’ils n’avaient à se préoccuper que de lui. « Pourquoi me regardent-ils ainsi, songeait-il, ou est-ce un effet de mon imagination ? »
Enfin, il pensa qu’il ferait peut-être mieux de se diriger vers la Néva. Il y avait en effet moins de monde sur les quais du fleuve. Il risquait moins d’être remarqué ; puis il était plus commode d’y jeter les objets ; surtout il serait plus loin de son quartier. Et soudain, il se demanda avec étonnement pourquoi il avait passé une demi-heure au moins à errer si anxieusement dans des lieux dangereux au lieu de trouver cette solution. Il avait perdu une demi-heure, toute une demi-heure, à vouloir accomplir un projet insensé, uniquement parce qu’il en avait formé le plan dans son délire. Il devenait à la vérité extrêmement distrait, sa mémoire sombrait et il s’en rendait compte. Décidément, il fallait faire vite !
Il se dirigea vers la Néva par la perspective V..., mais chemin faisant, une autre idée lui vint. Pourquoi la Néva. Pourquoi jeter les objets à l’eau ? Ne valait-il pas mieux s’en aller quelque part au loin, dans les îles par exemple, et là, chercher un endroit solitaire, dans un bois, y enfouir le paquet au pied d’un arbre, en prenant soin cependant de noter l’endroit ? Bien qu’il se rendît compte qu’il était incapable, à cette minute, de raisonner logiquement, cette pensée lui parut fort pratique.
Mais il était dit qu’il ne parviendrait pas non plus jusqu’aux îles. Comme il débouchait de la perspective V... sur la place, il aperçut tout à coup sur sa gauche l’entrée d’une cour entourée d’immenses murailles ; à droite en entrant, un mur, qui semblait ne jamais avoir été peint, celui d’une haute maison voisine ; à gauche, parallèle à ce mur, une clôture de bois qui s’enfonçait de vingt pas environ dans la cour, puis tournait à gauche ; elle délimitait un espace de terrain isolé et couvert de matériaux. Plus loin, tout au fond de la cour, on apercevait un hangar dont le toit dépassait la palissade. Il devait y avoir là un atelier de sellerie, de menuiserie ou quelque chose d’approchant. Tout le terrain était noirci d’une poussière de charbon qui s’étalait partout. « Voilà un endroit où jeter les objets, puis s’en aller », pensa-t-il. Ne voyant personne autour de lui, il se faufila dans la cour et aperçut tout près de la porte, contre la palissade, une gouttière (comme on en voit souvent dans les bâtiments qui abritent des ateliers). Au-dessus de la gouttière on avait inscrit à la craie, sur la clôture, comme il convient, en pareil cas : « Défense du riné ». C’était déjà un avantage qu’il ne risquât pas d’éveiller les soupçons en s’y arrêtant. Il songea : « Je pourrais tout jeter ici quelque part et m’en aller. »
Il promena un dernier regard autour de lui et mit la main à sa poche. Mais, à ce moment-là, il remarqua tout à coup près du mur extérieur, entre la porte et la gouttière, une énorme pierre non équarrie qui devait peser une cinquantaine de kilos au moins. De l’autre côté du mur, dans la rue, on entendait le bruit des passants, toujours assez nombreux à cet endroit. Du dehors, personne ne pouvait l’apercevoir ; il aurait fallu pour cela que quelqu’un se penchât dans la cour, ce qui pouvait arriver du reste. Il fallait donc se hâter.
Il se baissa vers la pierre, la saisit à deux mains par son sommet, et, réunissant toutes ses forces, parvint à la renverser. Le sol à l’endroit qu’elle avait occupé, formait un petit creux ; il y jeta aussitôt tout ce qu’il avait dans ses poches. La bourse par-dessus les bijoux. Néanmoins la cavité n’était pas encore entièrement comblée. Il releva d’un seul mouvement la pierre et parvint à la replacer à l’endroit où elle se trouvait auparavant ; tout au plus semblait-elle un peu exhaussée. Mais il tassa avec son pied un peu de terre contre les bords. Il n’y paraissait plus.
Alors il sortit et se dirigea vers la place. De nouveau, une joie intense, presque insupportable, s’empara momentanément de lui. Ni vu ni connu. « Et qui songerait, non, mais qui pourrait songer à fouiller sous cette pierre ? Elle est peut-être là depuis qu’on a bâti la maison, Dieu sait combien de temps elle y restera encore. Et même si on trouvait les objets ? Qui songera à moi ? Tout est fini. Plus de preuves ! » Il se mit à rire, oui, il se souvint plus tard d’avoir ri d’un petit rire nerveux, muet, interminable. Il riait encore en traversant la place, mais, quand il arriva sur le boulevard où il avait l’autre jour fait la rencontre de la jeune fille, son hilarité cessa brusquement.
D’autres pensées lui étaient venues. L’idée de passer devant le banc, où il était resté à réfléchir, après le départ de la fillette, lui paraissait épouvantable, effroyable également celle de rencontrer ce gendarme « moustachu » auquel il avait donné vingt kopecks. « Le diable l’emporte ! »
Il continuait à marcher en jetant autour de lui des regards furieux et distraits. Toutes ses pensées tournaient maintenant autour d’un seul point dont il s’avouait lui-même toute l’importance. Il sentait, que pour la première fois depuis deux mois, il se trouvait seul en face de cette question, en tête à tête avec elle.
« Ah ! le diable emporte tout cela ! pensa-t-il tout à coup dans un accès de violente colère. Le vin est tiré, il faut le boire, que le diable l’emporte et la nouvelle vie aussi ! Que tout cela est bête, Seigneur ! Que de mensonges j’ai débités, combien j’ai commis de bassesses aujourd’hui ! Quelles misérables platitudes pour me concilier la bienveillance de l’exécrable Ilia Petrovitch. Bah ! qu’importe ! Je me moque pas mal de tous ces gens et des turpitudes que j’ai pu commettre ! Ce n’est pas du tout de cela qu’il s’agit. Pas le moins du monde... »
Et soudain, il s’arrêta net ; une question nouvelle, inattendue, infiniment simple, venait de se poser à lui et le frappait d’étonnement : « Si tu as agi dans toute cette histoire en homme intelligent et non en imbécile, si tu as poursuivi un but précis, comment se fait-il que tu n’aies pas jeté un coup d’œil dans la bourse et comment en es-tu à ignorer ce que t’a rapporté l’acte dont tu n’as pas craint d’assumer les dangers, l’horreur et l’infamie ? N’étais-tu pas prêt tout à l’heure à jeter à l’eau cette bourse, ces bijoux que tu n’as même pas regardés ?... Enfin, à quoi cela rime-t-il ? »
Oui, toutes ces réflexions étaient parfaitement fondées. Il le savait bien avant de se les formuler. La nuit où il avait résolu de tout jeter à l’eau, il avait pris cette décision sans hésiter, comme s’il lui eût été impossible d’agir autrement... Oui, il savait toutes ces choses et se souvenait du moindre détail ; il savait que tout devait se passer ainsi ; il le savait depuis le moment où il avait tiré les écrins du coffre sur lequel il était penché... Oui, parfaitement...
« C’est parce que je suis très malade, décida-t-il enfin, d’un air sombre. Je me torture et me déchire moi-même ; je suis incapable de contrôler mes actions... Hier, avant-hier et tous ces jours-ci, je ne fais que me martyriser... Quand je serai guéri, je ne le ferai plus... Mais si je ne guéris jamais ? Seigneur ! Comme je suis las de toute cette histoire ! »
Il continuait à marcher, tout en réfléchissant ainsi. Il avait terriblement envie d’échapper à ces pensées, mais ne savait comment s’y prendre. Une sensation nouvelle s’emparait irrésistiblement de lui et croissait d’instant en instant. C’était un dégoût presque physique, un dégoût opiniâtre, haineux pour tout ce qu’il rencontrait, toutes les choses et les gens qui l’entouraient. Il avait horreur de tous les passants, horreur de leurs visages, de leur démarche, de leurs moindres mouvements. Il aurait aimé leur cracher à la face, il était prêt à mordre quiconque lui adresserait la parole...
Arrivé sur le quai de la Petite-Néva, dans Vassilievski Ostrov, il s’arrêta soudain brusquement près du pont. « C’est là qu’il habite, ici, dans cette maison, pensa-t-il. Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Mes jambes m’ont machinalement porté jusqu’au logis de Rasoumikhine, la même histoire que l’autre jour. C’est tout de même très curieux ; suis-je venu exprès ou bien ai-je été amené ici par le hasard ? N’importe, j’ai bien dit l’autre jour que j’irais chez Rasoumikhine le lendemain. Eh bien ! voilà, je suis venu ! Est-ce que je ne pourrais plus lui rendre visite par hasard ? »
Il monta au cinquième étage où habitait son ami.
Ce dernier était chez lui en train d’écrire dans sa chambre ; il vint lui ouvrir lui-même. Ils ne s’étaient pas vus depuis quatre mois. Il portait une robe de chambre toute usée, presque en lambeaux ; il avait les pieds nus dans des pantoufles, les cheveux ébouriffés ; il n’était ni rasé, ni lavé. Il parut étonné en voyant Raskolnikov.
« Que t’arrive-t-il ? » s’écria-t-il en l’examinant des pieds à la tête, puis il se tut et laissa échapper un sifflement. « Les affaires vont donc si mal ? Le fait est, frère, que tu arrives à nous dépasser tous en fait d’élégance, ajouta-t-il en examinant les haillons de son camarade. Assieds-toi donc, tu dois être fatigué. » Et quand Raskolnikov se laissa tomber sur le divan turc tendu de toile usée (un divan pire, entre parenthèses, que le sien), Rasoumikhine remarqua soudain que son hôte paraissait souffrant.
« Mais tu es sérieusement malade, le sais-tu au moins ? » Il voulut tâter le pouls. Raskolnikov lui arracha sa main.
« Non, fit-il, inutile, je suis venu... voilà, je n’ai plus de leçons... je voulais... non, je n’ai nul besoin de leçons...
– Veux-tu que je te dise une chose ? Tu as le délire, fit observer Rasoumikhine qui le considérait attentivement.
– Non, je ne l’ai pas... », répondit Raskolnikov en se levant.
Il n’avait pas prévu, en montant chez Rasoumikhine, qu’il allait se trouver face à face avec son ami. Or, il comprit à cet instant qu’un tête-à-tête avec quiconque était la chose au monde qui lui répugnait le plus. Le seuil de Rasoumikhine à peine franchi, il avait failli étouffer de colère contre lui-même.
« Adieu, fit-il en se dirigeant vers la porte.
– Mais attends, attends donc, espèce de fou.
– Inutile, répéta l’autre en retirant brusquement la main que son ami avait saisie.
– Mais alors, pourquoi diable es-tu venu ? Tu as perdu la boussole, enfin... C’est presque une offense que tu me fais. Je ne te laisserai pas partir comme ça.
– Eh bien, écoute. Je suis venu chez toi, car je ne connais que toi qui puisses m’aider à commencer... parce que tu es meilleur qu’eux tous, c’est-à-dire plus intelligent et tu peux juger... Maintenant, je vois que je n’ai besoin de rien, entends-tu, de rien du tout... Je me passe des services et de la sympathie des autres... Je suis seul et me suffis à moi-même... Puis, en voilà assez. Laissez-moi tranquille.
– Mais attends une minute, espèce de pantin ! Il est fou, ma parole ! Tu peux en faire à ta guise, tu sais. Moi non plus, je n’ai pas de leçons et je m’en moque. J’ai au marché un libraire Kherouvimov qui vaut bien une leçon en son genre. Je ne l’échangerai pas contre cinq leçons dans des familles de marchands. Il publie des petits livres sur les sciences naturelles ; cela s’enlève comme du pain. Les titres à eux seuls sont des trouvailles ! Voilà, tu m’as toujours traité d’imbécile ; eh bien vrai, je te donne ma parole qu’il y a des gens plus bêtes que moi. Mon éditeur, qui ne sait ni a ni b, veut suivre le mouvement, et moi, naturellement, je l’encourage. Tiens, tu as ici deux feuilles et demie de texte allemand, du pur charlatanisme selon moi ; en un mot, l’auteur se préoccupe de savoir si la femme est un être humain. Naturellement, il tient pour l’affirmative et il s’attache à le démontrer solennellement. Kherouvimov juge cette brochure d’actualité en ce moment où le féminisme est à la mode ; je la lui traduis donc. Il tirera bien six feuilles de ces deux feuilles et demie de texte allemand. Nous les ferons précéder d’un titre ronflant qui remplira bien une demi-page et nous vendrons cela cinquante kopecks le volume. Cela marchera ! On me paye ma traduction à raison de six roubles la feuille, ce qui fait quinze roubles pour le tout ; j’en ai touché six d’avance. Quand nous aurons fini, nous traduirons un livre sur les baleines ; puis nous avons choisi quelques menus cancans dans les Confessions, et nous les traduirons aussi. Quelqu’un a dit à Kherouvimov que Rousseau est une sorte de Radichtchev1. Naturellement, je ne proteste pas, le diable les emporte. Eh bien, veux-tu traduire la seconde feuille de la brochure : La femme est-elle un être humain ? Si tu veux, prends immédiatement le texte, des plumes, du papier, tout cela est aux frais de l’éditeur, et voilà trois roubles ; puisque j’en ai reçu six d’avance pour toute la traduction, cela fait donc trois qui te reviennent pour ta part. Quand tu auras traduit ta feuille, tu en recevras encore trois. Surtout, ne va pas te figurer que tu me dois de la reconnaissance ; au contraire, dès que tu es entré, j’ai pensé à t’utiliser. Tout d’abord, je ne suis pas fort en orthographe et ensuite mes connaissances en allemand sont vraiment pitoyables, si bien que je suis souvent obligé d’inventer ; je m’en console en pensant que l’ouvrage ne peut qu’y gagner. Mais après tout, peut-être ai-je tort ?... Alors, c’est dit, tu acceptes ? »
Raskolnikov prit en silence les feuilles du texte allemand et les trois roubles, et sortit sans dire un mot, Rasoumikhine le suivit d’un regard étonné. Mais, arrivé au premier coin de rue, Raskolnikov revint brusquement sur ses pas et remonta chez son ami ; il déposa sur la table les feuilles et les trois roubles, puis ressortit, toujours en silence.
« Mais tu deviens fou, vociféra Rasoumikhine, pris enfin de fureur. Quelle est cette comédie que tu joues là ? Tu m’as fait perdre la tête, parole d’honneur. Pourquoi es-tu venu dans ce cas, mille diables ?
– Je n’ai pas besoin de traductions, marmotta Raskolnikov, en continuant à descendre.
– Mais alors de quoi diable as-tu besoin ? » lui cria Rasoumikhine, du haut de son palier.
L’autre descendait toujours en silence.
« Hé, dis donc, où habites-tu ? »
Pas de réponse.
« Eh bien, alors, le d-d-diable t’emporte ! »
Mais Raskolnikov était déjà dans la rue ; il traversait le pont Nicolas quand une aventure désagréable le fit encore revenir momentanément à lui. Un cocher, dont les chevaux avaient failli le renverser, lui donna un grand coup de fouet dans le dos après lui avoir crié de se garer au moins trois ou quatre fois. Ce coup de fouet le mit dans une telle fureur qu’il bondit jusqu’au parapet (Dieu sait pourquoi il avait marché au milieu de la chaussée jusqu’ici) en grinçant des dents. Tout le monde naturellement s’était mis à rire autour de lui.
« C’est bien fait !
– Encore un voyou, pour sûr.
– On connaît cela, il fait l’ivrogne, il se fourre exprès sous les roues, et ensuite c’est moi qui suis responsable.
– Il y en a qui vivent de cela, naturellement. »
Il était encore là, appuyé au garde-fou, en se frottant le dos, à suivre des yeux, le cœur plein de fureur, la voiture qui s’éloignait, quand il sentit que quelqu’un lui glissait une pièce d’argent dans les mains. Il tourna la tête et vit une vieille marchande en bonnet, chaussée de bottines en peau de chèvre, accompagnée d’une jeune fille en chapeau, qui tenait une ombrelle verte, sa fille sans doute.
« Prends cela, mon ami, au nom du Christ ! »
Il prit l’argent. Elles continuèrent leur chemin. C’était une pièce de vingt kopecks. Elles avaient très bien pu le prendre, à sa mine et à son costume, pour un véritable mendiant des rues ; quant à cette offrande généreuse de vingt kopecks, il en était sans doute redevable au coup de fouet qui avait apitoyé les deux femmes.
Il serra la pièce dans sa main, fit une vingtaine de pas et se tourna vers le fleuve, dans la direction du Palais d’Hiver. Le ciel était sans un nuage et l’eau de la Néva, par extraordinaire, presque bleue. La coupole de la cathédrale de Saint-Isaac2 (c’était précisément l’endroit de la ville où elle apparaissait le mieux) rayonnait et l’on pouvait, dans l’air transparent, distinguer jusqu’au moindre ornement de la façade. La brûlure occasionnée par le coup de fouet s’apaisait. Raskolnikov oubliait son humiliation ; une pensée inquiète et un peu vague le préoccupait ; il restait là immobile, le regard fixé sur l’horizon. L’endroit où il se trouvait lui était particulièrement familier. Quand il fréquentait encore l’Université, il avait l’habitude, surtout au retour, de s’y arrêter (il l’avait fait plus de cent fois) et de contempler ce panorama vraiment merveilleux. Il s’étonnait toujours d’une impression confuse et vague qui l’envahissait à cet instant ! Ce tableau splendide lui semblait inexplicablement glacial, comme privé d’esprit et de résonance... Il se sentait surpris chaque fois de cette impression mystérieuse et sombre mais il ne s’arrêtait pas à l’analyser et il remettait toujours à plus tard l’espoir d’en trouver l’explication. Il se souvenait maintenant de ces incertitudes, de ces sensations vagues... et non pas pur hasard, croyait-il. Le seul fait de s’être arrêté au même endroit qu’autrefois, comme s’il avait imaginé pouvoir retrouver les mêmes pensées, s’intéresser aux mêmes spectacles qu’alors... que tout dernièrement encore, lui paraissait bizarre, extravagant, un peu comique même, bien qu’il en eût le cœur douloureusement serré ; tout ce passé, enfin, ses anciennes pensées, ses intentions, les buts qu’il avait poursuivis, ce paysage bien connu et lumineux, tout, tout cela lui paraissait enfoui dans un trou profond et presque invisible sous ses pieds... Il lui semblait s’envoler dans l’espace et voir disparaître toutes ces choses... Il fit un geste machinal et sentit la pièce de vingt kopecks toujours serrée dans sa main fermée. Alors il l’ouvrit, regarda fixement l’argent, leva le bras et jeta la pièce dans le fleuve. Ensuite, il se détourna et rentra chez lui. Il lui semblait, à cet instant, avoir tranché lui-même, aussi sûrement qu’avec des ciseaux, le lien qui le retenait à l’humanité, à la vie en général.
Le soir tombait quand il arriva dans son logis ; il avait donc marché six heures au moins, mais il ne put se souvenir par quelles rues il avait passé. Il se déshabilla en tremblant tout entier comme un cheval fourbu, s’étendit sur son divan, se couvrit de son vieux pardessus et s’endormit aussitôt...
L’obscurité était complète quand il fut réveillé par un cri affreux. Quel cri, Seigneur ! Il n’avait jamais entendu pareils gémissements, pareils hurlements, pareils grincements de dents, pareils sanglots, pareils coups. Il n’aurait pu imaginer une fureur aussi bestiale.
Il se souleva épouvanté, et s’assit sur son lit, torturé par l’horreur et la crainte. Mais les coups, les plaintes, les invectives croissaient d’instant en instant. Et soudain, il reconnut, à son profond étonnement, la voix de la logeuse. Elle geignait, hurlait. Les mots sortaient de sa bouche si pressés, si rapides, qu’il était impossible de comprendre ce qu’elle disait, mais elle devait supplier qu’on cessât de la frapper, car on la battait impitoyablement dans l’escalier. La voix de son bourreau n’était plus qu’un râle furieux, mais lui aussi parlait avec la même hâte et ses paroles pressées, étouffées, étaient également inintelligibles.
Raskolnikov se mit soudain à trembler comme une feuille : il venait de reconnaître cette voix ; c’était celle d’Ilia Petrovitch. Ilia Petrovitch était ici et il battait la logeuse. Il la battait avec les pieds, il lui frappait la tête contre les marches ; on l’entendait distinctement, on pouvait en juger aux cris de la victime, au bruit des coups.
Mais était-ce le monde renversé ? Les gens, accourant au bruit, se rassemblaient sur l’escalier. Il en venait de tous les étages, on entendait des exclamations, des bruits de pas qui montaient ou descendaient ; les portes claquaient. « Mais pourquoi la bat-il ? pourquoi ? et peut-on admettre une chose pareille ? » se demandait Raskolnikov, persuadé qu’il devenait fou. Mais, non, il percevait trop distinctement tous ces bruits... Ainsi, on allait bientôt venir chez lui aussi, puisque... « car assurément, c’est pour la chose d’hier... Seigneur... ! »
Il voulut verrouiller sa porte, mais il n’eut pas la force de lever le bras ; d’ailleurs à quoi bon ? La frayeur glaçait son âme, le paralysait tout entier... Enfin ce vacarme, qui avait duré dix bonnes minutes, s’éteignit peu à peu. La logeuse gémissait doucement. Ilia Petrovitch continuait à jurer et à menacer, puis lui aussi se tut ; on ne l’entendait plus. « Seigneur ! il est donc parti ! Oui, il s’en va et la logeuse aussi, tout en larmes, gémissante... »
La porte a claqué. Les locataires quittent l’escalier, tous regagnent leurs appartements, ils poussent des exclamations, discutent, s’interpellent d’abord à grands cris, puis à voix basse en murmurant. Ils devaient être fort nombreux, toute la maison avait dû accourir. « Seigneur, tout cela est-il possible ? Et lui, pourquoi, au nom du Ciel, est-il venu ? »
Raskolnikov retomba, à bout de forces, sur son divan, mais il n’arriva plus à fermer l’œil de la nuit ; une demi-heure passa ; il était en proie à une épouvante, à une horreur qu’il n’avait jamais éprouvées. Tout à coup, une vive lumière illumina sa chambre. Nastassia était entrée, une bougie et une assiette de soupe à la main. La servante le regarda attentivement et, s’étant assurée qu’il ne dormait pas, elle déposa la bougie sur la table, puis disposa tout ce qu’elle avait apporté : le pain, le sel, la cuiller, l’assiette.
« Tu n’as sûrement pas mangé depuis hier. Tu as traîné toute la journée sur le pavé avec la fièvre dans le corps !
– Nastassia, pourquoi a-t-on battu la patronne ? »
Elle le regarda fixement.
« Qui a battu la patronne ?
– Tout à l’heure, il y a une demi-heure. Ilia Petrovitch, l’adjoint du commissaire de police, sur l’escalier... pourquoi l’a-t-il battue ainsi... et que venait-il faire ? »
Nastassia avait froncé les sourcils ; un long moment elle l’examina en silence ; son regard inquisiteur troublait Raskolnikov ; il finit même par l’effrayer.
« Nastassia, pourquoi ne réponds-tu pas ? demanda-t-il enfin d’une voix faible et timide.
– C’est le sang, murmura-t-elle enfin, comme si elle se parlait à elle-même.
– Le sang ?... quel sang ? » balbutia-t-il, en pâlissant et il recula vers la muraille.
Nastassia cependant continuait à le regarder.
« Personne n’a battu la patronne », fit-elle enfin d’une voix ferme et sévère. Il la considérait, respirant à peine.
« Mais j’ai entendu moi-même... je ne dormais pas... j’étais assis, fit-il d’une voix plus timide encore. J’ai longtemps écouté... L’adjoint du commissaire est venu... Tout le monde est accouru de tous les logements, dans l’escalier...
– Personne n’est venu ; c’est le sang qui crie en toi. Quand il ne tourne plus, il forme des caillots dans le foie et on a la berlue... Vas-tu manger ou non ? »
Il ne répondit pas. Nastassia toujours penchée sur lui continuait à le regarder attentivement et ne s’en allait point.
« Donne-moi à boire, Nastassiouchka3. »
Elle descendit et revint deux minutes plus tard, rapportant de l’eau dans une petite cruche de terre ; mais là s’arrêtaient les souvenirs de Raskolnikov. Plus tard, il se souvint seulement avoir lampé une gorgée d’eau fraîche et laissé tomber un filet d’eau sur sa poitrine. Ensuite il perdit connaissance.
1 Radichtchev : Écrivain de la fin du XVIIIème siècle. Auteur du célèbre Voyage de Pétersbourg à Moscou où il s’élève violemment contre les abus du servage et du système judiciaire russe. Exilé en Sibérie par Catherine II.
2 La cathédrale Saint-Isaac : La plus grande église de Saint-Pétersbourg, bâtie par Montferrand, surmontée d’un dôme majestueux qui rappelle ceux de Saint-Pierre de Rome et du Panthéon.
3 Forme caressante de « Nastassia » – Anastasie.