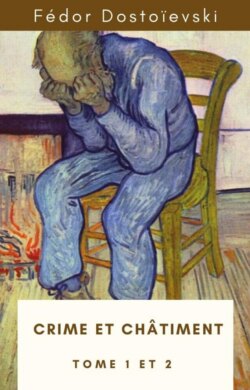Читать книгу Crime et châtiment (Tome 1 et 2) - Fedor Dostoievski - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
Оглавление« Je me proposais, en effet, il n’y a pas bien longtemps, de demander à Rasoumikhine de me procurer du travail, des leçons ou autre chose... songeait Raskolnikov. Mais, à présent, que peut-il pour moi ? Mettons qu’il me trouve des leçons et même qu’il partage son dernier kopeck avec moi, s’il en a un... de telle sorte que je puisse m’acheter des chaussures, réparer mes habits afin de pouvoir aller donner mes leçons, hum ! Bon, et après ? Que ferai-je de ces kopecks ? Est-ce ce dont j’ai besoin à présent ? Je suis vraiment ridicule d’aller chez Rasoumikhine. » La question de savoir pour quelle raison il se rendait maintenant chez Rasoumikhine le tourmentait plus qu’il ne se l’avouait à lui-même. Il cherchait fiévreusement un sens sinistre, pour lui, à cette démarche, en apparence si anodine.
« Quoi donc, se peut-il que j’aie pensé arranger toute l’affaire grâce au seul Rasoumikhine ? trouver la solution à toutes ces graves questions en lui ? » se demandait-il avec surprise.
Il réfléchissait, se frottait le front, et, chose bizarre, tout à coup, après qu’il se fut mis longtemps l’esprit à la torture, une idée extraordinaire lui vint brusquement.
« Hum ! j’irai chez Rasoumikhine, fit-il soudain du ton le plus calme, comme s’il avait pris une décision définitive. J’irai chez Rasoumikhine, cela est certain... mais pas maintenant... j’irai chez lui... le lendemain, après la chose, quand la « chose » sera finie et quand tout aura changé... »
Tout à coup, Raskolnikov revint à lui.
« Après la chose, s’écria-t-il en sursautant, mais cette chose aura-t-elle lieu, aura-t-elle vraiment lieu ? »
Il quitta le banc et s’éloigna d’un pas rapide ; il courait presque, avec l’intention de retourner en arrière, de rentrer, mais, à cette idée, le dégoût s’empara de lui. C’était chez lui, là, dans un coin de cet horrible placard qu’était sa chambre, qu’avait mûri la « chose », il y avait déjà plus d’un mois, et il se mit à marcher droit devant lui, à l’aventure.
Son tremblement nerveux avait pris un caractère fébrile ; il se sentait frissonner ; il avait froid malgré la chaleur accablante. Cédant à une sorte de nécessité intérieure et presque inconsciente, il s’efforça péniblement de fixer son attention sur les divers objets qu’il rencontrait, afin de se distraire de ses pensées, mais ses efforts étaient vains ; il retombait à chaque instant dans sa rêverie. Au bout d’un moment, il tressaillait encore, relevait la tête, jetait un regard autour de lui et ne pouvait plus se rappeler à quoi il pensait tout à l’heure. Il ne reconnaissait même pas les rues qu’il parcourait. Il traversa ainsi tout Vassilievski Ostrov, déboucha devant la petite Néva, passa le pont et arriva aux îles1. La verdure et la fraîcheur du paysage réjouirent d’abord ses yeux las, habitués à la poussière des rues, à la chaux, aux immenses maisons écrasantes. L’air ici n’était plus étouffant, ni puant ; on n’y voyait point de cabaret. Mais bientôt ces sensations nouvelles perdirent leur charme ; un agacement maladif le reprit.
Il s’arrêtait par moments devant une villa coquettement nichée dans la verdure ; il regardait par la grille et voyait au loin des femmes élégantes sur les balcons et les terrasses ; des enfants couraient dans les jardins. Il s’intéressait surtout aux fleurs ; c’étaient elles qui attiraient particulièrement ses regards. De temps en temps, il voyait passer des cavaliers, des amazones et de belles voitures ; il les suivait d’un œil curieux et les oubliait avant qu’ils eussent disparu.
Une fois, il s’arrêta et compta son argent ; il lui restait trente kopecks : « vingt au sergent de ville, trois à Nastassia pour la lettre, j’en ai donc donné hier à Marmeladov quarante-sept ou cinquante », se dit-il. Il devait avoir une raison de calculer ainsi, mais il l’oublia en tirant l’argent de sa poche et ne s’en souvint qu’un peu plus tard en passant devant un marchand de comestibles, une sorte de gargote plutôt ; il sentit alors qu’il avait faim.
Il entra dans la gargote, y avala un verre de vodka et mangea quelques bouchées d’un petit pâté qu’il emporta et acheva en se promenant. Il y avait très longtemps qu’il n’avait bu de vodka ; le petit verre qu’il venait d’avaler agit sur lui d’une façon foudroyante. Ses jambes s’appesantirent ; il éprouva une forte envie de dormir. Il voulut retourner chez lui, mais, arrivé à l’île de Petrovsky2, il dut s’arrêter, complètement épuisé.
Quittant donc la grande route, il entra dans les taillis, se laissa tomber sur l’herbe et s’endormit aussitôt.
Les songes d’un homme malade prennent très souvent un relief extraordinaire et rappellent la réalité à s’y méprendre. Le tableau qui se déroule ainsi est parfois monstrueux, mais les décors où il évolue, tout le cours de la représentation sont si vraisemblables, pleins de détails si imprévus, si ingénieux et d’un choix si heureux, que le dormeur serait assurément incapable de les inventer à l’état de veille, fût-il un artiste aussi grand que Pouchkine ou Tourgueniev. Ces rêves – nous parlons toujours de rêves maladifs – ne s’oublient pas facilement ; ils produisent une vive impression sur l’organisme délabré et en proie à une excitation nerveuse.
Raskolnikov fait un rêve effrayant. Il se revoit enfant dans la petite ville qu’il habitait alors avec sa famille3. Il a sept ans et se promène un soir de fête avec son père, aux portes de la ville, en pleine campagne. Le temps est gris, l’air étouffant, les lieux exactement pareils au souvenir qu’il en a gardé. Au contraire, il retrouve en songe plus d’un détail qui s’était effacé de sa mémoire. La petite ville apparaît tout entière, à découvert. Pas un seul arbre, pas même un saule blanc, aux environs ; au loin seulement, à l’horizon, aux confins du ciel, dirait-on, un petit bois fait une tache sombre.
À quelques pas du dernier jardin de la ville s’élève un cabaret, un grand cabaret, qui impressionnait toujours désagréablement l’enfant et l’effrayait même quand il passait par là en se promenant avec son père. Il était toujours plein d’une foule de gens qui braillaient, ricanaient, s’injuriaient et chantaient d’une façon si horrible avec des voix éraillées et se battaient si souvent. Autour du cabaret erraient toujours des ivrognes aux figures affreuses. Quand le garçonnet les rencontrait, il se serrait convulsivement contre son père et tremblait tout entier. Près du cabaret, un chemin de traverse toujours poussiéreux, et dont la poussière semblait si noire ! Il était sinueux ; à trois cents pas environ du cabaret, il obliquait à droite et contournait le cimetière.
Au milieu du cimetière s’élève une église de pierre à la coupole verte. L’enfant y allait deux fois par an avec son père et sa mère entendre célébrer la messe pour le repos de l’âme de sa grand-mère morte depuis longtemps et qu’il n’avait pas connue. À ces occasions, ils emportaient toujours sur un plat enveloppé d’une serviette le gâteau des morts4 où la croix était figurée par des raisins secs. Il aimait cette église, ses vieilles images saintes presque toutes sans cadres et aussi son vieux prêtre à la tête branlante. Près de la pierre tombale de sa grand-mère se trouvait une toute petite tombe, celle de son frère cadet, mort à six mois, qu’il n’avait pas connu non plus et dont il ne pouvait pas se souvenir. On lui avait seulement dit qu’il avait eu un petit frère et, chaque fois qu’il venait au cimetière, il se signait pieusement devant la petite tombe, puis s’inclinait avec respect et la baisait.
Voici maintenant son rêve. Il suit avec son père le chemin qui mène au cimetière ; ils passent devant le cabaret. Il tient son père par la main et y jette un regard effrayé. Or, un fait particulier attire son attention : il semble qu’il s’y passe une fête aujourd’hui. On y voit une foule de bourgeoises endimanchées, de paysannes avec leurs maris, puis tout un ramassis d’individus louches. Tous sont ivres et chantent des chansons ; devant la porte stationne une charrette des plus bizarres, une de ces énormes charrettes attelées généralement de lourds chevaux de trait et qui servent à transporter des marchandises et des fûts de vin. Raskolnikov aimait toujours contempler ces grandes bêtes à la longue crinière, aux jarrets épais, qui avancent d’un pas mesuré et tranquille et traînent sans fatigue de véritables montagnes (on dirait même au contraire qu’elles marchent mieux attelées à des chargements que libres). Mais, à présent, chose étrange, à cette lourde charrette est attelé un petit cheval rouan d’une maigreur pitoyable, une de ces rosses qu’il avait vues bien souvent tirer avec peine une haute charretée de bois ou de foin, que les paysans accablent de coups, allant jusqu’à les frapper en plein museau et sur les yeux quand les pauvres bêtes s’épuisent vainement à essayer de dégager le véhicule embourbé. Ce spectacle lui faisait toujours venir les larmes aux yeux quand il était enfant, et sa maman alors se hâtait de l’éloigner de la fenêtre.
Soudain, un grand tapage s’élève dans le cabaret. Il en sort, avec des cris, des chants, un tas de grands moujiks avinés, en chemises bleues et rouges, la balalaïka à la main, la souquenille jetée négligemment sur l’épaule. « Montez, montez tous, crie un homme encore jeune, au cou épais, à la face charnue d’un rouge carotte. Je vous emmène tous, montez. » Ces paroles provoquent des exclamations et des rires.
« Une rosse pareille faire le chemin ?
– Mais il faut que tu aies perdu l’esprit, Mikolka, pour atteler une pauvre bête comme ça à cette charrette !
– Dites donc, les amis, elle a au moins vingt ans cette jument rouanne !
– Montez, j’emmène tout le monde ! » se remet à crier Mikolka, en sautant le premier dans la charrette.
Il saisit les rênes et se dresse de toute sa taille sur le siège.
« Le cheval bai est parti tantôt avec Mathieu, crie-t-il de sa place, et cette jument-là, les amis, est un vrai crève-cœur pour moi. J’ai envie de l’abattre, parole d’honneur, elle n’est même pas capable de gagner sa nourriture. Montez, vous dis-je. Je la ferai bien galoper ; je vous dis que je la ferai galoper. »
Il prend son fouet et se prépare avec délice à fouetter la jument rouanne.
« Mais montez donc, voyons, ricane-t-on dans la foule, puisqu’on vous dit qu’elle va galoper !
– Il y a au moins dix ans qu’elle n’a pas galopé !
– Oh ! elle vous ira bon train !
– Ne la ménagez pas, les amis, prenez chacun un fouet ; allez-y. C’est cela. Fouettez-la. »
Tous grimpent dans la charrette de Mikolka avec des rires et des plaisanteries. Ils s’y sont fourrés à six et il reste encore de la place. Ils prennent avec eux une grosse paysanne à la face rubiconde, vêtue d’une saraphane5, la coiffure garnie de verroterie ; elle croque des noisettes et ricane.
La foule qui entoure l’équipage rit aussi et, en vérité, comment ne pas rire à l’idée qu’une pareille rosse devra emporter au galop tout ce monde ! Deux gars qui se trouvent dans la charrette prennent aussitôt des fouets pour aider Mikolka. On crie : « Allez ! » Le cheval tire de toutes ses forces, il est non seulement incapable de galoper, mais c’est à peine s’il réussit à marcher au pas. Il piétine, gémit, plie le dos sous les coups que tous les fouets font pleuvoir sur lui dru comme grêle. Les rires redoublent dans la charrette et parmi la foule ; mais Mikolka se fâche et, dans sa colère, frappe de plus belle la petite jument comme s’il espérait la faire galoper.
« Frères, laissez-moi monter moi aussi, fait un gars alléché par ce joyeux tintamarre.
– Monte ! Montez tous, crie Mikolka ; elle nous emmènera tous ; je la ferai bien marcher à force de coups. » Et de fouetter, de fouetter la bête. Dans sa fureur, il ne sait même plus avec quoi la frapper pour la faire souffrir davantage.
« Papa, petit père, crie Rodia, petit père, que font-ils ? Ils battent le pauvre petit cheval.
– Allons, viens, viens, dit le père. Ce sont des ivrognes, ils s’amusent, les imbéciles. Allons-nous-en, ne regarde pas. »
Il veut l’emmener, mais l’enfant lui échappe et se précipite hors de lui vers la pauvre bête. Le malheureux animal est déjà à bout de forces. Il s’arrête tout haletant, puis se remet à tirer ; peu s’en faut qu’il ne s’abatte.
« Fouettez-la, qu’elle en crève, hurle Mikolka. Il n’y a que ça ; je vais m’y mettre.
– Pour sûr, tu n’es pas un chrétien, espèce de démon, crie un vieillard dans la foule.
– A-t-on jamais vu une petite jument comme celle-là traîner une charge pareille ? ajoute un autre.
– Tu la feras crever, crie un troisième.
– Ne m’embêtez pas, elle est à moi, j’en fais ce que je veux. Venez, montez tous ! Je veux absolument qu’elle galope... »
Soudain, une bordée d’éclats de rire retentit dans la foule et couvre la voix de Mikolka. La jument, accablée de coups redoublés, avait perdu patience et s’était mise à ruer malgré sa faiblesse. Le vieux n’y peut tenir et partage l’hilarité générale. Il y avait de quoi rire en effet : un cheval qui tient à peine sur ses pattes et qui rue !
Deux gars se détachent de la foule, s’arment de fouets et courent cingler la bête des deux côtés, l’un à droite, l’autre à gauche.
« Fouettez-la sur le museau, dans les yeux, en plein dans les yeux, vocifère Mikolka.
– Frères, une chanson », crie quelqu’un dans la charrette, et tous de reprendre le refrain ; la chanson grossière retentit, le tambourin résonne, on siffle la ritournelle ; la paysanne croque ses noisettes et ricane.
Rodia s’approche du petit cheval ; il s’avance devant lui ; il le voit frappé sur les yeux, oui sur les yeux ! Il pleure. Son cœur se gonfle ; ses larmes coulent. L’un des bourreaux lui effleure le visage de son fouet ; il ne le sent pas, il se tord les mains, il crie, il se précipite vers le vieillard à la barbe blanche qui hoche la tête et semble condamner cette scène. Une femme le prend par la main et veut l’emmener ; il lui échappe et court au cheval, qui à bout de forces tente encore de ruer.
« Le diable t’emporte, maudit ! » vocifère Mikolka dans sa fureur. Il jette le fouet, se penche, tire du fond de la carriole un long et lourd brancard et, le tenant à deux mains par un bout, il le brandit péniblement au-dessus de la jument rouanne.
« Il va l’assommer, crie-t-on autour de lui.
– La tuer.
– Elle est à moi », hurle Mikolka ; il frappe la bête à bras raccourcis. On entend un fracas sec.
« Fouette-la, fouette-la, pourquoi t’arrêtes-tu ? crient des voix dans la foule. Mikolka soulève encore le brancard, un second coup s’abat sur l’échine de la pauvre haridelle. Elle se tasse ; son arrière-train semble s’aplatir sous la violence du coup, puis elle sursaute et se met à tirer avec tout ce qui lui reste de forces, afin de démarrer, mais elle ne rencontre de tous côtés que les six fouets de ses persécuteurs ; le brancard se lève de nouveau, retombe pour la troisième fois, puis pour la quatrième, d’une façon régulière. Mikolka est furieux de ne pouvoir l’achever d’un seul coup.
« Elle a la vie dure, crie-t-on autour de lui.
– Elle va tomber, vous verrez, les amis, sa dernière heure est venue, observe un amateur, dans la foule.
– Prends une hache, il faut en finir d’un coup, suggère quelqu’un.
– Qu’avez-vous à bayer aux corneilles ? place ! » hurle Mikolka. Il jette le brancard, se penche, fouille de nouveau dans la charrette et en retire cette fois un levier de fer.
« Gare », crie-t-il ; il assène de toutes ses forces un grand coup à la pauvre bête. La jument chancelle, s’affaisse, tente un dernier effort pour tirer, mais le levier lui retombe de nouveau pesamment sur l’échine ; elle s’abat sur le sol, comme si on lui avait tranché les quatre pattes d’un seul coup.
« Achevons-la », hurle Mikolka ; il bondit, pris d’une sorte de folie, hors de la charrette. Quelques gars, aussi ivres et cramoisis que lui, saisissent ce qui leur tombe sous la main : des fouets, des bâtons, ou un brancard, et ils courent sur la petite jument expirante. Mikolka, debout près d’elle, continue à frapper de son levier, sans relâche. La pauvre haridelle allonge la tête, pousse un profond soupir et crève.
« Il l’a achevée ! crie-t-on dans la foule.
– Et pourquoi ne voulait-elle pas galoper ?
– Elle est à moi », crie Mikolka, son levier à la main. Il a les yeux injectés de sang et semble regretter de n’avoir plus personne à frapper.
« Eh bien, vrai, tu es un mécréant », crient plusieurs assistants dans la foule.
Mais le pauvre garçonnet est hors de lui. Il se fraye un chemin, avec un grand cri, et s’approche de la jument rouanne. Il enlace son museau immobile et sanglant, l’embrasse ; il embrasse ses yeux, ses lèvres, puis il bondit soudain et se précipite, les poings en avant, sur Mikolka. Au même instant, son père qui le cherchait depuis un moment, le découvre enfin, l’emporte hors de la foule...
« Allons, allons, lui dit-il, allons-nous-en à la maison.
– Petit père, pourquoi ont-ils tué... le pauvre petit cheval ? » sanglote l’enfant. Mais il a la respiration coupée et les mots s’échappent de sa gorge contractée en cris rauques.
« Ce sont des ivrognes, ils s’amusent ; ce n’est pas notre affaire, viens ! » dit le père. Rodion l’entoure de ses bras, mais sa poitrine est serrée dans un étau de feu ; il essaie de reprendre son souffle, de crier – et s’éveille.
Raskolnikov s’éveilla, le corps moite, les cheveux trempés de sueur, tout haletant et se souleva plein d’épouvante.
« Dieu soit loué ; ce n’était qu’un rêve », dit-il en s’asseyant sous un arbre ; il respira profondément.
« Mais qu’est-ce donc ? Une mauvaise fièvre qui commence ? Ce songe affreux me le ferait croire ! »
Il sentait tout son corps moulu ; son âme était sombre et troublée. Appuyant les coudes sur ses genoux, il laissa tomber sa tête dans ses mains.
« Seigneur, s’exclama-t-il, se peut-il, mais se peut-il vraiment que je prenne une hache pour la frapper et lui fracasser le crâne ? Se peut-il que je glisse sur le sang tiède et gluant, que j’aille forcer la serrure, voler, trembler, et me cacher tout ensanglanté... avec ma hache ?... Seigneur, cela est-il possible ?... »
Il tremblait comme une feuille en parlant ainsi.
« À quoi vais-je penser ? continua-t-il d’un ton de profonde surprise. Je savais bien que je n’en serais pas capable. Pourquoi me tourmenter ainsi ?... Car, enfin, hier encore, quand je suis allé faire cette... répétition, j’ai parfaitement compris que c’était au-dessus de mes forces... Pourquoi recommencer maintenant ? me tâter encore ? Hier, en descendant cet escalier, je me disais que c’était lâche, horrible, odieux, odieux. La seule pensée de la chose me soulevait le cœur et me terrifiait. Non, je n’en aurai pas le courage ; je ne l’aurais pas, lors même que mes calculs seraient parfaitement justes, que tout mon plan forgé ce mois-ci serait clair comme le jour et exact comme l’arithmétique. Seigneur ! je n’en aurai pas le courage, jamais... jamais... Qu’ai-je donc à continuer encore... »
Il se leva, lança un regard étonné autour de lui comme s’il eût été surpris de se trouver là et s’engagea sur le pont. Il était pâle, ses yeux brillaient ; ses membres étaient douloureux, mais il commençait à respirer avec moins de peine. Il sentait qu’il avait déjà rejeté ce fardeau effrayant qui, si longtemps, l’avait écrasé de son poids ; son âme lui semblait allégée et paisible. « Seigneur, pria-t-il, indique-moi ma route et je renoncerai à ce rêve... maudit ! »
En traversant le pont, il regardait la Néva et le flamboyant coucher d’un soleil magnifique. Malgré sa faiblesse, il n’éprouvait pas de fatigue. On eût dit que l’abcès qui, tout ce mois, s’était peu à peu formé dans son cœur, venait de crever soudain. Libre ! Il était libre ! Le charme était rompu, les maléfices insidieux avaient cessé d’agir.
Plus tard, quand Raskolnikov évoquait cette période de sa vie et tout ce qui lui était arrivé pendant ce temps, minute par minute, point par point, une chose le frappait toujours d’un étonnement presque superstitieux, quoiqu’elle n’eût après tout rien d’extraordinaire, mais elle lui semblait avoir eu une influence décisive sur son destin.
Voici le fait qui resta toujours pour lui une énigme : Pourquoi, alors qu’il se sentait fatigué, harassé, qu’il aurait dû rentrer chez lui par le chemin le plus court, le plus direct, pourquoi était-il retourné par la place des Halles centrales6 où il n’avait rien à faire ? Sans doute ce détour n’allongeait pas beaucoup son chemin, mais il était tout à fait inutile. Il lui était certes arrivé des dizaines de fois de rentrer sans savoir par quelles rues il avait passé. Mais, pourquoi, se demandait-il, pourquoi cette rencontre si importante, si décisive pour lui, et en même temps si fortuite sur la place des Halles (où il n’avait rien à faire), s’était-elle produite à présent, à cette heure, à cette minute de sa vie et dans des conditions telles qu’elle devait avoir, et elle seule, sur sa destinée, l’influence la plus grave, la plus décisive ? Il était tenté de la croire préparée par le destin.
Il était près de neuf heures quand le jeune homme arriva sur la place des Halles centrales. Tous les marchands en plein vent, les colporteurs, les boutiquiers et les gros commerçants se préparaient à fermer leurs magasins ; ils débarrassaient leurs éventaires, vidaient leurs étalages, serraient leurs marchandises et rentraient chez eux, ainsi que leurs clients. Devant les gargotes, qui occupaient les caves des maisons sales et nauséabondes de la place, et surtout à la porte des cabarets grouillait une foule de petits trafiquants et de loqueteux.
Raskolnikov fréquentait volontiers cet endroit et les ruelles avoisinantes quand il sortait de chez lui sans but précis. Ses propres haillons n’y attiraient le dédain de personne et l’on pouvait s’y montrer accoutré n’importe comment sans risquer de soulever le scandale. Au coin de la ruelle K..., un marchand et sa femme vendaient des articles de mercerie étalés sur deux tables : du fil, du coton, des cordons, des mouchoirs d’indienne, etc. Ils se préparaient à s’en aller eux aussi ; ils s’étaient simplement attardés à causer avec une personne qu’ils connaissaient et qui venait de s’approcher. C’était Elisabeth Ivanovna, ou comme on avait coutume de l’appeler, Lisbeth, la sœur cadette de cette même vieille Alena Ivanovna, la veuve du contrôleur, l’usurière chez laquelle Raskolnikov avait été la veille engager sa montre et tenter une répétition... Il y avait longtemps qu’il était renseigné sur le compte de cette Lisbeth ; elle aussi le connaissait un peu. C’était une grande fille de trente-cinq ans, gauche, timide et douce, presque une idiote ; elle tremblait devant sa sœur qui la traitait en esclave, la faisait travailler jour et nuit et allait même jusqu’à la battre.
Debout, un paquet à la main devant le marchand et sa femme, elle les écoutait attentivement et semblait indécise. Eux lui expliquaient quelque chose d’un air fort animé. Quand Raskolnikov aperçut Lisbeth, il éprouva un sentiment étrange qui ressemblait à une sorte d’étonnement profond, quoique cette rencontre n’eût rien de surprenant à la vérité.
« Vous devriez, Lisbeth Ivanovna, prendre toute seule votre décision, faisait le marchand à haute voix. Venez, par exemple, demain vers les sept heures ; eux viendront de leur côté.
– Demain, fit Lisbeth d’une voix traînante et l’air pensif, comme si elle avait peine à se décider...
– Elle a su vous en inspirer, une peur, Alena Ivanovna ! s’écria la marchande, qui était une gaillarde, d’une voix aiguë. Quand je vous regarde comme ça, il me semble que vous n’êtes qu’un petit enfant. Après tout, elle n’est que votre demi-sœur, et voyez comme elle vous domine.
– Pour cette fois, je vous le conseille, vous devriez ne rien dire à Alena Ivanovna, interrompit le mari. Bien sûr. Venez chez nous sans demander la permission. Il s’agit d’une bonne affaire. Votre sœur pourra elle-même s’en convaincre.
– Oui... Si je venais tout de même ?
– Entre six et sept. Les vendeurs enverront quelqu’un eux aussi, et vous déciderez vous-même, voilà !
– Et nous vous offrirons du thé, ajouta la femme.
– Bien, je viendrai », proféra Lisbeth qui semblait continuer à hésiter ; elle se mit à prendre congé de sa façon traînante.
Raskolnikov avait déjà dépassé le groupe et n’en entendit pas davantage. Il avait ralenti le pas insensiblement et s’était arrangé de façon à ne pas perdre un mot de la conversation. À la surprise du premier moment avait succédé peu à peu une horreur qui faisait passer un frisson entre ses omoplates. Il venait d’apprendre, brusquement et d’une façon imprévue, que le lendemain, à sept heures précises, Lisbeth, la sœur de la vieille et son unique compagne, serait absente de la maison et que, par conséquent, demain soir à sept heures précises, la vieille se trouverait seule chez elle !
Le jeune homme n’était plus qu’à quelques pas de son logement. Il entra chez lui comme un condamné à mort. Il n’essayait même pas de raisonner, il en était d’ailleurs incapable, mais il sentit soudain de tout son être qu’il n’avait plus de libre arbitre, plus de volonté et que tout venait d’être définitivement décidé.
Certes, il aurait pu attendre des années entières une occasion favorable, essayer même de la faire naître, sans en trouver une meilleure et offrant plus de chance de succès que celle qui venait de se présenter à lui. En tout cas, il lui aurait été difficile d’apprendre la veille de façon sûre, et cela sans courir le moindre risque et n’avoir à poser aucune question dangereuse, que le lendemain, à telle heure, certaine vieille femme contre laquelle se préparait un attentat serait toute seule chez elle.
1 Aux îles : Les îles étaient la résidence d’été des Pétersbourgeois aisés. Ils y habitaient des villas dispersées dans la verdure. À la pointe de Vassilievski Ostrov le fleuve se divise en grande et en petite Néva.
2 L’île Petrovsky : Cette île tient son nom de Pierre le Grand qui y créa un parc.
3 Il se revoit enfant... : Le rêve de Raskolnikov est entremêlé de souvenirs des vacances que Dostoïevski passait, enfant, dans le domaine de ses parents à Darovoïé à 150 kilomètres de Moscou dans la province de Toula.
4 Le gâteau des morts : Plat de riz ou bouillie de froment garni de raisins secs et de fruits confits qu’on sert au repas des funérailles et qu’on apporte à l’église lors d’un service de commémoration.
5 Saraphane : Costume des paysannes russes, sorte de robe brodée qu’elles passent sur leur jupe.
6 La place des Halles : Ancien marché au foin, où s’étaient installées les Halles, quartier très animé surtout au moment des grandes fêtes.