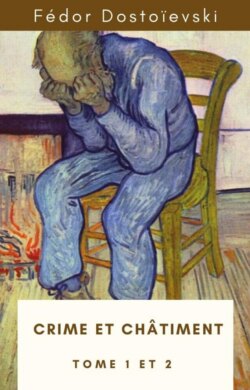Читать книгу Crime et châtiment (Tome 1 et 2) - Fedor Dostoievski - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеRaskolnikov n’avait pas l’habitude de la foule et, comme nous l’avons dit, ces derniers temps surtout, il fuyait la société de ses semblables. Mais à cet instant il se sentit tout à coup attiré vers eux. Une sorte de révolution semblait s’opérer en lui ; il éprouvait le besoin de voir des êtres humains. Il était si las de tout ce mois d’angoisse et de sombre exaltation qu’il venait de vivre dans la solitude, qu’il éprouvait à présent le besoin de se retremper, même une minute, dans un autre monde, n’importe lequel. Aussi s’attardait-il avec plaisir dans ce cabaret malgré la saleté qui y régnait. Le tenancier se tenait dans une autre pièce, mais il faisait de fréquentes apparitions dans la salle. On le voyait descendre les marches ; c’étaient ses bottes, d’élégantes bottes bien cirées à larges revers rouges, qui apparaissaient tout d’abord. Il portait une blouse, un gilet de satin noir tout graisseux, et n’avait pas de cravate. Tout son visage semblait huilé comme un cadenas de fer. Un garçon de quatorze ans était assis au comptoir, un autre plus jeune servait les clients. Des concombres1 coupés en morceaux, des biscottes de pain noir et des tranches de poisson étaient exposés en vitrine. Ils exhalaient une odeur infecte. La chaleur était insupportable, l’atmosphère si chargée de vapeurs d’alcool qu’elle risquait de vous griser en cinq minutes.
Il nous arrive parfois de rencontrer des personnes, souvent des inconnus, qui nous inspirent un intérêt subit, à première vue, avant même que nous ayons pu échanger un mot avec elles. Ce fut l’impression que produisit sur Raskolnikov l’individu assis à l’écart, et qui ressemblait à un fonctionnaire en retraite ; plus tard, chaque fois que le jeune homme se rappelait cette première impression, il l’attribuait à une sorte de pressentiment. Il ne le quittait pas des yeux, l’autre non plus ne cessait de le regarder et paraissait fort désireux d’engager la conversation. Quant aux autres personnes qui se trouvaient dans le cabaret (y compris le patron), il les considérait d’un air d’ennui avec une sorte de mépris hautain, comme des êtres d’une classe et d’une éducation trop inférieures pour qu’il daignât leur adresser la parole.
C’était un homme qui avait dépassé la cinquantaine, robuste et de taille moyenne. Ses quelques cheveux grisonnaient. Son visage était bouffi par l’ivrognerie, d’un jaune presque verdâtre ; entre ses paupières gonflées luisaient de tout petits yeux injectés de sang, mais pleins de vivacité. Ce qui étonnait le plus dans ce visage, c’était l’enthousiasme qu’il exprimait – peut-être aussi une certaine finesse et de l’intelligence – mais dans son regard passaient des éclairs de folie. Il portait un vieux frac tout déchiré, qui avait perdu ses boutons, sauf un seul avec lequel il le fermait, dans un désir de correction sans doute. Un gilet de nankin laissait voir un plastron tout fripé et maculé de taches. Comme tous les fonctionnaires, il ne portait pas la barbe mais il ne s’était pas rasé depuis longtemps : un poil rude et bleuâtre commençait à envahir son menton et ses joues. Ses manières avaient une gravité bureaucratique mais il semblait fort agité. Il fourrageait dans ses cheveux, les ébouriffait et se prenait la tête à deux mains d’un air d’angoisse, ses bras aux manches trouées accoudés sur la table crasseuse. Enfin il regarda Raskolnikov bien en face et articula d’une voix haute et ferme :
« Oserai-je, monsieur, m’adresser à vous pour engager une conversation des plus convenables ? Car malgré la simplicité de votre mise mon expérience devine en vous un homme instruit et non un pilier de cabaret. Personnellement j’ai toujours respecté l’instruction unie aux qualités du cœur. Je suis d’ailleurs conseiller titulaire2 : Marmeladov, tel est mon nom, conseiller titulaire. Puis-je vous demander si vous faites partie de l’administration ?
– Non, je fais mes études », répondit le jeune homme un peu surpris par ce langage ampoulé et aussi de se voir adresser directement et à brûle-pourpoint la parole par un étranger. Malgré son récent désir d’une compagnie humaine quelle qu’elle fût, il éprouvait au premier mot qui lui était adressé son sentiment habituel et fort désagréable d’irritation et de répugnance pour tout étranger qui tentait de se mettre en rapport avec lui.
« C’est-à-dire que vous êtes étudiant ou que vous l’avez été, s’écria vivement le fonctionnaire. C’est bien ce que je pensais. Voilà ce que c’est que l’expérience, monsieur, une longue expérience. » Et il porta la main à son front comme pour louer ses facultés cérébrales. « Vous avez fait des études ! Mais permettez... » Il se souleva, chancela, prit son verre et alla s’asseoir près du jeune homme. Quoique ivre il parlait avec aisance et vivacité. De temps en temps seulement ses discours devenaient incohérents et sa langue s’empâtait. À le voir se jeter si avidement sur Raskolnikov, on aurait pu croire que lui aussi n’avait pas ouvert la bouche depuis un mois.
« Monsieur, commença-t-il avec une sorte de solennité, pauvreté n’est pas vice, cela est une vérité absolue. Je sais également que l’ivrognerie n’est pas une vertu et c’est tant pis. Mais la misère, monsieur, la misère est un vice, oui. Dans la pauvreté vous conservez encore la noblesse de vos sentiments innés, dans l’indigence jamais et personne ne le pourrait. L’indigent, ce n’est pas à coups de bâton qu’on le chasse de toute société humaine, on se sert du balai pour l’humilier davantage et cela est juste, car il est prêt à s’outrager lui-même. Voilà d’où vient l’ivrognerie, monsieur. Sachez que le mois dernier ma femme a été battue par M. Lebeziatnikov, et ma femme, monsieur, ce n’est pas du tout la même chose que moi ! Comprenez-vous ? Permettez-moi de vous poser encore une question ! Oh ! par simple curiosité ! Avez-vous jamais passé la nuit sur la Néva, dans les barques à foin ?...
– Non, cela ne m’est jamais arrivé, répondit Raskolnikov.
– Eh bien, moi j’en viens, voilà, c’est ma cinquième nuit. » Il remplit son verre, le vida et devint songeur. En effet des brins de foin s’apercevaient çà et là sur ses habits et même dans ses cheveux. Il ne s’était apparemment pas déshabillé ni lavé depuis cinq jours. Ses grosses mains rouges aux ongles noirs étaient particulièrement sales. Toute la salle semblait l’écouter, assez négligemment du reste. Les garçons se mirent à ricaner derrière leur comptoir. Le patron était descendu, exprès, pour entendre ce drôle de type ; il s’assit un peu à l’écart, en bâillant avec indolence, mais d’un air fort important. Marmeladov paraissait fort bien connu dans la maison. Il devait probablement son bagout à cette habitude des bavardages de cabaret avec des inconnus, qui prend le caractère d’un véritable besoin, surtout chez certains ivrognes quand ils se voient jugés sévèrement chez eux et même maltraités ; aussi essaient-ils toujours de se justifier auprès de leurs compagnons d’orgie et même de gagner leur considération.
« Dis donc, espèce de pantin, dit le patron, d’une voix forte, pourquoi ne travailles-tu pas ? Pourquoi n’es-tu pas dans une administration puisque tu es fonctionnaire ?
– Pourquoi je ne suis pas dans une administration, monsieur ? répéta Marmeladov en s’adressant à Raskolnikov, comme si la question avait été posée par ce dernier. Pourquoi je n’entre pas dans une administration, dites-vous ? Vous croyez que je ne souffre pas de cette déchéance ! Quand M. Lebeziatnikov, le mois dernier, a battu ma femme de ses propres mains et que moi j’étais là ivre mort, croyez-vous que je ne souffrais pas ? Permettez, jeune homme, vous est-il arrivé... hum... eh bien, mettons de solliciter un prêt sans espoir...
– Oui... Mais qu’entendez-vous par cette expression « sans espoir » ?
– Eh bien, sans ombre d’espoir, dis-je, en sachant que vous allez à un échec. Tenez, par exemple, vous savez d’avance et parfaitement que tel monsieur, un citoyen fort bien pensant et des plus utiles à son pays, ne vous prêtera jamais et pour rien au monde de l’argent, car, je vous le demande, pourquoi vous en prêterait-il ? Il sait bien, n’est-ce pas, que je ne le rendrai jamais. Par pitié ? Mais M. Lebeziatnikov, qui est toujours au courant des idées nouvelles, a expliqué l’autre jour qu’à notre époque la pitié est défendue aux hommes par la science elle-même, qu’il en est ainsi en Angleterre où existe l’Économie politique. Pourquoi donc je vous le demande cet homme me prêterait-il de l’argent ? Or, tout en sachant d’avance qu’il ne vous donnera rien, vous vous mettez en route, et...
– Mais pourquoi, dans ce cas... ? interrompit Raskolnikov.
– Et si l’on n’a pas où aller, si l’on n’a personne d’autre à qui s’adresser ? Chaque homme, n’est-ce pas, a besoin de savoir où aller. Car il arrive toujours un moment où l’on sent la nécessité de s’en aller quelque part, n’importe où. Ainsi quand ma fille unique est allée se faire inscrire à la police, pour la première fois, je l’ai accompagnée... (car ma fille est en carte...), ajouta-t-il entre parenthèses en regardant le jeune homme d’un air un peu inquiet. Ce n’est rien, monsieur, ce n’est rien, se hâta-t-il d’ajouter avec un flegme apparent, quand les deux garçons partirent d’un éclat de rire derrière leur comptoir, et que le patron lui-même sourit. Ce n’est rien, non ! Ces hochements de tête désapprobateurs ne sauraient me troubler, car tout cela est connu de tout le monde, et tout mystère finit toujours par se découvrir. Et ce n’est point avec mépris, mais avec résignation que j’envisage ces choses. Soit ! soit donc ! « Ecce homo ». Permettez, jeune homme, pouvez-vous... mais non, il faut trouver une expression plus forte, plus imagée, pouvez-vous, dis-je, oserez-vous en me regardant dans les yeux, affirmer que je ne suis pas un porc. »
Le jeune homme ne répondit rien.
« Eh bien, voilà ! continua l’orateur et il attendit d’un air posé et plus digne encore la fin des ricanements qui venaient d’éclater de nouveau.
« Eh bien, voilà, mettons que je suis un porc et elle est une dame. Je ressemble à une bête et Catherine Ivanovna, mon épouse, est une personne bien élevée, la fille d’un officier supérieur. Soit, mettons que je suis un goujat et elle possède un grand cœur, des sentiments élevés, une éducation parfaite, cependant... ah ! si elle avait eu pitié de moi ! Monsieur, monsieur, mais chaque homme a besoin de se sentir plaint par quelqu’un. Or, Catherine Ivanovna, malgré sa grandeur d’âme, est injuste... et quoique je comprenne moi-même parfaitement que lorsqu’elle me tire les cheveux, c’est assurément par intérêt pour moi, car, je le répète sans honte, elle me tire les cheveux, jeune homme, insista-t-il avec un redoublement de dignité en entendant ricaner encore. Mais, Seigneur, si elle pouvait, une fois seulement... mais non, non tout cela est vain, n’en parlons plus ! Car mon souhait s’est réalisé plus d’une fois, plus d’une fois je me suis vu pris en pitié, mais... tel est mon caractère, je suis une vraie brute !
– Je crois bien », observa le patron en bâillant.
Marmeladov donna un grand coup de poing sur la table.
« Tel est mon caractère ! Savez-vous, monsieur, savez-vous que je lui ai bu jusqu’à ses bas ? Pas les souliers, remarquez bien, car enfin, ce serait plus ou moins dans l’ordre des choses, mais ses bas ; je lui ai bu ses bas, oui. Et j’ai bu aussi sa petite pèlerine en poil de chèvre, un cadeau qu’on lui avait fait avant notre mariage, sa propriété, non la mienne ; nous habitons un trou glacé, un coin ; cet hiver elle a pris froid, elle s’est mise à tousser et à cracher le sang ; nous avons trois petits enfants et Catherine Ivanovna travaille du matin au soir, à gratter, à faire la lessive, à laver les enfants, car elle est habituée à la propreté depuis sa plus tendre enfance. Tout cela avec une poitrine délicate et une prédisposition à la phtisie ; moi je sens tout cela. Est-ce que je ne le sens pas ? Plus je bois, plus je souffre. C’est parce que je cherche à sentir, et à souffrir davantage que je me livre à la boisson. Je bois pour mieux souffrir, plus profondément. »
Il inclina la tête d’un air désespéré.
« Jeune homme, reprit-il en se redressant, je crois déchiffrer sur votre visage l’expression d’une douleur. Vous étiez à peine entré que j’en avais l’impression, voilà pourquoi je vous ai aussitôt adressé la parole. Si je vous raconte l’histoire de ma vie, ce n’est point pour servir de risée à ces oisifs, qui d’ailleurs sont au courant de tout cela, mais parce que je cherche un homme instruit. Sachez donc que mon épouse a été élevée dans un pensionnat aristocratique de province et que le jour de sa sortie elle a dansé avec le châle3 devant la dame du gouverneur de la province et d’autres personnages de marque ; elle en a été récompensée par une médaille d’or et un diplôme. La médaille !... elle est vendue... depuis longtemps ; quant au diplôme, mon épouse le conserve dans son coffre, elle le montrait dernièrement à la logeuse. Bien qu’elle soit à couteaux tirés avec cette femme, elle éprouvait le besoin de se vanter à quelqu’un de ses succès passés et d’évoquer les temps heureux. Je ne lui en fais pas un crime, non, car elle n’a plus que ces souvenirs, tout le reste s’est évanoui. Oui, c’est une dame ardente, fière, intraitable, elle lave elle-même son plancher et se nourrit de pain noir, mais elle ne souffrirait pas qu’on lui manquât de respect. Voilà pourquoi elle n’a pas toléré la grossièreté de Lebeziatnikov et quand ce dernier, pour se venger d’avoir été remis à sa place, l’a battue, elle s’est mise au lit, non point tant à cause des coups qu’elle avait reçus, mais plutôt pour des raisons sentimentales. Je l’ai épousée veuve avec trois enfants en bas âge ; son premier mariage avait été un mariage d’amour, avec un officier d’infanterie, elle s’était enfuie avec lui de la maison paternelle. Elle adorait son mari, mais il se mit à jouer, il eut maille à partir avec la justice et mourut. Les derniers temps il la battait ; elle ne le lui pardonna point, je le sais de bonne source, et pourtant même maintenant elle ne peut pas l’évoquer sans larmes, elle établit entre lui et moi des comparaisons peu flatteuses pour mon amour-propre, mais j’en suis heureux, car ainsi, elle se figure au moins qu’elle a été heureuse un jour. Elle est restée toute seule après sa mort avec trois petits enfants dans un district lointain et sauvage où je me trouvais alors. Elle vivait dans un si affreux dénuement que moi, qui ai vu des drames de toute sorte, je ne me sens pas capable de le décrire. Ses parents l’avaient tous abandonnée. Elle était fière d’ailleurs, trop fière... C’est alors, monsieur, alors, comme je vous le dis, que moi, veuf également et qui avais de mon premier mariage une fille de quatorze ans, je lui ai offert ma main, car je ne pouvais pas la voir souffrir ainsi. Vous pouvez juger de sa misère, puisque instruite, cultivée et d’excellente famille comme elle l’était, elle a accepté de m’épouser. Mais elle l’a fait en pleurant, en sanglotant, en se tordant les mains, elle l’a fait pourtant ! Car elle n’avait pas où aller. Comprenez-vous, comprenez-vous bien, monsieur, ce que cela signifie, n’avoir plus où aller ? Non, vous ne pouvez pas encore le comprendre... Et toute une année j’ai rempli mon devoir honnêtement et saintement, sans toucher à cela (il montra du doigt la demi-bouteille posée devant lui) car j’ai des sentiments. Mais je n’arrivais point à la satisfaire : sur ces entrefaites j’ai perdu ma place, sans pourtant qu’il y ait de ma faute, à cause de changements administratifs ; alors je me suis mis à boire !... Voilà un an et demi qu’après mille déboires et toutes nos pérégrinations, nous nous sommes fixés dans cette capitale magnifique et ornée d’innombrables monuments. Ici j’ai pu trouver une place. Je l’ai trouvée et l’ai perdue de nouveau. Comprenez-vous, monsieur ? Cette fois par ma propre faute, à cause de mon penchant qui se manifestait... Nous habitons maintenant un coin chez la logeuse Amalia Fedorovna Lippevechsel, mais comment vivons-nous, avec quoi payons-nous nos dépenses ? Cela, je n’en sais rien. Il y a là bien d’autres locataires à part nous, c’est un véritable enfer, oui, que cette maison. Entre-temps la fille que j’ai eue de ma première femme a grandi et ce qu’elle a pu souffrir de sa belle-mère, cette fille, j’aime mieux le passer sous silence. Car bien qu’elle soit remplie de sentiments magnanimes, Catherine Ivanovna est une dame irascible, incapable de se contenir... Oui, voilà. Mais à quoi bon rappeler tout ça ? Vous imaginez bien que Sonia n’a pas reçu une très bonne éducation. J’ai essayé de lui apprendre, il y a quatre ans, la géographie et l’histoire universelle, mais comme je n’étais pas moi-même bien fort dans ces matières et que de plus nous ne possédions pas de bons manuels, car les livres que nous pouvions avoir... hum, eh bien, nous ne les avons plus, les leçons ont pris fin. Nous nous sommes arrêtés à Cyrus, roi des Perses. Plus tard, elle a lu quelques livres de caractère romanesque et dernièrement encore, Lebeziatnikov lui en a prêté un : la Physiologie de Lewis4. Vous connaissez cet ouvrage, n’est-ce pas ? Elle l’a trouvé très intéressant, et nous en a même lu plusieurs passages à haute voix, voilà à quoi se borne sa culture intellectuelle. Maintenant je m’adresserai à vous, monsieur, de ma propre initiative pour vous poser une question d’ordre privé. Une jeune fille pauvre, mais honnête, peut-elle gagner convenablement sa vie avec un travail honnête ? Elle ne gagnera pas quinze kopecks par jour, monsieur, si elle est honnête et ne possède aucun talent, cela en travaillant sans répit. Bien plus, le conseiller d’État Klopstock, Ivan Ivanovitch, – vous avez entendu parler de lui ? – non seulement n’a pas payé la demi-douzaine de chemises en toile de Hollande qu’elle lui a faites, mais il l’a encore honteusement chassée en prétendant qu’elle n’avait pas bien pris la mesure du col et qu’il allait tout de travers. Et les gosses affamés..., Catherine Ivanovna qui va et vient dans la chambre en se tordant les mains, les pommettes colorées de taches rouges, comme il arrive toujours dans cette maladie, en criant : « Tu vis chez nous en fainéante, tu manges, tu bois, bien au chaud. » Or qu’y avait-il à manger et à boire, je vous le demande, quand les enfants eux-mêmes passent des trois jours sans voir une croûte de pain !
« Moi j’étais couché à ce moment-là..., autant vous le dire, j’étais ivre et j’entends ma Sonia lui répondre (elle est timide, sa voix est si douce..., toute blonde avec son petit visage toujours pâle, si mince) : « Comment, Catherine Ivanovna, pourrai-je faire une chose pareille ? »
« Daria Frantzovna, une mauvaise femme bien connue de la police, était déjà venue trois fois lui faire des ouvertures par l’entremise de la logeuse.
« – Comment ? répète Catherine Ivanovna en la singeant. Qu’as-tu donc à préserver avec tant de soin ? Voyez-moi ce trésor ? »
« Mais ne l’accusez pas, monsieur, non, ne l’accusez pas. Elle n’avait pas conscience de la portée de ses paroles. Elle était bouleversée, malade, elle entendait les cris des enfants affamés et puis c’était plutôt pour vexer Sonia qu’avec une intention sérieuse. Car Catherine Ivanovna est ainsi faite, dès qu’elle entend pleurer les enfants, même si c’est de faim, elle se met aussitôt à les battre. Tout à coup, il était un peu plus de cinq heures, je vois ma Sonetchka se lever, mettre un fichu, un châle et sortir du logement ; à huit heures passées elle était de retour. Elle entra, alla droit à Catherine Ivanovna et déposa devant elle sur la table trente roubles, en silence. Elle n’a pas proféré une parole, vous m’entendez, elle n’a pas eu un regard, elle a pris seulement notre grand châle de drap vert (nous possédons un grand châle de drap vert en commun), s’en est couvert la tête et le visage et elle s’est couchée sur le lit, la figure tournée contre le mur ; seuls ses petites épaules et tout son corps étaient agités de tressaillements... Et moi j’étais toujours couché dans le même état. J’ai vu alors, jeune homme, j’ai vu Catherine Ivanovna s’approcher silencieusement, elle aussi, du lit de Sonetchka ; elle a passé toute la nuit à genoux devant elle à lui baiser les pieds sans vouloir se relever. Ensuite elles ont fini toutes deux par s’endormir enlacées... toutes les deux, toutes les deux... Oui... voilà, et moi... j’étais ivre, oui. » Marmeladov se tut comme si la voix lui avait manqué. Puis il se versa brusquement à boire, vida son verre, soupira et continua après un silence.
« Depuis lors, monsieur, par suite d’une circonstance malheureuse et sur la dénonciation de personnes malveillantes (Daria Frantzovna y a pris une grande part ! elle prétendait qu’on lui avait manqué de respect), depuis lors ma fille, Sophie Simionovna, a été mise en carte et elle s’est vue, pour cette raison, obligée de nous quitter. D’ailleurs, d’une part, la logeuse Amalia Feodorovna5 n’eût point toléré sa présence (alors qu’elle-même avait favorisé les menées de Daria Frantzovna) et de l’autre M. Lebeziatnikov... hum... C’est à cause de Sonia qu’il a eu cette histoire dont je vous ai parlé avec Catherine Ivanovna. Au début il courait lui-même après Sonetchka et puis tout à coup il s’est piqué d’amour-propre. « Comment un homme éclairé comme moi pourrait-il vivre dans la même maison qu’une pareille créature ? » Mais Catherine Ivanovna lui a tenu tête, elle a pris la défense de Sonia... et voilà comment la chose est arrivée... À présent, Sonetchka vient surtout nous voir à la chute du jour. Elle aide Catherine Ivanovna et lui apporte quelque argent... Elle habite chez le tailleur Kapernaoumov, elle y loue un logement. Kapernaoumov est boiteux et bègue, et toute sa nombreuse famille l’est également. Sa femme elle aussi est bègue... ils habitent tous dans une seule chambre, mais Sonia a la sienne, séparée de leur logement par une cloison. Hum, voilà... Des gens misérables et affectés de bégaiement... Alors un matin je me suis levé, j’ai revêtu mes haillons, tendu les bras vers le ciel, et je m’en suis allé chez son Excellence Ivan Afanassievitch. Connaissez-vous son Excellence Ivan Afanassievitch ? Non ? Eh bien, c’est que vous ne connaissez pas l’homme de Dieu. C’est de la cire... Une cire devant la face du Seigneur, il fond comme la cire, il a même eu les larmes aux yeux après avoir daigné écouter mon récit jusqu’au bout. « Allons, me dit-il, Marmeladov, tu as déjà trompé une fois la confiance que j’avais mise en toi... Je veux bien te reprendre sous ma responsabilité. » C’est ainsi qu’il s’est exprimé. « Tâche de t’en souvenir, voulait-il dire, tu peux te retirer. » J’ai baisé la poussière de ses bottes, mentalement, car il ne me l’aurait pas permis en réalité, étant un haut fonctionnaire et un homme imbu d’idées modernes et très éclairées. Je suis revenu chez moi et, Seigneur ! qu’est-ce qui s’est passé, lorsque j’ai annoncé que je reprenais du service, et que j’allais recevoir un traitement ! »
Marmeladov s’arrêta encore, tout ému. À ce moment-là le cabaret fut envahi par une bande d’ivrognes déjà pris de boisson, les sons d’un orgue de barbarie retentirent à la porte de l’établissement, une voix frêle et fêlée d’enfant s’éleva, chantant l’air de la « Petite Ferme6 ». La salle s’emplit de bruit. Le patron et ses garçons s’empressaient auprès des nouveaux venus. Marmeladov, lui, continua son récit sans faire attention à eux. Il paraissait très affaibli, mais devenait plus expansif à mesure que croissait son ivresse. Les souvenirs de son dernier succès, cet emploi qu’il avait reçu, semblaient l’avoir ranimé, et mettaient sur son visage une sorte de rayonnement. Raskolnikov l’écoutait attentivement.
« C’était, mon cher monsieur, il y a cinq semaines de cela, oui... Dès qu’elles apprirent toutes les deux, Catherine Ivanovna et Sonetchka, la nouvelle, Seigneur, ce fut comme si j’étais transporté au paradis. Autrefois quand il m’arrivait de rester couché j’étais comme une bête, je n’entendais que des injures. À présent on marchait sur la pointe des pieds et l’on faisait taire les enfants. « Chut ! Simion Zakharovitch est fatigué de son travail, il faut le laisser reposer, chut ! » On me faisait boire du café avant mon départ pour le bureau et même avec de la crème. Elles se procuraient de la vraie crème, vous entendez ! Où ont-elles pu découvrir onze roubles cinquante kopecks pour remonter ma garde-robe, je ne puis le comprendre. Des bottes, des manchettes en calicot superbes, un uniforme7, le tout en parfait état pour onze roubles cinquante kopecks. Je rentre le premier jour de mon bureau à midi et qu’est-ce que je vois ? Catherine Ivanovna a préparé deux plats : la soupe et du petit salé avec une sauce, chose dont nous n’avions même pas idée jusqu’à présent. Des robes, il faut dire qu’elle n’en a point, c’est-à-dire pas une, non ; et là, on dirait à la voir qu’elle se prépare à aller en visite, elle s’est arrangée, non pas qu’elle ait de quoi, mais elles savent fabriquer quelque chose avec rien du tout ; c’est la coiffure, un petit col par-ci bien propre, des manchettes, on dirait une autre femme, rajeunie, embellie. Sonetchka, ma colombe, elle ne voulait que nous aider de son argent, mais maintenant, « venir vous voir souvent », nous dit-elle, « je juge que ce n’est pas convenable, ou alors à la nuit tombante, de façon que personne ne puisse me voir ». Entendez-vous, entendez-vous bien ? Je suis allé me coucher après dîner, et, qu’en pensez-vous, Catherine Ivanovna n’a pas pu y tenir. Il y avait à peine une semaine qu’elle s’était querellée à mort avec la logeuse Amalia Ivanovna, et maintenant, elle l’invite à prendre le café. Elles sont restées deux heures à bavarder tout bas. « Simion Zakharovitch, dit-elle, a maintenant un emploi et il reçoit un traitement, il s’est présenté lui-même à son Excellence, et son Excellence est sortie et a ordonné à tout le monde d’attendre et a tendu la main à Simion Zakharovitch et l’a fait passer ainsi devant tout le monde dans son cabinet. Entendez-vous, entendez-vous bien ? » « Je me souviens naturellement, dit-il, Simion Zakharovitch, de vos services et quoique vous persistiez dans votre faiblesse, mais puisque vous nous promettez... et que, d’autre part, tout a mal marché chez nous, en votre absence (entendez-vous, entendez-vous bien ?), je compte, dit-il, maintenant sur votre parole d’honnête homme. »
« Je vous dirai que tout cela elle l’inventait purement et simplement et non par légèreté ou pour se vanter. Non, voilà, elle-même y croit, elle se console avec ses propres inventions, ma parole d’honneur ! Je ne le lui reproche pas, non, je ne puis le lui reprocher. Et quand je lui ai rapporté, il y a six jours, le premier argent que j’avais gagné, vingt-trois roubles quarante kopecks, intégralement, elle m’a appelé son petit oiseau. « Eh ! me dit-elle, espèce de petit oiseau » et nous étions en tête-à-tête, comprenez-vous ? Et dites-moi, je vous prie, quel charme puis-je avoir et quel époux puis-je bien être ? Eh bien non, elle m’a pincé la joue, « son petit oiseau », m’a-t-elle dit. »
Marmeladov s’interrompit, tenta de sourire, mais son menton se mit à trembler, il se contint cependant. Ce cabaret, ce visage d’homme déchu, cinq nuits passées dans les barques à foin, cette bouteille enfin et en même temps cette tendresse maladive pour sa femme et sa famille, tout cela rendait son auditeur perplexe. Raskolnikov était suspendu à ses lèvres, mais il éprouvait un sentiment pénible, il regrettait d’être entré dans ce lieu.
« Monsieur, cher monsieur, s’écria Marmeladov, un peu remis, ô monsieur, peut-être trouvez-vous tout cela comique, comme tous les autres, et je ne fais que vous ennuyer avec tous ces petits détails misérables et stupides de ma vie domestique, mais moi je vous assure que je n’ai pas envie de rire, car je sens tout cela... et toute cette journée enchantée de ma vie, tout ce soir-là, je les ai moi-même passés à faire des rêves fantastiques : je rêvais à la manière dont j’organiserais notre vie, dont j’habillerais les gosses, au repos que j’allais lui donner à elle, je comptais enlever ma fille à cette vie honteuse, et la faire rentrer au sein de la famille... Et bien d’autres choses encore ! Tout cela est permis, monsieur. Mais voilà, monsieur (Marmeladov tressaillit soudain, leva la tête et regarda fixement son interlocuteur), voilà : le lendemain même du jour où je caressais tous ces rêves (il y a juste cinq jours de cela), le soir j’ai inventé un mensonge et dérobé, comme un voleur de nuit, la clef du coffre de Catherine Ivanovna et pris le reste de l’argent que j’avais rapporté. Combien y en avait-il ? Je ne m’en souviens plus, mais regardez-moi, tous. Il y a cinq jours que je ne suis pas rentré chez moi et les miens me cherchent et j’ai perdu ma place, laissé mon uniforme au cabaret près du pont d’Égypte en échange de ce costume... tout est fini ! »
Il se donna un coup de poing à la tête, serra les dents, ferma les yeux, et s’accouda lourdement sur la table. Au bout d’un instant, son visage parut transformé ; il regarda Raskolnikov avec une sorte de malice voulue et de cynisme joué, éclata de rire et dit :
« Aujourd’hui j’ai été chez Sonia, je suis allé lui demander de l’argent pour boire. Hé ! hé ! hé !
– Et elle t’en a donné ? cria un des nouveaux venus avec un gros rire.
– Cette demi-bouteille que vous voyez a été payée de son argent, reprit Marmeladov en ne s’adressant qu’à Raskolnikov. Elle m’a remis trente kopecks de ses propres mains, les derniers, tout ce qu’elle avait, je l’ai vu moi-même, elle ne m’a rien dit et s’est bornée à me regarder en silence... Un regard qui n’appartenait pas à la terre mais au ciel, ce n’est que là-haut qu’on peut souffrir ainsi pour les hommes, pleurer sur eux, sans les condamner. Non, on ne les condamne pas ! mais c’est plus dur, quand on ne vous condamne pas ! Trente kopecks, voilà, oui, et cependant elle-même en a besoin, n’est-ce pas ? Qu’en pensez-vous, mon cher monsieur, elle a besoin de se tenir propre à présent. Cette propreté coûte de l’argent, une propreté spéciale, vous comprenez ? Il faut de la pommade, des jupons empesés, des petites bottines un peu élégantes, qui fassent valoir le pied quand on a une flaque à enjamber. Comprenez-vous, comprenez-vous, monsieur, l’importance de cette propreté ? Eh bien voilà, et moi, son propre père, je lui ai arraché ces trente kopecks. Je bois, oui, je les ai déjà bus... Dites-moi, qui donc aura pitié d’un homme comme moi, hein ? Dites, monsieur, avez-vous maintenant pitié de moi, oui ou non ?... Parlez-moi, monsieur, me plaignez-vous, oui ou non ? Ha ! ha, ha ! »
Il voulut se verser à boire, mais la bouteille était vide.
« Pourquoi te plaindre ? » cria le patron qui apparut de nouveau auprès des deux hommes.
Des rires mêlés d’injures éclatèrent dans la pièce. C’étaient les auditeurs du fonctionnaire qui riaient et juraient ainsi ; les autres, qui n’avaient rien entendu, se joignaient à eux rien qu’à voir sa figure.
« Me plaindre ? Et pourquoi me plaindrait-on ? hurla soudain Marmeladov en se levant, le bras tendu avec exaltation, comme s’il n’avait attendu que ces paroles. Pourquoi me plaindre, dis-tu ? Oui, il n’y a pas lieu de me plaindre, il faut me crucifier, me mettre en croix et non pas me plaindre. Crucifie-moi donc, juge, fais-le, et en me crucifiant aie pitié du supplicié ; j’irai alors moi-même au-devant du supplice, car ce n’est point de joie que j’ai soif, mais de douleur et de larmes... Crois-tu donc, marchand, que ta demi-bouteille m’a procuré du plaisir ? C’est la douleur, la douleur que je cherchais au fond de ce flacon, la douleur et les larmes ; je les y ai trouvées et savourées. Mais nous ne serons pris en pitié que par Celui qui a eu pitié de tous les hommes. Celui qui a tout compris, l’Unique et notre seul Juge, Il viendra au jour du Jugement et demandera : « Où est la fille qui s’est sacrifiée pour une marâtre cruelle et phtisique, pour des petits enfants qui ne sont point ses frères ? Où est la fille qui a eu pitié de son père terrestre et ne s’est point détournée avec horreur de ce crapuleux ivrogne ? » Il lui dira : « Viens ! Je t’ai déjà pardonné une fois... pardonné une fois... et maintenant que tous tes péchés te soient remis, car tu as beaucoup aimé... » Et il pardonnera à ma Sonia, Il lui pardonnera, je sais qu’il lui pardonnera... Je l’ai senti dans mon cœur tantôt, quand j’étais chez elle ! Tous seront jugés par Lui, les bons et les méchants, et nous entendrons Son Verbe : « Approchez, dira-t-il, approchez, vous aussi les ivrognes, approchez, les faibles créatures éhontées ! » Nous avancerons tous sans crainte et nous nous arrêterons devant Lui et Il dira : « Vous êtes des porcs, vous avez l’aspect de la bête et vous portez son signe, mais venez aussi. » Et alors vers Lui se tourneront les sages et se tourneront les intelligents et ils s’écrieront : « Seigneur ! Pourquoi reçois-tu ceux-là ? » et Lui dira : « Je les reçois, ô sages, je les reçois, ô vous intelligents, parce qu’aucun d’eux ne s’est jamais cru digne de cette faveur. » Et Il nous tendra Ses bras divins et nous nous y précipiterons... et nous fondrons en larmes... et nous comprendrons tout... alors nous comprendrons tout... et tous comprendront... Catherine Ivanovna elle aussi comprendra... Seigneur, que Ton règne arrive ! »
Il se laissa tomber sur le banc, épuisé, sans regarder personne, comme s’il avait oublié tous ceux qui l’entouraient dans la profonde rêverie qui l’absorbait. Ces paroles produisirent une certaine impression, le silence régna un moment, puis les rires reprirent de plus belle, mêlés aux invectives.
« C’est du propre !
– Radoteur !
– Bureaucrate !
etc.
– Allons-nous-en, monsieur, s’écria soudain Marmeladov en levant la tête et en s’adressant à Raskolnikov, ramenez-moi, maison Kosel, dans la cour. Il est temps de retourner chez Catherine Ivanovna... »
Raskolnikov songeait depuis longtemps à s’en aller et il avait bien pensé à lui offrir son soutien dans la rue. Marmeladov avait les jambes moins fermes que la voix et s’appuyait lourdement sur le jeune homme. Il y avait deux ou trois cents pas environ à faire. Le trouble et la frayeur de l’ivrogne croissaient à mesure qu’il approchait de son logis.
« Ce n’est pas Catherine Ivanovna que je redoute à présent, balbutiait-il dans son émoi, ce n’est pas la perspective de me voir tirer les cheveux qui me fait peur. Qu’est-ce que les cheveux ? Mais absolument rien du tout... C’est bien ce que je dis ! Il vaut même mieux qu’elle se mette à les tirer, ce n’est pas ce que je crains... Je... ce sont ses yeux qui me font peur... oui... ses yeux, les taches rouges de ses pommettes, je les redoute aussi ; son souffle... As-tu remarqué comment on respire dans ces maladies-là, quand on est en proie à une émotion violente ? Je crains aussi les pleurs des enfants, car, si Sonia ne leur a pas donné à manger... je ne sais plus comment... ils ont pu... je ne sais plus ! Mais les coups ne me font pas peur ! Sachez bien, monsieur, que ces coups-là non seulement ne me font pas souffrir, mais me procurent une jouissance... Je ne pourrais pas m’en passer. Cela vaut mieux... Il faut qu’elle me batte, cela la soulagera... cela vaut mieux... Voici la maison, la maison de Kosel... un serrurier allemand, riche... Conduis-moi ! »
Ils traversèrent la cour et montèrent au quatrième étage. L’escalier devenait de plus en plus sombre. Il était presque onze heures et quoique, à cette époque de l’année, il n’y eût point, à proprement parler, de nuit à Pétersbourg, le haut de l’escalier était pourtant plongé dans l’obscurité.
La petite porte enfumée, qui donnait sur le dernier palier, était ouverte. Un bout de chandelle éclairait une pièce des plus misérables, longue à peine de dix pas, qu’on pouvait du vestibule embrasser tout entière d’un coup d’œil. Elle était dans le plus grand désordre, tout y traînait de tous côtés, surtout des langes d’enfant ; un drap troué masquait l’un des coins les plus éloignés de la porte, il devait dissimuler un lit. Dans la pièce elle-même, il n’y avait que deux chaises et un antique divan recouvert d’une toile cirée qui s’en allait en lambeaux ; une vieille table de cuisine nue en bois blanc lui faisait face.
Là, sur un chandelier de fer, achevait de brûler un bout de chandelle. Marmeladov avait donc sa chambre à lui, et non pas un simple coin8 ; mais elle donnait sur les autres pièces et était, en fait, un couloir. La porte qui ouvrait sur les chambres, ou plutôt les cages, dont se composait l’appartement d’Amalia Lippevechsel, était entrouverte. On entendait du bruit, des cris. Des rires éclataient. Par là on devait jouer aux cartes et prendre le thé. Des bribes de phrases grossières arrivaient parfois jusqu’au logement des Marmeladov.
Raskolnikov reconnut à première vue Catherine Ivanovna. C’était une femme horriblement amaigrie, fine, assez grande et svelte, avec des cheveux châtains encore très beaux ; comme l’avait dit Marmeladov, des taches rouges brûlaient à ses pommettes. Les lèvres desséchées, la respiration courte et irrégulière, elle arpentait la petite chambre de long en large, les mains convulsivement pressées contre la poitrine. Ses yeux brillaient d’un éclat fiévreux, mais le regard en était fixe et dur et ce visage bouleversé de poitrinaire produisait une impression pénible à la lumière mourante du bout de chandelle presque consumé, dont la lueur tremblotante tombait sur lui. Raskolnikov jugea qu’elle devait avoir trente ans et que Marmeladov ne lui convenait pas du tout en effet. Elle ne remarquait pas la présence des deux hommes ; elle semblait plongée dans une sorte d’hébétement, qui la rendait incapable de voir et d’entendre. Il faisait étouffant dans la pièce, mais elle n’ouvrait pas la fenêtre ; de l’escalier arrivaient des odeurs infectes ; pourtant elle ne songeait pas à fermer la porte du carré ; enfin, la porte intérieure, simplement entrebâillée, laissait passer des vagues épaisses de fumée de tabac qui la faisaient tousser sans qu’elle songeât à pousser cette porte. L’enfant la plus jeune, une fillette de six ans, dormait assise par terre, le corps à demi tordu et la tête appuyée au divan. Le garçonnet, d’un an plus âgé, tremblait de tout son corps dans un coin et pleurait. Il venait probablement d’être battu. L’aînée, une fillette de neuf ans, longue et mince comme une allumette, portait une chemise toute trouée. Sur ses épaules nues était jeté un vieux manteau de drap, fait pour elle deux ans auparavant sans doute, car il lui venait à peine aux genoux ; elle se tenait près de son petit frère et lui entourait le cou de son bras desséché. Elle devait essayer de le calmer et lui murmurait quelque chose pour le faire taire ; elle suivait en même temps sa mère d’un regard craintif de ses immenses yeux sombres qui semblaient plus grands encore dans ce petit visage amaigri.
Marmeladov n’entra point dans la pièce ; il s’agenouilla devant la porte et poussa Raskolnikov en avant. La femme, voyant cet étranger, s’arrêta distraitement devant lui et, revenue à elle, – momentanément, – sembla se demander : « Que fait-il là, celui-là ? » Mais elle dut s’imaginer aussitôt qu’il traversait leur chambre pour aller dans une autre pièce. S’étant dit cela, elle se dirigea vers la porte d’entrée pour la fermer et poussa soudain un cri, en apercevant son mari agenouillé sur le seuil.
« Ah ! cria-t-elle, prise de fureur. Te voilà revenu, scélérat, monstre, et où est l’argent ? Qu’as-tu dans ta poche ? Monstre ! Ce ne sont pas tes vêtements ! Où sont les tiens ? Où est l’argent ? Parle ! » Elle se mit à le fouiller précipitamment ; Marmeladov aussitôt écarta docilement les bras pour faciliter la visite de ses poches. Il n’avait pas un kopeck sur lui.
« Où est l’argent ? criait-elle. Oh ! Seigneur ! se peut-il qu’il ait tout bu. Il restait pourtant douze roubles dans le coffre. » Prise d’un accès de rage, elle saisit son mari par les cheveux et l’attira dans la chambre. Marmeladov, lui, essayait d’adoucir son effort et la suivait humblement en se traînant sur les genoux. « C’est une jouissance pour moi ! non une douleur, mais une jou-i-ssance-cher-monsieur ! » criait-il, tandis qu’il était ainsi secoué par les cheveux. Son front même vint heurter le plancher. L’enfant qui dormait par terre s’éveilla et se mit à pleurer. Le garçonnet debout dans son coin ne put supporter cette scène ; il se reprit à trembler, à hurler, et se jeta dans les bras de sa sœur, en proie à une terrible épouvante, presque dans une crise convulsive. La fille aînée, elle, frissonnait comme une feuille.
« Il a tout, tout bu, criait la pauvre femme dans son désespoir ; ce ne sont pas ses vêtements. Ils sont affamés ! Ils sont affamés ! (Elle désignait les enfants en se tordant les bras.) Ô vie trois fois maudite ! Et vous, vous n’avez pas honte ? » Elle prenait à partie Raskolnikov. « Vous n’avez pas honte de venir du cabaret ? Tu as bu avec lui, toi aussi ! tu as bu avec lui ! Va-t’en d’ici ! »
Le jeune homme se hâta de sortir sans dire un mot. La porte intérieure, au surplus, venait de s’entrouvrir et plusieurs curieux y apparaissaient, allongeant des figures effrontées et moqueuses, la calotte sur la tête, la cigarette ou la pipe aux lèvres. On les voyait, les uns en robes de chambre, d’autres en costumes d’été légers jusqu’à l’indécence, quelques-uns avaient même les cartes en main. Ils se mirent surtout à rire de bon cœur, lorsqu’ils entendirent Marmeladov crier qu’il éprouvait une jouissance à être tiré par les cheveux. Certains pénétraient dans la pièce. Enfin, on entendit une voix sifflante de mauvais augure ; c’était Amalia Lippevechsel elle-même qui se frayait un passage à travers la foule pour rétablir l’ordre à sa manière et effrayer, pour la centième fois, la malheureuse femme en lui donnant au milieu d’injures l’ordre brutal d’avoir à vider les lieux dès le lendemain. En sortant, Raskolnikov eut le temps de mettre la main dans sa poche, d’y prendre ce qui lui restait de monnaie sur le rouble qu’il venait de changer au cabaret et de la déposer, sans être vu, dans l’embrasure de la fenêtre. Puis, quand il fut dans l’escalier, il se repentit de cette générosité et il fut sur le point de remonter.
« Quelle sottise ai-je faite là ! songea-t-il, – eux, ils ont Sonia tandis que moi je suis dans le besoin. » Mais, s’étant dit qu’il ne pouvait retourner reprendre l’argent et que, de toute façon, il ne l’aurait pas fait, il se décida à rentrer chez lui. « Sonia, elle, a besoin de crème, – continua-t-il en avançant dans la rue, avec un rire sardonique ; cette propreté-là coûte de l’argent. Hum ! Sonetchka peut se trouver sans le sou aujourd’hui, car cette chasse-là, c’est comme la chasse au fauve, une affaire de chance. Sans mon argent ils se serreraient tous le ventre. Eh ! cette Sonia tout de même ! Ils ont trouvé une vraie mine d’argent. Et ils en profitent ! car enfin ils en profitent ! Ils en ont pris l’habitude, pleurniché d’abord, puis pris l’habitude ; crapule humaine, qui s’habitue à tout ! »
Il devint songeur. « Et si c’est faux, – s’écria-t-il soudain involontairement, – si l’homme n’est pas réellement une crapule, c’est-à-dire s’il ne l’est pas en général ? Eh bien, c’est que tout le reste, ce sont des préjugés, des craintes vaines et l’on ne doit jamais s’arrêter devant quoi que ce soit. Agir, voilà ce qu’il faut ! »
1 Concombres : Les Russes les mangent, peu salés, avec les hors-d’œuvre et la vodka.
2 Neuvième grade de la hiérarchie civile russe correspondant au grade de capitaine.
3 Châle : Danse appelée pas de châle.
4 Lewis : G. H. Lewis, grand admirateur d’Auguste Comte auquel il consacra plusieurs ouvrages, auteur de Physiology of Common Life. Ce livre fut traduit très rapidement en russe.
5 Appelée tantôt Amalia Feodorovna, tantôt Amalia Ivanovna par l’auteur.
6 La petite Ferme : Chanson populaire.
7 Un uniforme : Les fonctionnaires russes portaient un uniforme.
8 Un simple coin : Avoir une chambre à soi était considéré comme un luxe chez les gens pauvres. Dans les habitations à bon marché, on louait les coins d’une pièce. On y installait plusieurs locataires.