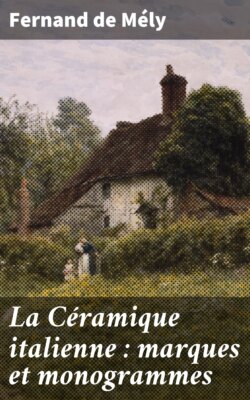Читать книгу La Céramique italienne : marques et monogrammes - Fernand de Mély - Страница 5
INTRODUCTION.
ОглавлениеL’étude de la céramique italienne est tout particulièrement pleine d’intérêt.
C’est qu’en suivant attentivement les différentes phases par lesquelles elle passe successivement, on y retrouve toujours l’art; soit qu’il s’applique à charmer l’œil par le contraste des couleurs, pour orner, ce qu’à l’époque de la renaissance on appelle les crédences, soit que plus tard il allie à ce premier mouvement artistique la science du dessin et de la composition: et alors se produisent ces chefs-d’œuvre que nous admirons et qui placent si haut dans l’histoire de l’art ces majoliques italiennes si justement estimées par notre époque.
Ce qui vient encore ajouter un mérite incontestable aux produits des grandes manufactures italiennes, c’est qu’il n’en est pas de ces plats merveilleux, de ces aiguières gracieuses, de ces vases savamment étudiés, comme des faïences françaises, les Rouen, les Nevers, les Moustiers. Ces dernières ne peuvent réellement trouver place que dans les véritables collections; il faut être essentiellement amateur, je dirai même connaisseur, pour aimer nos produits nationaux.
Il en est tout autrement des majoliques italiennes.
Du moment où l’on sent l’art, où on le comprend — et c’est là une des gloires de notre époque d’avoir une moyenne d’appréciation assez élevée pour saisir presque toutes ces nuances — il est impossible de ne pas s’arrêter quelques instants devant une majolique italienne. Malgré soi, ces rudesses de ton, cette chaleur de coloris, qui s’harmonisent si complètement, ce dessin, parfois si correct qu’il en arrive à pouvoir lutter sans trop de désavantage avec les cartons des grands maîtres, vous frappent et vous attachent.
Rien d’étonnant à cela.
Les grands artistes du quinzième et du seizième siècle ne se contentent pas d’embrasser une seule branche de l’art. Peinture, sculpture, architecture, ils les réunissent et brillent également dans chacune de ces spécialités. Ne voyons-nous pas Léonard de Vinci, ce génie universel, laissant de côté son pinceau pour diriger la canalisation de la Lombardie, Michel-Ange, peignant la chapelle Sixtine après en avoir conçu et exécuté le plan, sculptant son Moïse et défendant Florence.
Puis, au milieu de cette pléiade d’artistes, nous trouvons les Jules II, les Léon X, les ducs d’Urbin, de Ferrare, les Médicis, réunissant autour d’eux dans leurs cours ces gloires éclatantes, les dirigeant, et excitant par leur haute protection ce souffle divin qui passe sur l’Italie.
Et tous, admirant cette nouvelle branche de l’art qui vient de prendre naissance, la céramique, soutiennent ses premiers efforts, l’encouragent par leur munificence et, après avoir fondé de nouvelles manufactures, ouvrent les portes de leurs palais à ces produits merveilleux, dont la Perse et la Chine avaient jusqu’alors conservé le secret.
Non contents des premiers essais, qui montrent, dès les premiers pas, à quelle hauteur peut s’élever l’art de la majolique, ils demandent aux grands maîtres de la peinture, des cartons, des dessins, pour couvrir de délicates arabesques les vases qu’ils font exécuter. Ce ne sont plus de modestes potiers, de simples mouleurs de terre qui suivent leur inspiration. Ils trouvent leurs modèles dans les fouilles; Titien, Raphaël surveillent les nouvelles formes et ils arrivent, une fois l’aiguière finie, à pouvoir lutter avec les pièces délicates qui sortent des mains de Benvenuto Cellini.
Quand nous étudierons chaque pays, en citant les noms célèbres qui ont contribué à faire de Gubbio, d’Urbino, de Ferrare, des centres incomparables, nous rappellerons qu’ici, on trouve un vase incontestablement dessiné par Raphaël, que là, nous rencontrons l’inspiration de Titien, et toujours, planant au-dessus de tous, les grands princes d’Italie, qui n’hésitent pas à récompenser, même par des titres de noblesse, les vaillants artistes qui, peu à peu, par un travail persévérant, parviennent à des résultats pour ainsi dire inespérés.
La fabrication de la majolique italienne se divise en deux catégories bien distinctes.
La première, la plus ancienne, c’est celle que Passeri appelle la demi-majolique. Le potier recouvre l’argile d’une mince engobe de terre blanche, sur cette légère couche l’artiste trace le dessin. Pesaro, Deruta, dans les premiers essais de leur fabrication, ont employé ce mode de faire; Passeri, qui, malgré son enthousiasme pour sa patrie, nous donne cependant parfois des détails intéressants, perdus au milieu de ses erreurs, prétend que c’est à l’aide de ce procédé que Pesaro découvrit ses magnifiques reflets nacrés et parvint à sa réputation. Mais depuis longtemps la question a été tranchée dans le sens contraire.
Deruta, Gubbio, Caffagiolo, nous montrent les merveilles que peut donner le talent sur la véritable majolique, qui forme la deuxième catégorie et que nous rencontrons le plus souvent. Ici le sujet est peint sur la terre naturelle, puis cuit au grand feu. L’émail stannifère, les couleurs du décor se fondent ensemble, et lui donnent une harmonie de tons incomparables. C’est le procédé encore employé de nos jours par certains imitateurs des maîtres de la renaissance.
Heureusement pour nous, malgré l’habileté de leurs procédés, il est facile de distinguer leurs produits de ceux des artistes anciens, et quand ils copient les M° Giorgio, les Fontana, les Xanto, ils arrivent à peine à la hauteur des maîtres de la décadence, c’est-à-dire de la fin du seizième et du dix-septième siècle.
Quand nous avons dit plus haut que c’était un souffle divin qui passait sur l’Italie, nous ne croyons pas avoir exagéré. Un siècle et demi ne s’écoule pas, en effet, sans que nous voyons décliner rapidement les fabriques et leurs produits. Les grands maîtres, en mourant, semblent emporter avec eux, dans la tombe, les secrets de leur art; ils laissent à peine quelques élèves et si une nouvelle école se forme, celle des Patanazzi à Urbino, c’est le dernier éclat d’un feu qui va s’éteindre. Tout disparaît en même temps, et les couleurs brillantes, qui chez certains artistes viennent habilement relever un dessin parfois moins magistral, et les cartons eux-mêmes, qui se modifient profondément. Au lieu de rester artiste, le potier devient commerçant, et de ce moment date cette décadence si prompte, qui mettra plus de temps à atteindre la peinture.
Les grands protecteurs des céramistes ont disparu en même temps. Les Guidobaldo, les Médicis, les ducs de Ferrare, ont laissé la place à des successeurs moins artistes, et, avec le commencement du dix-septième, nous arrivons à la simple production commerciale. A Rome, pourtant, nous retrouvons encore Savino et Simone qui, vers 1605, tentent de relever l’école d’Urbino, mais si leur dessin conserve encore une certaine fermeté, leur coloris est loin de leurs visées artistiques. Seule, l’école des Abruzzes avec les Grue tente de soutenir l’art qui s’en va; mais on sent, malgré les solides leçons puisées dans l’école d’Urbino, à leur faire, plutôt qu’à leur coloris, que le moment approche, où l’Italie ne pourra plus tenir en Europe, le sceptre de la céramique.
Les origines de la majolique italienne sont assez obscurés. Le goût et le secret de cet art nouveau, pour l’Italie, vient-il, comme le prétendent certains auteurs, de l’Espagne, où, dès le treizième siècle, la fabrication moresque était assez avancée pour que Jacques Ier d’Aragon, s’emparant de Valence, crût devoir protéger, par une charte spéciale, les potiers mores de Xativa, ou de l’Orient latin? En tous cas, ce que nous en savons, c’est que Pise fut un des centres primitifs de la fabrication italienne. Cela résulte de cette citation d’Ercolano. «Ses faïences (de Valence) sont si belles et si élégantes, qu’en échange des faïences que nous envoie l’Italie DE PISE, nous expédions des vaisseaux chargés de celles de Manissès. » (Jacquemart.)
Donc il y avait ÉCHANGE avec l’Espagne. Malgré les beaux produits hispano-moresques, on estimait assez à Valence, — le grand centre céramique — les majoliques italiennes pour les mettre en parallèle avec celles de Manissès; ainsi les deux fabriques travaillaient en même temps et nous devons rechercher d’un autre côté la filiation des produits italiens.
Pour nous, elles ont une autre origine.
M. François Lenormant, dans son voyage à travers l’Apulie et la Lucanie, nous parle des baccini, employés dans la décoration des églises, par les architectes italiens, dès le onzième siècle. A ce propos, il nous signale les constatations qu’il a faites à l’église de Lucéra, et c’est aux habitants de cette ville, instruits par les colons orientaux, qu’il faudrait attribuer, d’après lui, la création des ateliers dont les produits devaient se répandre plus tard dans toute l’Italie. Plus loin, il mentionne le chaînon géographique qui relierait les travaux de Lucéra avec ceux de Pesaro, travaux ORIGINAIRES DE L’ORIENT.
Ici nous approchons de la vérité. Mais c’est à Pise surtout qu’il faut étudier la majolique italienne dans ses débuts, parce que, là, nous retrouvons des traces matérielles d’une industrie certainement originaire de l’Orient.
Malheureusement les savants italiens n’ont pas encore apporté grande attention aux premières pièces que nous trouvons en Italie. Pourtant il serait intéressant, même au point de vue de la civilisation européenne, de refaire l’histoire de ses débuts en Italie: et si les archives de Pise ne nous ont fourni aucun document dans la période de ses rapports avec l’Orient latin, les registres des fabriques, les comptes des municipes, les chartriers des monastères doivent renfermer au moins une trace des poteries émaillées qui apparaissent dès le douzième siècle à Pise et dans l’ancien royaume des Deux-Siciles.
D’après M. Drury-Fortnum, ces baccini seraient le produit d’une décoration inventée dans le pays même: s’il disait fabriquée, nous tomberions d’accord, mais inventée, il est difficile de le croire, pas plus que nous ne les regarderions comme des trophées rapportés par les Pisans de leurs excursions contre les Arabes.
Peut-être faudrait-il rechercher leur origine dans l’histoire même de Pise et de Gênes, et c’est pour cela que nous regrettions tout à l’heure de voir les savants italiens laisser de côté l’origine de ces disques émaillés.
Dès le onzième siècle Gênes, déjà fort puissante, s’en alla fonder des colonies en Orient, en Crimée et sur les bords de la mer Noire. Aujourd’hui encore nous trouvons les ruines imposantes des monastères génois fondés à cette époque aux environs du Caucase. En Mingrélie, les armes de Gênes sont encore apparentes sur la porte du monastère de Tchakwidgi. Non loin de là, les Pisans vinrent à leur tour fonder un monastère, celui de Pisunda, reconnaissable à son nom et à celui des familles Cheilia et Bendeliani encore établies dans le pays. Les luttes entre Pise et Gênes se continuèrent jusqu’en Asie Mineure, et les Pisans de Pisunda durent fuir devant les attaques des Génois et retourner dans leur pays. Or, pour ceux qui ont pu voir dans les ruines des anciennes mosquées de Tabriz et d’Érivan du onzième et douzième siècle les lambris merveilleux de faïences émaillées, sur lesquels le temps n’a rien pu que donner une patine métallique, il existe un rapport vraiment extraordinaire entre les majoliques persanes et italiennes. Des carreaux émaillés que nous avons rapportés de la mosquée d’Érivan aux fonds jaune d’or, au bleu profond, sur lesquels se détachent de larges fleurs de pivoine violacées, bordées d’un léger trait de manganèse, semblent sortir de la manufacture de Caffagiolo et de Faenza; c’est à croire que les mêmes artistes ont travaillé ensemble, et les baccini de Pise datent de cette époque! Les Pisans n’auraient-ils donc pu prendre des leçons dans les ateliers d’où sortirent ces merveilleuses majoliques, avant de rentrer dans leur patrie?
Fragment de lambris du douzième siècle. Mosquée d’Erivan.
Peut-être encore ces pavés sont-ils l’œuvre de Persans prisonniers à Pise? M. du Sommerard, dont les connaissances archéologiques sont d’une si grande ressource pour les collectionneurs, a réuni, depuis quelques années, une certaine quantité de plats de facture orientale qui proviennent de Rhodes; la tradition du pays rapporte qu’une galère chargée de majolistes persans vint faire naufrage près de l’île. Les chevaliers les gardèrent prisonniers et leur firent exécuter les nombreuses pièces qui ornent aujourd’hui le musée de Cluny. L’un de ces captifs, du reste, s’est chargé de transmettre à la postérité sa plainte, en traçant sur une feuille qu’il tient à la main:
«Oh mon Dieu! quelle souffrance; qu’ai-je fait pour être tellement tourmenté dans l’exil. Quand y aura-t-il un terme à cette douleur? Ce que mon cœur désire quand sera-t-il accompli? J’aurais encore, oh mon Dieu! bien des choses à te dire, mais comment m’entendras-tu? Ibrahim dit cela; quand donc ma prière sera-t-elle exaucée?...
(Faïences de Lindos, n° 2143, Cluny.)
Ne se pourrait-il donc pas, qu’au milieu de prisonniers faits par les Pisans dans leurs luttes avec les Orientaux, il se fût trouvé quelque artiste majoliste, qui, pour adoucir sa captivité, ait enseigné aux ouvriers pisans l’art d’émailler la terre?
A tout cela on peut opposer l’influence arabe, les conquêtes et les trophées des Pisans, en Espagne; mais en étudiant les deux céramiques, il est facile de se convaincre que dès leur origine elles ont suivi une impulsion artistique différente: au quinzième siècle, la faïence hispano-moresque florit parallèlement à la majolique italienne: nous l’avons vu tout à l’heure, ses reflets mordorés séduisent les habitants de la Sicile, qui les imitent, mais la majolique italienne, aux couleurs profondes, au dessin bien arrêté, procède directement de la Perse.
Le pavage de San Giacomo de Bologne en est encore une preuve évidente. En Faenza du quinzième siècle, on y retrouve ces feuilles lancéolées qui décorent les plats de Rhodes et se retrouvent encore aujourd’hui dans les faïences de Perse.
D’ailleurs les relations de l’Italie avec l’Orient étaient à ce moment déjà fort anciennes; au dixième siècle, nous trouvons les Pisans sur les rives de l’Asie Mineure et c’est là certainement qu’ils puisèrent le goût, puis le secret de la majolique, qui pendant deux siècles va tenir une si grande place dans l’histoire des beaux-arts.
Nous avons parlé de Pise, parce que c’est là, croyons-nous, qu’il faut chercher les premières manifestations de la céramique, plus loin nous reprendrons chaque pays en particulier. Là, nous suivrons les artistes et leurs monogrammes différents, qui pour d’aucuns changent avec leur manière, et alors nous nous arrêterons sur les caractères particuliers qui peuvent en dehors de toute signature, faire reconnaître souvent les produits d’une fabrique.
Mais, avant tout, il nous faut faire une remarque.
Il y a sous les pièces de céramique deux sortes de signatures. L’une, le nom de l’artiste, nous l’appellerons le monogramme, l’autre la marque de fabrique, c’est le sigle. Il en était des potiers comme des autres corporations. Pour ouvrir boutique, BOTTEGA, comme nous le trouvons sous nombre de pièces, il fallait être maître; ces maîtres avaient chez eux des artistes habiles et souvent inconnus, mais qui, eux aussi, mettaient parfois à côté de la marque de fabrique, du sigle, les uns une lettre, les autres un détail destiné à les faire reconnaître: ce n’est que par une étude suivie qu’il devient possible de les distinguer, par une suite de comparaisons, par l’examen de la touche, du dessin, de la couleur qu’on peut les distinguer. A Urbino, à Castel-Durante où les boutiques étaient si nombreuses qu’il existe encore dans cette dernière la VIA DELLA PORCELLANA, nous retrouverons cet ordre d’idées nettement établi.
Nous n’avons pas l’envie de comprendre dans cette énumération les noms de M° Giorgio, des Xanto, des Fontana, des Patanazzi, des Grue; mais tous les collectionneurs ne peuvent prétendre s’arrêter à ces grands noms, il faut donc chercher à connaître leurs contemporains et leurs successeurs.
Les premiers mettaient souvent leurs noms sous leurs œuvres; ils ont d’ailleurs une manière qui les rend reconnaissables; on signe leur œuvre sans voir leur monogramme, qu’ils oublient parfois: leur dessin magistral, la grande tournure qui le caractérisent les mettent au niveau des grands peintres et des grands coloristes de la renaissance. Ils ont fait, eux aussi, école, et c’est de leurs élèves qu’il faut se préoccuper. Nul doute qu’avec le temps, notre siècle, si amoureux de l’art, ne parvienne à découvrir le nom de ces artistes: à côté des monogrammes, ils nous ont laissé peut-être un autre moyen de les reconnaître: mais que de temps, de recherches, de patientes études il faudra pour y arriver.
Sous nombre de pièces nous ne trouvons que l’explication du sujet. Ici: Moyse con popolo; plus loin: Per amore. Sous d’aucuns une devise, ou bien les vers du poète qui a su inspirer l’artiste. Par la forme des lettres, on doit arriver à découvrir l’auteur. Voilà donc deux points de repère que nous avons maintenant, la touche et l’écriture. Certains, les Patanazzi, écrivent en romaine, en grandes lettres, d’autres, Fontana, Nicolo, d’une écriture fine et déliée; quelques-uns, d’une main lourde, Xanto. Il faut pouvoir réunir les modèles de ces différentes écritures et nul doute qu’un heureux résultat ne récompense un jour nos efforts.
C’est à la fin du quatorzième siècle que commence à se développer, en Italie, l’art de la majolique. Au Louvre le carreau de saint Crépin et saint Crépinien nous montre les premiers pas des céramistes, qui sont déjà surprenants. Puis, en 1396, Jehan des Potteries, quittant Forli, vient s’établir à Pesaro: nous croyons, avec Passeri, trouver là le point de départ des merveilles que dans un siècle nous allons rencontrer.
Et quand nous disons un siècle, évidemment la marge est trop grande. Dès 1438 nous avons une magnifique encoignure chez M. Castellani; en tous cas, si la date, qui est peu lisible, paraît trop ancienne, nous avons celle de 1459 d’Urbino, au musée de Pesaro; elle se trouve sous une pièce naïve de dessin, surtout dans la perspective, mais qui montre la route que va suivre l’école métaurienne. Le plat représente le taureau de Phalaris, et porte comme sigle «Urbinas die undecima januarii 1459» et sur cette date aucune objection à faire. Les chiffres sont parfaitement distincts; quant à croire à une imitation, nous n’avons aucun motif d’y penser. Pièce peu importante, elle n’aurait pu attirer, il y a cent ans, l’attention des collectionneurs, qui avaient autour d’eux à discrétion les Xanto et les Giorgio. Ceux-là, par exemple, ont été imités au dix-septième siècle, les contrefacteurs y avaient intérêt, mais pour un plat comme celui de Pesaro, le bénéfice n’eût pas récompensé leur peine. Depuis longtemps d’ailleurs il se trouve au musée Urbique, dont le marquis Antaldi soigne avec amour la magnifique collection.
D’un autre côté, en parcourant les petites villes du duché d’Urbin, perdues dans les Apennins, nous avons découvert à Gubbio un portrait fort intéressant, qui reporte de quelques années en avant la fabrication de M° Giorgio. Ce portrait nous montre le maître après son anoblissement en 1498. Sa figure fatiguée, ses traits accusés, lui donnent au moins cinquante ans. De plus, il n’est pas présumable que son premier essai, bien loin de sa dernière manière, lui ait fait donner le patriciat. On peut donc supposer que depuis vingt années au moins M° Giorgio s’occupait de majoliques. C’est alors vers 1475 qu’il faudrait faire remonter ses premiers travaux.
Mais avant ces artistes, nous avons la dynastie des Robbia. Statuaires, dès le commencement du quinzième siècle, ils entreprennent, en présence des nombreuses commandes qu’ils ne pouvaient satisfaire, de produire en terre cuite des bas-reliefs, qu’ils recouvrent d’émaux le plus souvent bleus et blancs; un peu plus tard, ils les entourent de couronnes artistement composées de fleurs et de fruits émaillés de jaunes et de verts. D’abord ce ne sont que des bas-reliefs d’église; à Florence, à Pise, dans toute cette partie de l’Italie, on en rencontre de magnifiques, surmontant les tombeaux, décorant les autels, les portes des couvents; plus tard ils travaillent pour les palais, créent des compositions moins religieuses, abandonnent leur caractère un peu archaïque, et en arrivent aux véritables chefs-d’œuvre de la renaissance, dont le musée d’Urbino possède un petit, mais si remarquable spécimen. Le cadre et le but de notre travail ne nous permettent malheureusement pas de nous étendre plus longuement sur leurs travaux, que des maîtres autorisés ont d’ailleurs si soigneusement étudiés avant nous .
La faïence italienne est facile à reconnaître. Après quelques mois de recherches, il devient même possible de reconnaître les différentes écoles, auxquelles peuvent appartenir les pièces qui passent par nos mains. Mais lorsque nous voulons mettre un nom de fabrique sur une de ses œuvres, et surtout sur un produit inférieur, le véritable collectionneur lui-même, se sent embarrassé.
Rien d’étonnant à cela! Pendant la période où fleurit le grand art céramique, les artistes vont de ville en ville, tantôt cherchant des travaux, tantôt appelés par la munificence des princes qui les attirent par la promesse de leur protection. Souvent aussi, après la découverte d’un procédé nouveau, un maître va porter dans un autre pays ses connaissances, ses talents, et c’est ainsi que les reflets se répandent en Italie. D’abord spécialité de Pesaro, ils se développent ensuite à Gubbio, où M° Giorgio arrive à conquérir ces magnifiques reflets rubis, signature presque certaine de ses produits. A Urbino, dans les États de l’Église les artistes s’appliquent à couvrir de ces éclatantes couleurs les produits de leurs fabriques. Presque seule, l’école des Abruzzes semble rester en dehors de cette nouvelle découverte. Pourtant, son véritable réformateur, Oratio Pompéï, devait la connaître, quand quittant Urbino vers 1590, il allait redonner la vie à ce centre qui depuis quelque temps semblait abandonné.
Vers la seconde partie du quinzième siècle, elle avait eu, elle aussi, un moment de splendeur. Nardo di Castelli et Antonius Lollus avaient créé près de Naples une école dont les spécimens du musée de San Martino peuvent nous donner une haute idée. Antonius Lollus, lui, avait découvert la dorure sur faïence et les plats magistralement décorés, rehaussés de lignes d’or, permettaient à leur auteur d’écrire au bas «Antonius Lollus inventor».
Il fallait qu’après lui le secret en eût été perdu, puisqu’en 1567 Guidobaldo II, duc d’Urbin, rendait en faveur de Jacomo Lanfranco un édit qui l’autorisait à user exclusivement de la découverte qu’il venait de faire de la dorure sur faïence. Jusqu’à présent les pièces rehaussées d’or de Pesaro passaient pour les plus anciennes, mais San Martino possède ce spécimen signé Lollus, dont le nom ne permet pas de douter que vers, la fin du quinzième siècle, l’or savamment appliqué sur la majolique servait à enrichir la maestria du dessin. C’est donc un nouveau jour qui viendrait se faire sur cette partie de la décoration céramique. D’ailleurs quelle autre acception donner au mot «inventor», puisque plus tard, dans la collection de M. Rey, de Naples, j’ai retrouvé le même plat, portant simplement: «Antonius Lollus fecit» et ce dernier n’avait aucune trace de dorure: même sujet, le Jugement de Pâris, même manière, même teinte, tout, excepté la dorure et le mot inventor. Restituons donc à Lollus la découverte de ce procédé ; du reste en céramique nous aurons continuellement de nouveaux renseignements. Depuis Passeri, combien de pierres sont venues s’ajouter à l’édifice, pourtant si remarquable, que lui, le premier, avait songé à élever.
Chaque jour apporte son contingent à ce grand œuvre. Les savants directeurs des musées d’Italie, comprenant qu’il était temps de s’occuper sérieusement des questions céramiques, une des gloires de leur pays, commencent à puiser dans leurs archives les renseignements précieux qui s’y trouvent renfermés depuis des siècles. Nous voulons ici les remercier de l’accueil aimable que nous avons trouvé près d’eux, des documents qu’ils nous ont fourni. A Pesaro, c’est le marquis Antaldi, qui catalogue si soigneusement son musée; compulsant Passeri, dont les nombreux ouvrages ne sont pas encore tous connus, il y puise de nouvelles données, qui montreront sans nul doute que le vieil érudit Pesarais n’a pas toujours erré ; à Bologne, le savant bibliothécaire Fratti, réunissant tous les sénatus-consultes du sénat bolonais, y découvre la date et les noms des premiers fondateurs des manufactures bolonaises; à Urbino, le directeur du musée des Marches s’applique à conserver les produits de l’école métaurienne; à Naples enfin, le gouvernement rassemble à San Martino les faïences des Abruzzes, tandis que le palais royal renferme les produits de Capo di Monte.
Et de tout cela, il n’y a pas fort longtemps. La France, elle, avait pris la première part de cette renaissance, non pas de l’art, mais du goût de ces anciennes merveilles; ce sont nos collectionneurs, nos grands amateurs qui ont tracé la route. Lorsque l’Italie a vu que nous allions chercher chez elle les chefs-d’œuvre de l’art céramique qu’elle laissait dans l’oubli, elle a compris que ses tableaux, ses statues, n’étaient pas les seuls représentants de la renaissance; elle aussi s’est dit qu’il était temps d’arrêter cette émigration d’un nouveau genre, et maintenant nous pouvons, dans ses musées, admirer, à côté des grands maîtres de la peinture sur toile, les grands maîtres de la peinture sur faïence.
Avant de commencer ce travail, il fallait se tracer un plan. Nous nous sommes demandé quel ordre nous devions suivre. Fallait-il prendre l’ordre géographique, c’est-à-dire, partir de la haute Italie, pour descendre jusqu’à la Pouille, ou l’ordre chronologique. Ce dernier parti nous a paru plus rationel. Mais là s’élevait une difficulté d’un nouveau genre.
Au seuil du seizième siècle, nous devions choisir entre toutes les manufactures qui apparaissent presque en même temps. Une seule devançait toutes les autres, Pesaro, où, avec Jehan des Potteries, venant de Forli, nous voyons s’ouvrir une boutique dès la fin du quatorzième siècle. Ici nous voulons des documents écrits, et bien que Jehan des Potteries vînt de Forli, comme le constate Passeri, nous n’avons aucun renseignement certain sur les fabriques de cette dernière ville avant la date de 1466, inscrite sous le coq de Cluny, n° 2805. Après ces deux pays il fallait choisir. Mais voilà que la manufacture d’Urbino nous apparaît avec une date nouvelle. Le 11 janvier 1459, il s’y fait un plat, qui peut déjà donner une idée du développement artistique qui s’y prépare. Les Montefeltre avant de disparaître donnent une preuve de leur goût pour la céramique: un plat de Pesaro, sans date, mais à leurs armes et de la fin du quinzième siècle, avec cette devise, «Evviva il ducca d’Urbino» sur le manteau d’une jeune femme, ne laisse pas douter de la protection qu’ils accordent aux peintres sur faïence, et ils disparaissent en 1512; puis c’est Gubbio, avec M° Giorgio vers 1475, ou 1480. Enfin, il paraît évident aujourd’hui, qu’après Pise, c’est à l’école métaurienne qu’il faut donner l’antériorité dans les âges de la majolique italienne.
Les pièces datées sont assez rares. Une encoignure de Caffagiolo, dans la collection Castellani, porte une date assez difficile à déchiffrer; et, par malheur, c’est justement le chiffre important qu’un accident de cuisson a fait presque entièrement disparaître. Porte-t-elle 1438 ou 1498? Sa facture est magistrale, c’est une date importante; mais nous ne nous permettrons pas de trancher la question dans un sens ou dans l’autre.
Vers 1500, François-Marie, avant d’être duc de Ferrare, va s’occuper de majoliques.
Mais, en artiste éclairé, en travailleur persévérant, il s’occupera aussi de rechercher la fabrication de la porcelaine. Celles de Chine, importées par Venise, le tentaient singulièrement, et s’il n’a pu parvenir aux résultats qu’il espérait, il encouragea longtemps les travaux de Bernardo Buontalenti. Tous les princes, amis des arts, s’efforcent d’arriver à ce but si convoité ; les ducs d’Urbin s’engagent aussi dans cette voie à Pesaro; mais seul François-Marie a laissé dans l’histoire de la porcelaine des traces palpables qui resteront uniques jusqu’au moment où, dans la deuxième partie du dix-septième siècle, elle fit son apparition en France; d’abord en 1664 avec Claude Révérend, qui s’établit à Paris où malheureusement il ne réussit pas, et en 1673 avec Poterat, qui nous donna enfin à Rouen les premiers spécimens artistiques de la porcelaine européenne.
Avec le dix-huitième siècle, nous voyons disparaître les majoliques. C’est alors que se fonde la manufacture de Doccia, près Florence, puis celle de Capo di Monte, protégée à ses débuts par Charles III, des Deux-Siciles. La mode est à la porcelaine; seule l’école des Abruzzes vivra pendant quelques années; mais elle va s’éteindre avec la dynastie des Grue et nous n’aurons plus pour représenter cette grande page de l’histoire artistique de l’Italie que les deux manufactures de porcelaine dont nous venons de parler. Encore la manufacture de Capo di Monte disparaîtra-t-elle, emportée par les crises politiques de 1822, et aujourd’hui la fabrique de Doccia, habilement dirigée par le marquis Ginori, est la seule qui essaye de continuer les grandes traditions de la céramique italienne.