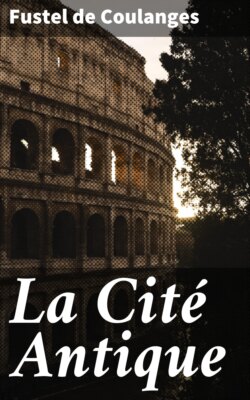Читать книгу La Cité Antique - Fustel de Coulanges - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NOTES
Оглавление[1] Quelques historiens ont émis l'opinion qu'à Rome la propriété avait d'abord été publique et n'était devenue privée que sous Numa. Cette erreur vient d'une fausse interprétation de trois textes de Plutarque (Numa, 16), de Cicéron (République, II, 14) et de Denys (II, 74). Ces trois auteurs disent, en effet, que Numa distribua des terres aux citoyens; mais ils indiquent très clairement qu'il n'eut à faire ce partage qu'à l'égard des terres conquises par son prédécesseur, agri quos bello Romulus ceperat. Quant au sol romain lui-même, ager Romanus, il était propriété privée depuis l'origine de la ville.
[2] [Grec: Hestia, hestaemi] stare. Voy. Plutarque, De primo frigido, 21; Macrobe, I, 23; Ovide, Fast., VI, 299.
[3] [Grec: Herchos hieron]. Sophocle, Trachin., 606.
[4] A l'époque où cet ancien culte fut presque effacé par la religion plus jeune de Zeus, et où l'on associa Zeus à la divinité du foyer, le dieu nouveau prit pour lui l'épithète de [Grec: hercheios]. Il n'en est pas moins vrai qu'à l'origine le vrai protecteur da l'enceinte était le dieu domestique. Denys d'Halicarnasse l'atteste (I, 67) quand il dit que les [Grec: theoi hercheioi] sont les mêmes que les Pénates. Cela ressort, d'ailleurs, du rapprochement d'un passage de Pausanias, (IV, 17) avec un passage d'Euripide (Troy., 17) et un de Virgile (En., II, 514); ces trois passages se rapportent au même fait et montrent que le [Grec: Zeus hercheios] n'est autre que le foyer domestique.
[5] Festus, v. Ambitus. Varron, L. L., V, 22. Servius, ad Aen., II, 469.
[6] Diodore, V, 68.
[7] Cicéron, Pro domo, 41.
[8] Ovide, Fast., V, 141.
[9] Telle était du moins la règle antique, puisque l'on croyait que le repas funèbre servait d'aliment aux morts. Voy. Euripide, Troyennes, 381.
[10] Cicéron, De legib., II, 22; II, 26. Gaius, Instit., II, 6. Digeste, liv. XLVII, tit. 12. Il faut noter que l'esclave et le client, comme nous le verrons plus loin, faisaient partie de la famille, et étaient enterrés dans le tombeau commun. La règle qui prescrivait que chaque homme fût enterré dans le tombeau de la famille souffrait une exception dans le cas où la cité elle-même accordait les funérailles publiques.
[11] Lycurgue, contre Léocrate, 25. A Rome, pour qu'une sépulture fût déplacée, il fallait l'autorisation des pontifes. Pline, Lettres, X, 73.
[12] Cicéron, De legib., II, 24. Digeste, liv. XVIII, tit. 1, 6.
[13] Loi de Solon, citée par Gaius au Digeste, liv. X, tit. 1, 13. _Démosthènes, contre Calliclès. Plutarque, Aristide, 1.
[14] Siculus Flaccus, édit. Goez, p. 4, 5. Voy. Fragm. terminalia, édit. Goez, p. 147. Pomponius, au Digeste, liv. XLVII, tit. 12, 5. Paul, au Digeste, VIII, 1, 14.
[15] Même tradition chez les Étrusques: « Quum Jupiter terram Etruriae sibi vindicavit, constituit jussitque metiri campos signarique agros. » Auctores rei agrariae, au fragment qui a pour titre: Idem Vegoiae Arrunti, édit. Goez.
[16] Lares agri custodes, Tibulle, I, 1, 23. Religio Larum posita in fundi villaeque conspectu. Cicéron, De legib., II, 11.
[17] Cicéron, De legib., I, 21.
[18] Caton, De re rust., 141. Script. rei agrar., édit. Goez, p. 808. Denys d'Halicarnasse, II, 74. Ovide, Fast., II, 639. Strabon, V, 3.
[19] Siculus Flaccus, édit. Goez, p. 5.
[20] Lois de Manou, VIII, 245. Vrihaspati, cité par Sicé, Législat. hindoue, p. 159.
[21] Varron, L. L., V, 74.
[22] Pollux, IX, 9. Hesychins, [Grec: oros]. Platon, Lois, VIII, p. 842.
[23] Ovide, Fast., II, 677.
[24] Festus, v° Terminus.
[25] Script. rei agrar., édit. Goez, p. 258.
[26] Platon, Lois, VIII, p. 842.
[27] Plutarque, Lycurgue, Agis. Aristote, Polit., II, 6, 10 (II, 7).
[28] Aristote, Polit., II, 4, 4 (II, 5).
[29] Id., ibid., II, 3, 7.
[30] Eschine, contre Timarque. Diogène Laërce, I, 55.
[31] Aristote, Polit., VII, 2.
[32] Mitakchara, trad. Orianne, p. 50. Cette règle disparut peu à peu quand le brahmanisme devint dominant.
[33] Ce prêtre était appelé agrimensor. Voy. Scriptores rei agrariae.
[34] Stobée, 42.
[35] Cette règle disparut dans l'âge démocratique des cités.
[36] Une loi des Éléens défendait de mettre hypothèque sur la terre, Aristote, Polit., VII, 2. L'hypothèque était inconnue dans l'ancien droit de Rome. Ce qu'on dit de l'hypothèque dans le droit athénien avant Solon s'appuie sur un mot mal compris de Plutarque.
[37] Dans l'article de la loi des Douze Tables qui concerne le débiteur insolvable, nous lisons: Si volet suo vivito; donc le débiteur, devenu presque esclave, conserve encore quelque chose à lui; sa propriété, s'il en a, ne lui est pas enlevée. Les arrangements connus en droit romain sous les noms de mancipation avec fiducie et de pignus étaient, avant l'action Servienne, des moyens détournés pour assurer au créancier le payement de la dette; ils prouvent indirectement que l'expropriation pour dettes n'existait pas. Plus tard, quand on supprima la servitude corporelle, il fallut trouver moyen d'avoir prise sur les biens du débiteur. Cela n'était pas facile; mais la distinction que l'on faisait entre la propriété et la possession, offrit une ressource. Le créancier obtint du préteur le droit de faire vendre, non pas la propriété, dominium, mais les biens du débiteur, bona. Alors seulement, par une expropriation déguisée, le débiteur perdit la jouissance de sa propriété.