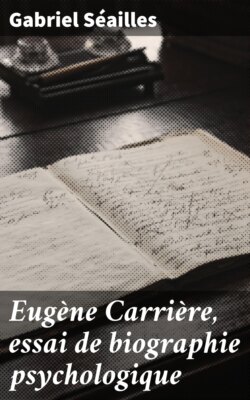Читать книгу Eugène Carrière, essai de biographie psychologique - Gabriel Seailles - Страница 6
I
ОглавлениеLa vraie vie d’un artiste est sa vie intérieure, elle est moins dans les événements que dans les pensées, les sentiments dont ils ont été l’occasion. La vie d’Eugène Carrière nous intéresse par ce qu’elle trahit de son esprit et de son caractère, par ce qui la rattache à son art et contribue à nous en donner l’intelligence. Regardée du dehors, je n’en sais pas de plus simple, de plus banale; mais elle prend par là même quelque chose de général et d’humain; elle nous présente l’exemple d’un homme qui, sans à-coup, sans .rien brusquer, entre en possession de lui-même; elle enseigne aux gens pressés ce que donne de courage dans la lutte, de force pour la soutenir, de sérénité dans les épreuves inévitables, la fidélité inviolable à l’idéal supérieur, qui libère ses serviteurs de toutes les autres servitudes.
Le sixième enfant d’une famille qui en compta sept, j’imagine qu’il fut accueilli à son entrée dans le monde avec plus de résignation que d’enthousiasme; mais il ne s’est point lassé de nous dire — ce qu’il sait bien sans doute — que la tendresse des mères est infinie. Fille d’un médecin de campagne d’Alsace, sa mère était la femme simple, qui ne discute ni le devoir ni la vie, l’être de dévouement obstiné qui ne songe qu’aux autres et ne regarde la tâche qu’après qu’elle est accomplie. Il lui doit son esprit sérieux, réfléchi, son sens du devoir, son acceptation tranquille de la destinée, le courage des dures besognes qui s’imposent et que relève la dignité dont elles sont la sauvegarde. Carrière ne fut pas un enfant prodige, il n’accomplit rien d’extraordinaire dans son berceau; et, comme le sort ne lui avait réservé aucune faveur, comme il devait tout attendre de sa propre volonté, les diseurs de bonne aventure n’eurent rien à lui prédire. Durant les longues années de la première enfance, il fut l’être obscur, silencieux, qu’il a si souvent peint: d’abord le petit animal qui sourit ou s’effare, à peine détaché du sein qui le nourrit et l’abrite; puis le garçon grandi, déjà fort, qui se reconnaît, se sépare, découvre le monde, tour à tour étonné, inquiet ou ravi. Le père, souvent absent, en route pour ses affaires, les heures coulaient lentement auprès de la mère dans la maison silencieuse.
Appelé à l’existence active, au labeur précoce, Carrière recevait une instruction modeste, toute pratique; aucun maître ne devançait pour lui l’expérience, il n’était point initié à la beauté par la poésie, il ignorait ce qu’est l’art ou même qu’il existât; il était condamné à savoir seulement ce qu’il apprendrait lui-même, ce qu’il découvrirait peu à peu du présent et du passé, par une sorte de croissance spontanée, en amplifiant sa vie, en reliant son propre effort à l’effort antérieur des autres hommes. L’existence dure qu’on menait autour de lui et dont il partageait les vicissitudes, était sa première éducation: témoin des soucis, des inquiétudes, du perpétuel recommencement de la lutte, il faisait, sans y songer, l’apprentissage de la patience, du courage, des solides vertus sur lesquelles une vie pose sans chanceler.
Mais dans l’enfant sérieux, dont l’originalité ne se trahissait guère que par la lenteur et la timidité, sommeillaient les germes du talent qui allait décider de sa destinée. Son grand-oncle était peintre; son grand-père paternel était professeur de dessin au lycée de Douai; il faisait correctement, avec une habileté scrupuleuse, des portraits, aquarelles et pastels, dont j’ai vu quelques-uns jadis, images aujourd’hui pâlies, à demi-effacées de mon souvenir. C’est une pauvre philosophie que celle du succès: notre effort peut-être se continuera, s’achèvera par un effort plus heureux, que nous aurons rendu possible. De braves gens, par un obscur labeur, préparent le mécanisme que les lois mystérieuses de l’hérédité transmettront à celui qui fera leur nom inoubliable. Tout petit, Carrière aimait les images, éprouvait un obscur besoin de les reproduire, les sentait comme descendre de son cerveau dans ses doigts, et s’attardait à ce jeu que ses difficultés faisaient plus passionnant. A douze ans, il dessinait déjà tout seul, sans y voir de mystère, sans y mettre de vanité, pour son plaisir, pour obéir à l’instinct qui, sans qu’il le soupçonnât, marquait l’orientation de sa vie. Carrière a le respect de la nature, de ses libres mouvements; il veut que le grain lève et mûrisse à son heure, mais, s’il ne précipite rien, dès qu’il a pris conscience d’une tendance en lui, il y applique la volonté la plus constante. Il y avait une académie à Strasbourg, il en suivit les cours, sans but précis, parce qu’il était naturellement où on dessinait. Élève assidu, bien doué, travaillant l’ornement, la bosse, le modèle vivant, avec un zèle où se trahissaient sa passion et son entêtement, chaque année il remportait tous les prix. N’attachant à ses succès aucune importance, sa famille les ignorait.
Le père avait le légitime souci de voir les enfants se suffire à eux-mêmes le plus promptement possible; les leçons de dessin et les pastels de famille ne lui avaient pas laissé de la profession d’artiste un souvenir qui la lui fît envier pour l’un de ses enfants; il n’admettait pas même l’idée d’une telle fantaisie, et il s’occupait de trouver au garçon déjà grand un métier qui d’ores et déjà nourrît son homme. A quinze ans, Carrière entrait en apprentissage chez un lithographe; à dix-neuf ans, il quittait Strasbourg pour Saint-Quentin, où il travaillait de son métier, «composant, pour les commerçants et les industriels, des en-tête de factures, des vignettes de réclames.» (Élie Faure.) Mais une sorte d’instinct, servi par une volonté tenace, le conduisait sûrement vers la vie qui devait être la sienne. A Saint-Quentin, il fit une découverte qui marque un moment décisif du lent progrès par lequel il s’élevait à la conscience de lui-même. A Strasbourg, il avait dessiné. Ses albums montrent avec quelle patience, avec quel scrupule il avait, d’un crayon bien effilé, parfait ses chefs-d’œuvre d’écolier; mais il avait ignoré l’art, il n’avait pas soupçonné la peinture, ce langage de l’émotion par la ligne, la forme, la couleur; il n’avait pas même su voir dans l’église Saint-Pierre les chefs-d’œuvre de Martin Schongauer, le maître charmant de Colmar. A Saint-Quentin, dans les salles solitaires du musée, il trouva l’œuvre de Latour: des pastels achevés, des «préparations» plus précieuses encore, par ce qu’elles révélaient de la vision de l’artiste, de l’acuité de son observation, de la certitude, de la décision avec lesquelles il ramenait la nature complexe et fuyante à une idée claire. Il y avait là des philosophes et des financiers, des grands seigneurs et des danseuses: J.-J. Rousseau, Maurice de Saxe, la Favart et la Camargo, des inconnus, qui bientôt n’étaient plus des étrangers pour lui. Carrière se mit à l’école de Latour, il donna tous ses loisirs à la copie de ces pastels, à l’étude de cet art fait d’analyse et de vie; il apprit de ce maître ardent et réfléchi qu’une tête est définie d’abord par son ossature, qu’il faut la construire avant de l’animer, que la physionomie n’est que grimace, isolée du caractère permanent qu’elle modifie.
A quelque temps de là, un court séjour à Paris lui donna l’occasion de visiter le musée du Louvre. Jusqu’à cette heure, il avait dessiné sans plan arrêté, par instinct, parce qu’il avait en lui une sorte de mécanisme préformé qui liait l’image au mouvement et dont le jeu l’amusait. En sortant du Louvre, il avait fait un pas décisif dans la découverte de lui-même; il avait compris ce qu’il pressentait, trouvé ce que, depuis son enfance, il cherchait obscurément. C’est devant les toiles de Rubens qu’au choc d’une émotion soudaine avait jailli en lui la résolution d’être peintre: l’admiration est surprise, étonnement autant que sympathie. Cette décision, à dire vrai, n’était que le terme d’un long travail antérieur: selon la loi de sa nature, l’idée lentement mûrie, éclose à son heure, s’achevait en une volonté que rien ne devait plus ébranler.
En dépit de l’opposition paternelle, il quitta Saint-Quentin et vint s’installer à Paris. Sans trembler, il entrait dans la ville redoutable, il affrontait la grande solitude que fait à l’inconnu l’indifférence de la foule; il n’avait à compter sur personne, il n’avait ni argent ni relations, pas même la sympathie lointaine des siens, dont l’hostilité achevait son abandon. Il ne joua ni au héros ni au génie méconnu; comme tous les hommes d’action, qui prennent l’initiative d’eux-mêmes, il avait le courage des commencements. Il avait prévu la misère, il avait horreur de la bohème, de la vie sans dignité, faite d’excès et de privations, où la volonté s’affaiblit et s’énerve. Le problème était de vivre et de trouver le temps de l’effort désintéressé qu’exige l’apprentissage de l’art; il le résolut par le travail. Il avait un métier, il était homme de ressource; il se fit dessinateur, il ne trouva aucune besogne indigne de lui, il prit sur ses nuits, il vécut. Tout en gagnant le pain de chaque jour, il trouvait le temps de suivre les cours de l’École des Beaux-Arts. Il avait l’optimisme des vaillants et des forts. Ceux qui l’ont connu dans ces années d’apprentissage, se rappellent sa franche gaieté, ses inventions comiques, les éclats de son rire sonore.
Sur ces entrefaites, la guerre éclata. Après les premières défaites, il partait pour Strasbourg; il voulait rej oindre ses parents, prendre sa part des épreuves communes. Strasbourg déjà était investie par les Prussiens; il s’engagea pour la durée de la guerre et rallia la garnison de Neuf-Brisach. La place, écrasée d’obus, bientôt capitulait et il était interné en Saxe, dans la ville de Dresde. Aux souffrances de la captivité, il opposa son courage tranquille d’homme qui n’aime pas les gestes inutiles; il se ramassa et subit ce qu’il fallait subir. Un soir, chez Alphonse Daudet, il évoquait ces souvenirs lointains: pour toute nourriture, dans les premiers temps, la soupe au millet; les camarades et lui en blouse bleue, en sabots, «tout semblables aux facteurs ruraux l’été, — et cela pendant qu’il gelait à pierre fendre», et il concluait qu’au fond les prisonniers n’avaient pas eu à se plaindre des Allemands.
«Alors, on a été très aimable avec vous, lui dit ironiquement une dame qui attendait sans doute des plaintes de cet homme qui ne se plaint pas.
— Oh! madame, on n’est pas aimable avec vingt-cinq mille hommes.» (Journal des Goncourt.)
Carrière trouvait là-bas, paraît-il, le temps de travailler: j’ai pu voir un dessin, assez banal d’ailleurs, une composition centrale entre deux épisodes de la guerre de Vendée, qui porte cette suscription: «Frontispice d’un futur ouvrage d’un futur écrivain qui partage ma captivité. Décembre 1870.» Un hasard lui permit de visiter l’admirable musée de Dresde, mais trop vite: de tant de chefs-d’œuvre, dont les Rembrandt que l’on sait, il n’emportait qu’une image, celle de la madone de Saint-Sixte, que le génie de Raphaël, par le balancement de deux lignes, enlève d’un si noble élan.
La guerre avait reculé bien des choses dans le passé. Les longs mois de captivité écoulés, Carrière regagnait Strasbourg, y recevait bon accueil et, après avoir pris quelque repos auprès des siens, revenait à Paris mener la dure vie qu’il avait choisie. Élève de l’École des Beaux-Arts, il appartenait à l’atelier de Cabanel, qui semble avoir eu le rare mérite d’aimer l’originalité chez les autres et de ne pas porter atteinte à celle de ses élèves. Carrière n’était pas, à l’École, un rapin superbe, trouvant, dans la conscience de son génie, le dédain de la technique et des professeurs chargés de lui en transmettre la tradition. Élevé dans le respect des hommes officiels, dont la boutonnière fleurit, dont l’habit verdit, il se pliait à la discipline avec une parfaite bonne foi; il apportait aux exercices de l’École sa forte volonté et son sentiment du devoir. «Cette éducation me paraissait une chose sacrée devant me mener à un but, que je n’apercevais pas mais qui me semblait fatalement supérieur.» Plus tard il était tenté de croire «qu’il avait perdu beaucoup de temps dans cette maison», jugement qu’il corrigeait par l’aveu «que, tant que l’homme n’a pas pris conscience de lui-même, il ne peut faire que des choses neutres». Maintenons pour le principe qu’il est bon que l’artiste commence par le commencement, qu’ici ou là il apprenne son métier, et devienne le bon compagnon qu’avant tout il doit être.
En 1876, Carrière montait en loge, et il était classé le premier pour l’esquisse (Priam venant réclamer à Achille le corps d’Hector); mais son succès s’arrêtait là, et il quittait l’École comme il y était entré.
La même année, il exposait un portrait de sa mère, d’une facture un peu lourde, avec des sécheresses, des ombres dures, mais d’une sincérité touchante, qui montre de quel œil attentif il regardait la nature, avec quel scrupule il se laissait guider par elle, et aussi ce que déjà il savait exprimer de la vie intérieure.