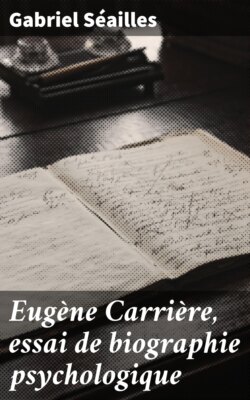Читать книгу Eugène Carrière, essai de biographie psychologique - Gabriel Seailles - Страница 7
II
ОглавлениеSix années s’étaient écoulées, il n’était pas plus avancé qu’au jour, déjà lointain, où il débarquait audacieusement à Paris; il était aussi inconnu, il n’avait pas plus de relations ni de ressources, il lui fallait comme alors gagner le pain qui permettait à l’artiste de vivre. Il restait debout, portant allègrement le poids de ce double labeur; la vie ne lui faisait pas peur, il en abordait les difficultés l’une après l’autre, il triomphait de l’heure présente sans s’effrayer de l’avenir: à chaque jour suffit sa peine.
En 1877, avec la vaillance tranquille de l’homme qui a des réserves de courage, et «qui consent à la vie», il associait à sa rude destinée la femme, dont l’image est si intimement mêlée à son art, si inséparable de sa pensée, qu’il semble qu’elle en soit née ou que, lui ayant été accordée par je ne sais quelle harmonie préétablie, il n’ait eu qu’à la reconnaître pour la choisir.
Après son mariage, une chimérique espérance le conduisit à Londres. Il ne connaissait personne, il ignorait la langue; il arrivait là avec l’impuissance à se défendre d’un sourd-muet. C’était tenter le sort: la misère vint, et il n’était plus seul. Il ne s’abandonna pas; comme toujours, il se ramassa pour la résistance, et là même, dans cette ville sans limites, «où le silence des foules lui donnait un sentiment d’effroi», il fit le miracle de vivre.
«Dans sa débine, contait-il à de Goncourt, il s’était avisé de faire quelques dessins de femmes et d’amours, — des réminiscences de l’École des Beaux-Arts — et les avait portés dans la semaine qui précédait Noël à un journal illustré. Les dessins avaient plu au directeur, qui lui en avait demandé deux, et le lendemain, avec les quelques livres qu’il recevait, il courait de suite à une taverne mettre un peu de viande dans son estomac. Le directeur s’éprenait de lui et l’invitait quelquefois à dîner, et le retenait à causer, à regarder des images et des bibelots, si bien que tout à coup, ses yeux tombant sur la pendule, il s’écriait:
«Ah! vraiment, je vous ai fait rester trop tard, vous ne trouverez plus d’omnibus.»
Et l’Anglais demeurait au diable de Crystal-Palace, près duquel gîtait Carrière, qui répondait imperturbablement:
«Oh! je prendrai un cab à la petite place de voitures qui est à côté.»
Et il revenait à pied et rentrait chez lui, tant c’était loin, à quatre heures du matin.
«Ce qui m’a sauvé, jette-t-il en manière de péroraison, c’est qu’il y avait chez moi, dans ma jeunesse, beaucoup d’animalité, de force animale.»
Carrière a raison, mais de cette force animale, le tout est de faire la matière d’une énergie vraiment humaine.
Voici en quels termes il résume ses souvenirs de Londres:
«De 1877 à 1878, j’avais passé six mois à Londres; sans relations, je m’étais tiré d’affaire; j’avais dépensé une énergie excessive; toujours vivant seul, je passais mon temps à travailler et à penser; il me restait Turner dans l’esprit.»
De retour à Paris, «la vie et moi, nous reprenions notre cours, l’une dure, l’autre obstiné ». Installé dans une petite maison de banlieue, à Vaugirard, il travaillait tout le jour et, bien souvent, une partie de la nuit. Dans les vieux papiers, auxquels j’ai fait allusion déjà, j’ai retrouvé les témoignages de ce labeur acharné : des vignettes, des illustrations, des réclames pour le magasin du Printemps, des menus, des dessins de mobilier ou d’architecture, parfois une composition ingénieuse; dès que l’enfant apparaît, son dessin prend quelque chose d’original et d’ému. Il travailla pour un céramiste, décora des plats, de têtes de femmes et d’enfants; il peignit au vernis Martin, pour un marchand de meubles, des fêtes galantes, parfois des scènes qu’il imaginait. A ceux qui seraient tentés de le plaindre, Carrière répondrait sans doute, comme Turner, qui avait connu les mêmes épreuves: «Je ne me plains pas, c’était un excellent exercice». Son travail de peintre était son loisir; «dans cette existence de forçat», il n’oubliait pas ce qui d’abord la lui avait fait affronter: il avait achevé pour le Salon un tableau, une Jeune mère allaitant son enfant. Enfermé chez lui, sans distraction, Carrière était amené à voir les choses passionnantes, que tant d’autres ne songent pas à regarder: sa femme, son enfant, leurs gestes de tendresse, leur émoi charmant, et dans le cercle étroit, où tenait tout ce qu’il aimait, il découvrait un monde que tous croyaient connaître et dont il apportait comme une expérience nouvelle. Le tableau, auquel étaient confiées de si chères espérances, fut relégué dans des hauteurs où il était invisible. Bien des yeux se levèrent vers lui, personne ne le vit: il était placé au-dessus d’un grand portrait qui valut à son auteur la médaille d’honneur, «une partie se perdait dans le vélum et l’autre servait de tache sobre au coloriste Duran». Le tableau voyagea, on le vit en diverses villes de France; enfin en 1883, il obtenait une médaille de vermeil à l’Exposition d’Avignon, et il était acheté huit cents francs pour le musée de cette ville aimable, qui possède quelques œuvres de premier ordre.
Si Carrière ne perdait pas courage, c’est qu’il était soutenu par la joie, par l’espèce d’ivresse qu’il trouvait dans le travail même; c’est aussi qu’il se sentait grandir, que, sans avoir besoin du témoignage des autres, il avait conscience du progrès continu qui l’approchait lentement du but vers lequel, dès l’enfance, avant même de s’en rendre compte, il avait tendu. Peu à peu, il arrivait à savoir ce qu’il voulait, il faisait sortir son langage de sa pensée, de la ferme volonté de l’exprimer sans altération ni surcharge. En 1884, il exposait un Portrait d’enfant avec un chien: son tableau était vu et lui méritait enfin une mention honorable. C’était bien peu, mais son long effort silencieux l’avait préparé aux œuvres décisives, qui allaient forcer l’attention des artistes, et, en dépit des étonnements et des résistances, imposer son nom à l’indifférence du public. En 1885, l’Enfant malade, applaudi par les uns, contesté par les autres, remarqué, critiqué par tous, obtenait une médaille, et, non sans difficulté d’ailleurs, était acquis par l’État pour la somme de dix-huit cents francs. Carrière était presque joyeux: il avait travaillé de longs mois sur cette grande toile, mais il sortait enfin du silence et de la solitude, il avait eu du succès, il se voyait libéré des tâches ingrates qui lui volaient son temps; «un créancier cruellement idiot me prit la somme presque tout entière en paiement d’une dette que j’avais follement contractée pour un autre». La même année, au mois de septembre, un grand deuil entrait dans la maison: le second de ses enfants, un petit garçon de six ans, était enlevé en quelques jours par le croup.
Il y avait de quoi lasser un moins ferme courage, Carrière reçut, dans le recueillement, la grande leçon de la douleur, intimement mêlée désormais à sa vision et à sa pensée. Mais, sans s’attarder à de vaines plaintes, il rechargea le fardeau sur sa vigoureuse épaule, et, comme le bon ouvrier qui, d’un coup de reins, l’ajuste au mieux de l’effort, il se remit en marche. L’année suivante, il donnait, avec un portrait de jeune homme, le Premier voile, vaste toile, qui rassurait les amis inconnus qu’avait faits au peintre l’Enfant malade, et qui justifiait le style de l’artiste de manière irrécusable, par un chef-d’œuvre. Mais, pour mener à bien cette entreprise, il avait fallu du courage encore, des privations pour tous, la patience héroïque de la mère, dont le visage grave et charmant dans le tableau même disait assez les longues attentes, la lassitude commencée. Cette toile de grande dimension ne pouvait être achetée que par l’État: un tel effort valait bien un encouragement. Ce chef-d’œuvre, après de longues instances, fut acquis pour la modeste somme de douze cents francs, et quand l’artiste se présenta pour la toucher, on lui apprit qu’elle lui était allouée sur la caisse des secours et qu’il la recevrait par fragments de cent cinquante francs tous les trois mois. «Il toucha ces acomptes avec de pauvres vieilles qui venaient chercher leur aumône de l’État.»
Cependant les faits, qu’avait posés son énergique vouloir, amenaient leurs conséquences. Parce qu’il ne les avait pas subies, les lois des choses conspiraient à ses desseins; il était plus avancé qu’il ne le croyait lui-même. Des amis venaient à ce solitaire: Roger Marx, qui avait su voir la Jeune mère de 1879, qui le premier avait cherché l’artiste inconnu pour lui dire sa sympathie et l’avait publiquement défendu; Maurice Hamel, le lettré délicat; Jean Dolent,
«l’amoureux d’art» ; Galimard, l’amateur éclairé ; le critique d’art, Gustave Geffroy; le peintre Benjamin Constant qui, dès l’apparition de l’Enfant malade, sans souci des rivalités serviles, avait pris en main la cause du nouveau venu avec un véritable enthousiasme. En 1887, Carrière exposait le très beau portrait du sculpteur Devillez, qui consacrait ses succès antérieurs et lui valait une seconde médaille. Il avait convaincu les artistes, il lui restait à persuader le public.
Je n’ai pas oublié notre première rencontre. Sur l’instance d’un ami, beaucoup par surprise, j’avais accepté de faire un Salon. Cormon, le peintre nerveux des Fils de Caïn, me dit: «Allez chez Carrière, il a une très belle étude de nu.» Le jour déjà tombait, un de ces jours d’avril, où le printemps ressemble tant à une fête donnée aux hommes, qu’il est difficile de croire à l’indifférence des choses; une sérénité descendait dans la lumière apaisée. J’arrivai à l’impasse Hélène; les enfants jouaient dans la cour, la fille aînée gentiment m’indiqua le tout petit pavillon qu’habitait la famille. Carrière était absent, mais sa femme me reçut, et, me conduisant à l’atelier, me montra avec une simplicité touchante, après le tableau déjà dans son cadre, les études, les esquisses de son mari. Je venais de parcourir bien des ateliers: ceux de Montparnasse, ceux de Neuilly, de l’avenue de Villiers; dans beaucoup j’avais trouvé la comédie de la richesse, un luxe fripé de bazar oriental; nulle part je n’avais éprouvé l’émotion que j’éprouvais dans cet intérieur où rien ne mentait. Je comprenais mieux l’art de Carrière, le rapport du personnage à son milieu, ce que les choses ambiantes gardent de l’âme des hommes. Cette belle femme, que sacrait la noblesse d’une maternité prochaine, disait la droiture, la résignation, les vertus des simples et des forts. Tout en retournant les toiles, nous nous étions mis à causer, à les regarder ensemble, une sorte de confiance s’était établie entre nous; je lui disais que son mari était un artiste, que c’est un grand danger pour un peintre, qu’à coup sûr il serait reconnu un jour, mais que nul ne pouvait prédire ce jour. Je n’avais pas vu Carrière, j’étais désormais son ami. A peine formulée, ma prédiction se réalisait; la bataille était gagnée. En 1889, Carrière était proposé pour une médaille d’honneur et décoré ; les expositions du Champ de Mars, en groupant ses œuvres, les faisaient mieux comprendre; les artistes, les écrivains, ceux qui «n’arrivent» pas, ceux qui vivent par la pensée et pour elle, le saluaient comme un des leurs; les amateurs venaient à lui; le public, un peu déconcerté par sa vision, se laissait toucher par ce qu’il sentait d’humanité dans cet art où malgré tout il se reconnaissait. «Je me trouvai alors, dit-il lui-même, après une vie si obscure et silencieuse, en contact avec les hommes qui, dans ma toute jeunesse, m’avaient paru à jamais loin de moi. J’étais trop meurtri par la vie, déjà trop avancé en âge et trop spécialement façonné par l’isolement, pour pouvoir me fondre dans ce nouveau milieu, mais j’eus la satisfaction de me voir exprimer de la sympathie par des hommes dont je n’aurais pas osé l’espérer.»
Carrière sortait de cette longue épreuve fortement trempé, mais intact, sans colère, sans haine. Il n’avait jamais été le petit démocrate à la Werther, qui s’indigne que la société ne s’incline pas d’abord devant son génie, et qui prend les exigences de sa sensibilité maladive pour un droit aux caresses des sensations délicates que donnent le luxe et la richesse; pas un instant l’idée ne lui vint de jouer les gentilshommes de la palette; il resta ce qu’il avait été, l’ouvrier robuste, dont l’atelier ne dit que le travail; l’homme que nous voudrions appeler l’homme de demain, l’homme de cœur sain et de ferme raison, qui sait où est la vraie noblesse et qui s’y tient. Les épaules larges, Carrière portait, sur un cou fort, une tête puissante: le front haut, comme martelé, que dominaient et parfois recouvraient à demi les cheveux rebelles; les pommettes saillantes, le menton ferme modelaient le visage, où l’ossature affleurait, comme le roc perce la terre; enfoncés sous l’arcade sourcilière en relief, abrités par la paupière un peu lourde, les yeux petits, volontiers baissés, avaient, quand ils se fixaient, un regard d’une insoutenable ardeur, une flamme qui semblait entrer en tournant dans les êtres et les pénétrer; sous les moustaches courtes, la lèvre inférieure avançait en une moue, où se trahissaient les impatiences et les dédains de l’artiste. Cette tête exprimait d’abord la résolution; elle avait la construction solide d’une machine faite pour battre l’obstacle jusqu’à ce qu’il tombe; la mélancolie des jours passés, malgré tout, la voilait à demi; l’attention la transfigurait, mais rien ne valait la lumière dont l’éclairait le sourire de l’amitié.
Quand Carrière parlait de sa vie passée, c’était sans amertume, en homme qui applique son entendement aux choses mêmes qui le touchent; aussi bien, comme tous ceux qui sentent qu’ils ont une œuvre à faire et qui ne sera jamais achevée, il était plus occupé de l’avenir que du passé ; s’il s’arrêtait un instant sur la route, ce n’était pas pour se fatiguer du souvenir des fatigues d’autrefois, c’était pour reprendre les forces qui devaient le mener plus loin. Cédant aux sollicitations d’un ami, s’il se recueille et se tourne vers sa vie passée, il conclut: «Voilà, cher ami, la route parcourue; comme je ne voyageais pas seul, elle a été dure, mais elle a été ce qu’elle devait être. Ayant librement choisi, j’étais résigné au départ, les accidents du chemin ne m’ont pas découragé. Les ennuis matériels ne m’ont guère laissé de tristes souvenirs, et mon amour-propre social blessé ne me tourmente pas non plus; seules les vraies douleurs sont restées vives, parce qu’elles sont les seules qui aient pu m’atteindre... Ayant mis mon but très loin, je savais qu’il me faudrait beaucoup de temps pour y parvenir, je trouve tout cela très logique.» Comment ne pas associer à cette vie celle qui en fut vraiment la compagne, qui, par sa patience, par son labeur obscur, la rendit possible, y mit la grâce et la dignité ? Il aj oute: «Ma femme a été belle de dévouement passif et actif; elle fut un élément de force naturel qui soutient sans qu’on le sache, correspondant à notre équilibre».
Ce qui, plus que tout le reste, soutint Carrière et lui donna de la force pour aller plus loin, ce fut sa passion désintéressée pour l’art, sa foi à quelque chose de supérieur à lui-même, la conscience qu’il obéissait à sa destinée véritable; le sentiment religieux, si j’ose dire, qu’il travaillait à sa façon à l’œuvre impersonnelle qui reliait son effort à l’effort de l’humanité, et sa pensée à la pensée universelle. L’égoïste pressé de jouir, l’ambitieux qui ne veut que la réputation et les avantages qu’elle apporte, songe plus à plaire aux autres qu’à se satisfaire lui-même; il se diminue pour se mettre à la mesure de tous, il s’allège pour se faire porter par le flot. Pour Carrière, les événements sont des accidents extérieurs qui n’ont de sens que par leur rapport au progrès de son art et de sa pensée. Son dernier mot, quand il revient sur le passé, n’est pas pour parler de succès ni d’argent, mais de ce qu’il regarde comme les seules acquisitions véritables. «L’évolution de mon esprit se fit au milieu de tout cela, ajoutant une chose à une autre, amenant la découverte de lois qui se complétaient entre elles. Toujours je me refusai à donner dans mon œuvre une chose dont je n’étais pas très sûr; je répugnai à tromper par l’apparence d’une force que je ne possédais pas véritablement. Je compris un moment — lorsque accusé de faire toujours la même chose, — que changer signifiait grandir, et que mieux comprendre, ce serait aussi comprendre plus de choses. Je trouvai la correspondance des formes du paysage avec la figure, l’unité du principe des formes; j’en eus un grand bonheur. Je sentis ma conception s’élargir. Rien ne m’était plus étranger, et en voyant une chose, une forme, je sentais les autres s’y fondre en la complétant. Cette idée me dirigea et me dirige de plus en plus, elle me fit voir que tout avait été juste dans ma vie, et je me sentis plus de forces. Je compris que, si le public n’avait pas été prêt, c’est que je ne l’étais pas non plus, et que les choses fortes et simples veulent être dites fortement, que c’est long, très long, jamais abouti; je sais maintenant que la vie est une suite d’efforts continués par d’autres plus tard. Cette idée m’encourage, puisqu’elle laisse-tout en travail et en action, et que seule la pensée d’arriver à une fin est triste.»