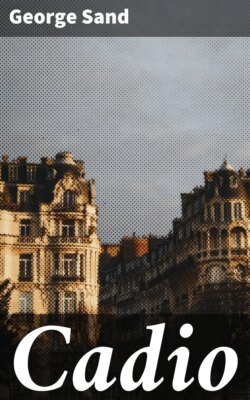Читать книгу Cadio - George Sand - Страница 7
PREMIÈRE PARTIE
ОглавлениеAu printemps, 1793.--Au château de Sauvières, en Vendée. 1--Un grand salon riche.--Une grande salle avec escalier au fond.
SCÈNE PREMIÈRE.--Le comte DE SAUVIÈRES, ROXANE, LOUISE, M. DE LA TESSONNIÈRE, MARIE HOCHE. La Tessonnière joue aux cartes avec Louise, le comte lit un journal, Roxane parfile, Marie brode.
Note 1: (retour) Les localités indiquées sont de pure convention.
LE COMTE. Non, ma soeur, non! on ne rétablira pas la monarchie avec une poignée de paysans.
ROXANE. Une poignée! ils sont déjà plus de vingt mille sous les armes.
LE COMTE. Fussent-ils cent mille, ils n'y pourront rien. Le roi n'est plus!--Louis XVI emporte notre dernier espoir dans sa tombe.
LOUISE. Il n'a pas même une tombe!
ROXANE. La royauté est immortelle. Le dauphin règne!
LE COMTE. Dans un cachot!
ROXANE. Délivrons-le! (Louise, émue, semble approuver sa tante. La Tessonnière donne des signes d'impatience quand elle se distrait de son jeu.)
LE COMTE. Le délivrer, pauvre enfant! Tenter cela serait le sûr moyen de hâter sa mort. Ah! les émigrés auront éternellement celle du roi sur la conscience!
ROXANE. Alors, vous ne voulez rien faire? C'est plus commode, mais c'est lâche! Ah! ma nièce, si nous étions des hommes, souffririons-nous ce qui se passe?
LE COMTE. Louise, réponds, mon enfant: que ferais-tu? (Louise baisse la tête et ne répond pas.) Ton silence semble me condamner... Pourtant... tu sais que j'ai pris des engagements...
LOUISE, (soupirant.) Je sais, mon père!
LA TESSONNIÈRE, (avec humeur.) Eh! vous mettez un valet sur un neuf, ça ne va pas. (Marie prend la place de Louise et continue la partie avec la Tessonnière.)
ROXANE, (à son frère.) Vos engagements, vos engagements! Il ne fallait pas les prendre.
LE COMTE. Je les ai pris; donc, ils existent. Vous-même m'avez approuvé quand j'ai juré de défendre notre district envers et contre tous, en acceptant le commandement de la garde nationale. (S'adressant à Louise.) Suis-je le seul qui ait agit de la sorte? n'était-ce pas le mot d'ordre de notre parti?
ROXANE. Le mot d'ordre, oui, à la condition de s'en moquer plus tard.
LE COMTE. Je n'ai pas accepté, moi, le sous-entendu de ce mot d'ordre.
ROXANE. Ah! tenez! si vous n'aviez pas fait vos preuves à l'armée du roi, du temps qu'il y avait un roi et une armée, je croirais que vous êtes un poltron! Oui, prenez-le comme vous voudrez... je dis un...
LOUISE. Ma tante!...
LE COMTE. Cela ne m'offense pas, mon enfant! Devant les arrêts de sa propre conscience, un homme peut trembler et reculer.
ROXANE. Ainsi vous reculez? c'est décidé? Heureusement, notre neveu Henri... Ah! celui-là,... ton fiancé, Louise, c'est l'espoir de la famille!
LOUISE. Vous croyez que Henri...?
MARIE. Oui, certes, M. Henri vous reviendra!
LE COMTE. Il le peut, lui! Enrôlé par force, pour échapper à la terrible liste des suspects, il a le droit de déserter.
LOUISE. Ah! vous l'approuveriez? En effet, ce serait son devoir! Espérons qu'il le comprendra. Quand il saura dans quelle situation vous vous trouvez, entre la bourgeoisie que vous êtes forcé de protéger, et les paysans qui menacent de se tourner contre vous, il accourra pour prendre un commandement dans l'armée vendéenne, et il vous fera respecter de tous les partis.
LE COMTE. Ma pauvre Louise, tu crois donc aussi, toi, au succès de l'insurrection?
LOUISE. Comment en douter quand on voit tout marcher à la guerre sainte, jusqu'aux prêtres, aux femmes et aux enfants? Que cet élan est beau, et comme le coeur s'élance vers cette croisade!...
ROXANE. Vive-Dieu, Louise! tu as raison: cela transporte, cela enivre! Il y a des moments où j'ai envie de prendre des pistolets, de chausser des éperons, de sauter sur un cheval, et de donner la chasse aux vilains de la province!
LE COMTE. Vous?
ROXANE. Oui, moi! moi qui vous parle, je sens bouillir dans mes veines le sang de ma race!
LE COMTE. Pauvre Roxane! Gardez un peu de cette vaillance pour les événements qui menacent, car je crains bien qu'au premier coup de fusil...
ROXANE. Vous ne me connaissez pas! je suis capable... (A Marie, lui mettant familièrement les mains sur les épaules.) N'est-ce pas, Marie? dites; mais j'oublie toujours que vous ne pensez pas comme nous!
MARIE. Oubliez-le, si cela vous fâche; je ne vous le rappellerai jamais!
LOUISE. On sait cela, bonne Marie! mais, au fond... (bas) tu approuves mon père?
MARIE, (aussi à voix basse.) Ce qu'il dit est si noble, ce qu'il pense si respectable!... (Louise rêve.)
MÉZIÈRES, (entrant.) Une lettre pour M. le comte.
LOUISE. D'Henri peut-être! Oui! (Donnant la lettre au comte.) Lisez vite, mon père!
MÉZIÈRES. Je voyais bien ça... au timbre!... Puis-je rester pour savoir...? (Louise fait un signe affirmatif.)
ROXANE, (au comte.) Il arrive, n'est-ce pas? Dites donc!
LE COMTE, (qui parcourt des yeux.) Il va bien, il va bien!...
MÉZIÈRES, (sortant.) Dieu soit béni! Ce cher enfant! il va bien! (Il sort.)
ROXANE, (au comte.) Mais vous avez l'air étonné?
LE COMTE, (donnant la lettre à Louise.) Oui. Il ne paraît pas avoir reçu nos lettres. Elles ont du être saisies.
ROXANE. Ou la prudence l'empêche de répondre clairement. Voyons! il faut deviner...
LE COMTE, (à Louise.) Il se montre enivré de joie d'avoir battu...
ROXANE. Battu!... Qu'est-ce qu'il a donc battu?...
LOUISE. Les Prussiens.
ROXANE. Les émigrés, par conséquent?... Eh bien, alors... Mais non, mais non! Il fait semblant! c'est très-adroit de sa part!...
LE COMTE, (qui lit avec Louise.) Il est officier.
LOUISE. Et il en est fier.
ROXANE. Il en est humilié, au contraire. Il faut prendre le contre-pied de tout ce qu'il dit. Il est très-fin, il est plein d'esprit, ce garçon-là!
LOUISE, (lui donnant la lettre.) Ma tante..., prenons-en notre parti, et ne nous faisons plus d'illusions: Henri nous abandonne... Cela ne m'étonne pas autant que vous. Il a toujours eu le caractère léger.
MARIE. Léger?... Mais non, chère Louise!
ROXANE, (lisant.) Ah! grand Dieu! comme il traite nos amis les étrangers! il est donc fou?... et quel ton! «Nous leur avons flanqué une frottée!» Frottée! ça y est! C'est donc un soudard, à présent? un enfant si bien élevé! «J'espère que ma tante Roxane sera fière de moi...» Compte là-dessus, vaurien! «Et que, pour fêter mon épaulette, elle mettra sa plus belle robe, sans oublier d'ajouter aux roses de son teint...» (jetant la lettre.) Polisson!
LOUISE, (ramassant la lettre.) Consolez-vous, ma tante, je ne suis guère mieux traitée. (Lisant.) «Je compte aussi que ma petite Louise se redressera de toute sa hauteur, et qu'elle attachera un noeud d'argent aux cheveux de sa poupée!» Il me fait l'honneur de croire que je joue encore à la poupée, c'est flatteur!
LE COMTE. Il oublie que deux ans se sont déjà écoulés depuis son départ.
LOUISE. Il oublie les malheurs de notre parti, il ne se dit pas que, chez nous, il n'y a plus d'enfants!
LE COMTE. Il est enfant lui-même: à vingt-deux ans!
ROXANE. Tant pis pour lui! Louise, j'espère que vous n'épouserez jamais ce monsieur-là?
LOUISE. Je n'ai jamais désiré l'épouser, ma tante, et, si mon père me laisse libre...
LE COMTE. Je ne te contraindrai jamais; mais tu avais de l'amitié pour lui malgré vos petites querelles. Il était si bon pour toi... et pour tout le monde!
LOUISE. De l'amitié..., c'est fort bien. Je lui rendrai la mienne, s'il revient de ses erreurs; mais faut-il se marier par amitié?
MARIE. Vous ne dites pas ce que vous pensez!
LOUISE. Si fait! A ce compte-là, pourquoi n'épouserais-je pas aussi bien M. de la Tessonnière?
LA TESSONNIÈRE. Hein? quoi?
ROXANE. Rien; continuez votre petit somme.
LA TESSONNIÈRE, (montrant les cartes.) Alors, la partie...?
LOUISE. Un peu plus tard, mon ami.
LA TESSONNIÈRE, (à Roxane.) Et vous..., vous ne voulez pas...?
ROXANE. Un peu plus tard, un peu plus tard; c'est l'heure de votre promenade.
LA TESSONNIÈRE. Vous croyez? Je n'aime guère à me promener seul; les paysans ont des figures si singulières à présent...
LE COMTE. Singulières? Pourquoi?
LA TESSONNIÈRE. Oui, oui... ils deviennent très-méchants!
ROXANE. Allons donc, allons donc! Allez-vous avoir peur, ici à présent? Vous irez dans le jardin, là, près des fenêtres.
MARIE. J'irai avec vous!
LA TESSONNIÈRE. Bien, bien! (Il sort avec Marie.)
LE COMTE. Qu'est-ce qu'il veut dire? De quoi a-t-il peur?
ROXANE. De tout! c'est son habitude, vous le savez bien, puisqu'il est venu s'installer chez nous à cause de ça.
LE COMTE. Il avait peur de ses paysans, qui lui en voulaient d'être poltron; mais les nôtres sont si doux, si tranquilles...
ROXANE. Ne vous y fiez pas, mon cher! Ils espèrent toujours que vous vous montrerez!... Mais voici les autres hôtes du château.
SCÈNE II.--Les Mêmes, le baron DE RABOISSON, le chevalier DE PRÉMOUILLARD
RABOISSON. Mesdames, je vous apporte des nouvelles.
ROXANE.--Ah! baron, ce mot-là me fait toujours trembler! Bonnes ou mauvaises, vos nouvelles?
RABOISSON. Bah! pourvu qu'elles soient nouvelles! ça désennuie toujours. L'insurrection vient nous trouver.
LOUISE. Enfin!
LE COMTE. Est-ce sérieux, Raboisson, ce que vous dites là? Comment savez-vous...?
RABOISSON. Mon valet de chambre arrive de la ville. Il n'y est bruit que de la marche de l'armée royale.
LE CHEVALIER. Malheureusement, c'est la douzième fois au moins que Puy-la-Guerche est en émoi pour rien.
LE COMTE. Vous dites malheureusement?
LE CHEVALIER. Oui, monsieur le comte. L'inaction à laquelle, par égard pour vous, nous nous sommes condamnés, commence à me peser plus que je ne puis dire. J'espère qu'en présence d'une force considérable telle qu'on l'annonce, vous ne conseillerez point à la garde nationale du district une résistance inutile... et désastreuse!
LE COMTE. Je prendrai conseil des circonstances, chevalier. Il faut d'abord savoir s'il s'agit ici d'une véritable armée commandée par des chefs raisonnables, auquel cas j'engagerai les gens de la ville à se soumettre; mais, si c'est un ramassis de bandits sans ordre et sans mandat...
RABOISSON. J'ai envoyé à la découverte, nous saurons bientôt à quoi nous en tenir. Le bruit du moment est que cette troupe est commandée par Saint-Gueltas.
LE COMTE. Qui appelez-vous ainsi? Je ne me souviens pas...
RABOISSON. Eh! c'est le petit nom du fameux marquis!
LOUISE. Le marquis de la Roche-Brûlée? Ah! mon père, on le dit si cruel!... Soyez prudent!
ROXANE. Et on le dit invincible! Mon frère, ne vous y risquez pas.
LE COMTE. Je ferai mon devoir; si cet homme agit de son chef et sans ordre de la cour, je conseillerai et j'organiserai la résistance.
RABOISSON. Mais s'il est en règle?... et il y est, je vous en réponds... Saint-Gueltas est aussi prudent que hardi.
LOUISE. Vous le connaissez, monsieur de Raboisson?
RABOISSON. Je l'ai connu beaucoup dans sa jeunesse.
ROXANE. Il n'est donc plus jeune?
RABOISSON, (souriant.) Si fait! une quarantaine d'années, comme nous!
ROXANE. On le dit charmant!
RABOISSON. Au contraire, il est laid, mais il plaît aux femmes.
LOUISE, (ingénument.) Pourquoi?
RABOISSON, (embarrassé.) Parce que... parce qu'il est laid, je ne vois pas d'autre raison.
ROXANE, (bas, à Raboisson.) Et parce qu'il les aime, n'est-ce pas?
RABOISSON, (de même.) Chut! il les adore!
ROXANE. Alors, c'est un héros! comme César, comme le maréchal de Saxe!
LE COMTE, qui a parlé avec le chevalier. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de ne pas courir au-devant de l'insurrection. Ce serait m'exposer à des soupçons... Si elle vous entraîne et vous emporte en passant, je n'aurai de comptes à rendre à personne; mais n'oubliez pas qu'en vous donnant asile chez moi dans ces jours de persécution, j'ai répondu de vous sur mon propre honneur.
LE CHEVALIER. Je ne l'oublierai pas, monsieur.
RABOISSON. Quant à moi, mon cher comte, il y a une circonstance qui me rendra aussi sage que vous pouvez le désirer: c'est que l'insurrection est fomentée par les prêtres; or, je ne suis pas de ce côté-là: voltairien j'ai vécu, voltairien je mourrai.
LE CHEVALIER. Il n'y a pas de quoi se vanter, monsieur!
RABOISSON. Pardonnez-moi, jeune homme! Libre à vous de donner dans les idées contraires. Élevé pour l'Église, vous étiez abbé l'an passé. La mort de vos aînés vous remet l'épée au flanc, et vous êtes impatient de la tirer pour la cause que vous croyez sainte; mais, moi, j'aime la ligne droite et ne veux pas faire les affaires du fanatisme sous prétexte de faire celles de la monarchie.
LE CHEVALIER. Pourtant, monsieur...
ROXANE. Ah! mon Dieu! allez-vous encore vous quereller? C'est bien le moment! Parlez-nous plutôt du charmant Saint-Gueltas...
MÉZIÈRES, (entrant.) Monsieur le comte, il y a là M. Le Moreau, municipal de Puy-la-Guerche, avec M. Rebec, son adjoint..., celui qui est aubergiste à présent, votre ancien marchand de laines.
ROXANE. Fripon sous toutes les formes! (Au comte.) Est-ce que vous allez recevoir ces gens-là?
LE COMTE, (à Mézières.) Faites entrer. (Mézières sort. A sa soeur.) Le Moreau est un très-galant homme.
ROXANE. Ça? un abominable suppôt de la gironde, qui a approuvé le meurtre du roi?
LE COMTE. Ma soeur, soyez calme.
ROXANE. Non! je suis indignée!
LOUISE. Alors, ne restez pas ici.--Venez, ma tante.
ROXANE. Oui, oui, sortons! J'étouffe de rage! Mon frère, vous êtes un tiède, un... (Louise lui ferme la bouche par un baiser.) Tiens, sans toi, je crois que je deviendrais fratricide! (Elles sortent.)
RABOISSON. Devons-nous rester?
LE COMTE. Vous, certes; mais le chevalier est vif...
RABOISSON. Et jeune!
LE CHEVALIER, (au comte.) Je me retire, monsieur. (Il sort.)
SCÈNE III.--LE COMTE, RABOISSON, LE MOREAU, REBEC.
REBEC, (obséquieux, avec de grands saluts.) Nous nous sommes permis...
LE COMTE. Soyez les bienvenus, messieurs. Qu'y a-t-il pour votre service?
REBEC, (ému.) Voilà ce que c'est, citoyen comte. Les brigands sont à nos portes.
LE COMTE, (incrédule.) A vos portes?
REBEC. On a signalé l'apparition de plusieurs bandes éparses dans les bois, et même très-près d'ici on a trouvé des traces de bivac.
RABOISSON. On est sûr que c'étaient des brigands?
REBEC. Oui, citoyen baron, des paysans révoltés contre le tirage.
LE COMTE. Ont-ils fait quelque dégât?
REBEC. Aucun encore; mais...
LE COMTE. Vous vous pressez peut-être beaucoup de les traiter de brigands!
REBEC. Ah! dame! si M. le comte croit qu'ils n'en veulent pas à nos personnes et à nos biens..., c'est possible! moi, j'ignore... (Bas, à Le Moreau, qui se tient digne et froid, observant avec sévérité le comte et Raboisson.) Il ne faudrait pas le fâcher! (Haut.) Moi, j'ai des opinions modérées... J'ai toujours été dévoué à la famille de Sauvières.
LE COMTE, (avec un peu de hauteur.)--Il est blessé de l'examen que lui fait subir Le Moreau. Ma famille a toujours su reconnaître les preuves de respect et de fidélité; mais je vous sais alarmiste, monsieur Rebec, et je voudrais être sérieusement renseigné. Pourquoi M. Le Moreau garde-t-il le silence?
LE MOREAU, (prenant un siége et faisant sentir qu'on ne lui a pas encore dit de s'asseoir.) Monsieur le comte ne m'a pas encore fait l'honneur de m'interroger.
LE COMTE, (lui faisant signe de s'asseoir.) Veuillez parler, monsieur.
LE MOREAU. Je ne suis pas aussi persuadé que M. Rebec de l'approche de ces bandes; mais la population s'en émeut, et il faut la rassurer. Les paysans des districts voisins, gagnés par l'exemple des districts plus éloignés, commencent eux-mêmes à commettre des actes de brigandage, on n'en peut plus douter. La loi du recrutement est dure pour eux, j'en conviens, et ils n'en comprennent pas la nécessité; des suggestions coupables, des intrigues perverses que je n'ai pas besoin de vous signaler...
RABOISSON. Quant à cela, je ne vous dirai pas le contraire. Le clergé des campagnes...
LE COMTE. Ne parlons pas du clergé, je le respecte.
LE MOREAU. Je le respecte aussi, quand il ne prêche pas la guerre civile.
LE COMTE. La guerre civile! en sommes-nous là, bon Dieu?
LE MOREAU. Oui, monsieur, nous en sommes là, et, si vous l'ignorez, vous vous faites d'étranges illusions.
LE COMTE. Le peuple n'en veut qu'aux jacobins, messieurs, et Dieu merci, il n'y en a pas dans notre district.
LE MOREAU. Du moins, il y en a peu; mais, en revanche, il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme moi.
LE COMTE. Nous pensons tous de même; nous voulons tous la fin des fureurs démagogiques.
LE MOREAU. C'est pour cela, monsieur le comte, que nous devons réprimer toutes les démagogies, de quelque titre qu'elles se parent. Venez commander nos gardes nationaux, et, s'il est vrai que le torrent se dirige de notre côté, il passera auprès de notre ville sans oser la traverser.
REBEC. Autrement, ils feront ce qu'ils ont fait à Bois-Berthaud, ils dévasteront tout. Ils pilleront les auberges, ils gaspilleront les provisions de bouche...
LE MOREAU. Et, chose plus grave, ils insulteront nos femmes et menaceront nos enfants! Hâtez-vous, monsieur. Si les nouvelles sont exactes, ils ont fait ce matin le ravage au hameau du Jardier, à six lieues d'ici; ils peuvent être chez nous ce soir!
LE COMTE. Mais ce ne sont pas des gens de nos environs. Qui sont-ils? d'où viennent-ils?
LE MOREAU, (méfiant.) Vous l'ignorez, monsieur le comte?
LE COMTE, (blessé.) Apparemment, puisque je le demande.
LE MOREAU. Ils viennent du bas Poitou.
RABOISSON. Et ils sont commandés...?
LE MOREAU. Par le ci-devant marquis de la Roche-Brûlée, un homme perdu de dettes et de débauches.
RABOISSON. Vous êtes sévère pour lui... Il vaut peut-être mieux que sa réputation.
LE MOREAU. Si vous le connaissez, monsieur, et que nous soyons réduits à capituler, vous nous viendrez en aide, et, en nous servant d'intermédiaire, vous n'oublierez pas la confiance que les autorités de Puy-la-Guerche ont cru pouvoir vous témoigner; mais nous commencerons par nous bien défendre, je vous en avertis, et j'imagine que M. le commandant de notre garde civique ne nous abandonnera pas dans le danger.
LE COMTE. Le doute m'offense, monsieur. Laissez-moi le temps de donner chez moi quelques ordres, et je vous suis. (A Raboisson.) Venez, baron, c'est à vous que je veux confier la garde du château en mon absence. (Ils sortent.)
SCÈNE IV.--LE MOREAU, REBEC.
REBEC. Eh bien, il a tout de même l'air de vouloir faire son devoir, le grand gentilhomme! Avez-vous vu comme il hésitait au commencement? Sans moi, qui lui ai dit son fait...
LE MOREAU. Il hésitera encore, il faut le surveiller. Honnête homme, timoré et humain, mais irrésolu et royaliste. Ces gens-là sont bien embarrassés, croyez-moi, quand ils essayent de faire alliance avec nous. Nous nous flattons quelquefois de les avoir assez compromis pour qu'ils soient forcés de rompre avec leur parti; mais, le jour où ils peuvent nous fausser compagnie, ils s'en tirent en disant que nous leur avons mis le couteau sur la gorge.
REBEC. Bah! bah! celui-ci, nous le tiendrons, c'est-à-dire... (regardant par une fenêtre) vous le tiendrez! Moi, je...
LE MOREAU. Où allez-vous?
REBEC. Je vais sur le chemin surveiller l'arrivée de mes denrées.
LE MOREAU. Quelles denrées?
REBEC. Eh bien, mes approvisionnements, mes bestiaux, mes lits, mon linge, et mes deux servantes que je ne suis pas d'avis d'abandonner aux hasards d'une jacquerie!
LE MOREAU. Vous prenez vos précautions; mais où menez-vous tout cela?
REBEC. Tiens! ici, pardieu!
LE MOREAU. Ici?
REBEC. Et où donc mieux? Je ne suis pas le seul qui vienne se mettre à l'abri du pillage derrière les mâchicoulis du ci-devant seigneur de la province. Mes voisins de la grand'rue et ceux du Vieux-Marché aussi, enfin tous ceux qui ont quelque chose à perdre, nous sommes une douzaine, avec nos charrettes, nos bêtes et nos gens, qui avons résolu de nous retrancher céans, que la chose plaise ou non à M. le comte. Nous avons fait la part du feu, et nous sauvons le meilleur dans les caves et greniers de la féodalité. Il faut bien que ça nous serve à quelque chose, les châteaux que nous avons laissés debout!
LE MOREAU. Vous êtes fous! Si M. de Sauvières nous trahissait...
REBEC. Raison de plus, c'est prévu, ça! S'il ne se conduit pas bien à la ville, s'il tourne casaque, comme on dit, nous lui fermons au nez les portes de son manoir, nous gardons ses dames et ses hôtes comme otages. Les murs sont bons, ici, beaucoup meilleurs que l'enceinte délabrée de Puy-la-Guerche, et, quand il s'agit de soutenir un siége, vive une petite forteresse bien située comme celle-ci! Ah! voilà mon convoi! Je cours...
SCÈNE V.--Les Mêmes, ROXANE, LOUISE, MARIE.
ROXANE, (sans répondre aux courbettes de Rebec.) Qu'est-ce qui se passe? La cour du donjon est encombrée, la population de la ville reflue ici, et c'est vous, messieurs, qui nous valez cet embarras et ce danger? Croyez-vous que nous n'ayons d'autre affaire que de défendre vos ânes crottés, vos charretées de fromage et vos vieilles hardes?
REBEC, (à Le Moreau, bas.) Diable! elle n'est pas polie, la vieille!
LE MOREAU, (à Roxane.) Madame, je n'ai pas encouragé cette panique ridicule. Je ne l'approuve pas. Je vais essayer de la faire cesser. (Il salue et sort avec dignité.)
ROXANE, (à Rebec.) Celui-ci, à la bonne heure! mais vous, monsieur l'aubergiste,... c'est-à-dire toi, l'ancien brocanteur, si heureux autrefois de te chauffer au feu de nos cuisines...
REBEC. Madame, je suis citoyen et adjoint à la municipalité... Parvenu par mon mérite, je ne rougis pas de mes antécédents.
ROXANE. En attendant, monsieur l'adjoint, vous allez déguerpir de céans et remporter vos guenilles.
LOUISE, (bas, à Rebec.) Laissez dire ma tante. Elle est vive, mais très-bonne. D'ailleurs, mon père, qui n'a jamais refusé l'hospitalité à personne, vient d'ordonner que la cour fortifiée et le donjon fussent ouverts à quiconque voudrait s'y réfugier, et tant qu'il y aura de la place...
REBEC. Merci, aimable citoyenne et noble châtelaine; vous avez bien mérité de la patrie, et le donjon est bon! Merci pour le donjon! Je vais, avec votre permission, y installer mon petit avoir.
LOUISE. Allez, monsieur Rebec. (Il sort.)
ROXANE. Ah! Louise, toi aussi, tu ménages ces animaux-là?
LOUISE. Il le faut, ma tante; je ne vois pas sans crainte mon pauvre père s'en aller à la ville avec eux. Pour un soupçon, ils peuvent le garder prisonnier, le dénoncer à leur affreux tribunal révolutionnaire...
ROXANE. Il n'aurait que ce qu'il mérite!
LOUISE et MARIE. Ah! que dites-vous là!
ROXANE. C'est vrai, j'ai tort! Je ne sais ce que je dis, j'ai la tête perdue!
MARIE. Il faut pourtant montrer un peu de courage! Vous aviez tant promis d'en avoir!
ROXANE. J'en ai; oui, je me sens un courage de lion, si vraiment le marquis Saint-Gueltas est à la tête de ces bandes! Un homme du monde, galant, à ce qu'on dit!--Mais, si ce sont des paysans sans chef, des enfants perdus, des désespérés,... s'ils mettent le feu partout,... s'ils outragent les femmes... Et mon frère qui nous quitte!
MARIE. Pour quelques heures peut-être; s'il apprend à la ville que c'est encore une panique....
ROXANE. Qui sait ce que c'est? Ah! je me sens toute défaite. Je n'ai pas pris ma crème aujourd'hui.--L'ai-je prise? Je ne sais où j'en suis!
MARIE. Vous ne l'avez pas prise, et c'est l'heure. (Elle va pour sonner.) Mais voici la petite Bretonne qui vous l'apporte. Elle est exacte.
SCÈNE VI.--Les Mêmes, LA KORIGANE.
LA KORIGANE. Est-ce que vous vous impatientez? (Elle présente un bol de crème à Roxane.)
ROXANE. Non, non, petite, c'est fort bien. (Elle boit.) Elle est délicieuse, ta crème. Ah! ma pauvre enfant, nous voilà bien en peine! Tu n'as pas peur, toi?
LA KORIGANE. Moi, peur? Et de quoi donc, mamselle?
LOUISE. Des brigands!
LA KORIGANE. Oh! ça me connaît, moi, les brigands! c'est tout du monde comme moi!
ROXANE. Comme toi? Ah ça! où donc les as-tu connus?
LA KORIGANE. Oh! dame! dans tout le bas pays. Vous savez bien que j'ai pas mal roulé de ferme en ferme et de château en château avant que d'entrer chez vous. Vous m'avez prise parce que votre cousine, chez qui j'étais en dernier, vous a envoyé des vaches brettes et moi par-dessus le marché, comme le chien qu'on vend avec le troupeau. Elle ne tenait pas à moi,--pas plus que moi à elle!--Elle m'a dit comme ça: «Tu es mauvaise tête, tu ne souffres pas les reproches; mais tu sais soigner les bêtes, et je vais t'envoyer avec les tiennes chez des dames très-riches et très-douces.» Moi, j'ai dit: «Ça me va, de m'en aller. J'aime à changer d'endroit, je ne restais chez vous qu'à cause des vaches.» Et pour lors...
ROXANE. C'est bon, c'est bon, caquet bon bec! tu nous raconteras tes histoires un autre jour. Remporte ta tasse.
LOUISE. Permettez, ma tante, elle a peut-être vu chez notre cousine du Rozeray...
ROXANE. Eh! au fait!... elle recevait tous les chefs, la cousine!... Oui, oui. Dis-nous, Korigane..., est-ce que tu as entendu parler là-bas d'un personnage,... un certain marquis?...
LA KORIGANE. Un marquis! c'est Saint-Gueltas que vous voulez dire?
ROXANE. Justement! M. de la Roche-Brûlée. Tu l'as vu?
LA KORIGANE. Si je l'ai vu! vous me demandez si je l'ai vu?
ROXANE. Eh bien, sans doute; est-ce que tu ne te souviens pas?
LOUISE. Tu ne réponds pas, toi qui n'as pas l'habitude de rester court! (A Roxane.) Elle a oublié.
LA KORIGANE, exaltée. Oublier Saint-Gueltas, moi! Mamselle Louise, si vous voyez jamais cet homme-là quand ça ne serait qu'une petite fois et pour un moment, vous saurez qu'on ne l'oublie plus, quand même on vivrait cent ans après.
ROXANE. Ah! oui-da! tu me donnes envie de le voir.
LA KORIGANE, (à Louise, la regardant fixement.) Et vous, vous êtes curieuse de le voir aussi?
LOUISE, (embarrassée.) De le voir?... Peu m'importe; mais on nous menace de son arrivée dans le pays, et je voudrais savoir si nous devons nous en réjouir ou... ou nous cacher?
LA KORIGANE, (emphatiquement, naïvement.) Pour la cause du bon Dieu et des bons prêtres, réjouissez-vous, mesdames! Si Saint-Gueltas vient ici avec ses bons gars du Poitou, de la Bretagne et de la Loire, car il y en a de tous les pays qui le suivent, comptez que la sainte Vierge est à leur tête, et que pas un républicain, pas un trahisseur, pas même un tiède, ne restera sur terre. Quand Saint-Gueltas passe quelque part, c'est rasé! c'est comme le feu du ciel!--Mais, pour votre sûreté à vous, mes petites femmes, cachez-vous; cachez vos jupons roses et vos cheveux poudrés, et cachez-les bien, car il sait dépister les jeunes comme les mûres, les villageoises en sabots comme les bourgeoises en souliers et les princesses en mules de satin! Oui, oui, cachez-moi tout ça, ou malheur à vous!
LOUISE, (à sa tante.) Elle parle comme une folle! elle me fait peur!
ROXANE. Et moi, elle m'amuse. (A la Korigane.) C'est très-drôle, tout ce que tu nous chantes là; mais explique-toi mieux. Il ne respecte donc rien, ton fameux marquis?
LA KORIGANE. Il n'a pas besoin de respecter ni de pourchasser; il regarde!... Oh! il vous regarde avec des yeux... C'est comme le serpent qui charme sa proie. Alors, qu'on veuille ou ne veuille pas, il faut penser à lui le restant de ses jours. Voilà ce que je vous dis, est-ce clair, mamselle Louise? (Louise, troublée, s'éloigne avec un air de dédain.)
MARIE, (calme, souriant, à la Korigane.) Parlez pour vous, ma chère enfant!
LA KORIGANE. Pour moi?
ROXANE. Pardine! on voit bien que tu es amoureuse de lui.
LA KORIGANE. Amoureuse? Je ne sais pas, demoiselle! Je n'ai que seize ans, moi, et j'ai déjà couru de pays en pays pour gagner ma pauvre vie. J'aurais dû en apprendre long. Eh bien, je n'en sais guère plus que ces demoiselles, puisque je ne sais pas si j'ai été amoureuse et si je le suis.
ROXANE. A la bonne heure! On t'a prise comme une fille innocente, et j'aime à voir que...
LA KORIGANE. Vous ne voyez rien! A l'âge de six ans, j'avais déjà un ami que je suivais partout: c'était un champi comme moi. Je l'appelais mon petit mari, et lui, il m'appelait sa petite soeur. Quand il a eu dix-huit ans et moi quatorze, on s'est fâché, parce que je lui disais: «Il faudra nous marier ensemble,» et que lui, il ne voulait ni amitié ni mariage. Il était devenu comme fou; son idée, qu'il disait, c'était d'être moine. Alors, la colère m'est montée aux yeux. Je lui ai jeté mes sabots à la tête, et je me suis sauvée du pays, pieds nus, toujours courant. Je n'avais ni amis ni parents; personne n'a couru après moi, et j'ai été ici et là, n'aimant personne et toujours en colère, toujours pensant à cet imbécile qui n'avait pas voulu m'aimer! J'y ai pensé jusqu'au jour où j'ai vu Saint-Gueltas. Alors, j'ai toujours pensé à Saint-Gueltas, et j'ai oublié l'autre.
ROXANE. Et Saint-Gueltas... a-t-il fait attention à toi?
LA KORIGANE. Je ne sais pas! Un jour, votre cousine du Rozeray m'a dit des sottises et des injustices; j'ai bien vu qu'elle était jalouse...
ROXANE. Allons donc, impertinente! tu voudrais nous faire croire que la comtesse...
LA KORIGANE. Oh! si vous vous fâchez, je ne dirai plus rien.
ROXANE. Si fait, parle encore; tu nous amuses, tu nous distrais.--Que regardes-tu, Marie? est-ce que mon frère?... Il a promis de ne pas partir sans nous voir.
MARIE, (à la fenêtre.) Il est là, mademoiselle. Je ne comprends pas... il donne des ordres... La cour du donjon est pleine de gens de la ville...
LOUISE. Et mon père fait fermer les grilles. Veut-il les retenir prisonniers?
ROXANE. Il fait bien, s'il fait cela. Ces drôles l'auront menacé! (A la Korigane.) Va voir ce qui se passe et reviens nous le dire.
LA KORIGANE, (à la fenêtre, sur laquelle elle grimpe.) Oh! je vas vous le dire tout de suite. Voilà d'un côté les républicains de la ville qui se cachent, et... dans l'autre cour, mon doux Jésus! c'est les gens du roi qui entrent! Je reconnais bien le drapeau.
ROXANE, (effrayée.) Les brigands! On va se battre, là, sous nos fenêtres!
LOUISE. Non, non, ils ne se verront même pas! Mon père vient ici avec un chef.
ROXANE. Ah! qui est-ce? le marquis?...
LA KORIGANE, (regardant.) Ça? c'est Mâcheballe, le général des braconniers du bas pays. Je n'en vois pas d'autre!
ROXANE. Mâcheballe, l'assassin, comme on l'appelle? Nous sommes perdus!
LA KORIGANE. Dame, s'il sait comment vous le traitez! Il vous croira tournée au bleu, et il n'est pas tendre, je ne vous dis que ça!
LOUISE. Taisez-vous, taisez-vous, le voici!
SCÈNE VII.--Les Mêmes, LE COMTE, MACHEBALLE et une douzaine de Paysans armés, dont le nombre augmente insensiblement et envahit le salon. Ce sont gens de diverses provinces et quelques Vendéens nouvellement recrutés par eux. LE CHEVALIER, LE BARON, LA TESSONNIÈRE, MÉZIÈRES, STOCK. Plusieurs Vendéens, un peu mieux habillés ou mieux armés que les autres et simulant une sorte d'état-major, entourent Mâcheballe. Ils ont le chapeau ou le mouchoir sur la figure.
LE COMTE, (à Mâcheballe, qu'il introduit.) Entrez ici, et parlez, monsieur, puisque vous vous présentez au nom du roi, et que vos pouvoirs sont en règle. J'écoute les paroles que vous m'apportez et que vous voulez me dire en présence de mes hôtes et de ma famille.
MACHEBALLE. Eh bien, monsieur le comte, voilà. Je ne suis pas grand parolier, moi, et la chose que j'ai à vous dire ne prendra pas le temps de réciter un chapelet. Je suis devant vous, moi, Pierre-Clément Coutureau, dit Mâcheballe, capitaine, commandant ou général, comme ça vous fera plaisir, je n'y tiens pas; j'ai ma bande de bons enfants, je la mène du mieux que je peux; si elle est contente de moi, ça suffit!
LES INSURGÉS. Oui, oui, vive le général!
MACHEBALLE. Vous voyez, ils veulent que je le sois! On verra ça plus tard, quand on sera organisé; pour le quart d'heure, faut se réunir et se compter. Et, depuis trois mois qu'on avance dans le pays, on a emmené, chemin faisant, tous les bons serviteurs de Dieu et de l'Église. On est donc déjà vingt-cinq mille, chaque corps marchant dans son chemin. On n'est chez vous qu'une cinquantaine; mais, autour de vous, dans les bois, il y a autant d'hommes que d'arbres, monsieur le comte! et faudrait pas nous mépriser parce qu'on vous paraît une poignée. On est venu ici en confiance...
LE COMTE. Il est inutile de menacer, monsieur; fussiez-vous seul, vous seriez en sûreté chez moi!
MACHEBALLE. Alors, monsieur le comte, vous allez, je pense, rassembler vos métayers, vos domestiques et tout le monde de votre paroisse, et vous viendrez avec nous, pas plus tard que tout à l'heure, donner l'assaut à la ville de Puy-la-Guerche?
LE COMTE. Non, monsieur, je ne le ferai pas, et je vous prie, je vous somme au besoin, de vous retirer du district où j'ai le devoir de commander la garde nationale.
MACHEBALLE, (riant.) Vous me sommez, au nom de quoi?
LE COMTE. Au nom du roi, monsieur.
MACHEBALLE. Comment donc que vous arrangez ça dans le pays d'ici?
LE COMTE. Dans le pays, on procède comme ailleurs au nom de la République; mais avec vous j'invoque la seule autorité légitime que je reconnaisse.
MACHEBALLE. Alors, comment que vous arrangez ça dans votre cervelle? (Les Vendéens rient.) Comment donc prétendez-vous, au nom du roi, m'empêcher de servir le roi?
LE COMTE. Chacun entend le service du roi à sa manière. Vous avez méconnu la sainteté de sa cause en commettant des excès, des cruautés sans exemple. J'ai fait honneur à ceux qui ont signé votre mandat en écoutant vos ouvertures, et, maintenant que je les ai entendues, je les repousse. La guerre que vous faites est un prétexte au pillage et aux vengeances personnelles. (Murmures des insurgés. Le comte élève la voix.) Elle me répugne, et je la condamne. Passez votre chemin. Quand un chef royaliste digne de ce nom paraîtra devant moi, je verrai à m'entendre avec lui, si je le puis sans trahir le mandat qui m'est confié. (Murmures des insurgés.)
MACHEBALLE, (irrité.) Par le saint ciboire! je ne sais pas comment je vous laisse dire tant de sacriléges! (Il met la main sur ses pistolets. Un de ses hommes passe devant lui, et le repousse en arrière en lui disant tout bas: «Assez! tais-toi. Laisse-moi faire!» Cet homme ôte son chapeau. La Korigane s'écrie: «Saint-Gueltas!» Louise, qui s'est élancée vers son père menacé, recule avec effroi. Roxane laisse aussi échapper une exclamation.)
SAINT-GUELTAS. Saint-Gueltas, marquis de la Roche-Brûlée. Il paraît que mon nom effraye les dames; mais vous, monsieur le comte, peut-être me ferez-vous l'honneur de m'agréer comme le chef sérieux d'une force considérable,... à moins que vous ne me jugiez indigne aussi de servir le roi? C'est possible, si vous proscrivez la peine de mort! Moi, j'avoue que je n'ai pas encore découvert le moyen de faire la guerre sans exposer sa vie et sans compromettre celle des autres.
MACHEBALLE. Bien parlé! (Il explique tout bas les paroles de Saint-Gueltas à quelques paysans bretons qui approchent.)
LE COMTE. Je sais, monsieur le marquis, le respect qui est dû à votre bravoure, à votre dévouement et à votre habileté; mais vos sarcasmes ne m'empêcheront pas de réprouver les atrocités de vos triomphes. Vous avez pu être débordé...
SAINT-GUELTAS, (baissant la voix et s'approchant de lui et des femmes.) Débordé! comment ne pas l'être dans une guerre de partisans comme celle que nous faisons? Nous manquons de chefs, monsieur le comte, et je ne puis être partout; mais nous commençons à nous organiser. Suivez le bon exemple, donnez-le à ceux qui hésitent encore, et nos paysans deviendront des soldats soumis à une discipline; c'est le devoir de tout bon royaliste et de tout brave gentilhomme.
LE COMTE. Devant de si sages paroles, je ne puis que regretter vivement les engagements que j'ai pris...
MACHEBALLE, bas, à Saint-Gueltas. Il vous refuse aussi?
SAINT-GUELTAS, (bas, à Mâcheballe.) Prenez patience. Je vous réponds de l'emmener! (Haut, au comte.) Puis-je au moins adresser mes offres aux personnes libres qui vous entourent? (Allant à Raboisson.) Voici un ami qui ne me reniera peut-être pas?
RABOISSON, (lui serrant la main.) Non certes; mais tu sers les prêtres, marquis, et, moi...
SAINT-GUELTAS. Je sais, je sais! (Il fait un signe à Mâcheballe, qui se retire au fond du salon et jusque dans la pièce du fond avec les Vendéens.) Mon cher baron, tu peux être tranquille. Je ne suis pas plus bigot que toi. Je n'ai pas changé! Nous nous servons du mysticisme des paysans; mais que les gens sages nous secondent, et nous remettrons à leur place MM. les ambitieux et les démagogues de la soutane.
RABOISSON, (bas.) Bien... Alors, je grille de te suivre, car je m'ennuie ici considérablement; mais comment faire?
LE CHEVALIER, (bas, à Saint-Gueltas.) Moi aussi, monsieur le marquis, je brûle de vous suivre; mais nous sommes ici en quelque sorte prisonniers sur parole.
SAINT-GUELTAS. C'est bien simple. Allez ce soir à Puy-la-Guerche, et laissez-vous faire prisonniers par moi.
LE CHEVALIER. Il vaudrait mieux vaincre les scrupules de M. de Sauvières et nous emmener tous ensemble.
RABOISSON. Oh! vous ne les vaincrez pas, ses scrupules!
LE CHEVALIER. A moins que sa fille ne nous aide! Elle pense bien, et elle a de l'ascendant sur lui.
SAINT-GUELTAS. Sa fille?... (Regardant Marie, qui est plus près de lui que Louise.) Est-ce cette aimable et douce figure, qui ressemble à un sourire de soleil dans la tempête?
RABOISSON. Non. Celle-ci est mademoiselle Hoche, une orpheline sans nom et sans avoir, recueillie par la famille. Elle pense mal, mais elle agit bien.
SAINT-GUELTAS. Qui est celui-ci? (Il montre Stock, qui s'est approché de lui avec hésitation.)
RABOISSON. Un sous-officier des gardes suisses échappé au massacre,... M. Stock!
SAINT-GUELTAS, (à Stock.) Ah!... Et comment avez-vous fait, monsieur Stock, pour survivre à la journée du 10 août?
STOCK, (accent étranger prononcé.) J'étais en garnison avec mon bataillon sur la Loire.
SAINT-GUELTAS. Je veux le croire; mais que faites-vous ici quand votre place est marquée depuis longtemps dans les rangs de ceux qui vengent la mort de vos frères?
STOCK, (avec dignité.) Je vous attendais, monsieur.
SAINT-GUELTAS, (lui tendant la main.) Voilà une belle et bonne réponse, monsieur Stock. Je vous enrôle, vous commanderez un détachement. (A Raboisson montrant la Tessonnière.) Et celui-ci?
RABOISSON, (bas.) Le plus grand poltron de la terre. Je te défie de le faire marcher.
SAINT-GUELTAS. Nous allons bien voir. (A la Tessonnière.) Monsieur est certainement des nôtres?
LA TESSONNIÈRE. Oh! moi, je suis trop vieux pour guerroyer.
SAINT-GUELTAS. Pas plus âgé que M. Stock?
LA TESSONNIÈRE. Ma religion me défend de verser le sang.
SAINT-GUELTAS. Eh bien, monsieur, vous êtes un serviteur inutile ici. Je vais vous employer, moi!
LA TESSONNIÈRE. A quoi donc, s'il vous plaît?
SAINT-GUELTAS. J'ai promis, en échange de plusieurs de mes braves tombés dans les mains des bleus, de rendre un nombre égal de transfuges de la République. Le nombre n'y est pas, vous le compléterez.
LA TESSONNIÈRE. Vous voulez me faire passer...? C'est m'envoyer à la guillotine!
SAINT-GUELTAS. C'est vous envoyer au ciel. Choisissez, ou de verser le sang des scélérats, ou de donner le vôtre à la bonne cause.
LA TESSONNIÈRE, (éperdu.) Je me battrai, monsieur, j'aime mieux me battre! (Raboisson rit.)
LE COMTE. Je ne sais si la chose est plaisante, mais je la trouve arbitraire et cruelle. Quels que soient les pouvoirs de M. le marquis, je proteste contre toute contrainte exercée dans ma maison.
LOUISE, (animée.) Je m'y oppose aussi! Monsieur est notre parent, le plus ancien de nos amis. Il est âgé, infirme. Brave ou non, je le respecte et je l'aime. Personne ne lui fera violence ou injure tant qu'il me restera un souffle de vie!
ROXANE, (bas, à Louise.) Le fait est qu'il agit ici un peu cavalièrement, le héros!
SAINT-GUELTAS, (allant à Louise, la regarde avec insolence et menace; tout à coup il se radoucit, et, avec une émotion toute sensuelle, il lui prend et lui baise la main.) La beauté d'un ange et la fierté d'une reine! Je vous rends les armes, mademoiselle de Sauvières! Attachez votre mouchoir à mon bras en guise d'écharpe, je me regarderai comme votre chevalier, et je sortirai d'ici sans emmener ceux que vous voulez garder.
LOUISE. Vous me faites des conditions, monsieur? J'ai ouï dire que les chevaliers n'en faisaient point aux dames.
SAINT-GUELTAS. Eh bien, exaucez une prière, ne refusez pas de me donner un brassard; c'est un encouragement dû à un homme qui sera peut-être mort dans deux heures; car je me bats, moi, de ma personne et corps à corps, tous les jours et deux fois plutôt qu'une. Voyons, un bon regard, une douce parole, un gage fraternel que j'emporterais au combat et qui serait sans doute bientôt rougi de mon sang... Que craignez-vous donc en me l'accordant? Ce n'est ni votre coeur ni votre main que je vous demande. Est-ce qu'un homme dans ma position peut songer à enchaîner le sort d'une femme? Nous ne nous marions plus, nous autres! nous n'avons plus ni intérêts domestiques, ni joies de famille; nous sommes des martyrs. Une femme de coeur comme vous doit nous comprendre, nous estimer et nous plaindre, et, quand nous ne lui demandons qu'une larme ou un sourire a-t-elle le droit de détourner les yeux avec terreur... ou dédain?
LOUISE, (émue.) Eh bien, monsieur, voici mon gage! (Saint-Gueltas s'agenouille pendant qu'elle le lui attache au bras.) Voyez-y la preuve de mon enthousiasme pour la foi de mes pères, dont vous êtes le champion. Il faut que cet enthousiasme soit immense pour me faire oublier que vos victoires ont été souillées par des crimes!
SAINT-GUELTAS, (bas, en se relevant.) Aimez-moi, adorable enfant, et je deviendrai miséricordieux! (Il s'éloigne.)
LA KORIGANE, (bas, à Louise stupéfaite et comme éperdue.) Ah! il vous a regardée... il vous a parlé bas... Et voilà que vous l'aimez?
LOUISE. Taisez-vous, laissez-moi!
LA KORIGANE, (jalouse.) Je vous dis que vous l'aimez, demoiselle. Ce sera tant pis pour vous, ça! (Louise se réfugie auprès de sa tante.)
RABOISSON, (à Saint-Gueltas.) La belle Louise n'a pas demandé grâce pour nous; j'espère que tu ne renonces pas à nous tirer d'ici?
SAINT-GUELTAS, (bas.) La belle Louise vient de condamner son père à nous suivre sur l'heure.
RABOISSON. Comment ça?
SAINT-GUELTAS. Parce que, pour emmener l'une, il me faut emmener l'autre. Comprends-tu?
RABOISSON. J'ai peur de comprendre! Es tu déjà épris de mademoiselle de Sauvières?
SAINT-GUELTAS. Comme un fou!
RABOISSON. Allons donc!
SAINT-GUELTAS. Quoi d'étonnant? L'amour naît d'un regard, et un regard, c'est la durée d'un éclair.
RABOISSON. Diable! tu as dit que tu ne te mariais pas, et pour cause! Mais cette fille est pure, son père est mon ami, et elle est fiancée à un jeune cousin...
SAINT-GUELTAS. Un cousin, c'est de rigueur. On le fera oublier!
RABOISSON. Il défendra ses droits.
SAINT-GUELTAS. Les armes à la main? Eh bien, on le tuera. Allons au plus pressé! (Il va au comte.) Monsieur de Sauvières, votre adorable fille m'a donné une bonne leçon. Je suis devenu un sauvage dans cette guerre sauvage; il faut pardonner à la rudesse de mes manières. Ces messieurs (montrant Stock, le chevalier et Raboisson) m'ont déjà fait grâce; ils viennent avec moi de leur plein gré.
LE COMTE. Alors, c'est de leur plein gré qu'ils me rangent sur la liste des traîtres et m'envoient à la mort?
RABOISSON. Nous prendrons de telles précautions, que vous ne serez pas compromis.
LE CHEVALIER. Moi, je rougis de ce que vient de dire M. de Sauvières!
LE COMTE. Monsieur...
LE CHEVALIER. Oui, monsieur, je ne comprends pas que vous persistiez dans votre fidélité à l'infâme République!
LE COMTE. L'infâme République?... Elle a guillotiné vos frères, je le sais; mais des hommes plus humains vous ont permis de trouver chez moi un refuge; c'est donc à des républicains que vous devez la vie. Il ne fallait pas accepter cela, car à présent vous ne pouvez pas l'oublier.
SAINT-GUELTAS, (bas, à Raboisson, pendant que le comte et le chevalier discutent vivement.) Trop de principes! cet homme-là n'est bon à rien.
RABOISSON. Laissons-le, emmène-nous de force.
SAINT-GUELTAS. Je ne veux ni ne peux le laisser! mes gens s'impatientent...
MACHEBALLE, (qui s'est approché, à Saint-Gueltas.) Eh bien, mille tonnerres du diable! ça va-t-il bientôt finir, tout ça?
SAINT-GUELTAS. Il faut employer les grands moyens. Nos camarades arrivent-ils?
MACHEBALLE. Ils sont là, dans la cour.
SAINT-GUELTAS. Qu'ils montent l'escalier! et n'oublie pas l'homme habillé de toile.
MACHEBALLE. N'ayez peur! (Il sort.)
ROXANE, (approchant de Saint-Gueltas.) Mon frère est un trembleur, ma nièce une enfant qui s'est fait prier pour un simple mouchoir! Moi, je vous broderai une écharpe de satin blanc avec des fleurs de lis en or.
SAINT-GUELTAS. De l'or sur nos vêtements? Il en faudrait bien plutôt dans nos caisses, madame!
ROXANE. Je suis demoiselle, monsieur!
SAINT-GUELTAS. Alors, pardon! Vous ne pouvez rien pour nous.
ROXANE. Si fait! je suis majeure!
SAINT-GUELTAS, (ironique.) Vraiment? Je ne l'aurais pas cru!
ROXANE, (à part.) Allons, il est charmant! (Haut.) J'ai dans une petite bourse deux mille écus en or au service du roi.
SAINT-GUELTAS. Ce serait de quoi donner des sabots à nos gens qui vont pieds nus dans les épines.
ROXANE. Pauvres gens! je cours vous chercher mon offrande. (Elle sort en faisant signe à Marie, qui la suit.)
SAINT-GUELTAS, (à Raboisson, qui a entendu leur colloque.) Elle a des économies?...
RABOISSON. Et le coeur sensible!
SAINT-GUELTAS. Bien, ma bonne femme! tu viendras avec nous, alors!
MÉZIÈRES, (bas, au comte.) Ils arrivent par centaines, monsieur! Il en vient de tous les côtés sans qu'on les ait vus approcher; c'est comme s'ils sortaient de dessous terre.
LE COMTE. Pourvu qu'ils ne pénètrent pas dans la cour du donjon!
MÉZIÈRES. Il n'y a pas de risque. J'ai mis ces pauvres bourgeois sous clef, et ils se tiennent cois. Ils ont grand'peur.
LE COMTE, (regardant vers la salle du fond et voyant entrer de nouveaux groupes.) Les insurgés entrent jusqu'ici?
MÉZIÈRES. Ils n'ont pas l'air de menacer, mais ils ne demandent pas la permission. Et puis il y a les gens de la paroisse qui se rassemblent autour des murailles et qui ont l'air de vouloir s'insurger aussi.
LE COMTE, (allant à Saint-Gueltas et lui montrant la salle du fond, d'un ton de reproche.) Ceci a l'air d'une invasion, monsieur le marquis; je n'ai pas coutume de recevoir si nombreuse compagnie dans les appartements réservés aux dames.
SAINT-GUELTAS, (qui a été vers l'autre salle.) Ce sont des amis, de chauds amis, monsieur le comte. Ils viennent d'emporter le bourg du Jardier, et ils rejoignent ici leurs chefs afin de prendre les ordres pour ce soir.
LE COMTE. Les ordres... c'est d'attaquer ce soir Puy-la-Guerche?
SAINT-GUELTAS. Que vous comptez défendre? Libre à vous, monsieur le comte! Si vous voulez rejoindre votre poste, un mot de moi va vous ouvrir loyalement les rangs de ceux que vous acceptez pour ennemis; mais, avant de prendre une détermination aussi grave, réfléchissez encore un instant, je vous en supplie!
LE COMTE, (haut.) Et vous attendiez l'arrivée de ces nombreux témoins pour donner plus d'importance à ma réponse?
SAINT-GUELTAS. Je ne le nie pas, monsieur le comte; le temps des ambiguïtés de langage et de conduite est passé. Il y a un an et plus que nous préparons tout pour une guerre en règle, à laquelle la guerre de partisans a servi jusqu'ici de préambule. Elle éclate maintenant sur tous les points de la Vendée. Jusqu'ici, l'argent nous a suffi pour nous organiser. Ceux qui combattent comme moi y ont jeté leur fortune entière avec leur vie. Ceux des gentilshommes qui n'ont pas voulu payer de leur personne nous ont donné une année de leur revenu.
LE COMTE, (élevant la voix.) Moi, monsieur, j'en ai donné deux, et je l'ai fait volontairement.
SAINT-GUELTAS. Personne ne l'ignore, et c'est cette noble libéralité qui rend votre position fausse et impossible à soutenir. Vous ne pouvez payer les frais de la guerre contre vous-même. D'ailleurs, ces généreux sacrifices, ces utiles secours, ne suffisent plus. Il faut des bras à la sainte cause, des bras nouveaux et des coeurs éprouvés. Il faut des soldats, il faut des officiers surtout. Vous avez servi, vous avez des talents militaires; vous êtes encore jeune et robuste, vous disposez d'anciens vassaux aujourd'hui vos métayers et vos serviteurs dévoués, lesquels, nous le savons, ne demandent qu'à marcher sous vos ordres. Écoutez! écoutez-les qui vous réclament. (On entend au dehors des clameurs et des cris de «Vive le roi!») Le moment est donc venu. Nous voici sur vos terres avec une apparence d'invasion qui vous délie de vos promesses à la bourgeoisie. Nous ouvrons nos rangs avec respect pour vous faire place. Entrez-y, c'est aujourd'hui qu'il le faut ou jamais!
LE COMTE, (entraîné, faisant un pas.) Eh bien... (Il s'arrête en trouvant Mâcheballe devant lui.)
MACHEBALLE, (faisant assaut de popularité avec Saint-Gueltas et voulant se targuer d'avoir décidé le comte.) Oui, Sacrebleu! c'est aujourd'hui! ça n'est pas demain! Il y a assez longtemps que les nobles font trimer nos sabots pour ménager leurs escarpins, et le sang que nous avons perdu l'an passé, il l'ont regardé benoîtement couler sans se déranger de leurs chasses, galanteries et ripailles! On a assez de ça! Croyez-vous qu'on va se battre toute la vie comme des chiens pour rétablir vos priviléges? Non, par la peau du diable! on n'a plus qu'un intérêt, qui est aussi bien le vôtre que celui du paysan. C'est que la monarchie soit rétablie avec l'abolition des dîmes, de la milice, des tailles, et qu'on nous rende nos couvents, nos bons prêtres et nos fêtes. On s'était tous réconciliés en 89. Faut y revenir! Faut que le seigneur fasse ce qui est le bien du paysan, et, puisque le paysan veut venger son roi et son Dieu, faut que le noble se batte comme nous autres, que ceux qui sont en retard se dépêchent et fassent sonner le tocsin de leurs paroisses, ou bien on le sonnera nous-mêmes, et on mettra le feu aux maisons des feugnans; ça y est-il, vous autres! (Cris et clameurs des insurgés qui envahissent le salon. Saint-Gueltas va vers eux avec une autorité irrésistible et les fait reculer.)
LE COMTE, (avec énergie.) Devant les menaces, vous comprenez, monsieur le marquis, que je dis non, non, trois fois non! Je mets les femmes de ma maison sous la sauvegarde de votre honneur, et je vais à Puy-la-Guerche! (Aux insurgés.) Arrêtez-moi, si vous l'osez!
SAINT-GUELTAS. Personne ne l'osera... Mais un moment encore... Quelqu'un veut vous parler. (Aux insurgés.) Silence! (Bas, à Mâcheballe.) L'homme en toile!
MACHEBALLE. Le voilà! (Il fait sortir du groupe derrière lui un jeune paysan breton habillé de toile bise de la tête aux pieds, les cheveux longs, l'air doux, étonné.)