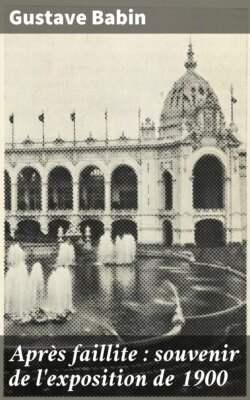Читать книгу Après faillite : souvenir de l'exposition de 1900 - Gustave Babin - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PROCÉDÉS NOUVEAUX DE CONSTRUCTION
ОглавлениеMars
Confesserai-je ici une de mes déceptions? Je m’attendais à voir apparaître sur les chantiers de l’Exposition davantage d’engins perfectionnés qu’on ne nous en a montré. N’allez pas, d’ailleurs, me demander lesquels; je ne suis pas grand clerc en la matière. Pourtant, comme je ne néglige jamais l’occasion de visiter, quand le bon hasard m’en met à même, une usine ou un atelier, j’ai eu, de temps à autre, quelques émerveillements. J’ai admiré des machines si expéditives, si travailleuses, et d’autres si précises, et j’oserai dire si sages; j’ai conçu pour elles une telle estime, une telle admiration que j’espérais de tout mon cœur les revoir, évadées un moment des halls enfumés où elles peinent d’habitude, venir travailler un peu au grand jour, et raboter, et river, et souder sous nos yeux, en pleine fête. Mais non; il paraît qu’elles avaient fait leur besogne auparavant, et que lorsque les fers arrivèrent à pied-d’œuvre, tout préparés pour le montage, on n’avait plus besoin du ministère de ces étonnantes travailleuses. Force nous fut donc de nous contenter du spectacle des forges portatives ronflant dans les échafaudages, des frappeurs, des riveurs audacieux, balançant à cinquante ou soixante pieds en l’air leurs marteaux rythmiques. Et, sans aucun doute, il était nécessaire qu’il en fût ainsi, car les ingénieurs avaient trop grand intérêt à bâtir vite; ils eussent, d’autre part, été trop fiers de nous montrer leurs dernières conquêtes, pour avoir laissé passer de gaîté de cœur une occasion pareille et qu’ils ne retrouveront plus de bien longtemps.
Pourtant, on nous aura présenté, aux chantiers du grand Palais des Champs-Elysée, une installation vraiment modèle.
Je n’apprendrai rien à aucun Parisien digne de ce nom, flâneur, par conséquent, en disant ici qu’à l’heure actuelle toute maison est construite à moitié dans la carrière même d’où proviennent ses matériaux. Pour peu qu’on se soit arrêté quelquefois devant une bâtisse en train, on aura constaté que le montage d’une maison par les maçons se réduit maintenant à n’être guère plus qu’un jeu de patience un peu grand. Les pierres, établies d’après les dessins fournis par l’architecte et par l’entrepreneur, d’après le «calepin» arrêté par eux, arrivent toutes taillées au chantier où elles doivent être utilisées — économie de main d’œuvre, puisque les ouvriers sont moins exigeants en province qu’à Paris, économie sur les droits d’octroi, la matière qui franchit les barrières où veillent les hommes vert-bouteille étant ramenée au strict minimum, au volume exact qu’elle doit occuper dans la construction, plus, toutefois, un excédent de trois centimètres sur chaque panneau, ce qu’on appelle le «pouce du carrier». L’œuvre des tailleurs de pierre sur place se trouve ainsi réduite à bien peu de chose, pour les blocs simplement équarris, sans moulures: à l’enlèvement du «pouce du carrier».
Eh bien! ici, on avait trouvé moyen d’amoindrir encore cette intervention de la main d’œuvre, de la limiter, autant dire, au ravalement, et c’était une machine qui enlevait les trois centimètres de marge, amenait la pierre à ses dimensions définitives; c’était la «scie diamantée» à laquelle tous les gens du métier qui se sont aventurés sur les chantiers ont rendu visite, sans parler d’innombrables profanes.
Cette scie était circulaire, d’un diamètre de 2m 20, d’une épaisseur, à la tranche, de 2 centimètres. Sur cette tranche et aussi sur les deux faces, en une circonférence très rapprochée des arêtes, étaient disposés, trois à trois, en triangle, une série de cent soixante petits diamants d’une eau, comme on pense, assez peu merveilleuse, et sans autre chose de commun qu’une parenté vague avec ces ruineuses gemmes qui scintillent de tous les feux du prisme sur le satin des gorges nues; c’étaient des «boorts» du Brésil, de vulgaires cailloux amorphes et sans éclat et valant tout au plus vingt fois leur poids d’or.
Actionnée par la vapeur, animée d’une vitesse de 3oo tours à la minute, la roue diamantée fournissait en une heure près de trente mètres carrés de parements de pierre tendre, soit environ la besogne de deux cent quarante bons tailleurs de pierres.
LE PALAIS DES FORÊTS
Cette économie considérable de main d’œuvre était multipliée encore, sur l’ensemble des travaux, par le perfectionnement des appareils dits de levage, grues et treuils qui, maintenant, simplifient étonnamment la besogne de l’ouvrier, aussi bien à l’usine que sur les chantiers. J’ai trouvé quelque part cette indication qu’une grande forge qui a travaillé précisément pour l’Exposition, et qui produisait, en 1860, 2,000 tonnes de charpentes métalliques dans son année, en employant 1,200 ouvriers, a fourni, en 1899, 10,000 tonnes de fers avec seulement 450 ouvriers. Et peut-être est-ce tout de même un peu inquiétant, ces conquêtes de la mécanique, et ce bilan du siècle que nous promettaient les organisateurs de l’Exposition, ne sera pas toujours très réjouissant à feuilleter.
Au chantier des Champs-Elysées, le progrès était représenté par un pont roulant électrique, — qui, à part son mode de propulsion, était la répétition identique des ponts à vapeur que vous connaissez, et, au surplus, la réduction des fameux ponts roulants de la galerie des Machines, en 1889, — et par une «grue à pylône» qui amusa beaucoup les badauds des quais, avec ses allures de franc échassier.
C’était, montée sur un wagon ou truc mis en marche au moyen de bielles et d’engrenages, une charpente métallique de près de 30 mètres de haut avec 24 mètres carrés de base seulement, une pyramide de treillage au haut de laquelle se balançait une grue ordinaire, un fléau articulé qui la prolongeait, s’inclinait à volonté, se tendait à la façon d’un bras dans toutes les. directions où son aide était nécessaire et qui était capable d’élever à 35 mètres de hauteur, un poids de 5.000 kilogrammes. Son crochet, pendant au bout d’une chaîne démesurée qui s’enroulait sur un treuil actionné en bas par la machine motrice de tout l’appareil, venait agripper sur le sol les pierres équarries et taillées et les déposait à leur assise, à leur place. Ce colossal engin roulait d’un bout à l’autre des façades, pivotait au doigt et à l’œil avec le fardeau qu’il hissait. Et si puissantes étaient toutes ces machines de levage, si raisonnablement réparties sur la surface entière du chantier qu’une pierre, à partir du moment où le bateau qui l’avait prise à la carrière l’amenait à quai, ne touchait presque plus la terre. Une grue la prenait sur la péniche, la déposait sur un wagon qui la conduisait jusqu’au pont roulant; soulevée de nouveau, elle était déposée quelques instants plus tard à proximité de la scie diamantée et, une fois débitée, elle reprenait sa promenade sur un autre wagonnet qui la venait présenter à la grande grue à pylône. Elle se balançait en l’air quelques minutes, puis bientôt reposait sur son lit de mortier. C’était de l’ouvrage proprement expédié, sans pertes de temps, sans fausses manœuvres, avec très peu de personnel.
Et c’est grâce à de pareils auxiliaires qu’on a pu édifier en trois années, — la première adjudication de travaux, celle de l’estacade où l’on déchargeait les matériaux est du 29 octobre 1896, — ce groupe des deux palais des Champs-Elysées, qui ne présentait pas moins de 40.000 mètres carrés de superficie. C’est bien, évidemment; toutefois, vous vous rappellerez à propos que Libéral Bruant et Mansart, qui n’avaient ni scie diamantée, ni grue à pylône, ni pont roulant électrique, ont édifié, pour Louis XIV, les Invalides, qui couvrent 126.985 mètres carrés, s’il vous plaît, de 1671 à 1675.
Progrès! progrès qu’on nous chante, serais-tu donc, en fin de compte, et malgré des apparences fallacieuses, un vain mot, et comme disait le génial et terrible Edgar Poë, «une extase de gobe-mouches?»
A côté de ces applications d’engins nouveaux ou peu connus, la construction de l’Exposition fut encore le prétexte d’un essai assez intéressant.
Vous n’êtes pas sans avoir lu, dans des journaux, dans des revues parfois très doctes, avec quelle facilité la foi scientifique des Américains transporte les montagnes qui ont ont cessé de se plaire à un endroit déterminé. On vous aura conté des histoires invraisemblables de mairies, de palais de justice, de cathédrales voyageant par petite vitesse, comme de simples colis. Piqués, j’imagine, par le récit de pareilles prouesses, nos ingénieurs brûlaient d’imiter ces tranquilles audaces; et, afin de leur en donner l’occasion, les architectes, pour une fois se montrant bons princes envers eux, eurent la complaisance de décider que la galerie de la Force motrice, située au fond du Champ-de-Mars, en avant de l’ancien palais des Machines de 1889, aurait exactement les dimensions de l’ancienne galerie des Industries diverses édifiée jadis par M. Bouvard, et surmontée de l’étonnante coupole de chocolat que vous connaissiez bien sous le nom de Dôme central, soit 30 mètres en largeur. On allait donc pouvoir accommoder les restes de la vieille charpente dans une construction neuve et les ingénieurs conçurent le téméraire projet de les utiliser sans démolition, en réduisant au strict nécessaire les travaux, c’est-à-dire en transportant à l’américaine les fermes entières de la place qu’elles occupaient primitivement à celle qu’elles devaient occuper dans l’avenir. On justifia l’entreprise par des raisons d’économie, argument pour lequel l’Administration tient toujours la bonne oreille ouverte. La vérité, un de mes confrères, qui est un peu celui des ingénieurs aussi, l’a dite ingénument: c’est que «l’occasion était vraiment trop tentante pour ne pas chercher à effectuer le déplacement d’un seul coup, comme cela se pratique assez souvent en Amérique». On succomba à la tentation.
On commença par sectionner en trois tronçons les six fermes métalliques qui composaient le vaisseau; — hélas! qu’on nous eût donc trouvés timides, «en Amérique!» — On avait ainsi trois immenses cages.
La galerie nouvelle se trouve disposée perpendiculairement à l’ancienne, c’est-à-dire que l’axe en est parallèle à celui de la galerie des Machines, au lieu de lui être perpendiculaire. Il fallait donc que les trois morceaux, composés chacun de deux fermes soigneusement reliées l’une à l’autre, «contreventées», en terme de métier, vinssent d’abord se placer d’un mouvement en avant ou en arrière suivant leur position dans le hall primitif, à l’alignement de la galerie de la Force motrice, puis qu’on les fît évoluer d’un quart de cercle avant de les rouler à leur emplacement définitif: deux mouvements de translation, un mouvement de rotation.
On isola d’abord, avec précautions, de leurs fondations les pieds droits, qui, soulevés doucement à l’aide de vérins à vis, furent montés sur de petits chariots munis de galets d’acier. En même temps on disposait au fond de fossés, de façon à esquiver l’obligation de lever trop haut la charge entière, deux voies ferrées perpendiculaires l’une à l’autre et d’un écartement égal à la portée des fermes, l’une courant dans le sens de la longueur de la vieille galerie, l’autre suivant le front des façades du bâtiment à construire. A leur croisée, on posa une voie circulaire d’un diamètre égal à-la diagonale de chaque travée, de telle sorte que les quatre pieds des fermes y vinssent se poser. Des treuils, placés sur un plancher léger, à la base des fermes, devaient actionner tout le système. Je passe sur les détails trop techniques, ceux qui touchent, notamment, à l’équipement des chariots de roulement.
Quand tout fut prêt, on convoqua, le 8 novembre 1898, pour assister à l’expérience, M. Paul Delombre, alors ministre du Commerce, et quelques invités de distinction. Tout marcha, on peut bien le dire, sur des roulettes: en fort peu de temps, la première travée, ayant roulé, pivoté, puis roulé encore, reposait sur ses chariots d’acier, à la place qui lui était assignée pour la durée de l’Exposition de 1900.
Par malheur, on s’enorgueillit trop de ce premier succès, et trop vite on abandonna à elles-mêmes les charpentes nomades: le 9 décembre suivant, un coup de vent jetait à bas les deux travées déjà transportées, et qu’on avait eu l’imprudence de débarrasser des poutres qui les contreventaient. Ce fut le lamentable couronnement d’un curieux travail. Adieu les économies entrevues! Mais n’empêche que l’expérience, en soi, avait été très bien conduite, et, au demeurant, avait réussi. Il en avait été comme pour ces effroyables exploits des chirurgiens auxquels le patient survit une heure, par persuasion, et afin que la science triomphante puisse proclamer qu’il succomba non à l’opération elle-même, mais bien aux suites de cette opération.
Je dois mentionner encore l’application à certains travaux de l’Exposition d’un système nouveau de fondations: les fondations sur sol comprimé.
Les procédés couramment employés pour asseoir solidement sur leur base nos maisons et nos monuments sont longs et dispendieux. Ils entraînent toujours, à tout le moins, des travaux de terrassements assez considérables. Pour peu qu’on ait affaire à un terrain peu résistant et qu’il faille, par surcroît, recourir aux pilotis, la dépense devient considérable.
L’économie de temps et d’argent que permettent de réaliser les fondations sur sol comprimé les ont fait adopter avec enthousiasme par les architectes de l’Exposition, gens très pressés d’arriver à l’heure, et réduits, comme crédits, à la portion congrue. On affirme, de plus, que les fondations ainsi établies sont extrêmement résistantes et ne peuvent occasionner nuls déboires. «Un puits bien battu, me disait un des jeunes architectes de l’Exposition, M. Auguste Bluysen, collaborateur de M. Ch. A. Gaultier, qui a tenté l’expérience aux serres de l’Horticulture, un puits bien battu fournit au moins la même résistance que trois pieux solides.» Le système nouveau avait donc pour lui tous les avantages. Aussi l’a-t-on utilisé abondamment: les serres du Cours-la-Reine, je le répète, le palais de la Ville de Paris et le palais des Congrès qui les encadrent; en face, plusieurs pavillons des puissances et le palais des Forêts; enfin, le pavillon du Commissariat général, le premier chantier de l’Exposition où en fut fait l’essai, sont fondés sur sol comprimé.
Voici, en gros, en quoi consiste le procédé : Une sonnette, toute pareille à celles dont on se sert pour battre les pilotis, mais armée d’un appareil à déclic d’une forme particulière, appelé «homard» en raison de son rôle de pince, élève à la vapeur, jusqu’à une dizaine de mètres, une masse de fonte de 1.500 kilogrammes environ, puis le «homard», rencontrant un collier qui desserre ses griffes, la laisse retomber en chute libre sur le sol.
La première masse employée est appelée par les ouvriers «la carotte», et ce vocable imagé en indique mieux qu’un croquis la forme. La «carotte», donc, s’enfonce en terre par sa pointe. A coups répétés, elle creuse le sol jusqu’à une profondeur estimée suffisante; mais elle le creuse sans déblais, en le comprimant tout autour du puits qu’elle fore ainsi.
Dans ce trou, on jette des bétons de composition variable qu’on comprime à leur tour, toujours par le même moyen, la chute libre d’un corps lourd; mais, cette fois, on emploie un poids d’une forme moins aiguë, une sorte d’obus — c’est d’ailleurs le nom que lui ont décerné les ouvriers, — s’enfonçant dans les matériaux par la pointe. Insensiblement, les pierrailles du béton, la chaux qu’elles entraînent sont refoulées dans le sol jusqu’à saturation, pour ainsi dire; jusqu’à refus. Bientôt, à chaque coup le poids s’enfonce un peu moins, et quand le puits est enfin rempli, on en achève le bourrage à l’aide d’une troisième masse dont la base, cette fois, est plane, et qui établit un champ horizontal. Les murailles, les fermes de métal viennent s’appuyer sur ces blocs cylindriques de maçonnerie, qui forment. en réalité, comme des pieux de pierre, si l’on peut dire, et des pieux robustes.
LE BOURRAGE D’UN PUITS
M. Dulac, l’inventeur de ce système, ou plutôt du principe de ce système, est mort il y a quelques années. Il n’aura donc pas assisté au triomphe des fondations sur sol comprimé. C’est dommage, car ce triomphe sera complet, on peut le prévoir, après la consécration que leur a donnée l’Exposition.
Il me reste, enfin, pour avoir épuisé la liste des procédés originaux employés à l’édification de l’Exposition, à parler de certains matériaux soit d’invention récente, soit utilisés dans un rôle qu’ils n’avaient pas encore joué, et encore de tours de main jusqu’alors peu connus. Tels sont l’acier moulé, le ciment armé, puis un succédané du staff, la «fibrocortchoïna», et enfin le métal déployé. Et tout en désirant éviter, dans ce livre, de vous infliger de la technologie à haute dose, je demande à vous les présenter en quelques mots.
C’est en acier moulé, je l’ai dit, que sont établis les quinze arcs du pont Alexandre III. L’adoption de ce métal n’a pas été, paraît-il, sans quelque résistance de la part du Conseil supérieur des ponts et chaussées qui, comme chacun sait, contrôle en France tous les travaux publics.
L’acier moulé n’avait, jusqu’à ce moment, été employé que par les ingénieurs des constructions navales, auxquels il fournissait de grosses pièces, bâtis de machines, étraves ou étambots de navires; par les artilleurs, qui lui demandaient la matière constitutive de leurs canons. Quelle figure allait-il faire dans le nouvel emploi qu’on se proposait de lui donner? Il y avait dans le savant aréopage des membres timorés, contemporains de Navier, peut-être, qui eussent volontiers reconstruit là le pont suspendu qu’il y avait jeté lui-même sous le bon roi Charles X, plutôt que de risquer une expérience qui les épouvantait. M. Résal fut assez heureux pour les convaincre et pour leur démontrer qu’étant donné la forme nécessaire du pont, très surbaissé, sans support intermédiaire, l’emploi de l’acier coulé s’imposait sans conteste. Ils ne doivent pas le regretter maintenant.
Chacune des pièces d’acier constituant les arcs, — il y en a trente-six pour chaque arc, — a donc été fondue aux usines, sur des gabarits très compliqués de lignes; car elles ne sont pas d’une section uniforme, et chaque arc va se renflant, de la rive, jusqu’à mi-distance environ de la clef, jusqu’au point d’épaisseur maxima appelé rein, puis diminue jusqu’à la clef. Ces pièces, ou voussoirs, sont réunies par boulonnage, non par rivetage comme dans les ponts en acier laminé, où les rivets produisent toujours, sur les faces apparentes, un effet si désobligeant.
Pour ce montage, en raison de ce qu’on ne pouvait songer à interrompre la navigation par rétablissement d’une file continue de pilotis au travers du fleuve, force fut encore de créer un accessoire nouveau, cette fameuse passerelle qui intrigua si fort, pendant des mois, les Parisiens, car ils la prenaient pour une partie du pont lui-même, cette sorte de longue poutre tubulaire qui, roulant sur des rails le long des rives, se transportait successivement à la place de chaque arc, entraînant avec elle, soutenu par des tirants solides, le plancher qui servait, en quelque sorte, de matrice à l’arc. Ce fut un admirable travail, dans ses moyens comme dans ses résultats, seuls visibles à l’heure qu’il est.
Le ciment armé va faire, après cette année, quelque bruit dans le monde(), encore que les Anglais et les Américains, réputés d’habitude si hardis, ne lui aient manifesté qu’une médiocre confiance en ne consentant jamais à établir directement sur lui, sans autre intermédiaire, la base de leurs pavillons du quai d’Orsay.
Tout le long de ce quai, en effet, des Invalides à Grenelle, la ligne du chemin de fer de l’Ouest, qui longe le fleuve en tranchée, est recouverte en ciment armé. C’est sur ce toit que sont construits en grande partie et les pavillons des Nations, et le palais des Armées, et celui de la Navigation de Commerce, et celui des Forêts; sur des pieux en ciment armé aussi que s’appuient, dans la partie où ils surplombent les basses cales, et le pavillon de la Ville de Paris, et le palais des Congrès, et les serres de l’Horticulture. En ciment armé encore, tous ou presque tous les balcons en encorbellement de l’Exposition, aux palais des Beaux-Arts, au palais de l’Éducation, à maint autre; et la passerelle qui relie le Trocadéro au pont d’Iéna, et les murailles de la tranchée où passent, à cette place, la voie des tramways et la rue carrossable, sont toujours de ciment armé. Or, il n’y a que cinq ou six ans que le ciment armé a vu le jour. C’est un beau commencement.
En substance, le ciment armé est du béton de ciment, ou mélange de gravier et de ciment, coulé sur place dans des moules de planches qui le modèlent, autour de tiges de métal rondes, de différents calibres suivant les charges que devra supporter l’ouvrage à exécuter; et ainsi on façonne tour à tour des piliers, comme au-dessous du Cours la Reine, des poutres, ou même des planchers entiers d’un seul bloc, comme au petit palais des Champs-Élysées et sur la voie ferrée des Moulineaux.
J’hésite à charger cette description trop sommaire du procédé. Cependant dois-je ajouter que, dans les poutres qui travailleront en flexion, c’est-à-dire en étant suspendues par une de leurs extrémités ou par les deux, des pièces de fer plat, noyées dans la masse transversalement aux fers ronds, relient ceux-ci et accroissent la résistance du bloc en lui donnant de l’homogénéité, remplissant précisément le rôle que joue, dans un fer en I, la partie verticale, le bâton, l’âme de la pièce. Et il ne manquera pas, parmi vos amis, d’ingénieurs qui, certes, vous exposeront, mieux que je ne saurais le faire, comment le fer résistant aux efforts de traction, tandis que le béton suffit à faire équilibre aux forces de compression, tout est pour le mieux dans le meilleur des systèmes possibles.
Maintenant, nous voici tout au... ou tout à la «fibrocortchoïna », car Littré ignora ce mot barbare. Mais, sans qu’il soit besoin d’un dictionnaire, vous en démêlerez sans peine, j’espère, la double étymologie, latine et très noble quant à sa racine, vraisemblablement auvergnate, et partant moins patricienne, pour la désinence.
La fibrocortchoïna, — allons pour le féminin! — c’est, si vous voulez, du plâtre armé, mais armé de copeaux et de roseaux. Et c’est très suffisant pour l’usage que cela doit fournir, plus résistant encore que le vieux staff, fait de plâtre et d’étoupe.
La fibrocortchoïna, préparée à l’atelier, arrivait en grandes planches de 2 mètres à peu près de longueur, de 40 à 5o centimètres de largeur, qui, bien sèches, étaient attachées, à l’aide de clous soigneusement étamés ou bien galvanisés, — car la rouille eût taché irrémédiablement les blanches murailles, — sur les pans de bois ou sur les charpentes. Parfois, dans les moments de presse, on préparait directement ces «planches de plâtre» sur les chantiers. Quelques minutes y suffisaient: sur une table, quatre baguettes ou tringles encadraient un espace rectangulaire dans lequel on coulait d’abord une mince couche de plâtre frais; puis, sur ce plâtre on étendait, sans précautions aucunes, de ces fins débris de bois ou fibres que les emballeurs utilisent pour envelopper les objets précieux, puis une poignée de roseaux de marais; on versait une nouvelle couche de plâtre, noyant le tout, et en quelques minutes, on démoulait une plaque grisâtre qu’on pouvait transporter, fumante, au tas où les ouvriers, le lendemain, la viendraient prendre pour l’appliquer sur le support destiné à la recevoir. Un enduit lisse par dessus, enduit qui prenait grâce aux aspérités volontairement ménagées à la surface des planches, surtout dans les planches fabriquées en grand à l’usine, et voilà d’admirables parois pour les palais, des parois que les peintres n’avaient plus qu’à grimer pour en faire, à leur gré, des marbres, des granits, des porphyres, des malachites, ou de très vieilles et de très vénérables pierres..., que six mois passés à l’air allaient effriter et renvoyer en poussière, comme font les siècles des plus augustes monuments que l’homme ait érigés.
Dans nombre de palais, pourtant, la muraille est plus solide, le support en étant constitué non par de fragiles roseaux secs, non par de l’étoupe, mais par du «métal déployé ».
Prenez garde à ce dernier venu dans l’art du constructeur: il ira loin. Son coup d’essai, qui est précisément l’Exposition, a été vraiment un coup magistral. Dans la plupart des pavillons étrangers, dans presque tous les palais du Champ de Mars, à droite, à gauche, il a tenu brillamment sa place.
Qu’est-ce que le métal déployé ? Son nom le définit mal.
Imaginez une mince lame de tôle, cisaillée à des intervalles réguliers de fentes parallèles, d’entailles disposées à sa surface en quinconce, c’est-à-dire de telle sorte que chaque entaille d’une rangée quelconque tombe entre deux entailles de la rangée supérieure et de celle d’au-dessous. Représentez-vous ensuite cette lame étirée à l’aide de machines puissantes, dans un sens perpendiculaire aux fentes; vous aurez ainsi obtenu un treillis métallique dont les vides auront la forme de losanges. Je ne vous expose pas ici le mode exact de fabrication; je cherche à vous donner une idée de l’aspect du métal déployé. Vous en pouvez voir, d’ailleurs des échantillons au Trocadéro, où il double et complète les clôtures de bois, de chaque côté de la voie charretière en tranchée, le long du quai Debilly.
Comme la feuille métallique primitive est, je le répète, assez mince, cette sorte de grille qu’elle est devenue demeure très malléable, très plastique, prend sous l’outil ou sous les doigts les profils les plus variés, se modèle selon le gabarit sommaire des moulures, tout en devenant très rigide, une fois posée et clouée.
Dans les constructions où il a été utilisé, le métal déployé a suppléé la toile grossière qui servait autrefois, qui a servi encore dans quelques cas, cette fois-ci, à supporter la mince couche de plâtre par quoi sont constituées les murailles précaires des palais d’Exposition. On le clouait, on le tendait comme cette toile, autour des pylônes de charpente composant l’ossature des piliers ou des pieds-droits; puis, sur ce réseau, on venait plaquer le plâtre à pleines truelles.
On en a fait des consommations formidables: plus de 500.000 mètres carrés dans l’intérieur de l’Exposition. Il y en a 13.600 mètres dans le plancher du palais de l’Électricité, 70.000 à la salle des Fêtes, 30.000 au palais des Mines; et c’est partout à l’avenant. Le ciment armé et le métal déployé sont les rois du moment; ils partagent le sceptre et le trône, dans cet empire transitoire du truquage qu’est la grande foire de 1900, avec le plâtre, avec le staff, avec la peinture, avec tout ce qui est clinquant, duperie.
Et je vous laisse le soin de prononcer si cela symbolise bien ou mal notre pauvre vieux siècle.