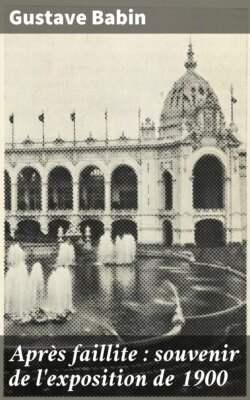Читать книгу Après faillite : souvenir de l'exposition de 1900 - Gustave Babin - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE COLOSSE
ОглавлениеMars 1900.
Donc, on a voulu que ce vieux siècle agonisant sombrât dans un rayonnement d’apothéose, et que son déclin fût pareil à un crépuscule d’astre, à un coucher de dieu. Eh bien! franchement, ce beau spectacle nous était dû, en dédommagement de tant d’angoisses, de deuils, de déceptions. C’est proprement la féerie où l’on conduit les enfants sages. Nous l’avons méritée. Et si, même, quelques lazzis devaient troubler la sérénité de cette fin décorative, si quelques éclats de gaieté en devaient altérer la solennité, nous aurions tort, je crois de nous indigner: le moribond fut, durant sa carrière, assez peu folâtre; il devient temps, justes cieux, qu’il se rattrape! Une Exposition tout uniment synthèse et philosophie des cent dernières années passées, selon la parole de M. Alfred Picard reproduite en épigraphe à la première page de ce volume, serait peut-être une fête morose. Mieux eût valu baisser bien vite le rideau. Grandeur! grâce! beauté ! J’ai très peur que M. le Commissaire général n’ait voulu justifier le renom que, si pieusement, lui ont établi ses familiers et ne se soit efforcé de contempler ce pauvre siècle qui s’en va avec une excessive indulgence: ainsi nous jugeons sans rigueur, à l’heure où ils disparaissent, les actions et la vie de ceux-là mêmes que nous avons aimés et estimés le moins. A tout chevet mortuaire la charité devient simplement décente. Et puis, il faut se rappeler et méditer le mot d’Hamlet: «Si chacun, jamais, n’était traité que selon ses mérites, qui donc échapperait aux étrivières?»
Va donc pour l’apothéose et pour la déification!
Au surplus, nous verrons à chaque pas combien les réalisations, en ce bas monde, sont toujours loin des intentions.
On nous a promis une Exposition grandiose, gracieuse et belle. Elle est avant tout immense.
En se mettant à l’œuvre, on nous a dit, non sans orgueil: «Cette Exposition, dont nous voulons vous éblouir, aura cent huit hectares de superficie, alors que sa devancière n’en avait que quatre-vingt-quinze, et elle couvrira juste six fois le terrain qu’occupait la première de nos expositions universelles, en 1855. Que si cette emprise formidable sur la ville ne lui suffisait pas, nous sommes prêts à aller chercher hors des remparts l’espace qu’il faut à cette géante pour étendre à l’aise ses membres, dussions-nous la dépecer.»
Et l’on a fait comme on avait dit.
Cent huit hectares! Ce n’est qu’un nombre, et, sans doute, cela ne dit rien de bien précis aux esprits mêmes les plus mathématiques.
Je n’ai eu, quant à moi, la conception nette de l’étendue que représente ce chiffre, et de l’effort démesuré qu’il a fallu pour bâtir, sur un pareil terrain, tant de palais et tant de kiosques, de pavillons et de pagodes, qu’un soir du dernier automne.
J’avais accompagné, jusqu’en haut de l’un des pylônes qui encadrent sa Porte monumentale, l’architecte René Binet. Ces deux pylônes, fichés comme deux cierges à l’entrée de la grande foire, sont déjà une indication, un symptôme de la monomanie du colossal qui nous tient, et dont l’Exposition tout entière est la plus probante manifestation. Leurs flammes, vers lesquelles les peuples vont se ruer, affolés, éblouis, des confins du monde, comme des alouettes de mer sur la lanterne d’un phare, leurs flammes hypnotisantes, monstrueuses, rayonneront dans l’azur sombre des nuits à quarante-cinq mètres de hauteur. Il semble qu’on n’ait eu, en les dressant là, d’autre ambition que d’humilier, d’écraser de ces deux torches géantes, l’obélisque de Louqsor, debout au milieu de la place de la Concorde, qui ne leur va pas à mi-corps. Mais la svelte aiguille a pour elle la durée, n’ayant pas la masse. Après plus de trois mille ans écoulés, elle évoque encore les splendeurs abolies de Thèbes aux Cent Portes, et les mystérieux hiéroglyphes entaillés dans le granit rose de Syène rediront au siècle qui va se lever la gloire de Ramsès II, «Maître du monde», alors que les deux minarets de clinquant, découronnés de leurs aigrettes électriques, auront depuis longtemps jonché le sol de leurs débris. Peut-être ces deux monuments plantés en face l’un de l’autre, la Porte et le monolithe, sont-ils très symboliques. Nous faisons grand. Faisons-nous durable? La piété des âges à venir voudra-t-elle recueillir, comme nous avons fait nous-mêmes de ce débris dépareillé, les œuvres de nos mains? Le pourra-t-elle?
Ce soir où je gravis l’un des pylônes, ils étaient loin, tous deux, d’être achevés encore. Ils aventuraient dans l’air épaissi déjà de primes brumes, dans le vent déjà âpre, de chancelantes ossatures de fer, peintes d’un brutal minium, qui détonnaient étrangement parmi les tons mourants de ce crépuscule d’octobre, nues mauves, ville grisâtre, fleuve livide, rouille précoce des arbres.
Il fallait se couler, tout recroquevillé, par une étroite cheminée aux parois ajourées; tantôt se hisser sur des échelons mal rabotés, tantôt s’arc-bouter aux croisillons de métal, aux entretoises de la charpente. On arrivait ainsi, à quarante mètres de hauteur, sur une étroite plate-forme de planches, qui ceignait le pylône, tout près de sa pointe, et qu’on avait accroché là pour permettre aux mouleurs de monter les staffs décoratifs, et, plus tard, aux peintres de les badigeonner, fragile support qui vacillait au souffle de la brise.
Mais, de là-haut, quel admirable panorama, et comme on était payé de ses peines!
Tout Paris reposait, frémissant, sous nos pieds, au fond de son cirque d’onduleux coteaux, sous sa délicate atmosphère vaporeuse, sous son tendre ciel auquel nul autre ciel n’est comparable en douceur, amas moutonnant de maisons haché d’entailles profondes par les avenues, par les boulevards, par les rues, et, çà et là, dominé par les masses altières des monuments, arcs triomphaux, flèches suppliantes, vénérables palais aux frontons auréolés de gloire.
Et c’est de là que, tourné vers le couchant, tandis que, derrière moi, tout le passé, Louvre solennel, cathédrale auguste, noire prison, s’endormait dans la pénombre montée de l’Orient, j’eus la vision soudaine de l’énormité, de la brutalité du monstre qui naissait.
Au milieu de la buée violette épandue sur la vieille ville, baignant là-bas les plaines environnantes, déferlant en vapeurs pourprées jusqu’à l’horizon sombre, la cité nouvelle, blanche et fardée, m’apparut semblable à une courtisane allongée en un lit d’hyacinthe, des points d’or étincelant à son front ainsi que des sequins, des virgules de rouge avivant ses joues de l’éclat fugace des cosmétiques.
Immense, insolente, elle envahissait les deux rives de la Seine, éventrant pour se faire place, avec une audace de harengère, les vieux bosquets à demi-défeuillés, culbutant comme un gêneur l’honnête palais de l’Industrie, dont les fragments encore debout, mornes, criblés d’éraflures et de plaies, semblaient trembler d’angoisse dans l’attente de la hache et de la pioche. Avec l’arche géante du pont, badigeonnée, eût-on dit, de sang vermeil, elle enjambait d’une berge à l’autre, se répandait sur l’Esplanade jusqu’au pied du dôme de Mansard, noble, dédaigneux, empli d’une clarté d’azur; elle déferlait d’un côté, moins criarde, dans le lointain, à travers le brouillard du soir, sur tout le Champ de Mars, d’où la tour Eiffel jaillissait comme un phare, jusqu’au pied des arcs géants de la galerie des Machines; de l’autre, elle venait battre de la marée de ses murs blafards, de ses minarets, de ses dômes, la colonnade en hémicycle du Trocadéro, la base des deux tours jumelles casquées d’armets sarrazins; elle submergeait les rues, les places; elle hérissait les quais ici des arceaux menus de deux immenses serres, là de clochetons gothiques, de pignons moyenâgeux, de tourelles en poivrière, en face d’un prodigieux amas de charpentes. On n’en pouvait embrasser d’un coup d’œil l’immensité. C’était une vision confuse de palais ébauchés, de colonnades imparfaites, de campaniles dégrossis à peine, d’arcades boiteuses, de rudiments de coupoles, de carcasses, d’échafauds; et cette masse empruntait à son état d’inachèvement, quelque charme, presque de la grâce.
A cette heure équivoque, dans la vapeur montée du fleuve, les squelettes des bâtisses pittoresques de la «rue des Nations» au quai d’Orsay, devenaient surtout séduisants. Le dessin ne s’en accusait pas encore; on ne distinguait qu’un enchevêtre. ment babélique de poutres et de sapines, quelque chose de vague et d’aérien, de confus et qui faisait songer aux chimériques architectures de Piranèse, ou bien au délicat lacis des mâtures dressées dans l’atmosphère trouble d’un port, ou encore à ces fallacieuses apparitions de minarets, de mosquées, de remparts, que le mirage fait surgir des sables roses du désert ou des profondeurs glauques de l’Océan. Toutes les formes s’entremêlaient à l’aventure: tours carrées, clochers effilés, dômes byzantins, des terrasses près de toits à redans; tous les styles aussi, nous devions le reconnaître plus tard: la Renaissance près du Louis XVI, et près de styles qui n’ont de nom dans aucune langue. Pour le moment, on n’y prenait pas garde, amusé par le caprice de ces charpentes, par les arabesques étranges de cette dentelle de bois. Hélas! combien de ces échafaudages n’avons-nous pas regretté, au jour où se sont montrées à nous dans leur vulgarité, dans leur platitude, telles des façades qu’ils enveloppaient d’un peu de mystère, dont ils masquaient la hideur comme fait un voile nuptial d’un visage banal d’épousée! Où sont ces charpentes que l’imagination revêtait d’idéales maçonneries, que la fantaisie habillait de murs harmonieux!
Et puis une impression l’emportait sur toutes les autres, celle de l’énormité de cette Mecque improvisée, germée du sol de Paris en trois ans, et vers laquelle allait pérégriner bientôt tout ce qui, dans les deux hémisphères, a soif de bacchanales et de bamboches.
Une hésitante braise qui couvait au bas du ciel se réveilla soudain sous la cendre grise des nuées; un jet de flamme ardente jaillit, mince comme une lame, auréola d’une lueur la cime pensive de l’Arc de Triomphe, alluma une aigrette au faîte de la tour Eiffel et des deux tours enturbannées du Trocadéro; mais pas un reflet n’en tomba jusqu’à la monstreuse cité de plaisir. L’ombre qui la gagnait l’agrandissait encore, en reculait à l’infini les limites incertaines. Et quand toute lumière fut morte là-haut, je ne distinguai plus, aux deux rives du fleuve, terne miroir que rayaient, çà et là, des sillages, qu’une vaste tache crayeuse et qui semblait s’étendre, toujours s’étendre davantage et ronger comme une dartre le vieux Paris bruissant, insensible à son mal, dans l’attente des joies promises.
Oui, cette Exposition est colossale; et c’est là un des côtés, peut-être, par lesquels elle flatte le mieux l’une de nos manies favorites: l’amour de l’énorme, du démesuré, le respect profond pour ce qui est hors d’échelle. Mais sous ce rapport même, elle ne saurait pourtant être guère plus significative, plus symbolique que sa devancière, l’Exposition de 1889, donnant naissance à ces deux monstres de fer: la Galerie des.Machines et la Tour Eiffel.
Le culte de l’anormal en étendue a fait cependant des progrès certains.
Il faut aller en chercher la preuve dans la liste des projets présentés à l’Administration, des idées de «clous» soumises aux autorités compétentes; — car, depuis cinq ou six ans au moins, bon nombre de Français, sans parler des étrangers, n’ont plus guère en tête que cette préoccupation unique: trouver le «clou».
L’un proposait la création d’un cadran d’horloge de 200 mètres de diamètre, dont le centre eût été au niveau de la troisième plateforme de la Tour Eiffel; l’autre d’un manège de chevaux de bois de 1.200 mètres de circonférence; un Américain, se rencontrant avec le Parisien plus haut mentionné, s’offrait à doter son horloge du timbre approprié, apportait comme contribution à la fête, une «grande cloche» ; un Anglais suggéra l’idée d’une «roue gigantesque», — que nous n’avons pu éviter, hélas! — et d’une «grande balançoire», — cœur insatiable, à qui ne suffisent pas les balançoires courantes! — Les lunettes monstres, les microscopes gigantesques étaient en nombre aussi dans la liste, sans parler du télescope qu’on a réalisé au Champ de Mars et que l’appellation de «Lune à un mètre» a vite popularisé. Deux citoyens de Hull (Angleterre) se disaient inventeurs d’un «appareil géant», sans autre désignation, ses folles dimensions constituant précisément son mérite. Celui-ci voulait faire de la tour de 300 mètres une «gigantesque cascade» ; celui-là rêvait d’un «Colosse de Paris», à l’imitation du Colosse de Rhodes; cet autre encore était hanté de la vision de montagnes russes charroyant, avec un bruit d’enfer, des wagons du toit du Trocadéro au sommet de la Tour Eiffel. Sans parler des statues grandes comme le monde, des tours babéliques, des arcs en-ciel, des parasols capables d’abriter un corps d’armée en manœuvres, des globes terrestres d’une lieue de tour, et de tant d’autres saugrenuités énormes, bouteilles, abat-jour, fontaines, ballons, colonnes.
Les mots «géant», «colossal», «gigantesque», «vaste», «immense» reviennent à chaque page, et plusieurs fois, dans ces listes étonnantes. La moitié des idées oscillent entre des trous sans fond et des cheminées dont la tête se perd dans les nues.
Des fous? que non pas. Les réflecteurs des préoccupations et des goûts ambiants; — des précurseurs, peut-être.
Cette mégalomanie a son écho encore dans les idées suggérées à l’Administration par des architectes, des ingénieurs, gens, cependant, par profession, fort graves et fort positifs, lorsqu’il s’agit de déterminer l’emplacement de la future Exposition. Il en est, parmi eux, qui vont trouver ridiculement mesquine la foire d’aujourd’hui; ceux, par exemple, qui ambitionnaient de la voir s’étaler sur des 300, 350, et jusqu’à 560 hectares!
Enfin, l’Administration elle-même, la sage Administration, n’a-t-elle pas subi pareillement cette hantise de l’immense et du disproportionné, au temps où elle songeait à donner au Pont Alexandre III jusqu’à 100 mètres de largeur? quand elle traça, à travers les Champs-Elysées, cette percée «monumentale» de 90 mètres d’ouverture, entre les deux palais des Beaux-Arts? quand elle édifia ces deux cheminées non moins monumentales, parce que non moins énormes, qui se dressent, géantes d’entre-sort aux atours trop voyants, de chaque côté du Champ de Mars, aux deux extrémités de la galerie de la Force motrice? quand elle s’évertuait à rééditer, mais amplifié, mais multiplié jusqu’au colossal dans le Château d’Eau le sortilège charmant des fontaines lumineuses? quand elle se vantait d’avoir exécuté, au grand palais des Beaux-Arts, les deux frises les plus vastes qu’on connaisse, opposant, à défaut d’autres avantages, leur surface à celle dix fois moindre des frises de Jean della Robbia, à Pistoïa? quand elle fit pousser sous cloche, enfin, dans le hall de l’ancien palais des Machines, le mutilant, cette salle des Fêtes capable de contenir vingt-cinq mille personnes? Tenez bien pour certain qu’elle se sent plus honorée de pouvoir citer de gros chiffres, de ces chiffres qui étonnent et laissent béant l’auditeur ou le lecteur, qu’elle ne le serait d’avoir, par impossible, doté Paris d’un nouveau chef-d’œuvre d’art. A ce point de vue, la joie qu’elle éprouva de proclamer l’excédent de superficie de 13 hectares de cette Exposition sur la précédente fut son premier triomphe, et le plus doux. Et les peuples le comprirent ainsi, émerveillés.
L’AVENUE NICOLAS II
Le seul point intéressant pour notre amour-propre national était de savoir si l’Amérique, à Chicago, n’avait pas fait plus colossal encore. Or, la World’s fair colombienne occupait un espace au moins double de celui que nous offrons aux flâneries des visiteurs cosmopolites. Nous demeurons, en somme, de tout petits garçons, dignes de peu de considération. A un banquet que lui offrit, lors de son arrivée parmi nous, la Chambre de Commerce américaine à Paris, M. Ferdinand Peck, Commissaire général des États-Unis, ne nous l’envoya pas dire, sans daigner même reconnaître pour honorables nos aspirations vers l’idéal yankee, vers l’énorme; pour distinguée la façon dont nous portons ce ridicule, dont nous enfourchons ce dada. Laissons-le avec son opinion de barbare et soyons fiers d’avoir fait tout notre possible pour nous associer à l’aberration à la mode. Sous ce rapport, nous nous montrons bien de notre fin de siècle. Il n’a pas dépendu de nous que la noble émulation qui nous enflammait n’emportât des résultats plus imposants. Consolons-nous en pensant que, par les intentions, du moins, notre Exposition de 1900 est réellement, comme on dit, «dans le train». Notre conscience n’a rien, vraiment, à nous reprocher.
Et puis, peut-être aurons-nous, sur d’autres chapitres, des revanches. Nous avons fait moins grand que nos émules. Ce serait bien de la malchance si nous n’avions pas fait aussi moins laid. Il est certain que si ridicules, si démodées que puissent être certaines de nos bâtisses, elles n’iront jamais, comme hideur, à la cheville de l’absurde et insolent pavillon édifié, au quai d’Orsay, par la «République Sœur» des toasts et des discours officiels. Mais, en admettant même l’égalité dans le mauvais goût, ce serait déjà une bonne fortune, n’ayant à y édifier que des monuments d’un pareil style, que d’avoir eu à couvrir une moindre étendue de terrain.
En vérité, tenons-nous pour satisfaits de notre effort. Pour des gens du vieux monde, il est encore bien gentil comme cela.
Et puis nous pourrions, par surcroît, nous enorgueillir de la rapidité avec laquelle tout cet amas de colonnades, de portiques, de chalets et de halls est sorti de terre, en trois ans. Il a été réalisé quelques crânes prouesses.
Notez que le concours pour la construction des palais des Champs-Elysées, par où commencèrent les travaux, est du 25 avril 1896, et qu’un an après, seulement, on en piquetait les fondations; que, dans un autre ordre d’idées, le palais des Armées, au quai d’Orsay, qui a 340 mètres de long sur 35 de large, a été commencé seulement en septembre 1899; qu’il a eu toutes les vicissitudes; que près de la moitié de sa charpente s’est écroulée en cours de construction, et que pourtant il sera prêt à l’heure à l’égal de n’importe quel autre palais, mieux même que certains autres qu’on pourrait citer.
Mais, sous ce rapport, il y avait beau temps que nous avions fait nos preuves, nous dont, cependant, l’un des proverbes favoris affirme que «Paris ne s’est pas bâti en un jour» ; et je dirai, quelque part, pourquoi je ne m’extasie pas- outre mesure devant cette célérité toute relative.