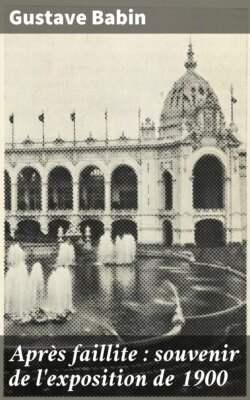Читать книгу Après faillite : souvenir de l'exposition de 1900 - Gustave Babin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE PLAN GÉNÉRAL. — LES PROJETS. — NOS ENNUIS
ОглавлениеAvril.
Ils sont heureux, les braves gens de province qui, à la première nouvelle que l’Exposition était ouverte, se sont mis en branle et n’ont eu qu’à tomber, un beau matin, la bouche en O, émerveillés, au pied des palais neufs, des pavillons fardés de frais, des jardins embaumés et pimpants. Ils ne se douteront jamais de tous les ennuis qu’il nous a fallu subir, trois ans durant, afin qu’ils eussent, à peu près à l’heure fixée, ces jouissances.
Ah! que de fois, au cours surtout des deux dernières années, nous avons envoyé à tous les diables et l’Exposition et ses organisateurs, et surtout les limonadiers. Car il n’a tenu qu’à ces derniers, en somme, que tant de vicissitudes nous fussent épargnées.
Quand il fut bien décidé que nous donnerions encore au monde, en 1900, exhibitionnistes incorrigibles, le spectacle d’une Exposition universelle, la seule annonce de cette nouvelle ouvrit, comme par enchantement, l’écluse toute grande aux imaginations. Une Commission avait été nommée pour étudier une sorte d’avant-projet, envisager toutes les questions préalables que soulève une pareille entreprise. Elle comptait dans son sein des hommes comme M. Alfred Picard, qui devait devenir plus tard le Commissaire général de l’Exposition; comme M. Georges Berger, qui fut l’un des triomphateurs de 1889; comme MM. Tirard, Lockroy, Antonin Proust, Adrien Hébrard, Krantz, Formigé, Bouvard, etc., etc. A peine était-elle constituée que les porteurs d’idées accoururent vers elle en foule. Il y en avait d’insensés, et quelques-uns de raisonnables. Et je range parmi ces derniers ceux qui rêvaient de voir l’Exposition future s’élever hors de Paris, sur un quelconque de ces admirables emplacements qui abondent: Vincennes, Issy, Saint-Cloud, Courbevoie, Bagatelle, le champ de courses d’Auteuil.
Puisqu’on voulait faire grand, les espaces ne manquaient en aucun de ces lieux. Nulle gêne; aucune entrave. Pas de vieilles murailles à démolir, pas même d’arbres à supprimer. Aux portes de Paris, reliée au point choisi par de multiples voies de communications, tramways rapides, chemins de fer, bateaux, une ville de 150 hectares pouvait éclore, sans presque que la cité vivante à côté s’en doutât. A peine, de loin en loin, le hasard d’une promenade, une curiosité exaspérée amenait quelques promeneurs, se risquant à affronter les boues, les fondrières, pour la joie de connaître, avant tous autres, l’ébauche du monstre. En paix, loin des regards indiscrets, à l’abri des palissades et des échafaudages, les bâtisseurs poursuivaient leur œuvre, et, point gênés par la préoccupation du cadre environnant, laissaient aller et s’épancher leur fantaisie. Les palais sortaient du limon, germaient du sol comme une moisson, en hâte, entre deux hivers, se paraient, se doraient pour la fête solennelle. Puis, à l’aurore du jour dit, apparaissait au monde tout un décor miraculeux et inconnu, ombragé de verdures naissantes; et les foules accourues, étonnées et ravies, avaient cette illusion de pénétrer le mystère même de la création, d’assister à la naissance spontanée d’un monde.
La Commission hésitait, séduite par la vision lointaine de ce miracle, et les amants du vénérable Paris respiraient, pleins d’espoir, quand un ultimatum du Conseil général de la Seine, et du Conseil municipal unis, ces deux si pures émanations du suffrage universel, survint à point pour tout gâter. Ils signifiaient à la Commission, par les bouches autorisées de MM. Alphonse Humbert et Alexis Muzet, qu’il leur fallait une Exposition dans Paris, dût-on saccager à fond la capitale; sinon ils refusaient de verser la subvention de 20 millions qu’ils avaient promise par avance. Ils protestaient que la tenue hors de l’enceinte urbaine de la «Foire du Monde» priverait la Ville de recettes d’octroi importantes et qu’ils seraient, par suite, dans l’impossibilité de tenir leurs engagements financiers.
La vérité c’est que «l’Alimentation parisienne» s’était émue; c’est que le marchand de vins, ce tout-puissant faiseur de rois, ce grand ressort des élections, avait senti lui échapper une aubaine ardemment et longuement convoitée.
La Commission s’inclina, bon gré mal gré ; M. Picard lui-même, si tenace d’ordinaire, se rallia, et «l’Alimentation» put inscrire à son drapeau, en lettres d’or, on peut le dire, une nouvelle victoire.
Et voilà pourquoi nous avons vu les rues éventrées, les arbres arrachés, les promenades fermées, des arrondissements entiers interdits aux passants, le service des bateaux même arrêté partiellement sur la Seine, la circulation des omnibus et des tramways livrée à toutes les fantaisies de rouliers ivres ou de chevaux rétifs, aux hasards des embourbements et des ruptures d’essieux, la ville entière la plus coquette du monde devenue répugnante et sordide, et soudain un objet d’horreur pour ses amoureux les plus fervents, mise à sac, enfin, à ce point que plus d’une lois nous nous sommes pris à regretter qu’il n’y eût pas, dans quelque coin du Code, une loi formelle et draconienne qui permît d’infliger des supplices chinois aux auteurs d’une profanation pareille!
Voilà pourquoi, pauvres Parisiens de naissance ou d’aventure, nous ne pouvons avoir ni les émerveillements, ni les illusions des étrangers subitement jetés dans la cité de fête qu’ils n’ont pas vu enfanter, et qui leur apparaît triomphante dans sa parure, telle qu’Athènè se montra casquée d’or aux Olympiens dès que s’ouvrirent au jour ses yeux glauques; car nous avons suivi, au jour le jour, la construction de ces palais, l’érection de ces statues; nous sommes dans le secret des dieux, nous avons vu ces marbres, ces porphyres, à l’état de boue blanchâtre, et nous savons que ces majoliques, que ces étincelantes faïences, qui si joliment reluisent au soleil, ne sont que peinture et que badigeon, et que duperie!
Si encore on nous avait dédommagés en prodiguant plus tard, sur nos pas, la beauté ! Mais de toutes les idées acceptées par la fameuse Commission ou par l’Administration, entité impuissante autant qu’irresponsable, deux seulement m’apparaissent dignes d’éloges: celle qui consistait à faire de la Seine, du beau fleuve tranquille et lent, la rue centrale, le grand boulevard mouvant de l’Exposition, et celle qui aboutit à la démolition du palais de l’Industrie et à la percée d’une avenue nouvelle ouvrant, des Champs-Elysées, une perspective sur l’hôtel des Invalides et sur le dôme altier de Libéral Bruant et de Mansart.
Non que j’eusse contre le pauvre vieil édifice qui avait abrité la première de nos expositions universelles, en 1855, le moindre grief personnel. Sa bonhomie, sa condescendance à se plier à tous les services qu’on lui demandait, me rendaient indulgent pour la plate insignifiance de ses lignes. Et puis, ma foi, sous ce rapport de l’esthétique, nous n’avons guère le droit de faire les renchéris, et nul tressaillement d’orgueil ne me secoue, pour mon compte, quand je m’arrête d’aventure à la place où s’érigeait autrefois le palais défunt. Même, il me semble que MM. Cendrier et Barrault, qui l’avaient construit, furent, en leur temps, d’autres audacieux que MM. Girault, Deglane, Louvet et Thomas, les auteurs des palais actuels.
D’autre part, je ne m’illusionne pas, et sais qu’il ne fallut, en réalité, aux promoteurs de l’avenue nouvelle, qu’une très faible dose d’inspiration: la perspective des Champs-Elysées avait existé jadis; de vieux plans, d’anciennes gravures nous la montrent, encadrant, comme aujourd’hui, dans le lointain, la coupole d’or. Et longtemps elle fut considérée comme un site intangible. Elle avait, il est vrai, à cette époque, l’avantage grand de ne point comporter d’architecture. De beaux massifs d’arbres seulement la limitaient: le carré Marigny, où les héros du temps venaient goûter les émotions de la petite guerre, sous l’œil extasié des nourrices et des bambins rêvant de tendresse ou de gloire. Ironie des choses! Quand on la supprima, quand on en aveugla rentrée en bâtissant le palais de l’Industrie, les artistes d’alors protestèrent avec la même énergie que déployèrent à s’indigner certains d’entre ceux d’aujourd’hui, quand il s’agit de la démolition de ce même palais; — car il y eut, souvenez-vous-en, vers 1896, des pleurs et des grincements de plumes lorsqu’on parla de toucher à cet édifice Maître Jacques! Le beau projet n’eut guère pour lui que les architectes.... et les sculpteurs tout naturellement. Le palais de MM. Cendrier et Barrault n’avait pas connu pareille fortune.
Le pont, enfin, le pont lui-même jeté sur la Seine dans l’axe de l’Esplanade, avait été prévu. Que dis-je? Il avait existé, en chair et en os; je veux dire en belle pierre de taille et en fer. Eh oui! De 1824 à 1826, l’ingénieur Navier avait construit, au point précis où le pont Alexandre III enjambe si crânement le fleuve, un pont suspendu, — c’était alors la grande mode! — Pourtant jamais l’ouvrage ne fut livré à la circulation. Lorsqu’on tendit entre ses pylônes les câbles de suspension, un mouvement se produisit dans les maçonneries. Les ingénieurs prétendirent bien, il est vrai, que le mal était réparable aisément; mais le Conseil municipal intervint. Déjà frondeur, il protesta contre les intentions du gouvernement; le pont lui déplaisait et comme emplacement et comme structure, car les quatre piles de ses têtes masquaient le dôme des Invalides. Les ingénieurs, peu sûrs d’eux-mêmes, furent-ils trop heureux de s’abriter derrière cette opposition de l’édilité, ou bien le gouvernement de Charles X saisit-il cette occasion de donner une facile satisfaction à sa bonne ville de Paris? Toujours est-il que le pont de Navier fut démoli avant d’avoir servi. Les ingénieurs du pont Alexandre III devaient en retrouver les fondations quand ils voulurent asseoir à leur tour les culées de leur ouvrage; ce fut même, pour le dire en passant, une des difficultés qui les contrarièrent le plus.
Enfin, et quoi qu’il en soit du mérite plus ou moins éclatant qu’on eut à exhumer ces idées oubliées, l’inspiration, à mon sens, fut louable, qui consista à les reprendre et à leur donner la vie.
Elle sortit du concours institué entre les architectes pour établir le plan général de l’Exposition, et où, déjà, était prévu le pont, nécessité par la construction de la néfaste gare des Invalides. Elle figurait dans cinq ou six projets, et notamment d’une façon très précise dans celui de M. Ch.-A. Gautier, l’architecte de ces jolies serres de l’Horticulture, et dans celui de M. Eugène Hénard qui est peut-être, de tous les architectes concurrents, celui qui a apporté aux organisateurs le plus de suggestions, les unes heureuses, les autres plus contestables.
Hélas! que n’a-t-on subi aussi docilement, pour notre joie, l’influence de tels artistes qui, guidant l’architecture dans sa voie aujourd’hui naturelle, fidèles à l’orientation donnée en 1889, la seule capable de nous conduire vers de la beauté non vue, acceptaient l’aide des auxiliaires nouveaux créés à leur intention, plaquaient fastueusement sur leurs façades, sur leurs toitures, les céramiques et les verres, maçonnaient des pans entiers en matériaux lumineux et souples, écrasaient à pleines mains la couleur, jonglaient avec les rayons ardents, ceignaient de frises aux miroitants reflets les fugaces palais de fête, faisaient scintiller et vibrer dans la profondeur des murailles jusqu’alors inertes, de crépitantes et vivantes flammes.
Ceux-là furent peu nombreux. Mais il n’en était pas besoin, et l’indication qu’ils apportaient était suffisante.
Trop d’autres s’étaient acharnés à la décevante poursuite du «clou», comme si l’on créait un clou, et comme si ce n’était pas la foule elle-même qui l’élisait, la foule aveugle et instinctive, et capricieuse, qui va où elle veut et fixe la vogue à sa guise. Trop d’autres encore se satisfirent avec ce rêve banal: faire grand, étonner; comme si charmer n’était pas préférable et autrement digne d’envie!
Il y avait bien encore, de ci de là, quelques trouvailles intelligentes et que j’eusse aimé, pour ma part, à voir adopter. Ainsi, ce rêve de «Maison moderne», qu’avait fait le premier M. Mathias Morhardt, qu’il soumit à la primitive Commission, et qui fut reprise plus tard par l’architecte Plumet: créer, dans un coin quelconque, — on avait parlé du Cours la Reine, — la maison modèle d’un petit rentier, construite dans un style neuf, agencée et meublée par des artistes qui sont à l’avant-garde du mouvement contemporain et qui n’auraient pas cru déchoir en dessinant des maquettes de tentures, en modelant des cuillers, des gobelets ou des plats; en fournissant des modèles de dentelles ou de broderies. L’entreprise, certes, eût présenté quelque attrait. Elle aurait résumé un effort d’art considérable, qui s’est produit en ces dix dernières années, et dont les résultats, avec la classification adoptée, logique, sans doute, mais injuste souverainement, sont maintenant éparpillés dans les classes, où seuls les chercheurs sagaces, les pourront découvrir. Il fallut y renoncer. La Ville de Paris, en maintes occasions si ouverte aux tentatives audacieuses, la Ville, pressentie, ne comprit pas l’idée, ou ne put l’encourager efficacement. On en demeura là, et ce fut grand dommage.
Mais, en somme, on retint à peu près tout le meilleur des idées contenues dans les sept ou huit cents projets qui furent soumis à l’examen des diverses Commissions.
L’idée de faire de la Seine la voie triomphale, l’axe de l’Exposition, se dégagea aussi, je l’ai dit, des projets soumis à l’Administration.
Sous le règne même de la Commission préparatoire de 1895, M. Le Thorel l’inscrivait dans une notice adressée à M. Alfred Picard. Il assignait comme champ à l’Exposition, «les emplacements de 1889 prolongés jusqu’à la Concorde, avec la Seine pour axe». Il semble que ce soit, dans ses grandes lignes, son programme même qu’on ait réalisé. On devait retrouver ce thème, au concours ouvert entre les architectes pour le plan général, dans plusieurs projets, dans celui de M. Ch. Girault, l’architecte du petit Palais des Champs-Élysées, notamment.
En 1889, on n’avait guère donné à refléter au fleuve que des façades sacrifiées. La rue, des Invalides au Champ de Mars, c’était le quai d’Orsay, fort peu intéressant, au demeurant, refuge de l’Agriculture et de l’Alimentation, présentant à peine, çà et là, un pavillon de carton pâte souriant de toutes ses fenêtres aux passagers des bateaux-mouches. Le vrai spectacle était ailleurs.
Cette fois, on a doté la Seine, où se mirent plus haut et Notre-Dame, et la Sainte-Chapelle, et le Louvre, d’un cadre digne d’elle, si varié, si mouvementé de lignes, si coloré, qu’on oublie volontiers l’insignifiance qu’il affecte par places, sa lourdeur, son manque d’air, son tassement excessif.
Il est certain que la vue du pavillon de la Ville de Paris, par exemple, n’est pas une apparition d’art si captivante que le flot s’attarde à la refléter; et vous me concéderez que le palais des Congrès, à l’autre bout du Cours la Reine, n’est pas non plus. un modèle de grâce svelte. Mais les serres de l’Horticulture, ces halls aux vitrages irisés et comme décomposés par le temps, avec leur parure délicate de treillages verts et de fleurs printanières; mais les pavillons mêmes de la rue des Nations, à quoi, précisément, je pensais en parlant plus haut de tassement, ces pavillons débordant jusque sur les berges, se poussant, dirait-on, jusqu’au bord du lent miroir, margent vraiment d’agréable façon ce bief de la Seine qu’on a baptisé «le Bassin des Fêtes» — parce que, dans l’esprit des organisateurs, ce doit être le théâtre le plus fréquent des illuminations, des soirées vénitiennes. Et plus loin, le Vieux Paris, tout enfantin, tout théâtral et «boite de jouets» qu’il soit, donne pourtant, à certaines heures, avec son va et vient de foules bigarrées, le soir, alors que ses vitraux flamboient, une amusante silhouette, capricieuse et haute en couleur.
Cependant, comme je descends, ce matin de printemps, la Seine blonde et limpide, d’où s’évaporent de flottantes buées, lentes comme une suprême caresse, où voguent et se jouent tous les rayons, toutes les nuances, la blancheur des palais, l’éclair métallique allumé à la pointe des flèches, et les serpenteaux veloutés qui sont l’image déformée de hautes tours, et les flammes violentes des bannières et des drapeaux; parmi tant de lumière, tant de mouvement et de bruit, parmi tant de joie partout déversée dans l’air léger, sur l’eau profonde, dans les rues éphémères qui s’animent, je me remémore, avec un regret, presque, l’habituel tableau des quais d’autrefois, d’avant cette kermesse colossale.
LE PALAIS DE LA NAVIGATION
Quelle tranquille allégresse, par ces premières belles matinées!
Sur le fleuve mal éveillé encore, le va et vient alerte des bateaux parisiens, la procession solennelle de quelque train de péniches entraînées par un remorqueur qui s’essouffle ou par la «chaîne» rageuse grinçant de tous ses engrenages.
Sur la berge, où de folles brises éventent le panache tendre des platanes touffus, des vieux ormes noueux, des peupliers penchants, une vie calme, une activité paisible. Des manouvriers, débardeurs, cribleurs de sable, accomplissent leur rude besogne quotidienne, sans hâte, sans fièvre, sachant, sans avoir lu jamais l’Ecclésiaste, qu’à toute chose il y a sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps, et qu’à chaque jour suffit sa peine. Ils vont, toujours du même geste machinal, le torse au vent, superbes, par ce soleil de renouveau qui revêt tout de nuances héroïques, les haillons les plus sordides et les nudités les plus misérables. Et non loin de ceux qui peinent, d’autres, moins heureux encore, des sans-travail, dorment à l’ombre transparente des platanes, des ormes et des peupliers, leur far niente troublé de songes mélancoliques.
Puis ce sont des groupes familiers, et dont tant de fois notre oisiveté s’amusa.
Le baigneur de chiens, d’abord, retroussé à mi-bras et à mi-jambes, attendant, les pieds dans l’eau, debout auprès de son baquet rempli de drogues nauséabondes, la clientèle aristocratique: Miss, jeune personne de la famille des terriers anglais, ou Bob, hargneux king-charles trop gâté, descendus du noble faubourg au bras d’un imposant valet de chambre. Les scènes inénarrables qu’on voyait! Miss et Bob, rebelles au bain, rebelles aux ciseaux, à toutes les coquetteries dont on les entourait, et enviant, qui sait? l’innommable caniche errant le long des berges, — ainsi que tels d’entre nous furent jaloux, certains soirs de lassitude, des pauvres hôtes errants des quais, des locataires à la nuit des dessous de ponts, de leur liberté, de leur indépendance, de leur existence vagabonde et traversée d’aventures! — et les éclats de rire des badauds penchés au bord des parapets, en présence de ces rébellions inattendues, ou bien encore les péripéties du sauvetage d’un bouchon ou d’une planche à la dérive par quelque bon gros terre-neuve, maniaque du dévouement, dont on se raillait!
Il y avait encore, de place en place, la baignade des chevaux, la cavalcade gesticulante et bruyante des palefreniers et des ordonnances descendus des abords de l’École militaire, du quartier des Invalides, qui entrait dans le fleuve avec des ruades et de grands rires puérils, et dont tant de flâneurs suivaient les ébats. Il y avait les lavoirs improvisés en plein vent, sur quelques pavés lisses, où tout le petit peuple des ports faisait sa lessive, l’été, profitant d’une journée chaude pour savonner un peu l’unique chemise ou le tricot unique, ou le bourgeron, ou même, horreur! le pantalon; multipliant les prodiges d’ingéniosité pour ne pas blesser la pudeur des passants ou seulement pour éviter la pleurésie.
Et le «perruquier des chemineaux», qui s’en allait le long des cales, emportant sous son bras l’essentiel de l’attirail de Figaro: ciseaux, rasoir, blaireau et, en guise de bol à savon, quelque vieille soucoupe, ou la moitié d’une noix de coco, moins fragile! Comme fauteuil, une pierre de taille égarée loin du tas, un sac de plâtre ou de ciment, un madrier. Pour un sou, un petit sou, il opérait, accommodait son patient avec les grâces mêmes d’un Lespès, et ses ronds de bras, et ses hochements de tête satisfaits. Il était, toutefois, plus expéditif: un sou de besogne, cela ne représente pas grand temps. L’opération terminée, le rasé de frais descendait au bord du quai et, comme disent les marins, se débarbouillait à la grande tasse, tandis qu’un autre prenait sa place entre les mains du barbier.
Or, on a démoli et reconstruit tous les quais; on a, pour employer le langage des ponts et chaussées, «transformé les ports de tirage en ports droits,; autrement dit, on a remplacé les cales inclinées qui venaient mourir en pente douce au bord du fleuve, par des quais verticaux qui plongent droit dans son lit. La navigation y trouvera plus de facilités. Seulement le moyen, maintenant, pour les baigneurs de chiens, pour Figaro, pour leurs clients, de s’approcher de l’eau, tour à tour miroir, lavabo et lavoir? Et où vont-ils s’en aller, tous, les perruquiers des bêtes et ceux des pauvres hères sans feu ni lieu?
Mais où sont déjà partis les arbres qui, l’été, leur versaient charitablement un peu d’ombre?
On en a fait un grand carnage, tant pour la construction de l’Exposition que pour l’établissement des deux gares d’Orléans et de l’Ouest, corollaires de l’Exposition. Du Jardin des Plantes à l’île des Cygnes, on a transplanté, coupé, arraché. Et avec tant d’hypocrisie! Ici, un fétichisme ridicule; là, des cruautés systématiques. Aux Commissaires étrangers on imposait, dans la construction de leurs pavillons, un respect absolu des plantations. En vain, ils proposèrent, collectivement, de déplacer à leurs frais, pour les mettre au vert dans les pépinières de la Ville, les arbres qui les gênaient, puis de les replacer, les travaux de démolition terminés. On fut sourd à ces propositions. On a préféré infliger aux pauvres martyrs des traitements dignes des Sioux. Ainsi, au pavillon de l’Impératrice Marie, à l’Esplanade des Invalides, on a mis l’architecte russe dans la nécessité de déguiser en piliers, pour sa construction, quatre ou cinq ormes vénérables, de les habiller de corselets de zinc enduits de plâtre, cerclés de bases et de chapiteaux. Ils en mourront, c’est bien certain, mais du moins on aura semblé déférer aux injonctions des sylvains de la presse.
A côté de cela, on a très sournoisement, nuitamment, dans le plus grand mystère, fait choir sous le fer d’innombrables platanes.
On avait, d’ailleurs, d’admirables possibilités de les faire disparaître: on avait besoin de tant de bois! Sitôt pris, sitôt pendus: on les abattait à l’aube; au grand jour ils étaient équarris; le soir enfouis dans les pilotis. Ainsi le regretté Dumollard en usait avec les servantes, vers 1855, à l’époque, justement, de la première Exposition universelle.
J’eus pourtant une fois ce divertissement morose de voir opérer les meurtriers, un jour qu’ils s’étaient sans doute attardés à d’autres besognes et n’avaient pu faire disparaître avant le plein midi les traces de leur dernier forfait.
C’était à l’Esplanade des Invalides, au bord du quai.
Un platane gisait sur le sol, tronc superbe, à l’épiderme marbré de squames, navré d’affreuses blessures rouges par où suintait toute sa sève. La veille encore, évidemment, il était debout, tendant vers le ciel des rameaux pleins d’espoir en le printemps prochain et gonflés déjà de sucs généreux prêts à jaillir en bourgeons verdoyants.
En bas, le «mouton» s’acharnait à coups redoublés sur d’autres pieux trop neufs, les voisins, les frères de ce mutilé, exécutés quelques heures avant lui; et chaque coup faisait mousser, sur la section tout humide faite par la scie, un peu d’écume. Lui, on allait l’équarrir; des marques de craie sur son écorce indiquaient au charpentier les arêtes à dresser. L’homme était là, au milieu d’un cercle de curieux attentifs, haut, large, les épaules saillantes sous son maillot de laine, et la main au manche de la hache. Il attaqua le grand cadavre étendu à ses pieds... La hache tournoyait comme le glaive du bourreau, traçait dans l’air un arc d’argent, et d’une poussée folle entrait dans l’aubier rosé qui saignait; puis, sous je ne sais quelle contraction des poings nerveux, s’arrêtait net à la marque blanche, aplanissait, taille à taille, la face voulue, avec la précision qu’y eût mise un ciseau entre des doigts experts. Et la prestigieuse habileté de cet ouvrier superbe rendait presque indulgent pour le crime dont il était complice.
A tout cela je resongeais, cette matinée d’avril en descendant la Seine en fête, l’âme occupée de ce regret que nous gardons aux êtres et aux choses que nous ne reverrons jamais plus. Je songeais aux beaux arbres disparus, au petit monde qui vivait à leur ombrage, baigneurs de chiens et perruquiers des chemineaux, aux chemineaux eux-mêmes, torses nus, ruisselants de sueur, bruns et luisants sous le soleil comme des bronzes, et jusqu’à ces bandes de corneilles familières de la rive gauche, qu’abritaient paternellement les beaux ormes du quai d’Orsay toujours désert, et qui, chassées par le tumulte des marteaux et des truelles, durent, passant les ponts, s’en venir, ce printemps dernier, accrocher les grosses pelotes noires de leurs nids aux platanes d’en face, au quai Debilly... A tous ceux qu’on exila, je pensais....
.... Et puis à vous,
Andromaque, des bras d’un grand époux tombée....