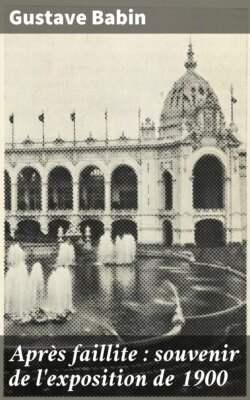Читать книгу Après faillite : souvenir de l'exposition de 1900 - Gustave Babin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BOIS CONTRE FER
ОглавлениеAvril.
Je flânais, un joli matin du dernier été, au quai d’Orsay, parmi les fantaisistes constructions de la rue des Nations.
La plupart n’étaient encore qu’à l’état de squelettes, et j’admirais les prestigieuses architectures que dessinaient dans l’air assoupi tant de charpentes, tant d’échafaudages.
Telles de ces armatures paraissaient équilibrées à peine, une poutre étayant l’autre, des fermes se maintenant on ne sait comme, au point qu’on se demandait si ce n’était pas la plus élémentaire prudence qui conseillait de profiter, pour les lever ainsi, de la saison où les brises sont occupées ailleurs. Il y en avait d’invraisemblables, de paradoxales, et qui semblaient le linéament fragile de chimériques châteaux de conte bleu, éclos une nuit pour quelque féerique fête sans lendemain, évaporés, fondus aux premiers rayons de l’aurore prochaine. Le fin réseau des mâts, des manœuvres, des vergues sur le ciel mouvant d’un port, n’est pas plus délicat que les dentelles capricieuses qu’avaient tendues ici les charpentiers. Ces échafaudages et ces charpentes de l’Exposition entière nous ont procuré, d’ailleurs, à nous tous qui avons suivi au jour le jour les travaux préparatoires, des joies d’art sans mélange que nous ne devions plus guère retrouver devant les maçonneries vraies ou fausses des constructions achevées. Traversées tantôt de flèches lumineuses jouant à travers leurs mailles, tantôt découpant sur des ciels incolores leurs toiles aranéennes, avec le jour, avec le temps, leurs aspects variaient à l’infini. Ces ossatures compliquées de sapin neuf, bleuâtres aux premières heures, se doraient par les beaux après-midi, s’empourpraient au crépuscule; sous le voile de l’averse, elles sombraient, s’évanouissaient comme des vapeurs, revêtaient des aspects fantômatiques, se reculaient dans le mystère; on songeait alors à la royale avenue d’une léthargique Thulé, abandonnée avant l’achèvement, ruine que dissolvent lentement les brumes.
C’était, dans les formes, la même variété. Tandis que le lourd dôme des Etats-Unis, si laid, si pataud dans son état définitif, jaillissait de son tambour en fuseaux, ceux du pavillon autrichien, incurvés à mi-hauteur, dessinés par des cercles parallèles évoquaient le souvenir falot d’une cage de crinoline. Plus loin, c’étaient des tours, de hauts clochers pointus, et des plates-bandes, et des frontons.
Et dire que pas un tableau, pas même une gravure magistrale ne nous conservera l’image de ces merveilles! Cependant que s’édifiaient tant de palais; que, dans cette ville bouleversée, méconnaissable, le pittoresque fourmillait, nos chers maîtres peinaient devant d’insaisissables paysages, congelaient sur des toiles des mers décourageantes de fluidité et de vie. Nous étions quelques douzaines, dans Paris déserté, à jouir en paix de ces visions de rêve.
Or, je m’applaudissais précisément de cette solitude où nous laissait le grand exode traditionnel vers la montagne ou vers la plage, et qui nous permettait de savourer tranquillement nos plaisirs, quand un vieil ouvrier passa, une pioche et une pelle sur l’épaule, bonne figure grisonnante et hâlée, avec deux yeux clairs, très riants. Il toucha du doigt sa visière, à la façon des militaires, et je saluai de mon sombrero gris. Nous suivions le même chemin, dans la direction des Invalides; il m’avait vu le nez en l’air, dans les charpentes; d’un coup, il entama la conversation au bon endroit.
«Eh bien! proféra-t-il, c’est la quatrième Exposition à laquelle je travaille; mais je n’ai jamais vu employer tant de bois!»
Ah! voilà un brave homme qui n’avait pas regardé sans voir, et encore que, sans doute, il n’eût pas été au nombre des invités du «bal des Nations», en 1867, j’aurais pu le feuilleter un moment sans ennui, si nous avions été tous deux de loisir. Mais nous ne pûmes échanger que quelques réflexions. Devant le pavillon de la Belgique, il me quitta: il était arrivé à son chantier.
L’ÉCHAFAUDAGE ROULANT DU GÉNIE CIVIL
Du moins, sur un point, avait-il porté un jugement précis: il constatait la revanche du bois à l’Exposition de 1900.
Les vingt et un coups de canon qui saluèrent, en 1889, l’apparition des trois couleurs françaises au faite de la tour Eiffel saluaient aussi l’apothéose du fer.
Il triomphait partout.
D’abord dans cette vaine cheminée de 300 mètres, laide, sans doute, mais où était réalisé tout de même un joli tour de force; dans les palais entiers du Champ de Mars, ces deux souriants palais versicolores de M. Formigé, cette galerie de M. Bouvard, d’une esthétique contestable et qui permit aux clairvoyants de présager, dès que commencèrent les travaux de l’Exposition actuelle, la maigre somme de beauté qu’elle nous révélerait, puisque l’auteur du Dôme central devenait le grand ordonnateur de l’architecture de 1900; dans cette imposante galerie des Machines, enfin, qu’on vient de mutiler si inutilement, dans cette galerie des Machines dont nul, je pense, n’a pu franchir pour la première fois la porte sans demeurer ému au seuil, écrasé devant la grandeur de ses arcs qui venaient de renouveler, de rajeunir, en l’amplifiant, le miracle de l’ogive gothique, nef prodigieuse qui nous émerveillait encore par sa hardiesse, par son immensité, par l’harmonie de ses proportions, aussi, quand elle nous apparut vide, prête à être livrée, pour la mise à sac, aux architectes et aux charpentiers d’à présent.
Cette fois, il est partout en recul sensible; et au moment même où la moindre des maisons de rapport est charpentée en fer, armée partout de fer, l’Exposition de 1900, en majeure partie, est construite en bois. Partout où l’emploi du métal n’a pas été impérieusement exigé par les dimensions des vaisseaux, son rival a fait un retour offensif.
Tous les pavillons des puissances, au quai d’Orsay, à part deux ou trois, — celui de l’Angleterre, où l’on a même renchéri dans l’emploi du métal, puisque les murailles entières y sont revêtues de tôle; celui de la Belgique, encore, édifié en ciment armé, — tous ces pavillons sont charpentés en bois. En bois également le palais des Armées, le pavillon des Forêts, le palais de la Navigation de Commerce; en bois, le pavillon des Congrès et le pavillon de la Ville de Paris et l’une des serres de l’Horticulture, au Cours la Reine; et le Vieux Paris, lui seul, au quai Debilly, a utilisé dans ses fondations des milliers et des milliers de troncs géants. Au Trocadéro, tout le long des quais, des forêts entières sont enfouies. Et je ne parle pas des innombrables «attractions» dont la construction a englouti des cubes invraisemblables de sapin, à épuiser la Norvège et les Alpes; de tous les petits théâtres, les panoramas, maréoramas, cinéoramas, dioramas et «autres ramas», comme on disait, d’après Balzac, dans les agences d’architecture, qui s’échelonnent de la Concorde au quai de la Cunette, à droite, à gauche, sur terre, sur pilotis, partout. Et je comprends, devant cet amoncellement de pieux, de poutres, d’arbalétriers, de moises, de pannes, de chevrons, l’étonnement de mon vieil ouvrier du quai d’Orsay.
Ce n’est pas encore sous ce rapport, je pense, que l’Exposition résume honnêtement les tendances du siècle,
Je sais, d’ailleurs, et je vais vous dire les raisons qui militaient en faveur du bois. Dans plus d’un cas, c’était une nécessité que d’y recourir.
Il y avait d’abord dans son emploi une question d’économie.
Si, en temps ordinaire, la construction en bois est déjà sensiblement meilleur marché que la construction en fer, qu’on songe à la situation qui se présentait depuis deux à trois ans: les usines, surmenées, n’arrivaient pas à fournir à la prodigieuse consommation qu’entrainaient les entreprises, parallèles à l’Exposition, de deux gares dans Paris, du Métropolitain, sans parler du regain d’activité et, partant, des demandes que déterminait, dans la France entière, l’approche même de la «Foire du Monde» ; les prix du fer haussaient dans des proportions inusitées, doublaient presque, je crois; de plus, à un moment donné, on put envisager la perspective de payer le charbon au prix du diamant.
La production des hauts fourneaux et des usines fut du coup ralentie, par suite de cette dernière crise, au moment même où les besoins étaient le plus pressants; toutes les constructions entreprises à la dernière heure dans l’Exposition, cafés, restaurants, théâtres, durent, par force, être édifiées sur des charpentes en bois.
L’obligation où l’on était de construire vite et d’être prêts à date à peu près fixe fut une raison aussi de l’adoption des bois comme matériaux de charpente, dans la plupart des cas. Dès le début des travaux, les architectes eurent la sagesse de prévoir que jamais la métallurgie, même au poids de l’or, ne pourrait arriver à satisfaire en temps voulu à toutes les demandes. Et les deux causes se tiennent, comme on voit: la raison d’économie et la difficulté de s’approvisionner.
Donc, au moment où l’on croyait son règne révolu, au moment où l’on allait le confiner dans les usages auxiliaires, construction de palissades ou d’échafaudages de service, le bois fait une réapparition imprévue; il entame contre son victorieux rival une lutte suprême.
Comme pour justifier une intervention aussi inattendue, il risque des fanfaronnades, il s’associe aux tentatives les plus aventureuses, mettant, dirait-on, une sorte de coquetterie à apparaître une fois encore en beauté. L’expérience des bâtisseurs en fer a profité aux charpentiers.
Au Champ de Mars, pour servir au montage des fermes du palais du Génie civil, ils édifient un pylône roulant qui émerveille même les ingénieurs, habitués aux prouesses. Ils entassent les poutres, les entretoises, les escaliers, superposent les paliers aux paliers jusqu’à vingt-cinq mètres de hauteur.
Et cette machine formidable et légère se déplace, glisse sur des rails d’un bout à l’autre du chantier avec une aisance parfaite, accourt partout où l’on a besoin d’elle, apportant des équipes entières d’ouvriers. Dites au métal d’en faire autant!
Au palais des Beaux-Arts, aux Champs-Élysées, quand il s’agit de mettre en place la coupole, la piste tout à coup se hérisse d’un tel entassement de madriers entrecroisés, que les fantaisies les plus folles du crayon et du burin courant, affranchis de toutes impossibilités et de toutes invraisemblances, sans autre règle que le caprice, paraissent du même coup dépassées. Les «chandelles», les hautes pièces verticales qui, rangées en cercle, constituent les piliers d’appui de toute la masse, s’élancent à des hauteurs vertigineuses avec une si belle crànerie, l’ensemble de la passagère construction donne une si complète impression de puissance alerte qu’on se prend à regretter de voir tant d’adresse, tant d’art dépensé pour une si brève durée.
LES ÉCHAFAUDAGES DU GRAND PALAIS
Et puis, cette masse énorme, invraisemblable, constitue presque un instrument de précision; elle vit, puisqu’elle peut se mouvoir. Des vérins la supportent et, au moindre affaissement susceptible de compromettre sa stabilité, vont la redresser, la remettre d’aplomb, bien en équilibre.
Un autre échafaudage tout grêle, haut et fier comme une tour, circule de long en large sur des voies, à travers le même palais, balançant à son sommet de longs fléaux pareils à des bras, capables d’atteindre n’importe quel point des arceaux à monter. Et ce n’est que grâce à ces deux gigantesques engins, l’échafaudage circulaire de la coupole, l’échafaudage mobile, que le fer peut aller tout là-haut essayer dans les cintres ses grâces d’acrobate.
Mais la merveille était peut-être à la galerie des Machines, où, pour l’édification de la salle des Fêtes, si saugrenue en soi, comme invention, s’entrelaçaient dans un fouillis, dans un pêle-mêle de chaos, les deux ennemis, le fer et le bois, chacun portant l’autre à tour de rôle: le bois ici employé comme échafaudage au montage des fers, le fer là encadrant les pans de bois dont sont formées, avec un revêtement de plâtre, les murs mêmes de la salle.
Dans tous ces ouvrages, le bois ne joue que le rôle d’un utile auxiliaire; plus loin nous le verrons tenir les premiers emplois, suffire aux usages les plus multiples, tantôt membrure de toits arrondis en calottes, effilés en flèches, renflés en tiares; tantôt âme et armature des façades de palais; tantôt épine centrale de colonnes ou de pilastres, suppléant la pierre dans ses besognes de portefaix; tantôt formant la membrure des architectures les plus inattendues, par exemple de cet absurde Globe céleste du Champ de Mars; plus loin, enfin, fournissant au constructeur des éléments décoratifs d’une infinie variété, ainsi dans les cloisons séparatives des palais et dans l’aménagement des classes, ainsi dans ces serres du Cours la Reine où il rayonne à la place d’honneur, découpé, festonné en fins treillages, habillant comme d’une parure de pliantes lianes les rèches arcades de fer, prenant je ne sais quelle allure de renouveau, tant ce mode ornemental était oublié, délaissé.
Et, dans ces fonctions multiples, il affirme une plasticité, une souplesse infinie égale à son audace. Alors que le métal demeure, à peu près partout, rude et sans grâce, le bois, docile, se laisse travailler, recourber, se prête à tous les caprices du décorateur ou de l’architecte, s’attendrit sous le ciseau qui l’entame, s’amollit sous les doigts qui le ploient, offre d’inépuisables ressources, justifie, en somme, le regain de préférence dont il jouit.
Or, tandis que le bois accomplit ces prouesses, le fer, je l’ai dit, bat en retraite; il se terre.
Sans doute, il demeure l’élément fondamental de tous les grands palais, au Champ de Mars, à l’Esplanade des Invalides: sans doute on en a construit tous les halls de quelque importance. Il se juche, en une cage saugrenue et d’une décourageante hideur, au-dessus du palais des Fils, Tissus et Vêtements, près de l’avenue Le Bourdonnais, et, de tout le grand palais des Champs-Élysées, les promeneurs n’aperçoivent, du plus loin, qu’une lourde toiture de métal et de verre. Il forme l’ossature encore, dans la galerie des Machines, mutilée, tronçonnée, de l’énorme et inutile salle des Fêtes. Mais on l’a utilisé sans conviction, et comme à contre-cœur.
Ceux qui bâtirent l’Exposition de 1889 aimaient le fer pour lui-même, pour les grandes choses qu’il permettait d’accomplir, pour les espérances qu’on pouvait fonder sur lui. Ils aspiraient à lui voir jouer un jour un autre rôle que le rôle utilitaire où il était confiné, rêvaient de le venger de l’injuste dédain où il avait croupi, jusque là, aux yeux des architectes, relégué dans le demi-jour des intérieurs; ils souhaitaient de l’attirer à la grande lumière, de l’associer à la gloire de la pierre dans les façades, dans la décoration des édifices. L’ambition n’était pas mesquine.
Les architectes d’aujourd’hui n’ont ni le même idéal, ni les mêmes ferveurs. Mieux: on pourrait supposer qu’il y a dans leur attitude à l’égard du métal plus que de l’indifférence et plus que du dédain, et maintes fois je me suis surpris à me demander s’ils n’avaient pas, d’un consentement unanime, tacite, peut-être, conspiré pour se relever de la retentissante défaite que leur avaient infligée, à la dernière Exposition, les ingénieurs, et si 1900 n’était pas, plutôt qu’un démenti, plutôt qu’un revirement, une revanche de 1889. Le surprenant, c’est seulement que cette revanche soit prise par eux sous le proconsulat d’un ingénieur aussi convaincu que M. Alfred Picard. Aurait-il donc tremblé qu’on ne l’accusât de favoriser trop les camarades?
LA SALLE DES FÊTES
Le fait certain, c’est que le rôle décoratif du fer, cette fois-ci, est, autant dire, nul dans les palais officiels, construits par les architectes de l’Administration.
Timidement, avec des pudeurs de jeune vierge et des maladresses de cyclope, le constructeur du grand hall des Champs-Élysées a essayé de tirer du métal lui-même les motifs d’ornementation de ses charpentes, en découpant ses tôles, en les gaufrant et les frisant bien gauchement et bien grossièrement.
Un peu plus résolument, l’architecte de la salle des Fêtes, M. Gustave Raulin, a abordé le problème dans certaines pièces de ses fermes, les grêles colonnes qui séparent ses travées, notamment; mais nous payons ces semblants de témérité de la vue de bien des staffs et de bien des peintures lamentables.
Tout près de là encore, le pont roulant électrique des sections étrangères, aux galeries de la Force motrice, cet engin formidable et si alerte apporté par les Allemands, témoigne de vagues aspirations à l’élégance, avec son arc treillissé, épousant la courbe même des fermes du hall qui l’abrite. Mais c’est là bien peu de choses; presque partout ailleurs, le fer est planté grossièrement, sans art, conserve des dehors de piles de viaduc, de grosse chaudronnerie, rebute par son aspect trop brutal, par la sécheresse de ses angles, par la roideur de ses courbes, sans souplesse et sans vie.
Certaines tentatives, d’ailleurs peu révolutionnaires, pour renouveler un peu les formes générales des nefs, ne sont pas à imiter. Les fermes des deux palais de l’Industrie chimique, et des Procédés généraux de la mécanique, au Champ-de-Mars, composées de parties rectilignes raccordées par de brèves courbes, et ainsi se rapprochant du dispositif des charpentes en bois, semblent, par un fâcheux effet de perspective, se rebeller et se redresser là-haut, et vouloir soulever le vitrage qu’elles portent à la façon d’un toit chinois, retroussé et grimaçant.
M. Blavette, au palais des Fils, a, dans ses grandes nefs, adopté un système de piliers qui, verticaux sur leur face extérieure, vont se renflant de bas en haut, perpendiculairement à la nef, sur leur face interne, et je veux croire qu’il a été guidé par d’autres raisons que des considérations d’art pur, car au point de vue de l’impression, l’effet de ces piliers fichés en terre par la pointe, pour ainsi dire, est peu rassurant. Mais ce défaut, encore acceptable dans ces vaisseaux immenses, ce défaut devient tout à fait choquant aux Invalides, dans le palais construit d’après le même principe par M. Esquié. Comme les espaces, ici, sont beaucoup moins vastes, que le manque de parallélisme des deux lignes de piliers opposées saute aux yeux d’une façon plus évidente, l’équilibre apparent du hall est détruit du coup. On voit les fermes chanceler, appuyées l’une sur l’autre, s’étayant comme deux ivrognes, oscillant, à la merci de la première brise un peu forte. Et ce n’est pas, parbleu, pour leur donner des émotions pareilles, que l’on convie les gens à vous venir rendre visite. Sortons, sortons vite!
Mais en face, du côté de la rue Fabert, chez MM. Larche et Nachon, ce sont des fantaisies pires encore: voici des piliers en deux morceaux, et qui semblent montés sur des échasses. Leur base, en effet, est très menue. Et puis, brusquement, à quelques mètres du sol, un ressaut, un encorbellement, en quelque sorte, et la ferme repart, plus massive, plus trapue. On dirait que le métal a manqué et qu’on a dû enter, tant bien que mal, et souder un support de fortune pour surélever à la hauteur voulue une cage d’abord trop basse. On pense à des ferrailles d’occasion, achetées au rabais et adaptées ensuite, à l’aventure, à une destination nouvelle. Par exemple, on cherche en vain à quelles nécessités de construction les architectes ont obéi et quel pouvait bien être l’intérêt de cet essai malencontreux.
Je me borne à ces quelques exemples, d’où vous pourrez conclure, s’il vous plaît, que l’art audacieux des Eiffel, des Dutert et des Contamin est, pour le quart d’heure, quelque peu somnolent.
Cependant, suivez-moi. Pas bien loin: jusqu’au bord de la Seine, jusqu’à un coin tranquille d’où l’œil embrasse en son ensemble le pont Alexandre III.
Voici ce que font les ingénieurs dès qu’on laisse à leur génie la bride sur le cou. Et quoi que les architectes aient tenté pour en altérer la mâle beauté, cette œuvre constitue un joli dédommagement à tant d’insignifiances et de platitudes, à tant de capitulations et d’apostasies.
Cette voûte d’acier de 107m 50 d’ouverture, supportant, par l’intermédiaire de sveltes montants, un tablier tout mince, est réellement d’une crânerie, d’une légèreté merveilleuses. Elle semble poser à peine sur les rives, souple comme une lame d’épée, robuste, néanmoins, à défier les ans. Ses arcs s’élancent de la berge de granit avec l’aisance de l’osier penchant tendu au-dessus d’un ruisseau. Et il y a dans son enjambée une allégresse irrésistible, une aisance telle qu’on ne perçoit pas, tout d’abord, Je tour de force. Car il est de par le monde des viaducs plus imposants par leurs dimensions, et, même dans Paris, nous avons été préparés à la naissance de celui-ci: le pont Mirabeau, d’Auteuil à Grenelle, n’est guère moins hardi; M. Jean Résal, l’ingénieur éminent qui les a construits tous deux, s’était en quelque sorte fait la main dans ce précédent ouvrage. Tout de même, son dernier né l’emporte en envolée: le pont Alexandre III marquera, dans l’art de bâtir en fer, une date, au même titre, presque, que la galerie des Machines de 1889. En dehors, en effet, de ses dimensions très respectables, de sa forme nouvelle, — il est le pont le plus surbaissé qui existe, — et des difficultés d’établissement qu’il a présentées en raison même de cette forme; en dehors encore de la hardiesse de ses lignes, il aura eu, au regard des ingénieurs, ce mérite de leur révéler un procédé nouveau de construction, de mettre à leur service une matière jusque-là inemployée à de pareils usages, l’acier moulé.
A voir le résultat superbe qu’ont obtenu pour ce coup d’essai M. Résal et M. Alby, qui fut son collaborateur, on peut attendre beaucoup de cet auxiliaire survenu aux constructeurs de grands travaux publics.
Vous venez de voir une œuvre de fer belle de puissance et d’audace. Suivez-moi encore, et nous allons découvrir le métal sous un jour plus inattendu.
C’est au Champ de Mars, au milieu de cette file de palais qui longe l’avenue de Suffren, au palais du Génie civil et des Moyens de transport.
Un architecte s’est trouvé, M. Jacques Hermant, qui, chargé d’installer à Chicago la section française, fut très frappé de l’impression d’extrême légèreté que laissaient les fermes de diverses galeries. Auprès de ce lacis ténu de tirants et d’entretoises, nos constructions en fer, à nous, lui apparurent massives, d’une lourdeur inutile, et donnant la sensation d’une matière gaspillée ou mal utilisée. La galerie des Machines, qui si fort nous émerveilla, et qui demeure une imposante chose, l’œuvre, en tout cas, de précurseurs, lui sembla pourtant, à distance, un travail presque barbare, loin, du moins, de la perfection, et un peu à côté du problème, rapproché du hall des Manufactures édifié par les Américains. Et, ayant étudié et comparé les charpentes des deux édifices, il s’avisa qu’il y avait deux façons très différentes d’employer le fer, et que les constructions métalliques peuvent, en dernier ressort, se résumer en deux types: le pont et le hall.
Dans le premier cas, il s’agit de créer un ouvrage peu encombrant, qui laisse au-dessous de lui le plus grand espace libre et qui s’élève aussi peu que possible, afin d’éviter, pour l’établissement des chemins d’accès, des terrassements coûteux; un ouvrage où le métal soit ramassé, condensé, pour produire, sous un minimum de volume, le maximum de résistance. Dans le second cas, au contraire, il faut jouer avec la souplesse du fer, alors qu’on mettait à profit tout à l’heure sa robustesse; il faut créer pour la toiture un support léger, élastique comme une lame de fleuret, et qui supportera le vitrage sans effort apparent, avec la même aisance que l’armature d’une ombrelle en tend la soie changeante. Nous avions, jusqu’ici, le tort d’appliquer au hall le principe du viaduc.
Ayant donc à construire un hall, M. Jacques Hermant a adopté résolument le parti américain. Il s’est efforcé de répartir sur de grands espaces des organes métalliques très fins. Il a écarté autant qu’il a pu ses entretoises en les allongeant, aminci ses supports, quitte à les multiplier.
Il a obtenu ainsi des fermes d’une grâce, d’une légèreté inouïe. Il a réalise une œuvre audacieuse, neuve, pleinement belle et que nous aurons l’occasion d’analyser.
LES FERMES DU GÉNIE CIVIL
On ne saurait trop l’en louer; on ne saurait trop le remercier de cette joie, de cette consolation qu’il nous donne au milieu des défections partout visibles. Par lui, l’art du constructeur en fer a fait chez nous un pas vers la beauté inconnue.
Mais c’est là le seul effort sérieux de l’architecture dans la voie nouvelle, — car je mets à part les serres du Cours la Reine, qui, je crois, nous intéressent à un autre point de vue. — Partout ailleurs, vous la verrez frappée de stérilité, impuissante à créer, dans le style monumental, des formes inédites, ou seulement à rafraîchir les vieilles ordonnances. C’est en vain qu’on aura mis à sa disposition des matériaux merveilleux, à la fois malléables à l’infini et résistants jusqu’à l’invraisemblance. Ou bien elle veut les ignorer, ou bien, les pratiquant, elle se défend d’avoir de si mauvaises connaissances; et quand, d’aventure, il lui faut, bon gré, mal gré, recourir à leur aide, elle nie, plus tard, honteuse, le concours qu’ils lui ont offert; elle les dissimule, les enfouit sous l’amas hypocrite des pierres et des plâtras; elle rougit d’avouer ces fréquentations plébéiennes: le granit seul ou le tuf, ou ce qui les imite, même, sont de grande race et de bon ton.
Ce qui caractérisera les artisans de cette Exposition, c’est leur haine de la vérité nue, leur haine, je le répète, du fer,... et de l’ingénieur qui si cruellement les humilia dix ans plus tôt.
Ils ont réagi de tous leurs efforts dans les bâtisses neuves qu’ils ont construites; ils s’en sont pris même à ce qu’ils ne pouvaient détruire et qui les offensait par une crânerie démodée: à la galerie des Machines, qu’ils ont mutilée, découpée en tronçons, comme on fait d’un serpent malfaisant qu’on rencontre, et lors du concours ouvert au début de la période de préparation, en vue de déterminer le plan général de l’Exposition, la tour Eiffel eut à subir de leur part les pires attentats et les derniers outrages, ici flanquée de cariatides, là habillée de plâtre, rasée, découronnée, affublée tour à tour en déesse et en éléphant.
Elle a résisté. Elle est debout, insolente, la tête dans la nue, presque jolie, maintenant, par comparaison, parée de sa seule franchise, en face de tous ces édifices mensongers, intéressante comme toutes les victimes, et il est des soirs où le panache tricolore de son phare flambe de je ne sais quelles lueurs de triomphe. Qu’elle demeure sereine dans l’attente de la revanche du fer. L’avenir est à elle, et puisqu’elle doit survivre à ces palais de boue et de crachats qui l’avoisinent, elle reverra luire les grands jours.
Que les foules s’arrêtent, surprises et ravies, au seuil du palais du Génie civil, tout défiguré qu’il soit par les cloisons et les vitrines, c’est déjà un présage heureux, cela.