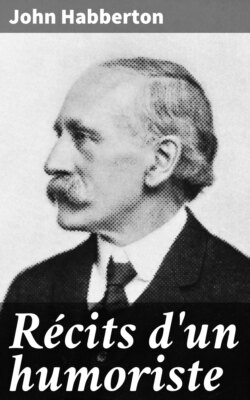Читать книгу Récits d'un humoriste - Habberton John - Страница 5
II.
ОглавлениеPendant les quinze jours qui suivirent, nous passâmes bien des heures à visiter les marchands de meubles, de tapis, de tableaux et de bric-à-brac. Ai-je besoin de dire que ces expéditions ruineuses, qui faisaient la joie de Wilhelmine, m’amusaient beaucoup moins? Je ne chercherai pas à vous apitoyer sur mon sort; je sais trop que les dames surtout ne me plaindraient guère. Comme l’aimable agent, après la signature du bail, avait eu la bonté de me prévenir que les prix, en général, étaient plus élevés dans la Vallée des Villas qu’à New-York, j’avais eu soin d’expédier d’avance une quantité raisonnable de provisions. Enfin le tapissier, ayant annoncé que les parquets étaient couverts et les rideaux posés, nous partîmes en compagnie d’une servante irlandaise que nous venions d’engager. Trois voitures de déménagement nous avaient précédés, de façon à nous rejoindre à heure fixe, car ma femme désirait présider elle-même à l’installation des meubles. Arrivés à la station, nous montâmes dans un fiacre pour nous rendre à notre nouvelle demeure.
Le cheval qui nous traînait semblait poussif; le cocher était ivre et son équipage malpropre, trois choses qui ne sont pas de nature à inspirer des idées poétiques. Néanmoins, chemin faisant, Wilhelmine, pour employer sa propre expression, éprouva la joie ineffable que dut ressentir Junon le jour où elle se vit accueillie en maîtresse sur les hauteurs de l’Empyrée. Quant à moi, trop modeste pour me comparer à Jupiter, je ne songeais pas sans orgueil que j’allais posséder un foyer à moi. C’est là, on le sait, le rêve de tout véritable Anglo-Saxon.
Le soleil inondait le cottage de ses rayons. Les stores et les rideaux neufs, entourés d’un cadre de verdure, produisaient un joli effet. Les oiseaux nichés dans le lierre gazouillaient comme pour nous souhaiter la bienvenue. Je finis presque par partager l’enthousiasme de ma compagne. J’ouvris la porte, et Wilhelmine entra la première dans notre salon.
–Bonté du ciel! s’écria-t-elle.
Le juron qui s’échappa de mes lèvres ne doit point figurer sur cette page; mais, si je fis preuve de vivacité, cette vivacité me semble excusable.
Un tonneau de farine, des pains de sucre et de savon, un barillet de mélasse, une caisse de chandelles, une jarre d’huile à brûler, des fruits secs, un baquet de beurre et diverses autres denrées couvraient le parquet, émettant une odeur d’épiceries aussi complexe que désagréable. La farine et la mélasse avaient coulé à travers les douves mal jointes; la caisse qui contenait le savon s’était ouverte, et plusieurs briques de cet utile objet de ménage avaient été collées au tapis par un talon de botte d’une dimension peu commune.
Wilhelmine s’avança avec tant de précipitation, qu’elle marcha dans une mare de mélasse, de sorte que la semelle de ses petites bottines parut vouloir rester attachée au sol.
–Ah, notre pauvre tapis! Quel horrible gâchis! s’écria Wilhelmine, qui, dans certaines circonstances, ne reculait pas devant une locution triviale.
–Pour combler la mesure, ajoutai-je en regardant par la croisée, les voitures arrivent, et celle où se trouvent les meubles du salon ouvre la marche.
Fort heureusement, nos commissionnaires étaient obligeants, ou du moins ils le devinrent. Dès que je leur eus promis un bon pourboire, ils transportèrent les provisions dans la cuisine. Puis leur chef consentit à nous céder une vieille pièce de toile cirée, sans exiger plus du triple de ce qu’elle valait étant neuve. Cette toile fut étendue sur le parquet afin d’éviter de nouveaux dégâts pendant que l’on viderait la première voiture. Les hommes étaient trop pressés pour laisser à la servante le temps de nettoyer le tapis. Wilhelmine se chargea de donner les ordres nécessaires; mais bientôt elle se montra très embarrassée.
–Cela ne tiendra jamais ici, dit-elle.
Et elle disait vrai. Une salle vide paraît toujours plus grande qu’elle ne l’est en réalité. Faute d’expérience, j’avais négligé de prendre la mesure des chambres. Une table ronde, une table à jeu, un piano, deux étagères, une causeuse, quelques fauteuils, une demi-douzaine de chaises et autant de tableaux, ce n’est certes pas trop pour un salon d’une dimension ordinaire. Par malheur, le nôtre était beaucoup plus petit que nous ne l’avions cru avant d’essayer d’y faire entrer nos emplettes.
–Le seul moyen d’en venir à bout, dit un des déménageurs, c’est d’entasser les meubles comme dans la boutique d’où ils sortent.
En effet, il n’y avait pas d’autre alternative. Wilhelmine se résigna donc à cet arrangement provisoire. Elle insista toutefois pour que la causeuse fût roulée en face de la fenêtre, et, à force de patience, on réussit à la contenter.
–De cette façon, me dit-elle, nous pourrons au moins nous asseoir là, afin d’admirer le coucher du soleil lorsqu’il répandra sur ces collines ses derniers rayons empourprés. Miséricorde, Pedro! où allons-nous fourrer le piano?
Le piano était déjà à la porte. Le chef des déménageurs, après avoir jeté un coup d’œil professionnel sur l’espace resté vide entre la fenêtre et la causeuse, prononça cet arrêt:
–Il y a juste assez de place, madame. Par exemple, il faudra glisser le tabouret sous la table; mais, si l’on tourne le clavier du côté de la croisée, il sera facile de faire de la musique en vous tenant dehors.
Wilhelmine crut d’abord que l’orateur se permettait de railler, et elle lui lança un regard sévère. Comme l’attitude du brave homme était fort respectueuse et qu’il gardait un sérieux imperturbable, elle demeura convaincue qu’il n’avait pas voulu lui manquer d’égards.
–Mettez le piano là en attendant, dit-elle, nous disposerons plus tard les meubles à notre convenance.
Au même instant, on se mit à jurer dans l’escalier; je gagnai non sans peine la porte du salon, et j’aperçus deux des déménageurs qui, bien que le chevet de lit dont ils étaient chargés ne fût pas très lourd, restaient immobiles sur les marches.
–Eh bien, pourquoi vous arrêtez-vous? demandai-je.
Je n’oublierai jamais le coup d’œil expressif dont me gratifia un de ceux que j’interrogeais. Son compagnon s’expliqua encore plus clairement. Il déclara qu’un … (j’omets un adjectif)… imbécile qui s’avisait de meubler une (deux adjectifs à supprimer) … maison, devrait au moins avoir assez d’esprit pour se servir d’un mètre ou pour consulter le tapissier.
Le reproche, bien que présenté sous une forme peu polie, semblait mérité. D’ailleurs, la situation était critique, et le coupable n’avait pas eu l’air de s’adresser directement à moi; aussi imposai-je silence à ma colère.
–Essayez de redescendre ce bois de lit, dis-je, puisqu’il n’y a pas moyen de le monter.
Ils essayèrent, et, grâce au vigoureux coup de main que je leur donnai, nous y parvînmes. Par malheur, nos efforts firent tomber une quantité de plâtras et une partie de la rampe.
–Ça ne passera pas dans l’escalier, ajoutai-je, c’est évident. Je doute même que ça tienne debout dans la chambre à coucher.
Je m’armai un peu tard d’un mètre, et je reconnus qu’il existait une différence de dix-huit pouces en faveur du bois de lit. J’appelai Wilhelmine, qui avait choisi ce bel échantillon de palissandre dont les ornementations devenaient si gênantes. Le meuble coûtait cher; mais les déménageurs déclaraient que leur temps aussi était précieux. L’un d’eux opina que l’on pourrait gagner environ deux pieds en enlevant la bordure sculptée qui décorait le haut de cette couche encombrante. Ma femme se montra plus raisonnable que je ne m’y attendais.
–Soit, dit-elle. Qu’importe, après tout? Un roi découronné n’en est pas moins un roi!
Il paraît que la couronne n’était pas trop solidement attachée, car il suffit de deux ou trois coups de maillet pour l’abattre. Le bois de lit fut installé. D’autres meubles suivirent sans qu’aucune fracture devînt nécessaire. Nous renonçâmes bien vite à les faire entrer tous dans la maison. Le bûcher était spacieux et d’un accès facile; on y déposa provisoirement un admirable buffet, une armoire à glace, un superbe bureau, une douzaine de sièges et diverses caisses contenant des tableaux.
Enfin les trois voitures se trouvèrent vides, et le chef des emballeurs m’adressa un gracieux sourire lorsque je lui remis le pourboire stipulé; puis il contempla d’un air inquiet le toit du cottage et me dit:
–La chose ne me regarde pas, je le sais; mais je n’aime pas à voir gâter de jolis meubles. A votre place, je surveillerais ce toit-là quand il tombera une averse.
Je le remerciai, et il s’éloigna. Je m’empressai de rejoindre Wilhelmine, qui cherchait à mettre un peu d’ordre dans la salle à manger, où, malgré l’absence du buffet, il restait fort peu d’espace disponible.
–Pedro, s’écria-t-elle, nous voici enfin chez nous! Nous ne sommes plus entourés de ces étrangers dont la conversation banale nous importunait! Loin des bruits de la ville, nous pourrons, sans que personne vienne troubler notre admiration pour la sainte nature, écouter le chant de l’oiseau et le murmure du feuillage, nous enivrer du parfum des fleurs, nous …
Tout à coup une tête ébouriffée se montra dans l’embrasure de la porte, et une voix hargneuse demanda:
–Est-ce que vous ne voulez pas dîner, madame?
Wilhelmine m’adressa un regard interrogateur; pour rien au monde elle n’eût avoué qu’elle avait faim.
–Certainement, répliquai-je.
–Où voulez-vous que je fasse la cuisine alors? reprit la bonne.
–Sur le fourneau, parbleu! répondis-je.
–Est-ce que vous croyez que je serais embarrassée s’il y avait l’ombre d’un fourneau dans la cuisine? Pas si bête.
–Sois tranquille, ma chère, dis-je à ma femme, qui me regardait d’un air consterné. Je n’ai pas été soldat pour rien. Je vais allumer un feu de bivouac dans la cour, et je te ferai une bonne tasse de thé. Heureusement, nous avons là des biscuits et de la viande conservée, de sorte que nous ne risquons pas de mourir de faim. Demain matin je commanderai un fourneau.
Le visage de Wilhelmine se rasséréna et la servante se calma. J’envoyai cette dernière chercher de l’eau, tandis que j’allumerais le feu. Son absence dura assez longtemps, et lorsqu’elle revint, ce fut pour nous annoncer d’un ton irrité qu’il n’y avait ni puits ni citerne dans le jardin.
Je me fâchai et je déclarai tout haut que nous avions été bien sots de signer un bail sans nous être d’abord assurés que l’agent n’avait pas menti. Wilhelmine, toujours optimiste, me reprocha mon manque de confiance.
–Pedro, dit-elle, il est indigne d’accuser un de ses semblables de mensonge sur le simple témoignage d’une mercenaire. Je suis convaincue que l’agent a dit vrai; car il a des yeux bleus dont la profondeur annonce la franchise, et d’ailleurs il demeure à côté de l’église presbytérienne.
L’un ou l’autre de ces arguments aurait suffi pour m’imposer silence. Je pris donc le seau, et je me mis moi-même en quête d’un puits ou d’une fontaine. Mes recherches furent vaines;–s’il existait sur les lieux un réservoir quelconque, il était si bien caché, que je ne pus en découvrir la moindre trace. Pour être sûr de mon fait, je parcourus le jardin dans tous les sens; puis je fis le tour des haies qui clôturaient mon domaine. Je venais de terminer mon examen, lorsque je vis s’avancer de mon côté un vieux monsieur qui se promenait la canne à la main, et dont le costume campagnard annonçait un indigène.
–Holàlà! criai-je.
–Holà vous-même! répliqua d’un ton jovial le passant, qui s’arrêta court. Bonjour, voisin. C’est vous qui avez loué le cottage?
–Oui. Connaissez-vous la propriété? L’agent m’a déclaré que l’eau est excellente; seulement, je ne sais pas où la trouver.
–Il parlait sans doute de mon puits, où ses locataires prennent de quoi s’abreuver. Le vôtre a été comblé, il y a plusieurs années, quand on a ouvert la nouvelle route, et maître Hubbell... allons, je ne veux pas médire du prochain, mais on prétend qu’il est trop avare pour en creuser un autre… Bah ! l’eau coule pour tout le monde, et vous êtes libre de remplir vos seaux chez moi. Arrivez!
J’ouvris la porte du jardin, et je suivis mon aimable guide, non sans maugréer contre les yeux bleus de l’agent. Tandis que je revenais, le cœur aussi plein de colère que mon seau était plein d’eau, j’aperçus le visage de Wilhelmine, qui me contemplait avec une admiration bien faite pour dissiper ma mauvaise humeur. Cependant l’effet que son gracieux sourire produisit sur moi fut de courte durée, car elle s’écria aussitôt:
–OPedro, quel joli sujet de tableau pastoral, toi et ton baquet, avec cette pelouse verdoyante au second plan! Si tu avais des rubans à ton chapeau, on te prendrait pour un vrai berger d’Arcadie.
J’eus presque envie de riposter que je devais plutôt avoir l’air d’un rossignol d’Arcadie–c’est ainsi, si je ne me trompe, que certains anciens nommaient les ânes–mais je m’abstins.
Fatigués de notre pénible journée, nous nous retirâmes de bonne heure. Le calme délicieux de notre retraite inspira à ma compagne une foule de réflexions poétiques. Elle parlait, je crois, de la lune dont les pâles reflets allaient bientôt éclairer les croisées de notre cottage, lorsque je devins trop oublieux des soucis terrestres pour garder rancune même à l’agent qui m’avait condamné à remplir le rôle de porteur d’eau. Ce furent les rayons du soleil, tamisés à travers les arbres plantés en face de notre demeure, qui nous réveillèrent. Cela ressemblait si peu à l’appel brutal de la cloche qui annonçait l’heure du lever à la pension bourgeoise, que Wilhelmine, mise en veine d’éloquence, salua l’astre du jour en récitant quelques vers de je ne sais plus quel grand poète américain. En ma qualité d’homme pratique, je songeai d’abord au bureau où ma présence était indispensable, et au déjeuner que j’avais promis d’apprêter, notre bonne nous ayant annoncé qu’elle ne s’abaisserait pas jusqu’à cuisiner en plein air. Ma toilette terminée, j’allumai le feu au même endroit que la veille; je préparai du café, une omelette, des tranches de jambon frit que Wilhelmine déclara exquis–elle ne regrettait qu’une seule chose, l’absence d’un costume de bohémienne approprié au paysage. Après avoir fait amplement honneur à ce repas champêtre, je me mis en route pour la station.
–Songe au fourneau, mon ami, me dit Wilhelmine en m’embrassant. Tu n’oublieras pas non plus d’envoyer le boucher, le boulanger, l’épicier, le…
–Et vous ferez bien aussi d’envoyer une autre bonne, ajouta notre servante, qui se présenta à l’improviste et se chargea de compléter la phrase commencée. S’il faut aller chercher de l’eau au diable deux ou trois fois par jour, ça ne me va pas.
Wilhelmine ne témoigna pas la moindre colère; loin de là, elle haussa les épaules avec un geste plein de compassion et murmura à mi-voix:
–Pauvre fille, elle est dépourvue de tout instinct poétique!
Lorsque je regagnai le cottage à l’heure du dîner, on n’avait pas encore achevé de monter le fourneau, de sorte que ma femme s’était contentée de biscuits pour son second déjeuner, et elle s’en plaignit en termes fort prosaïques. La servante interrompit les doléances de sa maîtresse en venant nous avertir que le fourneau était prêt, mais qu’elle ne pouvait se procurer ni bois ni charbon.
–Comment! m’écriai-je. Il y en a plein la cave.
–Ce n’est toujours pas dans la cave que l’eau manque, répliqua-t-elle. Venez un peu voir.
Me rendant à cette invitation, je descendis cinq des marches qui menaient à la cave; mais je dus m’arrêter à la sixième, le reste de l’escalier étant invisible. Sur l’espace liquide qui s’étendait devant moi flottaient un grand nombre de bûches dont le marchand m’avait garanti la sécheresse. A l’extrémité opposée du cellier, sous un soupirail à travers lequel on avait déchargé le combustible, s’élevait une masse noire qui ressemblait au sommet rugueux d’une roche basaltique. Je sondai le terrain à l’aide d’un manche à balai et je reconnus que l’eau n’avait guère plus de deux pieds de profondeur. Je possédais encore, entre autres souvenirs de mes campagnes, une paire de bottes aussi longues que les jambes de leur propriétaire; je les chaussai, puis je descendis dans la cave, armé d’une pelle et d’un seau à charbon. Comme les bottes n’avaient pas été huilées depuis cinq ans, elles accordèrent l’hospitalité à un ou deux litres d’eau. Lorsque mon pas lourd résonna sur les dalles de la cuisine et que je me débarrassai du seau avec une brusquerie qui fit trembler les casseroles, Wilhelmine battit des mains avec enthousiasme.
–Pedro! s’écria-t-elle, on le prendrait pour un robuste chevalier des temps féodaux. Tu devrais te faire photographier avec ces bottes-là.
Je m’aperçus bientôt qu’en dépit de la faim dont elle avait souffert, Wilhelmine n’était pas demeurée inactive. Elle avait décidé le garçon boulangera ouvrir les caisses qui contenaient les tableaux, et, avec le concours de la bonne, elle les avait transportés dans les chambres qu’ils devaient orner. Le plafond de la salle la plus élevée de notre futur domicile ne se trouvait qu’à six pieds et demi au-dessus du plancher, tandis que le moins grand des tableaux mesurait trois pieds et demi de haut. Wilhelmine, douée d’un esprit inventif, ne s’était pas découragée. Elle avait tout simplement fait poser à terre, appuyées contre le mur, les toiles dont la dimension ne permettait pas de les accrocher.
–Cela donne à l’œuvre du peintre un aspect tout nouveau. Ne trouves-tu pas? me demanda-t-elle.
Je trouvai qu’elle avait mille fois raison, bien que la franchise m’empêchât d’affirmer que le nouvel aspect présentât l’œuvre sous un jour avantageux. A cette époque, comme la mode obligeait les New-Yorkais à encourager les beaux-arts, nos magasins regorgeaient de toiles de rebut achetées à l’hôtel des ventes de Paris, et dont l’unique mérite, à mes yeux, consistait à ne pas coûter cher. Au fond, je ne me désolai pas trop de voir que les paysages choisis par ma femme couraient risque d’être bientôt crevés.
La soirée se passa en vains efforts pour rendre nos chambres moins semblables à un garde-meuble. Nous convînmes qu’il faudrait remplacer les papiers de tenture, dont les couleurs ternies juraient avec l’éclat de nos tapis neufs. J’avoue aussi que les taches que je remarquai sur le plafond me firent songer à certaines douleurs rhumatismales qui ne m’autorisent que trop à redouter l’humidité.
Ce soir-là, je me fus à peine endormi, que je rêvai que j’étais à l’Opéra. Une cacophonie merveilleuse, exécutée par un orchestre invisible, résonnait à mon oreille. Wagner avait dû composer ce morceau, où le bruit du trombone et du tambour dominait. Tout à coup la scène changea. Je me trouvai en pleine mer, à bord d’un navire ballotté par les flots en courroux. Le vent agitait mes cheveux; il pleuvait, et les gouttes d’eau que je recevais en plein visage me causaient une sensation qui n’avait rien de désagréable. Wilhelmine se tenait à mon côté; mais, chose étrange, au lieu de s’extasier devant l’immensité de l’Océan, au lieu d’admirer le murmure de la rafale, elle se plaignait amèrement. Surpris de cette absence de tout instinct poétique, que le matin même elle reprochait à notre pauvre servante, je lui adressai des remontrances si vives qu’elles me réveillèrent. Les plaintes qui m’avaient irrité n’en continuèrent pas moins. Je venais à peine de reconnaître que je n’étais pas à bord d’un navire, lorsque ma femme me mit au courant de la situation.
–Mon ami, me dit-elle, on doit avoir installé une douche au-dessus de notre lit, car il me tombe de temps à autre une goutte d’eau sur le nez.
–Et moi, j’ai la figure toute mouillée! m’écriai-je. Je ne rêvais donc pas? Non, parbleu! Est-ce que tu n’entends pas la pluie résonner sur le toit?
J’allumai une bougie et j’examinai le plafond. Juste au-dessus de nos têtes, il y avait deux taches brunes au milieu desquelles brillait une goutte d’eau qui ne tarda guère à nous arroser.
–Cela nous apprendra à nous fier à ce gredin aux yeux bleus, dis-je en grommelant, après avoir roulé le lit au milieu de la chambre et posé à terre deux cuvettes destinées à protéger le tapis.
–Que tu es injuste, Pedro! répliqua Wilhelmine, tandis que j’éteignais la lumière. Il ne pouvait pas grimper sur le toit pour examiner chaque tuile. Bonté du ciel! ça tombe encore ici!
Je rallumai la bougie et je changeai une seconde fois le lit de place. Avant que j’eusse eu le temps de me recoucher, Wilhelmine déclara qu’une rigole lui courait maintenant sur les pieds. Le lit fut déplacé de nouveau et alors l’eau ne tomba plus que sur mon oreiller à moi. Comme il paraissait impossible de nous abriter contre tous les robinets ouverts dans le plafond, nous nous réfugiâmes dans la chambre voisine, où Wilhelmine comptait loger Hélène Smith ou Mathilde Bishop. En ce moment, cette chambre était encore moins habitable que celle que nous venions de quitter.
Soudain, je me souvins d’une autre relique de mes campagnes. Courant à une vieille malle qui contenait mes effets personnels, j’en tirai une couverture de caoutchouc. L’étoffe n’avait rien perdu de son imperméabilité. Je l’attachai aux quatre coins du lit et elle nous eût permis de braver l’averse la plus formidable; seulement, si elle nous défendait contre l’eau, elle empêchait la libre circulation de l’air et menaçait de nous étouffer. Wilhelmine, cependant, ne se plaignit pas tout d’abord.
–Pedro, me dit-elle, cette couverture me rappelle les histoires que tu m’as racontées sur ta vie de soldat, alors que tu reposais sous cet abri, qui protégeait contre la pluie un brave officier fédéré.
–Moi, je ne songe pas à la guerre, bien que je ne puisse me vanter d’être dans des dispositions pacifiques. Si je tenais cet infernal agent, je t’assure qu’il passerait un vilain quart d’heure, en dépit de ses yeux bleus.
–Décidément, tu en veux à ce pauvre homme. Tu as tort. Il m’a assuré avoir loué plus de trois cents propriétés depuis le mois de janvier. On ne saurait exiger qu’il aille passer la nuit dans chacune de ces maisons lorsqu’il tombe par hasard une pluie d’orage.,
–En effet, ce serait pousser l’exigence un peu loin. D’ailleurs, puisque tu es satisfaite, je n’ai plus rien à dire.
–Non, je ne suis pas satisfaite. Je n’aime pas à entendre accuser un innocent, voilà tout.
Les es projets de vengeance que j’étais en train de former contre l’innocent en question m’absorbaient et je demeurai silencieux.
–Pedro, s’écria soudain ma femme, nous finirons par étouffer si nous restons ici. Il ne tombe pas d’eau dans le salon et là du moins nous pourrons respirer.
Je m’empressai de profiter de cette idée lumineuse. Nous descendîmes au rez-de-chaussée, où Wilhelmine s’installa sur la causeuse, tandis que je m’allongeais sur le tapis, entre deux rangées de sièges entassés les uns sur les autres. Je dormis fort mal–je crois même que je ne dormis pas– et je maugréai plus qu’il ne convient à un ancien soldat contre la dureté de la surface plane qui me servait de lit. Il ne me fallut pas longtemps pour reconnaître que le parquet du salon n’était pas une surface plane; il présentait un grand nombre de petites aspérités qui contribuèrent à me tenir éveillé. Je passai une partie de la nuit à me demander d’où provenaient ces rugosités. Dès l’aube, n’étant point parvenu à résoudre l’énigme, je soulevai un coin du tapis et je sus à quoi m’en tenir. Tout le monde connaît l’expression américaine: Dur comme un nœud de pin. Or, à l’époque où les citoyens des Etats-Unis dédaignaient le luxe des tapis, un frottement continuel avait peu à peu usé les planches, laissant en relief les nœuds, qui offrent plus de résistance. Vous me rappellerez peut-être que je possédais plusieurs fauteuils. A cela je répondrai que si vous aviez essayé de dormir dans un de mes fauteuils, vous auriez bien vite préféré le parquet.
A l’heure du déjeuner notre bonne se présenta, les yeux rouges, et déclara d’une voix enrouée qu’elle donnait sa démission. Elle ne nous reprochait rien; elle croyait que nous étions de braves gens; mais elle avait en Irlande une vieille mère qui comptait sur elle, et elle ne voulait pas risquer sa vie en restant dans une maison aussi humide.
–Qu’elle s’en aille, dit Wilhelmine dès que nous nous trouvâmes seuls. Un proverbe affirme que la variété fait le charme de l’existence.
–Le proverbe a peut-être raison, ma chère, répliquai-je. Pourtant, s’il faut payer souvent un mois de gages pour deux ou trois jours de service, le plaisir de la variété nous coûtera cher.
Mon premier soin, avant de me rendre à mon bureau, fut de passer chez l’agent. Je m’imaginais qu’il m’accueillerait les yeux baissés et en détournant la tête. Il n’en fit rien; il me serra cordialement la main et se déclara enchanté de me voir. Indigné de son effronterie, j’abordai sans autre préambule le sujet de ma visite:
–Ce toit, lui dis-je, ce toit est… Eh bien! c’est tout simplement un tamis. Vous m’aviez assuré que la maison n’était pas humide.
–Le propriétaire me l’avait affirmé, mon cher monsieur. Je ne suis que l’intermédiaire, et je ne gagnerais pas ma vie s’il me fallait inspecter en personne les centaines d’habitations que l’on me charge de louer dans le courant d’une année.
–En tout cas, le propriétaire se trompe. Vous voudrez donc bien le sommer de mettre le toit en bon état dans le plus court délai possible. Il devra aussi installer une pompe dans la cave, qui est inondée.
L’agent prit un air réfléchi.
–Lorsqu’on désire que le propriétaire se charge des réparations, on doit le stipuler dans le bail. Le contrat que vous avez signé porte que toutes les réparations devront être exécutées aux frais du preneur.
–Est-ce le propriétaire qui a rédigé le bail? demandai-je en fixant un regard sévère sur les yeux bleus de mon interlocuteur.
L’agent, loin de se laisser décontenancer, répondit avec une expression de dignité offensée:
–Je vous ai demandé si vous vouliez que le bail fût rédigé dans la forme ordinaire, et vous m’avez répondu: «Certainement.»
Je quittai brusquement cet honnête homme, que je me dispensai de saluer, et j’entrai dans un chantier voisin, où je m’informai de l’adresse du meilleur charpentier de la ville. On m’indiqua un gros gentleman qui se trouvait justement sur les lieux, en train de marchander un lot de bois de démolition. Je lui fis part de mon embarras et le priai de venir à mon aide. Il connaissait très bien le cottage qui avait captivé ma femme. Il tira un carnet de sa poche et me dit, tout en alignant des chiffres:
–Franchement, je vous engage à laisser ce toit tranquille. Tous les entrepreneurs des environs y ont travaillé et n’ont réussi qu’à le rendre moins solide. Le seul moyen de le mettre en état serait d’établir partout des bardeaux neufs. Cela vous coûtera337francs50centimes, à moins que les voliges ne soient trop pourries pour tenir les clous, et, dans ce dernier cas, vous pouvez compter 68francs75centimes de plus, ce qui donne un total de447francs25centimes.
J’inventai quelque prétexte pour échapper au charpentier et à ses odieux chiffres. Il accepta très courtoisement mes excuses. La rapidité de ses calculs et la politesse avec laquelle il accueillit mon refus tacite étaient sans doute le résultat de fréquentes entrevues avec d’autres infortunés assez sots pour avoir loué avant moi la maison que j’étais condamné à habiter. Je résolus de m’adresser au propriétaire, dont je connaissais le nom, et je demandai à un ami qui se rendait à New-York par le même train que moi, s’il pouvait me dire où je trouverais mon homme.
–Vous n’aurez pas loin à aller, me dit-il. Le voilà qui monte en wagon. Selon son habitude, il tient à la main un journal religieux.
Je jetai un coup d’œil sur l’individu que l’on venait de m’indiquer, et je jugeai qu’il serait inutile de faire la moindre démarche auprès de lui. Son regard dur et froid, son visage en lame de couteau, annonçaient aux moins clairvoyants que le pauvre le plus éloquent n’obtiendrait jamais un centime de ce monsieur-là. A quoi bon tenter de lui persuader de dépenser une forte somme pour une réparation que mon bail mettait à ma charge? Cependant, il fallait agir. Je perdis donc une partie de la journée à consulter divers entrepreneurs de New-York. Finalement, je consacrai environ150francs à l’achat d’une quantité de toile goudronnée provenant d’une tente d’hôpital mise au rebut, et je la fis tendre au-dessus du toit de ma demeure. Lorsque la besogne fut achevée, l’aspect de la maison était si grotesque, que j’aurais témoigné de la reconnaissance à un incendiaire qui serait venu m’obliger de changer de séjour. Mais, quand Wilhelmine contempla la toiture, elle battit des mains et s’écria:
–Nous pourrons nous croire dans une tente!
Faible consolation! Néanmoins, je me résignai. Dans la Vallée des Villas, nous ne serions pas obligés d’écouter, comme à la pension bourgeoise, des histoires que nous savions par cœur et dont on s’obstinait à nous régaler du matin au soir. Ceux de nos voisins dont nous fîmes la connaissance étaient des gens fort aimables; mais chacun d’eux trouvait quelque chose de terrible à nous dire. Le vieux pasteur de l’église paroissiale me confia que quelques-uns de ses souvenirs les plus doux, et aussi les plus pénibles, se rattachaient à notre habitation, dont divers locataires avaient été conduits par lui à leur dernière demeure terrestre. Un jeune médecin s’empressa de nous rendre visite, assurant que, depuis qu’il exerçait sa profession, tous les locataires de notre cottage avaient eu besoin de lui. Miss Blaythe, la fille du maire, apprit à ma femme que les fièvres intermittentes et d’autres maladies produites par l’humidité avaient causé de cruelles souffrances aux membres des deux familles qui nous avaient précédés. Puis les six marchands de charbon de la localité se disputèrent ma pratique avec une ardeur qui ne laissa pas de me flatter. Lorsque je parlai de cette concurrence au docteur, il ne témoigna pas la moindre surprise.
–Ils savent quelles sont les maisons les plus difficiles à chauffer en hiver, me dit-il, et ils travaillent en conséquence.
Par bonheur, l’hiver était encore loin. A mesure que la saison avançait, l’air devenait trop sec pour que nous eussions à craindre les rhumatismes. La brise nous apportait les parfums des centaines de rosiers qui poussaient un peu à la diable dans notre jardin; le chèvrefeuille et la vigne formèrent le long des murs un tapis plus épais. Wilhelmine passait des heures entières dans un fauteuil à bascule, admirant ce qu’elle appelait «notre nid de verdure». Pour ma part, je finis par m’attacher sincèrement à mon cottage, malgré la coiffure de toile cirée qui lui donnait un aspect étrange.
La cave, cependant, résista à tous nos efforts. On fit jouer une pompe à plusieurs reprises; mais il fallut renoncer à la dessécher complètement, et au mois d’août la maison fut envahie par une nuée de moustiques qui semblaient sortir des flaques d’eau dont le cellier restait émaillé, grâce aux inégalités du sol. Ces visiteurs incommodes couvraient les plafonds et les murs. Ils déjeunaient, dînaient, soupaient à nos dépens. Nous avions beau ouvrir les croisées, le jardin ne les attirait pas. C’est surtout Wilhelmine qui les attirait. Le visage de ma femme commença bientôt à ressembler à celui d’une malade atteinte de la petite vérole. Néanmoins, cette héroïne incomparable ne se plaignait pas. Je me souviens même qu’une après-midi, un peu avant l’heure du crépuscule, elle me dit, en fermant à moitié les yeux:
–Pedro, quand on contemple ainsi les murs, les moustiques leur donnent l’air d’être tendus de ce papier japonais semé de petits points noirs qui produisent un si drôle d’effet. S’ils avaient des goûts moins sanguinaires, je les trouverais jolis.
Enfin, le mois de septembre arriva, et avec lui les tempêtes équinoxiales. Nous venions de nous retirer un soir, fatigués d’écouter le vent qui mugissait au dehors, et Wilhelmine me récitait quelques vers de Longfellow appropriés à la circonstance, lorsque nous entendîmes un fracas effroyable, causé par la chute d’un corps lourd qui semblait s’être abattu en face de la maison. Ma femme, si courageuse en face des moustiques, se mit à trembler et se cramponna à moi.
Je me dégageai de son étreinte, et, à peine arrivé au bas de l’escalier, je découvris la cause de son effroi. Le souffle furieux d’Eole (pour parler comme le poète favori de Wilhelmine) avait renversé la porte d’entrée et abattu en même temps les montants, ainsi qu’une quantité considérable de plâtras.
Je promis à ma femme de veiller toute la nuit dans le salon, le pistolet au poing, afin de la protéger contre les voleurs qui pourraient se présenter. Elle insista pour me tenir compagnie, assurant qu’elle saurait au besoin m’aider à défendre notre foyer, et elle s’endormit sur la causeuse, avec un revolver à portée de sa main. Quant à moi, j’employai si bien mes loisirs, que je remis le lendemain à un imprimeur un manuscrit peu volumineux, mais dont les pages indignées ne manquaient pas d’une certaine verve. Le manuscrit avait pour titre: la Maison que j’habite. Le soir même, je reçus une épreuve que je remis au propriétaire du cottage, en lui annonçant que mon intention était d’offrir un exemplaire de cette brochure à tous les voyageurs qui descendraient aux deux stations de la Vallée des Villas. Après avoir pris connaissance de mon œuvre, il me proposa de résilier le bail, à la condition que je renoncerais à mon projet peu charitable. Son offre fut acceptée avec empressement. Deux jours plus tard, nous partîmes pour nous installer dans un logis d’un extérieur moins pittoresque, où tous nos meubles pouvaient tenir, et dont la toiture était en bon état. Cette fois, nous n’avions pas consulté l’agent aux yeux bleus, et j’avais tout examiné avec autant de soin que si j’eusse compté terminer mes jours dans notre nouveau domicile. Wilhelmine paraissait satisfaite. Cependant, tandis que nous suivions la dernière voiture de déménagement, elle se retourna pour contempler l’humide demeure que nous quittions, et s’écria, les yeux pleins de larmes:
–Malgré tout, Pedro, c’est un amour de cottage!