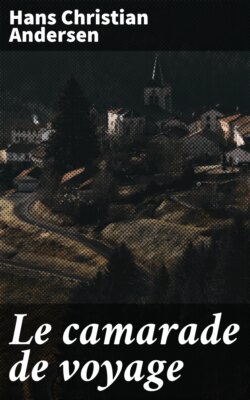Читать книгу Le camarade de voyage - Hans Christian Andersen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
Elle s’embarqua pour la France. Tous les jours Knoud errait longtemps à travers les rues de Copenhague. Les autres compagnons de l’atelier lui demandaient pourquoi il se promenait toujours ainsi plongé dans ses réflexions. Ils l’engagèrent à prendre part à leurs plaisirs. «Il faut s’amuser pendant qu’on est jeune!» lui disaient-ils.
Il alla avec eux à la salle de danse. Il y avait là beaucoup de jolies jeunes filles. Aucune n’était aussi jolie que Jeanne. Là où justement il croyait pouvoir l’oublier, il eut au contraire son image plus présente à la pensée.
«Dieu nous donne de la force, avait-elle dit, pourvu que nous ayons de la volonté et du courage. » Il se rappelait cette parole et elle lui inspirait des sentiments de piété. Les violons résonnèrent en ce moment, et les jeunes filles dansèrent une ronde. Il tressaillit d’effroi. Il lui paraissait qu’il était dans un endroit où il n’aurait pu conduire Jeanne, et cependant elle y était, puisqu’il la portait dans son cœur. Il sortit et courut, à travers les rues, passant devant la maison où elle avait demeuré. Là il faisait sombre; tout était vide et désert. Le monde suivait son chemin, et Knoud le sien.
L’hiver vint et les eaux gelèrent. La nature changea d’aspect et l’on eût dit partout des apprêts funèbres. Mais lorsque le printemps revint et que le premier bateau à vapeur reprit la mer, Knoud fut saisi du désir de voyager au loin, au loin, ailleurs qu’en France.
Il boucla son sac et s’en alla au loin, au loin, à travers l’Allemagne, de ville en ville, sans séjourner ni s’arrêter. Ce ne fut que lorsqu’il entra dans l’antique et curieuse cité de Nuremberg qu’il lui sembla qu’il redevenait maître de ses pieds, et qu’il se décida à y rester.
Nuremberg est une ville singulière, qui a l’air d’une image découpée dans quelque vieille chronique historiée.
Les rues serpentent capricieusement; les maisons n’y aiment pas à se suivre en rang et évitent la ligne droite. Partout des pignons flanqués de tourelles. Des statues sortent des murailles surchargées de sculptures bizarres. Du haut des toits de structure singulière, des gargouilles, sous forme de dragons, de lièvres, de chiens aux longues jambes, s’élancent jusqu’au milieu de la rue.
Knoud, le sac au dos, s’arrêta sur la place du Marché. Il resta debout près d’une vieille fontaine ornée de superbes statues de bronze figurant des personnages bibliques et historiques, entre lesquels les jets d’eau s’élancent. Une jolie servante y puisait précisément de l’eau. Knoud, fatigué par la marche, avait grande soif; elle lui présenta à boire, et lui donna aussi une des roses d’un bouquet qu’elle portait à la main. Cela parut au jeune homme d’un bon augure.
De puissants sons d’orgue venant d’une église-voisine se firent entendre et lui rappelèrent son pays. Ils lui semblaient tout pareils à ceux qui faisaient résonner l’église de Kjoegé. Il entra dans le vaste sanctuaire. Le soleil, y pénétrant à travers les vitraux de couleur, éclairait les rangées de hauts et sveltes piliers. La piété remplit les pensées de Knoud, et la paix et le repos rentrèrent dans son cœur.
Il chercha et trouva à Nuremberg un bon maître; il demeura chez lui et apprit la langue allemande.
Les anciens fossés qui entouraient les fortifications de la ville sont divisés et convertis en jardins potagers; mais les hautes murailles avec leurs tours massives sont encore debout. Le chemin couvert existe toujours. Le cordier y tourne sa corde. Dans les fentes des vieux murs, les sureaux croissent par bouquets touffus, avançant leurs branches au-dessus des petites maisonnettes basses qui sont adossées aux fortifications. Dans l’une de ces maisonnettes habitait le maître chez qui travaillait Knoud. Au-dessus de la mansarde où le jeune homme se tenait assis, un beau sureau étendait son feuillage.
Knoud resta là un été et un hiver; mais le printemps vint ensuite, et alors il ne put y tenir. Le sureau fleurit; il remplissait l’air de senteurs. Il rappelait à Knoud un autre sureau, et le jeune homme se sentait reporté dans le jardinet de Kjoegé. Alors il quitta ce maître pour en chercher un autre dans l’intérieur de la ville, où il ne poussait pas de sureau.
Son nouvel atelier était proche d’un vieux pont, au-dessous duquel roulait un ruisseau rapide qui faisait tourner bruyamment une roue de moulin. L’eau passait entre des maisons qui avaient toutes de vieux pignons délabrés; on eût dit qu’elles allaient les secouer dans le ruisseau. Là ne poussait pas de sureau, mais juste en face de l’atelier se dressait un grand vieux saule qui s’accrochait par ses racines à la maison pour ne pas être entraîné par le torrent. Il laissait une partie de ses branches pendre dans le ruisseau, comme celui du jardin de Kjoegé.
Oui, Knoud avait passé de la mère Sureau au père Saule. Les soirs de clair de lune, le saule avait quelque chose qui lui allait au cœur, l’attendrissait et le décourageait. Il ne put y tenir. Pourquoi? demandez-le au saule, demandez-le au sureau en fleur.
Il dit adieu à son maître de Nuremberg et quitta la ville. A personne il ne parlait de Jeanne. Il ensevelissait son chagrin au fond de lui-même. L’histoire des pains d’épice lui revenait parfois à la mémoire, et il en comprenait mieux que jamais le sens profond. Il savait pourquoi le bonhomme avait à gauche une amande amère. Le cœur de Knoud était aussi plein d’amertume. Jeanne, au contraire, qui avait toujours été si douce et si affectueuse, n’était — elle pas tout sucre et tout miel comme la demoiselle du naïf récit?
Sa pensée s’étant arrêtée à ces souvenirs, il se sentit oppressé. A peine pouvait-il respirer. Il crut que la courroie de son sac en était cause, il la desserra. Cela ne servit à rien. Pour lui, il y avait deux mondes dans lesquels il vivait: le monde extérieur qui l’environnait, et celui qui était au fond de son âme, monde de souvenirs et de sentiments; c’est dans celui-ci qu’il habitait le plus souvent, et à l’autre il demeurait à peu près étranger.
Ce n’est que lorsqu’il aperçut les hautes montagnes que son esprit se détacha des mornes pensées et prit garde aux choses du dehors. A ce spectacle grandiose, ses yeux se remplirent de larmes.
Les Alpes lui apparurent comme les ailes ployées de la terre. «Qu’arriverait-il, se disait-il, si elle déployait et étendait tout à coup ces ailes immenses avec leurs forêts sombres, leurs torrents, leurs masses de neige? Sans doute, la terre, au jugement dernier, s’élèvera ainsi portée dans l’infini, et, comme une bulle de savon au soleil, elle se dispersera en des millions d’atomes dans l’éclat des rayons de la divinité. Oh! que n’est-ce aujourd’hui le jugement dernier?» disait Knoud en soupirant.
Il traversa un pays qui lui parut un magnifique verger. Du haut des balcons des chalets, les jeunes filles qui battaient le chanvre le saluaient de la tête; il leur répondait honnêtement, mais sans jamais ajouter une parole gaie, comme font d’ordinaire les jeunes gens de son âge.
Lorsqu’à travers les épaisses feuillées, il découvrit les grands lacs aux eaux verdâtres, il se souvint de la mer qui baigne le rivage où il était né, et de la baie profonde de Kjoegé. La mélancolie envahit son âme, mais ce n’était déjà plus de la douleur.
Il vit le Rhin tout entier se précipiter du haut d’un rocher et s’éparpiller en des millions de gouttes qui forment une masse blanche et nuageuse à travers laquelle les couleurs de l’arc-en-ciel se jouent comme un ruban voltigeant dans l’air. Cet imposant spectacle le fit songer à la cascade bruissante et écumante du ruisseau qui agite les roues du moulin de Kjoegé. Partout le souvenir du lieu de sa naissance le poursuivait.
Volontiers il serait resté dans une de ces tranquilles cités des bords du Rhin; mais il y croissait trop de sureaux et trop de saules. Il continua de voyager; il franchit de hautes montagnes sur des sentiers qui longeaient des rocs coupés à pic, comme une gouttière longe le faîte d’un toit. Il se trouvait au-dessus des nuages qui flottaient sous ses pieds; il entendait à une prodigieuse profondeur le fracas des torrents roulant au fond des vallées. Rien ne l’effrayait ni ne l’étonnait. Sur les sommets neigeux où fleurissent les roses des Alpes, il marchait vers les pays du soleil. Il dit adieu aux contrées du Nord, et il arriva, sous des allées de châtaigniers enlacés de vignes, à des champs de maïs. Des monts escarpés le séparaient, comme une immense muraille, des lieux qui lui avaient laissé de si tristes souvenirs. «Et il était bon que cela fût ainsi,» se disait-il.