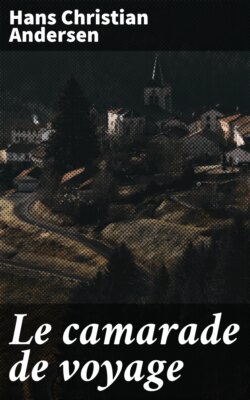Читать книгу Le camarade de voyage - Hans Christian Andersen - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеTable des matières
Il prit son sac et son bâton et marcha vers les montagnes. Il les monta et les descendit. Ses forces diminuaient, et il ne voyait encore ni village ni maison. Il allait vers le Nord. Les étoiles étincelaient autour de lui. Ses jambes vacillaient, la tête lui tournait. Au fond de la vallée, il vit briller aussi des étoiles, comme s’il y eût un ciel au-dessous de lui aussi bien qu’au-dessus.
Il se sentait malade. Les étoiles d’en bas augmentaient sans cesse. Leur lueur devenait de plus en plus forte, et elles se mouvaient çà et là. C’était une petite ville, dont il apercevait les lumières. Quand il eut reconnu cela, il rassembla ses dernières forces et atteignit une pauvre auberge.
Il y resta la nuit et tout le jour suivant. Il avait besoin de repos et de soins. Le dégel était venu; il pleuvait dans la vallée. Dans la matinée du jour suivant, il vint un homme avec une vielle, qui joua un air qui ressemblait tout à fait à une mélodie danoise. Il fut alors impossible à Knoud de séjourner plus longtemps, il se remit en route, il marcha vers le Nord; il marcha pendant bien des journées, avec hâte, comme s’il craignait que tout le monde ne fût mort en son pays avant qu’il y arrivât.
Il ne parlait à qui que ce fût de ce qui le poussait ainsi. Personne ne se doutait de la cause de son chagrin, qui était pourtant le plus profond qu’un homme puisse ressentir. Une pareille douleur n’intéresse pas le monde, pas même vos amis, et Knoud, du reste, n’avait pas d’amis. Comme un étranger, il traversait les pays étrangers, marchant toujours vers le Nord.
Le soir survint. Il suivait la grande route. La gelée se faisait de nouveau sentir. Le pays devenait plat. On voyait des prés, des champs. Au bord de la route s’élevait un grand saule. Tout avait un air qui rappelait à Knoud son pays. Il s’assit sous l’arbre; il était bien fatigué ; sa tête s’inclina, ses yeux se fermèrent pour le sommeil.
Cela ne l’empêcha pas de remarquer que le saule abaissait et étendait ses branches au-dessus de lui. L’arbre lui apparut comme un puissant vieillard. Oui, c’était le père Saule lui-même qui le souleva dans ses bras et le porta, le fils fatigué et épuisé, dans sa patrie, sur le rivage uni de Kjoegé. Oui, c’était le père Saule en personne qui avait parcouru le monde à la recherche de son Knoud, qui l’avait trouvé et ramené dans le jardin, au bord du ruisseau, et là était Jeanne dans toute sa splendeur, avec la couronne d’or sur la tête, telle qu’il l’avait vue la dernière fois; elle lui cria de loin: «Sois le bienvenu!».
Deux figures singulières se dressaient aussi devant lui. Il les connaissait dès son enfance, mais elles avaient bien plus la forme humaine qu’alors. Elles étaient fort changées à leur avantage. C’étaient les deux pains d’épice, l’homme et la femme; ils lui tournèrent le côté droit, et vraiment ils avaient fort bonne mine.
«Nous te remercions, lui dirent-ils, tu nous as rendu un grand service. Tu nous as délié la langue, tu nous as appris qu’il ne faut pas taire ses pensées; sans quoi l’on n’aboutit à rien. Aussi avons-nous atteint notre but et nous sommes fiancés.» Ayant dit, ils traversèrent les rues de Kjocgé, la main dans la main. Ils avaient l’air tout à fait convenable, et même du côté de l’envers il n’y avait rien à redire. Ils se dirigèrent vers l’église. Knoud et Jeanne les suivaient, eux aussi, la main dans la main. L’église était là comme autrefois avec ses murailles toujours tapissées de lierre vert. La grande porte s’ouvrit à deux battants. L’orgue résonnait. Ils entrèrent dans la grande nef. «Les maîtres en avant,» dirent les fiancés de pain d’épice, et ils firent place à Knoud et à Jeanne, qui s’agenouillèrent en face de l’autel. Jeanne pencha la tète contre le visage de Knoud; des larmes froides coulaient de ses yeux; la glace qui enveloppait son cœur fondait par l’ardent amour de Knoud. Il s’éveilla alors et se trouva assis sous le vieux saule, dans un pays étranger, par une froide soirée d’hiver. Les nuages secouaient une grêle qui lui fouettait le visage.
«Cette heure-ci, dit-il, a été la plus belle de ma vie; et c’était un rêve! Mon Dieu, laissez-moi rêver encore ainsi!» Il referma les yeux, s’endormit et rêva.
Vers le matin il tomba de la neige. Le vent la poussa sur lui. Il dormait toujours. Des gens des hameaux environnants passèrent, allant à l’église. Ils virent quelqu’un étendu au bord de la route. C’était un compagnon. Il était mort de froid sous le saule.