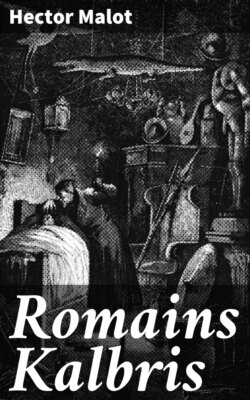Читать книгу Romains Kalbris - Hector Malot - Страница 5
III
ОглавлениеMon père était revenu en août; au mois de septembre, le temps, qui avait été beau pendant plus de trois mois, se mit au mauvais; il y eut une série d’ouragans comme il y avait eu une série de calme. On ne parlait que de naufrages sur nos côtes; un vapeur s’était perdu corps et biens dans le raz Blanchard; plusieurs barques de Granville avaient disparu, et l’on disait que la mer aux alentours de Jersey était couverte de débris; à terre, les chemins étaient encombrés de branches rompues; les pommes encore vertes couvraient le sol, aussi drues que si elles avaient été gaulées; bien des pommiers étaient les racines en l’air ou tordus par le milieu du tronc, et les feuilles pendaient aux branches, roussies comme si elles avaient été exposées à un feu de paille.
Tout le monde vivait dans la crainte, car c’était le moment du retour des Terreneuviers.
Cela dura près de trois semaines, puis un soir il se fit une accalmie complète à la fois sur la terre et sur la mer: je croyais la tempête passée, mais au souper mon père se moqua de moi quand je lui demandai si nous n’irions pas le lendemain relever nos filets qui étaient tendus depuis le commencement du mauvais temps.
— Demain, dit-il, la bourrasque se mettra en plein à l’ouest; le soleil s’est couché dans un brouillard roux, il y a trop d’étoiles au ciel, la mer gémit, la terre est chaude; tu verras plus fort que tu n’as encore vu.
Aussi le lendemain, au lieu d’aller à la mer, nous nous mîmes à charrier des pierres sur le toit du rouf. Le vent d’ouest s’était élevé avec le jour; pas de soleil, un ciel sale, éclairé de place en place par de longues lignes vertes, et, bien que la mer fût basse, au loin un bruit sourd semblable à un hurlement.
Tout à coup mon père, qui était sur le toit du rouf, s’arrêta dans son travail, je montai près de lui. Au large, à l’horizon, on apercevait un petit point blanc sur le ciel sombre: c’était un navire.
— S’ils n’ont point d’avaries, ils veulent donc se perdre! dit mon père.
En effet, par les vents d’ouest, le Port-Dieu est inabordable.
C’était une éclaircie qui nous avait montré le navire. Il disparut presque aussitôt à nos yeux. Les nuages s’entassaient dans une confusion noire; ils montaient rapides, mêlés, roulant comme des tourbillons de fumée qui s’échappent d’un incendie; la courbure extrême de l’horizon était le foyer d’où ils s’élançaient.
Nous descendîmes au village; on courait déjà vers la jetée, car déjà tout le monde savait qu’il y avait un navire en vue, c’est-à-dire en danger.
Au loin comme à nos pieds, à droite, à gauche, tout autour de nous, la mer n’était qu’une écume, une neige mouvante; elle montait plus vite qu’à l’ordinaire, avec un bruit sourd qui, mêlé à la tourmente, paralysait l’ouïe; les nuages, bien que poussés par un vent furieux, étaient si bas, si lourds, qu’ils semblaient appuyer de tout leur poids sur cette mousse savonneuse. Le navire avait grandi; c’était un brick; il était presque à sec de toile.
— Voilà qu’il hisse son guidon, dit le capitaine Houel, qui avait sa longue-vue; c’est celui des frères Leheu.
Les frères Leheu étaient les plus riches armateurs du pays.
— Il demande le pilote.
— Ah! oui, le pilote; il faudrait pouvoir sortir.
Ce fut le pilote lui-même, le père Housard, qui répondit cela; et comme il n’y avait là que des gens du métier, on ne répliqua point; on savait bien qu’il avait raison et qu’il était impossible de sortir.
Au même moment, on vit arriver du côté du village l’aîné des frères Leheu. Il ne savait assurément pas quelle était la violence du vent, car à peine eut-il dépassé l’angle de la dernière maison qu’il tourna sur lui-même et fut rejeté dans la rue comme un paquet de hardes. Tant bien que mal, trébuchant, tournoyant, piquant dans le vent comme le nageur dans la vague, il arriva jusqu’à la batterie derrière laquelle nous étions abrités; en chemin, il perdit son chapeau sans essayer de courir après, et tout le monde vit bien par là qu’il était terriblement tourmenté, car il était connu pour ne jamais rien perdre.
On sut en une minute que le brick lui appartenait; il avait été construit à Bayonne, il était monté par un équipage basque, c’était son premier voyage; il n’était pas assuré.
— Vingt sous du tonneau si vous l’entrez, dit M. Leheu en tirant le père Housard par son suroit.
— Pour l’aller chercher, il faudrait d’abord pouvoir sortir.
Les vagues sautaient par-dessus la jetée; le vent était devenu comme un immense balaiement qui emportait avec lui l’écume des vagues, les goëmons, le sable du parapet, les tuiles du corps de garde; les nuages éventrés traînaient jusque dans la mer, et la blancheur savonneuse de celle-ci les rendait plus noirs encore.
Quand le brick vit que le pilote ne sortait pas, il vira à moitié de bord pour tâcher de courir une bordée en attendant.
Attendre, c’était le naufrage sûr; entrer sans pilote, c’était le naufrage plus sûr encore.
On accourait du village; en tout autre moment, c’eût, été un risible spectacle de voir les trouées que le vent faisait dans les groupes, comme il les soulevait, les bousculait; il y avait des femmes qui se couchaient par terre et qui tâchaient d’avancer en se traînant sur les genoux.
M. Leheu ne cessait de crier: «Vingt sous du tonneau! quarante sous!» Il allait, venait, courait, et dans la même seconde passait des supplications aux injures.
— Vous êtes tous les mêmes, à la mer quand on n’a pas besoin de vous, dans votre lit quand il y a danger.
Personne ne répondait: on secouait la tête ou bien on la détournait.
Il s’exaspéra:
— Vous êtes tous des propres à rien! c’est trois cent mille francs de perdus; vous êtes des lâches!
Mon père s’avança:
— Donnez-moi un bateau, j’y vas.
— Toi, Kalbris, tu es un brave.
— Si Kalbris y va, j’y vas aussi, dit le père Housard.
— Vingt sous du tonneau, je ne m’en dédis pas, cria M. Leheu.
— Rien, dit le père Housard, ce n’est pas pour vous; mais si j’y reste et que ma vieille vous demande deux sous le dimanche, ne la refusez pas.
— Kalbris, dit M. Leheu, j’adopterai ton gars.
— Ce n’est pas tout ça, il nous faut le bateau à Gosseaume.
Ce bateau, qu’on appelait le Saint-Jean, était célèbre sur toute la côte pour bien porter la toile par n’importe quel temps.
— Je veux bien, dit Gosseaume cédant à tous les yeux ramassés sur lui, mais c’est à Kalbris que je le prête, il faut qu’il me le ramène.
Mon père m’avait pris par la main; nous nous mîmes à courir vers la cale où le Saint-Jean était à sec: en une minute, il fut appareillé de sa voile et de son gouvernail.
Outre mon père et le pilote, il fallait un troisième marin, un de nos cousins se présenta: on voulut le retenir.
— Kalbris y va bien, dit-il.
Mon père me prit dans ses bras, et d’une voix dont je me rappelle encore l’accent:
— On ne sait pas, dit-il en m’embrassant; tu diras à ta mère que je l’embrasse.
Sortir du port avec ce vent debout était la grande difficulté ; les haleurs qui tiraient sur l’amarre du Saint-Jean n’avançaient pas; il y avait des secousses qui leur faisaient lâcher prise et les éparpillaient en les bousculant. La pointe extrême de la jetée était balayée par les vagues; il fallait cependant que le Saint-Jean fût halé en dehors de cette pointe pour prendre le vent. Le gardien du phare se noua autour des reins un grelin, et, pendant que les haleurs maintenaient tant bien que mal le Saint-Jean dans le chenal, il se baissa le long du parapet et s’avança en tenant à deux mains la rampe en fer qui y est fixée. Il n’avait pas la prétention, vous le sentez bien, de sortir à lui tout seul la barque, que cinquante bras pouvaient à peine entraîner, mais seulement, et c’était un rude travail, de passer l’amarre autour de la poulie de bronze qui est à l’extrémité de la jetée, de telle sorte que la barque, trouvant là son point d’appui, pût s’avancer en sens contraire des haleurs revenant sur leurs pas. Trois fois il fut couvert par la vague, mais il avait l’habitude de ces avalanches d’eau, il résista et parvint à enrouler le grelin. Le Saint-Jean recommença à avancer lentement en plongeant si lourdement dans les lames que c’était à croire qu’elles allaient l’emplir. Tout à coup l’amarre mollit et vint d’elle-même; elle avait été larguée et le Saint-Jean doublait la jetée.
Je sautai sur le glacis de la batterie et j’embrassai si solidement de mes bras et de mes jambes le mât des signaux, que je pus m’y cramponner; il ployait et craquait comme si, vivant encore, il se fût balancé sur ses racines dans la forêt natale.
J’aperçus mon père au gouvernail: auprès de lui les deux hommes étaient appuyés contre le bordage, le dos au vent. Le Saint-Jean s’avançait par saccades; tantôt il s’arrêtait, tantôt il filait comme un boulet qui ricoche sur des flots d’écume; tantôt il disparaissait entièrement dans cette poussière d’eau que les marins nomment des embruns.
Le brick, dès qu’il le vit, changea sa route et gouverna en plein sur le phare; aussitôt que le Saint-Jean se fut assez élevé dans le vent, il changea aussi sa bordée et gouverna pour couper le brick; en quelques minutes ils se joignirent: la barque passa sous le beaupré du grand navire et presque aussitôt pivota sur elle-même; ils étaient attachés l’un à l’autre.
— La remorque ne tiendra pas, dit une voix.
— Quand elle tiendrait, ils ne pourront jamais s’affaler le long du brick, dit une autre.
Il paraissait, en effet, impossible que le Saint-Jean pût s’approcher assez du brick pour permettre au père Housard d’y grimper: ou le Saint-Jean devait être broyé ou le père Housard devait tomber à la mer.
Joints l’un à l’autre, emportés dans la même rafale, poussés par la même vague, le navire et la barque approchaient. Quand le beaupré plongeait, on voyait le pont se dresser et l’équipage, incapable de tenir pied, s’accrocher où il pouvait.
— Monte donc! monte donc! criait M. Leheu.
Trois ou quatre fois déjà le père Housard avait essayé de s’élancer, mais les deux navires s’étaient violemment séparés: la barque, lancée à vingt ou trente mètres au bout de la remorque, allait devant, derrière, au hasard des lames qui l’emportaient. Enfin le brick fit une embardée du côté du Saint-Jean, et, quand la vague qui l’avait soulevé s’abaissa, le pilote se cramponnait à son bord sur le porte-haubans.
Il semblait que le vent avait vaincu toute résistance, nivelé, démoli, emporté les obstacles: il passait sur nous et au travers de nous irrésistiblement, sans ces intervalles de repos et de reprise qui laissent au moins un moment pour respirer. On ne sentait plus qu’une violente poussée, toujours dans le même sens; on n’entendait plus qu’un soufflement qui rendait sourd. Sous cet aplatissement, les vagues étaient soulevées avant de se former; elles s’écroulaient les unes sur les autres en tourbillons.
Le brick arrivait rapide comme la tempête elle-même, portant seulement tout juste ce qu’il fallait de toile pour gouverner. Bien que la mer parût aplatie, il avait des mouvements de roulis et de tangage dans lesquels il s’abattait furieusement de côté et d’autre, comme s’il allait virer: au milieu d’une de ces secousses, on ne vit plus que des lambeaux de toile; son hunier avait été emporté ; n’ayant plus de point d’appui pour gouverner, il vint par le travers; il était à peine à deux ou trois cents mètres de l’entrée.
Un même cri sortit de toutes les poitrines.
Le Saint-Jean, à bord duquel étaient restés mon père et mon cousin, suivait le brick à une petite distance; pour ne pas se heurter contre cette masse, il prit au large, mais au même moment une trinquette fut hissée à bord du brick; celui-ci revint dans la passe, en coupant une fois encore la route à la barque, qu’il masqua entièrement de sa masse noire. Deux secondes après, il donnait dans le chenal.
C’était la barque que je suivais bien plus que le brick: quand je la cherchai, celui-ci entré, je ne la vis plus. Puis presque aussitôt je l’aperçus en dehors de la jetée; gênée par la manœuvre du grand navire, elle avait manqué la passe trop étroite, et elle courait vers une sorte de crique à droite de la jetée, où ordinairement dans les jours d’orage on trouvait une mer moins tourmentée.
Mais ce jour-là, comme partout, à perte de vue, la mer y était furieuse, et il fallait une impossibilité absolue de remonter dans le vent pour s’y laisser affaler; la voile fut amenée, une ancre fut mouillée, et aux vagues qui se précipitaient du large le canot présenta l’avant; entre lui et la plage se dressait une ligne de rochers qui ne devaient pas être couverts d’eau avant une demi-heure. L’ancre tiendrait-elle? La corde ne serait-elle pas coupée? Le Saint-Jean pourrait-il toujours s’élever à la lame sans plonger?
Je n’étais qu’un enfant, mais j’avais assez l’expérience des choses de la mer pour calculer l’horrible longueur de cette attente.
Autour de moi, j’entendais aussi se poser ces questions, car nous avions couru sur la grève et nous étions groupés en tas pour résister au vent:
— S’ils tiennent encore, ils pourront échouer; si le Saint-Jean vient au plein, il sera brisé en miettes.
— Kalbris est un rude nageur.
— Ah! oui, nager!
Une planche elle-même eût été engloutie dans ces tourbillons d’eau, d’herbe, de cailloux, d’écume, qui s’abattaient sur la plage, où ils creusaient des trous. Les vagues, repoussées par les rochers, produisaient un ressac qui, en reculant, rencontrait celles venant du large, et, ainsi pressées, elles montaient les unes par-dessus les autres et s’écroulaient en cascades.
Tandis que je restais haletant, les yeux sur le Saint-Jean, je me sentis saisir à deux bras; je me retournai, c’était ma mère qui accourait à moi éperdue; elle avait tout vu du haut de la falaise.
On vint nous entourer, le capitaine Houel et quelques autres; on nous parlait, on tâchait de nous rassurer: sans répondre à personne, ma pauvre mère regardait au large.
Tout à coup un grand cri domina le bruit de la tempête:
— L’ancre a lâché !
Ma mère tomba à genoux et m’entraîna avec elle.
Quand je relevai les yeux, je vis le Saint-Jean arriver par le travers sur la crête d’une vague immense; soulevé, porté par elle, il passa par-dessus la barrière de rochers; mais la vague se creusa pour s’abattre; la barque se dressa tout debout en tournoyant, et je ne vis plus rien qu’une nappe d’écume.
Ce fut seulement deux jours après qu’on retrouva le corps de mon père horriblement mutilé ; on ne retrouva jamais celui de mon cousin.