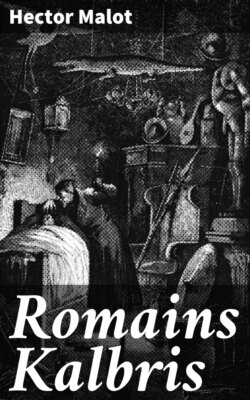Читать книгу Romains Kalbris - Hector Malot - Страница 6
IV
ОглавлениеPendant six années, la place de mon père avait été vide au bout de la table, mais ce n’était pas le vide effrayant et morne qui suivit cette catastrophe.
Sa mort ne nous réduisit pas absolument à la misère, car nous avions notre maison et un peu de terre; cependant ma mère dut travailler pour vivre.
Elle avait été autrefois la meilleure repasseuse du pays, et comme le bonnet du Port-Dieu est une des belles coiffures de la côte, elle retrouva des pratiques.
Les messieurs Leheu crurent devoir venir à notre aide.
— Mon frère vous prendra tous les quinze jours, dit l’aîné à ma mère, et moi tous les quinze jours aussi; une journée assurée toutes les semaines, c’est quelque chose.
Et ce fut tout. Ce n’était pas payer bien cher la vie d’un homme.
La journée de travail, au temps dont je parle, se réglait sur le soleil; j’eus donc, le matin et le soir, avant comme après l’école, des heures où, en l’absence de ma mère, je fus maître de faire ce qui me plaisait.
Or, ce qui me plaisait, c’était de flâner sur la jetée ou sur la grève, selon que la mer était haute ou basse. Tout ce que ma pauvre maman essayait pour me retenir à la maison était inutile; j’avais toujours des raisons pour m’échapper ou me justifier; heureux encore quand je n’en avais pas pour faire l’école buissonnière, c’est-à dire quand les navires ne rentraient pas de Terre-Neuve, quand il n’y avait pas de grande marée, quand il n’y avait pas gros temps.
Ce fut dans un de ces jours de grande marée et d’école buissonnière que je fis une rencontre qui eut une influence capitale sur mon caractère et décida de ma vie.
On était à la fin de septembre, et la marée du vendredi devait découvrir des rochers qu’on n’avait pas vus depuis longtemps. Le vendredi matin, au lieu d’aller à l’école, je me sauvai dans la falaise, où, en attendant que la mer descendît, je me mis à déjeuner: j’avais plus de deux heures à attendre.
La marée montait comme une inondation, et si les yeux se détournaient un moment d’un rocher, ils ne le retrouvaient plus, il avait été noyé dans cette nappe qui se soulevait avec une vitesse si calme, que c’était le rocher qui semblait avoir lui-même coulé à pic; pas une vague, mais seulement une ligne d’écume entre la mer bleue et le sable jaune; au large, au delà de l’horizon voûté des eaux, le regard se perdait dans des profondeurs grises; on voyait plus loin qu’à l’ordinaire; sur les côtes, le cap Vauchel et l’aiguille d’Aval, ce qui n’arrive que dans les grands changements de temps.
La mer resta étale bien longtemps pour mon impatience, puis enfin elle commença à se retirer avec la même vitesse qu’elle était venue. Je la suivis; j’avais caché dans un trou mon panier et mes sabots et je marchai pieds nus sur la grève, où mes pas creusaient une souille qui s’emplissait d’eau.
Nos plages sont en général sablonneuses; cependant on y rencontre, semés çà et là, des amas de rochers, que la mer, dans son travail d’érosion, n’a pas encore pu user et qui forment à marée basse des îlots noirâtres. Comme j’étais dans un de ces îlots à poursuivre des crabes sous les goëmons, je m’entendis héler.
Ceux qui sont en faute ne sont pas très-braves, j’eus un moment de frayeur; mais en levant les yeux je vis que je n’avais rien à craindre, celui qui m’avait hélé n’allait point me renvoyer à l’école: c’était un vieux monsieur à barbe blanche que dans le pays nous avions baptisé Monsieur Dimanche, parce qu’il avait un domestique qu’il appelait Samedi. De vrai, il se nommait M. de Bihorel et il habitait une petite île à un quart d’heure du Port-Dieu; autrefois cette île avait tenu à la terre, mais il avait fait couper la chaussée de granit qui formait l’isthme et l’avait ainsi transformée en une île véritable, que la mer, lorsqu’elle était haute, baignait de tous côtés. Il avait la réputation d’être le plus grand original qui existât à vingt lieues à la ronde; et cette réputation il la devait à un immense parapluie qu’il portait toujours tendu au-dessus de sa tête, à la solitude absolue dans laquelle il vivait, surtout à un mélange de dureté et de bonté dans ses relations avec les gens du pays.
— Hé ! petit, criait-il, qu’est-ce que tu fais là ?
— Vous voyez bien, je cherche des crabes.
— Eh bien! laisse tes crabes et viens avec moi, tu me porteras mon filet, tu ne t’en repentiras pas.
Je ne répondis pas; mais ma figure parla pour moi.
— Ah! ah! tu ne veux pas?
— C’est que...
— Tais-toi, je vais te dire pourquoi tu ne veux pas; dis-moi seulement ton nom.
— Romain Kalbris.
— Tu es le fils de Kalbris, qui a péri pour sauver un brick l’année dernière; ton père était un homme.
J’étais fier de mon père; ces paroles me firent regarder M. de Bihorel moins sournoisement.
— Tu as neuf ans, continua-t-il en me posant la main sur la tête et en plongeant ses yeux dans les miens, c’est aujourd’hui vendredi, il est midi, tu fais l’école buissonnière.
Je baissai les yeux en rougissant.
— Tu fais l’école buissonnière, poursuivit-il, ceci n’est pas bien difficile à deviner; maintenant je vais te dire pourquoi. Ne tremble pas, petit nigaud, je ne suis pas sorcier. Allons, regarde-moi. Tu veux profiter de la marée pour pêcher.
— Oui, monsieur, et pour voir la Tête de chien.
La Tête de chien est un rocher qui ne découvre que très-rarement.
— Hé bien! moi aussi, je vais à la Tête de chien; prends mon filet et suis-moi.
Je le suivis sans souffler mot, j’étais abasourdi qu’il m’eût si facilement deviné. Quoique je le connusse bien, c’était la première fois que j’échangeais autant de paroles avec lui, et je ne savais pas que son plaisir était de chercher le mobile secret des actions de ceux avec lesquels il se trouvait; une grande finesse et une longue expérience le faisaient souvent toucher juste, et, comme il ne craignait personne, il disait toujours son impression quelle qu’elle fût, gracieuse ou blessante.
Bien que j’en eusse peu envie, il me fallut parler, tout au moins répondre aux questions qu’il ne cessa de me poser. Il n’y avait pas un quart d’heure que je marchais derrière lui qu’il savait tout ce que je pouvais lui apprendre sur moi-même, sur mon père, sur ma mère, sur ma famille. Ce que je lui racontai de mon oncle l’Indien parut l’intéresser.
— Curieux, disait-il, esprit d’aventure, sang normand mêlé au sang phénicien; d’où peut venir Calbris ou Kalbris.
Cet interrogatoire ne l’empêchait pas d’examiner la grève sur laquelle nous avancions, et de ramasser de temps en temps des coquillages et des herbes qu’il me fallait mettre dans le filet.
— Comment appelles-tu ça? me disait-il à chaque chose.
Presque toujours je restais muet, car, si je connaissais bien de vue ces herbes ou ces coquillages, je ne savais pas leur nom.
— Tu es bien un fils de ton pays, dit-il impatienté ; pour vous autres, la mer n’est bonne qu’à piller et à ravager, c’est l’éternelle ennemie contre laquelle il faut se défendre; vous ne verrez donc jamais qu’elle est une mère aussi nourricière que la terre, et que les forêts qui couvrent ses plaines et ses montagnes sont peuplées de plus d’animaux que nos forêts terrestres! Cet horizon infini, ces nuages, ces flots ne vous parleront donc jamais que d’ouragans et de naufrages!
Il s’exprimait avec une véhémence qui stupéfiait ma timidité d’enfant, et c’est l’impression de ses paroles que je vous donne plutôt que ses paroles elles-mêmes, car j’ai mal retenu ce que je ne comprenais guère; mais l’impression m’est restée si vive que je le vois encore sous son parapluie, étendant son bras sur la haute mer et entraînant mes yeux avec les siens.
— Viens ici, continua-t-il en me montrant une crevasse de rocher d’où l’eau ne s’était pas retirée, que je te fasse comprendre un peu ce que c’est que la mer. Qu’est-ce que ça?
Il m’indiqua du doigt une sorte de petite tige fauve collée par la base à une pierre, et terminée à l’extrémité par une espèce de corolle jaune dont les bords découpés en lanières étaient d’un blanc de neige.
— Est-ce une herbe, est-ce une bête? Tu n’en sais rien, n’est-ce pas? Eh bien! c’est une bête; si nous avions le temps de rester là, tu la verrais peut-être se détacher, et tu sais bien que les fleurs ne marchent pas. Regarde de tout près, tu vas voir ce qui ressemble à la fleur s’allonger, se raccourcir, se balancer. C’est ce que les savants nomment une anémone de mer. Mais pour que tu sois bien convaincu que c’est un animal, tâche de m’attraper une crevette. Tu sais que les fleurs ne mangent point, n’est-ce pas?
Disant cela, il prit la crevette et la jeta dans la corolle de l’anémone; la corolle se referma et la crevette disparut engloutie.
Dans un trou plein d’eau, je pris une petite raie: elle avait enfoui ses ailerons dans le sable pour se cacher, mais ses taches brunes et blanches me la firent apercevoir; je la portai à M. de Bihorel.
— Tu as trouvé cette raie, me dit-il, parce qu’elle a des marbrures, et ce qui te l’a fait découvrir la dénonce aussi aux poissons voraces; or, comme au fond des mers règne une guerre générale dans laquelle on se tue les uns les autres, ainsi que cela arrive trop souvent sur la terre, simplement pour le plaisir et la gloire, ces pauvres raies, qui nagent mal, ne tarderaient pas à être exterminées si la nature n’y avait pourvu; regarde la queue de ta raie, elle est hérissée d’épines et de dards, si bien que, quand elle se sauve, elle ne peut être attaquée par là, et que les ennemis que ses taches attirent doivent s’arrêter devant sa cuirasse. Il y a là une loi d’équilibre universel que tu peux remarquer aujourd’hui et que tu comprendras plus tard.
J’étais émerveillé ; vous pouvez comprendre quel effet produisait cette leçon démonstrative sur un enfant naturellement curieux et questionneur, qui n’avait jamais trouvé personne pour lui répondre. La crainte, qui tout d’abord m’avait clos la bouche, s’était promptement dissipée.
Suivant toujours la marée qui se retirait, nous arrivâmes à la Tête de chien. Combien y restâmes-nous, je n’en sais rien. Je n’avais plus conscience du temps. Je courais de rocher en rocher, et je rapportais à M. de Bihorel les coquilles ou les plantes que je voyais pour la première fois. J’emplissais mes poches d’un tas de choses qui me semblaient très-curieuses au moment où je les trouvais et que bientôt je jetais pour les remplacer par d’autres qui avaient l’incontestable supériorité d’être nouvelles.
Tout à coup, en levant les yeux, je ne vis plus la côte; elle avait disparu dans un léger brouillard; le ciel était uniformément d’un gris pâle; la mer était si calme que c’était à peine si nous l’entendions derrière nous.
J’aurais été seul que je serais rentré, car je savais combien il est difficile, par un temps de brouillard, de retrouver son chemin au milieu des grèves; mais M. de Bihorel ne disant rien, je n’osai rien dire non plus.
Cependant le brouillard, qui enveloppait toute la côte, s’avança vers nous comme un nuage de fumée montant de la terre droit au ciel.
— Ah! ah! voici le brouillard, dit M. de Bihorel; si nous ne voulons pas faire une partie de colin-maillard un peu trop sérieuse, il faut nous en retourner: prends le filet.
Mais presque aussitôt le nuage nous atteignit, nous dépassa, et nous ne vîmes plus rien, ni la côte, ni la mer qui était à cinquante pas derrière nous; nous étions plongés dans une obscurité grise.
— La mer est là, dit M. de Bihorel sans s’inquiéter, nous n’avons qu’à aller droit devant nous.
Aller droit devant nous sur le sable, sans rien pour nous guider, ni ornière, ni trace quelconque, ni pente même pour indiquer si nous descendions ou nous montions, c’était jouer sérieusement le jeu du tapis vert de Versailles, dans lequel il s’agit d’aller les yeux bandés du parterre de Latone au bassin d’Apollon sans dévier et sans marcher sur le sable; avec cette circonstance aggravante pour nous que nous avions au moins une demi-lieue à faire avant de trouver les falaises.
Il n’y avait pas dix minutes que nous marchions, quand nous fûmes arrêtés par un amas de rochers.
— C’est les Pierres vertes, dis-je.
— C’est le Pouldu, dit M. de Bihorel.
— C’est les Pierres vertes, monsieur.
Il me donna une petite tape sur la joue:
— Ah! ah! il paraît que nous avons une bonne petite caboche, dit-il.
Si c’étaient les Pierres vertes, nous devions les longer en allant à droite et nous rapprocher ainsi du Port-Dieu; si, au contraire, c’était le Pouldu, nous devions prendre à gauche, sous peine de tourner le dos au village.
En plein jour, rien n’est plus facile que de distinguer ces deux rochers; même la nuit, à la clarté de la lune, je les aurais facilement reconnus; mais, dans le brouillard, nous voyions les pierres couvertes de varech et voilà tout.
— Écoutons, dit M. de Bihorel, le bruit de la côte. nous guidera.
Nous n’entendîmes rien, ni le bruit de la côte, ni le bruit de la mer. Il ne faisait pas un souffle de vent. Nous étions comme plongés dans une ouate blanche qui nous bouchait les oreilles aussi bien que les yeux.
— C’est le Pouldu, dit M. de Bihorel.
Je n’osai le contredire davantage et le suivis en tournant comme lui à gauche.
— Viens près de moi, mon enfant, me dit-il d’une voix douce, donne-moi la main, que nous ne nous séparions point; une, deux, marchons au pas.
Nous marchâmes encore environ dix minutes, puis je sentis sa main qui serrait la mienne. On entendait un faible clapotement. Nous nous étions trompés, c’étaient les Pierres vertes; nous nous dirigions droit vers la mer et nous n’en étions plus qu’à quelques pas.
— Tu avais raison, dit-il, il fallait prendre à droite; retournons.
Retourner où ? Comment nous diriger? Nous savions où était la mer parce que nous entendions le flot se briser doucement, mais en nous éloignant nous n’entendions plus rien, et nous ne savions plus si nous tournions le dos à la côte ou si nous donnions sur elle.
L’obscurité devenait de plus en plus opaque, car à l’épaisseur du brouillard s’ajoutait l’approche de la nuit. Nous ne voyions plus depuis quelques instants déjà le bout de nos pieds, et ce fut à peine si M. de Bihorel put distinguer l’heure à sa montre. Il était six heures; la marée allait commencer à remonter.
— Il faut nous hâter, dit-il; si le flot nous prend, il ira plus vite que nous; il a des bottes de sept lieues.
Il sentit au tremblement de ma main que j’avais peur.
— N’aie pas peur, mon enfant, le vent va s’élever de terre et pousser le brouillard au large; d’ailleurs, nous verrons le phare, qui va bientôt s’allumer.
Il n’y avait pas là de quoi me rassurer; le phare, je savais bien que nous n’apercevrions pas sa lumière. Depuis quelques minutes je pensais à trois femmes qui, l’année précédente, avaient comme nous été surprises sur cette grève par le brouillard et qui avaient été noyées; on avait retrouvé leurs cadavres seulement huit jours après; je les avais vu rapporter au Port-Dieu, et je les avais maintenant là devant les yeux, épouvantables dans leurs pauvres guenilles verdâtres.
Quoique je voulusse me retenir, je me mis à pleurer. Sans se fâcher, M. de Bihorel tâcha de me calmer par de bonnes paroles.
— Crions, me dit-il; s’il y a un douanier sur la falaise, il nous entendra et nous répondra; il faut bien que ces mâtins-là servent à quelque chose.
Nous criâmes, lui d’une voix forte, moi d’une voix entrecoupée de sanglots. Rien ne nous répondit, pas même l’écho; et ce silence morne me pénétra d’un effroi plus grand encore; il me sembla que j’étais mort au fond de l’eau.
— Marchons, dit-il; peux-tu marcher?
Il me tira par la main, et nous avançâmes à l’aventure. Aux paroles qu’il m’adressait de temps en temps pour m’encourager, je sentais bien qu’il était inquiet aussi, et sans confiance dans ses propres paroles.
Après plus d’une longue demi-heure de marche, le désespoir me gagna tout à fait, et, lui lâchant la main, je me laissai tomber sur le sable.
— Abandonnez-moi là, monsieur, pour mourir, lui dis-je en pleurant.
— Allons, bon! fit-il, autre marée maintenant; veux-tu bien rentrer tes larmes; est-ce qu’on meurt quand on a une maman? Allons, lève-toi, viens.
Mais tout, même cela, était inutile; je restais sans pouvoir bouger.
Tout à coup je poussai un cri.
— Monsieur!
— Eh bien, mon enfant?
— Là, là, baissez-vous.
— Veux-tu que je te porte, pauvre petit?
— Non, monsieur, tâtez.
Et lui prenant la main, je la posai à plat à côté de la mienne.
— Eh bien?
— Sentez-vous? voilà l’eau.
Nos plages sont formées d’un sable très-fin, profond et spongieux; à marée basse, ce sable, qui s’est imbibé comme une éponge, s’égoutte, et l’eau se réunissant forme de petits filets presque invisibles, qui suivent la pente du terrain jusqu’à la mer. C’était un de ces petits filets que ma main avait barré.
— La côte est là, et j’étendis le bras dans la direction d’où venait l’eau.
En même temps je me relevai; l’espérance m’avait rendu mes jambes; M. de Bihorel n’eut pas besoin de me traîner.
J’allais en avant; de minute en minute, je me baissais pour coller ma main sur la plage, et, par la direction de l’eau, remonter le courant.
— Tu es un brave garçon, dit M. de Bihorel; sans toi, nous étions, je crois, bien perdus.
Il n’y avait pas cinq minutes qu’il avait laissé échapper ses craintes, lorsqu’il me sembla que je ne trouvais plus d’eau. Nous fîmes encore quelques pas; ma main se posa sur le sable sec.
— Il n’y a plus d’eau.
Il se baissa et tâta aussi à deux mains; nous ne sentîmes que le sable humide qui s’attacha à nos doigts.
En même temps il me sembla entendre comme un léger clapotement. M. de Bihorel l’entendit aussi.
— Tu te seras trompé, dit-il, nous marchons vers la mer.
— Non, monsieur, je vous assure; et puis, si nous approchions de la mer, le sable serait plus mouillé.
Il ne dit rien et se releva. Nous restâmes ainsi indécis, perdus une fois encore. Il tira sa montre; il faisait bien trop sombre pour voir les aiguilles, mais il la fit sonner: elle sonna six heures et trois quarts.
— La marée monte depuis plus d’une heure.
— Alors, monsieur, vous voyez bien que nous nous sommes rapprochés de la côte.
Comme pour donner une confirmation à mon raisonnement, nous entendîmes derrière nous un ronflement sourd; il n’y avait pas à s’y tromper, c’était la marée montante qui arrivait.
— C’est une nau que nous avons devant nous, dit-il.
— Je le crois bien, monsieur.
Ces plages, précisément parce qu’elles sont formées d’un sable mouvant, ne restent pas parfaitement planes; il s’y forme çà et là de petits monticules séparés les uns des autres par de petites vallées; tout cela à peu près plat pour l’œil, tant les différences de niveau sont légères, mais parfaitement sensible pour l’eau, si bien qu’à la marée montante ce sont les vallées qui se remplissent les premières et les monticules restent à sec, formant des îles, battues d’un côté par le flot montant, entourées de tous les autres par l’eau qui court dans les vallées comme dans le lit d’une rivière. Nous étions en face d’une de ces rivières. Était-elle profonde? Toute la question était là.
— Il faut passer la nau, dit M. de Bihorel; tiens-moi bien.
Et comme j’hésitais:
— As-tu pas peur de te mouiller, dit-il, les pieds ou la tête? choisis; moi, j’aime mieux les pieds.
— Non, monsieur, nous allons nous perdre dans l’eau.
— Veux-tu donc rester là pour être pris par la mer?
— Non, mais passez le premier, je resterai là à crier, vous irez contre ma voix; quand vous serez de l’autre côté, vous crierez à votre tour et j’irai sur vous.
— Passe le premier.
— Non, je nage mieux que vous.
— Tu es un brave petit, viens, que je t’embrasse.
Et il m’embrassa comme si j’avais été son fils; ça me remua le cœur.
Il n’y avait pas de temps à perdre, la mer arrivait rapidement; de seconde en seconde on entendait son soufflement plus fort. Il entra dans l’eau et je commençai à crier.
— Ne crie pas, dit M. de Bihorel, que je ne voyais plus, chante plutôt si tu peux.
— Oui, monsieur, et je me mis à chanter:
Il est né en Normandie;
Il y fut nommé Rageau.
Sa beauté, dès son berceau
A chacun faisait envie.
Tra la, la, tra la, la.
Je m’interrompis.
— Avez-vous pied, monsieur?
— Oui, mon enfant, il me semble que je commence à remonter; chante.
Ses lèvres étaient vermeilles
Comme du sang de navet;
Sa bouche ne s’arrêtait
Qu’en rencontrant ses oreilles.
Tra la, la, tra la, la.
J’allais chanter le troisième couplet de cette ronde.
— A ton tour, me cria M. de Bihorel, je n’ai plus d’eau que jusqu’aux genoux, viens!
Et il entonna un air sans paroles qui était triste comme une chanson de mort.
J’entrai dans l’eau; mais je n’étais pas de la taille de M. Bihorel et ne tardai pas à perdre pied; ce n’était rien pour moi qui nageais comme un poisson. Seulement, comme il y avait du courant, j’eus peine à me diriger droit, et il me fallut plus d’un quart d’heure pour arriver jusqu’à lui.
Lorsque je l’eus rejoint, nous ne tardâmes pas à sortir tout à fait de l’eau et à nous retrouver sur le sable.
Il respira avec une satisfaction qui me montra combien son anxiété avait été vive...
— Prenons une prise, dit-il, nous l’avons bien gagnée.
Mais à peine avait-il atteint sa tabatière, qu’il poussa une exclamation en secouant ses doigts.
— Mon tabac qui est changé en marc à café et ma montre qui, bien sûr, tourne comme la roue d’un moulin dans l’eau, qu’est-ce que Samedi va dire?
Je ne sais à quoi cela tenait, mais je n’avais plus peur du tout. Il me semblait que le danger était passé.
Il ne l’était pas, et il nous restait plus de chemin à faire que nous n’en avions fait; nous étions entourés des mêmes dangers et nous avions les mêmes difficultés pour nous diriger.
Le brouillard semblait s’être encore épaissi; la nuit était venue, et, bien que nous fussions plus rapprochés de la falaise, nous n’entendions aucun bruit de ce côté qui nous dît: «La terre est là,» ni le beuglement d’une vache, ni un coup de fouet, ni le grincement d’un essieu, rien: un silence lourd devant nous; derrière, le grondement sourd et continu de la mer qui montait.
C’était là notre seule boussole maintenant, mais bien incertaine et bien perfide. Si nous avancions trop vite, nous pouvions nous perdre; si nous n’avancions pas assez vite, la marée menaçait de nous atteindre et de nous engloutir avant que nous fussions arrivés au galet, où la pente plus rapide ralentirait sa course.
Nous recommençâmes donc à marcher en nous tenant par la main; souvent je me baissais pour tâter le sable, mais je ne trouvais plus d’eau courante: nous étions sur un banc coupé de petites rides, et l’eau y restait stagnante dans les creux, ou bien, en petits filets, elle se répandait parallèlement au rivage.
L’espoir que j’avais eu, la nau traversée, nous abandonnait, lorsque subitement nous nous arrêtâmes tous les deux en même temps. Le son d’une cloche avait déchiré l’atmosphère qui nous enveloppait.
Après un intervalle de deux ou trois secondes, nous entendîmes un deuxième, puis bientôt un troisième coup.
C’était l’Angelus au Port-Dieu; nous n’avions plus qu’à marcher du côté d’où venait le son, nous étions sauvés.
Sans rien nous dire, et d’un commun accord, nous nous mîmes à courir.
— Dépêchons-nous, dit M. de Bihorel. L’Angelus ne durera pas assez longtemps; c’est une trop courte prière, aujourd’hui on devrait y joindre les litanies, pour nous guider.
Avec quelle émotion, courant sans reprendre haleine, nous comptions les volées de la cloche! Nous ne parlions ni l’un ni l’autre, mais je comprenais très-bien que, si elle cessait de se faire entendre avant que nous eussions atteint le galet, nous pouvions n’avoir été sauvés quelques instants que pour nous reperdre une fois encore.
Elle cessa; nous étions toujours sur le sable. Peut-être le galet n’était-il qu’à quelques mètres; peut-être n’avions-nous que la jambe à allonger pour le toucher; mais comment savoir de quel côté ? Le pas que nous allions faire en avant pouvait aussi bien nous rapprocher du salut que nous en éloigner, et dans ce cas nous rejeter au milieu des dangers que nous venions de courir.
— Arrêtons-nous, dit M. de Bihorel, et ne faisons plus un seul pas à l’aventure; tâte le sable, mon enfant.
Je tâtai; je collai mes deux mains sur la grève, j’attendis ; je les relevai sèches toutes les deux.
— As-tu compté combien nous passions de naus?
— Non, monsieur.
— Alors, tu ne sais pas s’il nous en reste encore à traverser: si nous les avons toutes passées, nous n’avons qu’à attendre; quand la mer arrivera, nous marcherons doucement en la précédant.
— Oui, mais si nous ne les avons pas toutes passées?
Il ne répondit pas, car il n’avait à me répondre que ce que je savais aussi bien que lui; c’est-à-dire que, si nous avions encore une nau entre nous et le galet, et si nous restions sans avancer, la mer l’emplirait doucement; il nous faudrait la passer à la nage et nous exposer à être entraînés par le courant, jetés peut-être dans des rochers d’où nous ne pourrions jamais sortir.
Nous eûmes un moment d’anxiété terrible, restant là, ne sachant que faire, n’osant nous décider à avancer, à reculer, à aller à droite, à aller à gauche, car en demeurant immobiles dans la position même où nous avions cessé d’entendre la cloche, nous étions sûrs au moins que le pays était là devant nous, comme si nous l’avions vu dans une éclaircie, tandis que, si nous faisions un seul pas, nous nous retrouvions livrés à toutes les angoisses de l’incertitude.
Notre seul espoir était désormais dans un coup de vent qui, balayant le brouillard, nous laisserait voir le phare, car d’entendre le bruit de la côte, il n’y fallait pas compter; nous estimions être au sud du village, en face d’une falaise déserte, d’où à pareille heure ne pouvait venir aucun bruit; mais l’atmosphère était si calme, si lourde, le brouillard était si compacte, si solide, que pour croire à une brise il fallait être dans une position comme la nôtre, où l’on en arrive à espérer l’impossible et à attendre un miracle.
Ce miracle se fit; la cloche qui avait cessé de sonner reprit en carillonnant.
Il y avait un baptême, et pour cette fois nous étions bien certains d’arriver, car le carillon du baptême dure souvent une demi-heure et quelquefois plus, quand le parrain s’est arrangé pour donner des farces au sonneur.
En moins de cinq minutes nous atteignîmes le galet, et, le remontant, longeant le pied de la falaise, nous arrivâmes à la chaussée qui joignait l’île de M. de Bihorel à la terre. Nous étions sauvés...
M. de Bihorel voulut me faire entrer chez lui; malgré toutes ses instances je refusai. J’avais hâte d’arriver à la maison, où ma mère était peut-être déjà arrivée.
— Eh bien! dis à ta mère que j’irai la voir demain soir.
J’aurais bien voulu qu’il ne nous fit pas cette visite qui allait apprendre à ma mère où j’avais passé ma journée, mais comment l’empêcher?
Ma mère n’était pas encore rentrée; quand elle arriva, elle me trouva avec des habits secs, auprès du feu que j’avais allumé.
Je m’acquittai de la commission de M. de Bihorel.
Le lendemain soir, comme il l’avait promis, il arriva; je le guettais; quand j’entendis ses pas, j’eus envie de me sauver.
— Ce garçon-là vous a-t-il raconté ce qu’il a fait hier? dit-il à ma mère, après s’être assis.
— Non, monsieur.
— Eh bien! il a fait l’école buissonnière toute la journée.
Ma pauvre maman me regarda avec une douloureuse inquiétude, croyant avoir à entendre tout un réquisitoire contre moi.
— Ah! Romain, dit-elle tristement.
— Ne le grondez pas trop, interrompit M. de Bihorel, car en même temps il m’a sauvé la vie. Allons, ne tremble pas comme ça, mon garçon, et viens là. Vous avez un brave enfant, madame Kalbris, vous pouvez en être fière.
Il raconta comment il m’avait trouvé la veille, et comment nous avions été surpris par le brouillard.
— Vous voyez que sans lui, continua-t-il, j’étais bien perdu, n’est-ce pas, ma chère dame? Je m’étais fâché le matin contre son ignorance, parce qu’il ne savait pas le nom d’une actinie. Mais quand le danger est arrivé, ma science ne m’a plus servi à rien; et si je n’avais pas eu pour m’aider l’instinct de cet enfant, ce seraient les actinies, les crabes et les homards qui, à cette heure, étudieraient mon anatomie. J’ai donc contracté une dette envers votre fils, je veux m’en acquitter.
Ma mère fit un geste.
— Rassurez-vous, dit-il sans se laisser interrompre, je ne veux rien vous proposer qui ne soit digne de votre fierté et du service que j’ai reçu. J’ai fait causer l’enfant, il est curieux de voir et de savoir; donnez-le-moi, je me charge de son éducation; je n’ai pas d’enfants et je les aime, il ne sera pas malheureux auprès de moi.
Ma mère accueillit comme elle le devait cette proposition, mais elle n’accepta pas.
— Permettez, fit M. de Bihorel en étendant la main vers elle, je vais vous dire pourquoi vous me refusez: vous aimez cet enfant passionnément, vous l’aimez pour lui et pour son père que vous avez perdu, il est désormais tout pour vous, et vous voulez le garder; c’est vrai, n’est-ce pas? Maintenant je vais vous dire aussi pourquoi vous devez me le donner néanmoins: il y a en lui un fond d’intelligence qui ne demande qu’à être cultivé ; à Port-Dieu, cela n’est pas possible, et, sans entrer dans vos affaires, il ne vous est pas possible, à vous, je crois, de l’envoyer ailleurs; ajoutez que l’enfant a un caractère indépendant et aventureux qui a besoin d’être surveillé. Pensez à cela; ne me répondez pas tout de suite, réfléchissez à tête posée, quand les premiers mouvements de votre cœur maternel se seront calmés; je reviendrai demain soir.
Lorsqu’il fut parti, nous nous mîmes à souper, mais ma mère ne mangea pas; elle me regardait longuement, puis, quand mes yeux rencontraient les siens, elle se détournait du côté du feu.
Quand je lui dis adieu, avant d’aller me coucher, je sentis ses larmes mouiller mes joues. Qui les faisait couler, ces larmes? Était-elle fière de moi pour ce que M. de Bihorel avait raconté ? Était-elle désespérée de notre séparation?
Je ne pensai en ce moment qu’à la séparation, dont l’idée me troublait aussi.
— Ne pleure pas, maman, lui dis-je en l’embrassant, je ne te quitterai pas.
— Si, mon enfant, c’est pour ton bien; M. de Bihorel a trop raison, il faut accepter.